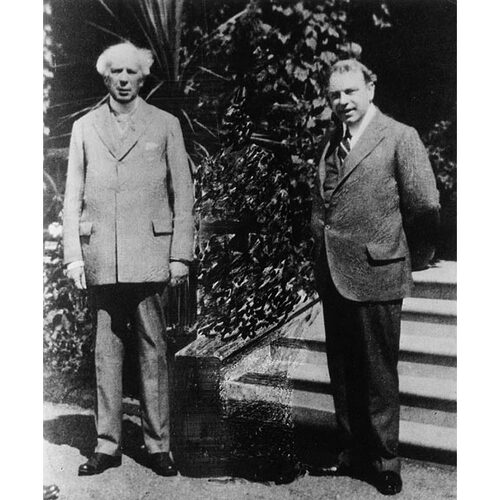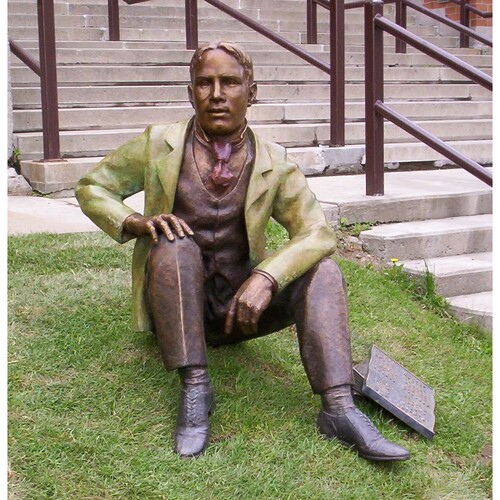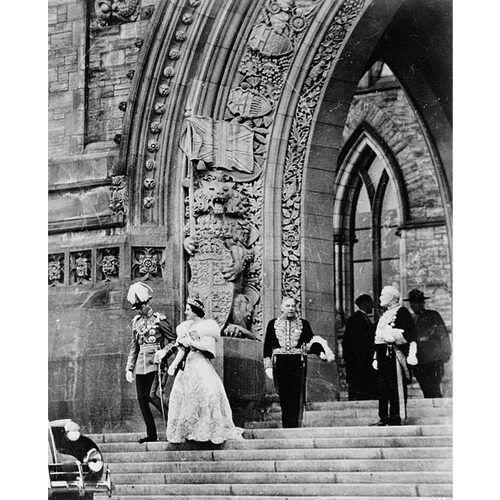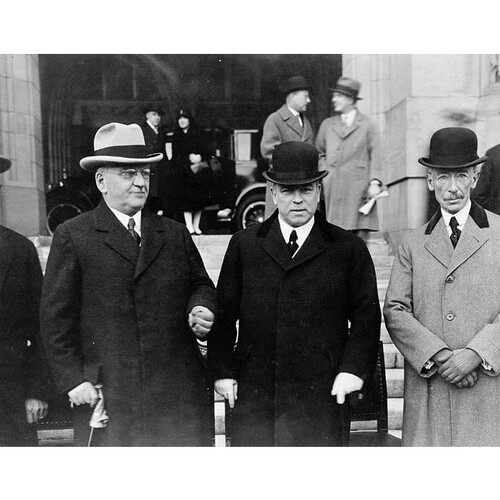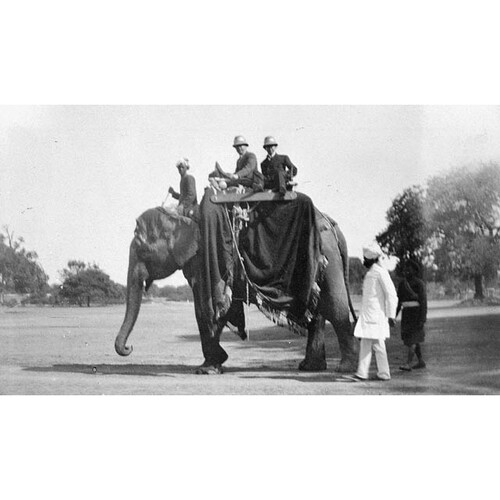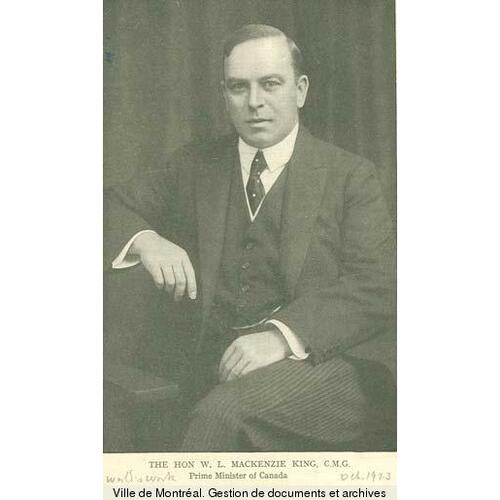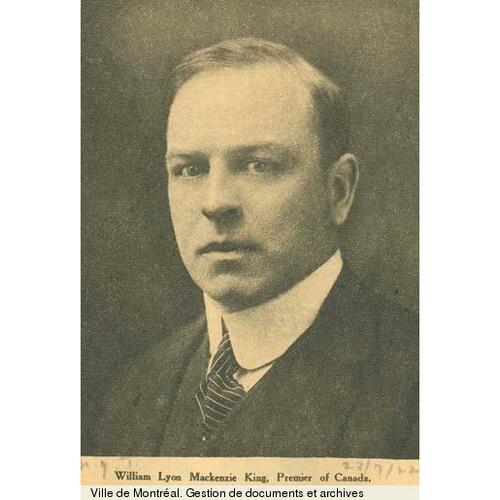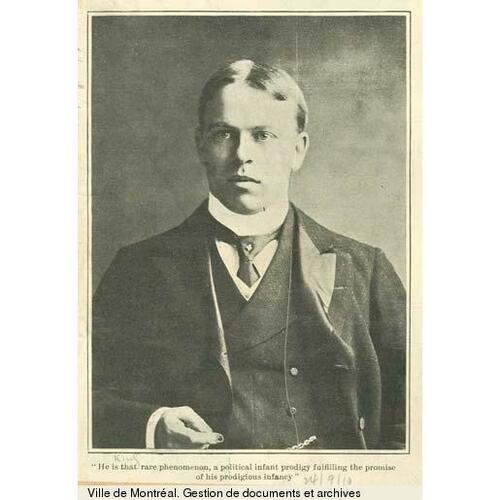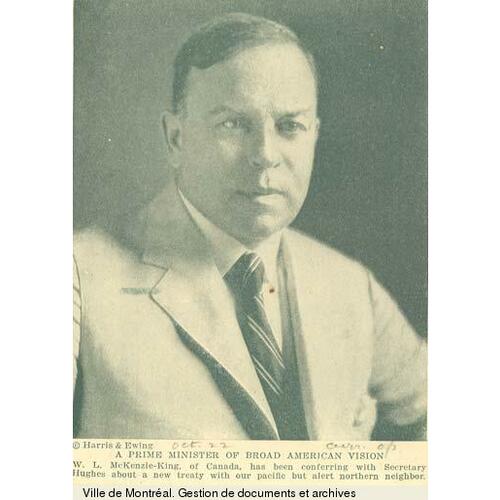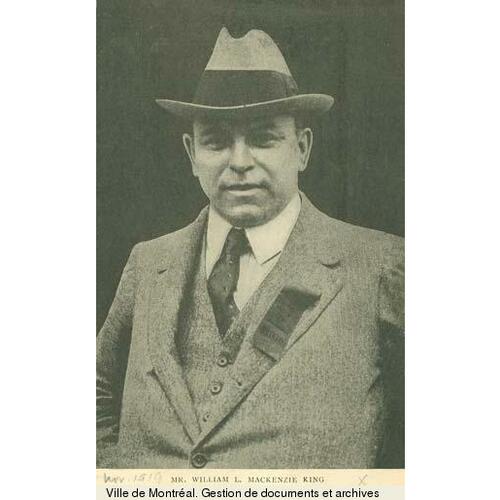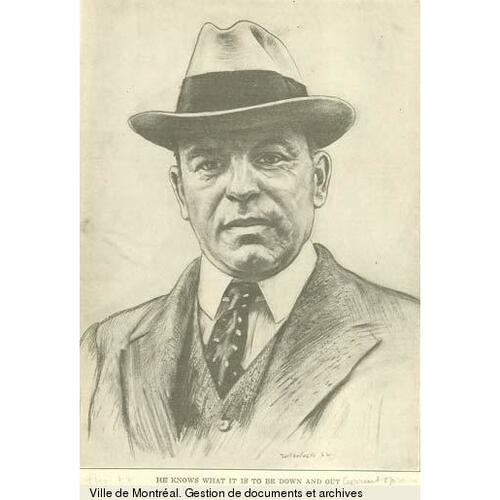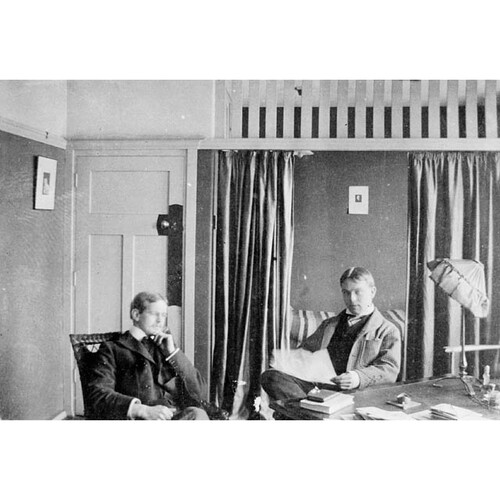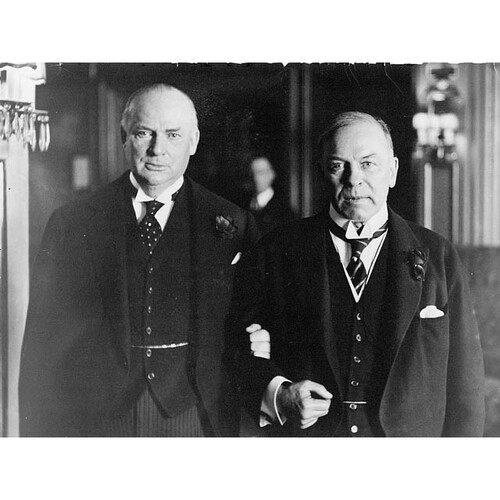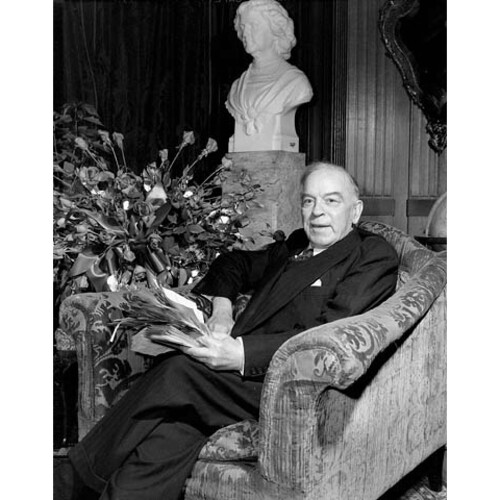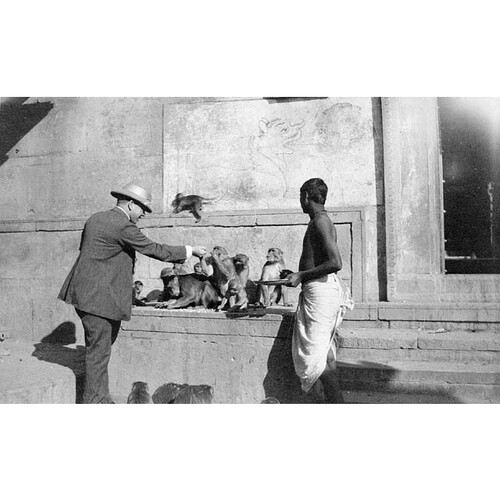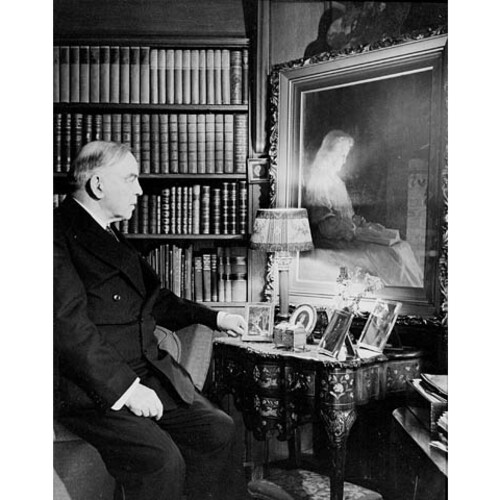Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3217560
KING, WILLIAM LYON MACKENZIE, journaliste, fonctionnaire, auteur, conciliateur et homme politique, né le 17 décembre 1874 à Berlin (Kitchener, Ontario), fils de John King et d’Isabel Grace Mackenzie* ; décédé célibataire le 22 juillet 1950 à Kingsmere, Québec.
William Lyon Mackenzie King eut une longue carrière politique. Il dirigea le Parti libéral depuis les tumultueuses années 1920 et la crise économique des années 1930 jusqu’au choc de la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de l’après-guerre et, de ses 29 années comme chef du parti, il en passa 21 comme premier ministre du Canada. Ses décisions contribuèrent de manière importante à façonner le Canada et à en faire une puissance intermédiaire influente sur la scène mondiale. De son vivant, ses réalisations ont parfois été occultées par son remarquable sens du compromis. Après sa mort, la révélation de ses manies personnelles a parfois éclipsé sa carrière politique.
Le père de King avait vécu à Berlin dans sa jeunesse, mais c’est à Toronto pendant ses études universitaires qu’il fit la connaissance de sa future épouse, Isabel Grace Mackenzie. Née aux États-Unis pendant l’exil de son père William Lyon Mackenzie*, cette dernière avait grandi dans la pauvreté et l’insécurité, et sa situation ne s’était pas beaucoup améliorée après le retour de sa famille à Toronto. Mackenzie vivait comme un gentleman, mais sans jamais en avoir les moyens. Un mariage avec l’avocat John King permettait à Isabel Grace d’entrevoir une certaine sécurité financière. King, cependant, renonça à faire carrière à Toronto et décida de retourner à Berlin en 1869 pour y pratiquer le droit. C’est là que William Lyon (Willie, de son surnom) passa son enfance. Ce dernier, son frère et ses deux sœurs conserveraient de beaux souvenirs de leurs premières années. À compter de 1886, ils habitèrent Woodside, jolie maison en brique entourée d’un grand jardin que leurs parents louaient à la périphérie de Berlin. William Lyon était un enfant en bonne santé, plein d’énergie, doté d’une assurance qui lui attirait parfois des ennuis et d’un sourire qui lui épargnait bien des punitions. Bon élève, aimant les débats et le sport, il était populaire auprès de ses camarades et avait la confiance de ses aînés. Les King étaient très unis, et William Lyon évoquerait plus tard avec nostalgie les jeux en famille et les cantiques qu’ils chantaient, accompagnés par Isabel Grace au piano.
Ces années furent moins idylliques pour les parents de William Lyon, aux prises avec de sérieuses difficultés financières qui ne s’aplaniraient jamais. John King n’avait pas de succès comme avocat. Il lui manquait le dynamisme nécessaire pour se bâtir une clientèle, sa famille souffrait des conflits et scandales entourant un de ses oncles (journaliste à Berlin) et la communauté allemande de l’endroit lui préférait les avocats germanophones. Ne gagnant pas assez d’argent pour payer les domestiques et sauvegarder les apparences, il s’endetta rapidement. Il se replia sur lui-même ; Isabel Grace devint frustrée et acariâtre. Le retour à Toronto en 1893, après que William Lyon eut commencé à fréquenter l’université, n’y changea pas grand-chose. John King gagna un peu d’argent grâce à une charge de cours à Osgoode Hall, mais il ne réussit pas à obtenir un poste de professeur et sa pratique du droit rapportait peu. William Lyon ne sut rien de cette situation dans son enfance, mais il en fut quand même marqué. Il assimila les valeurs sociales de ses parents, et leur misère dorée finit par l’embarrasser ; il apprit également à détecter leur humeur et à éviter l’affrontement. Fait plus révélateur encore, Isabel Grace en vint à voir en William Lyon celui qui pourrait lui apporter le prestige et la sécurité que John ne pourrait jamais lui donner. C’était là un poids dont le jeune Mackenzie King ne pourrait pas se défaire.
King s’inscrivit en sciences politiques à la University of Toronto en 1891. Discipliné et bien organisé, doué en outre d’une bonne mémoire, il obtint son diplôme avec la mention très bien et finit deuxième de sa classe. N’ayant pas à travailler fort pour avoir de bonnes notes, il prenait le temps de faire du sport, de collaborer au Varsity et de discuter, de longues heures durant, du sens de la vie et de questions morales avec d’autres élèves sérieux. Il se distinguait de ses camarades ; élu président de sa classe en première année, il fut en 1895 un des leaders de la grève organisée par les étudiants pour protester contre le renvoi arbitraire d’un professeur très apprécié, William Dale*. Sa famille l’appelait encore Willie, mais à l’université il commença à signer le nom de W. L. Mackenzie King et les autres étudiants l’appelaient Mackenzie. Ce nom, par lequel il projetait une image sérieuse de lui-même, témoigne d’une volonté d’identification à son grand-père que, déjà, il voyait comme un des premiers défenseurs du gouvernement responsable et de la liberté politique. Plus tard, quelques-uns de ses proches amis en Angleterre, dont John Buchan*, l’appelleraient Rex, mais personne parmi ses collègues et connaissances au Canada ne s’adresserait jamais à lui avec autant de familiarité.
King fut un presbytérien pratiquant dans sa jeunesse et, de fait, il fréquenta régulièrement l’église toute sa vie. Dans sa correspondance et ses journaux personnels de ses années d’études, il parle constamment de valeurs spirituelles et de sa volonté d’accomplir son devoir de chrétien. Ses opinions religieuses, qui paraissent sentimentales et dont il semblait se servir parfois pour se justifier lui-même, furent néanmoins déterminantes. King était peut-être suffisant, mais sa foi le poussait aussi vers de bonnes actions. Tout en poursuivant ses études, il fréquenta un club de lecture pour hommes dans un quartier ouvrier de Toronto ; il rendit régulièrement visite à des patients de l’Hospital for Sick Children. Il fit même quelques tentatives pour réformer des prostituées, mais on peut penser que, dans ce cas, la lascivité du jeune homme refoulé s’ajoutait aux motifs religieux. Les travaux d’Arnold Toynbee sur la révolution industrielle eurent une influence encore plus marquée sur lui ; il en conclut que c’était l’industrialisme qui constituait le plus grand défi pour le christianisme en cette fin du xixe siècle. Cette théorie l’amena sur la voie de la réforme sociale, mais non jusqu’au socialisme. King ne voyait aucune distinction entre sa foi religieuse et son engagement libéral à bâtir une société meilleure sur terre, mais il voulait changer les choses par la conversion, non par la coercition.
Chez King, le sentiment du devoir chrétien se doublait d’une grande ambition personnelle. Néanmoins, il hésitait encore sur la profession à choisir. Son père l’encouragea à devenir avocat et, après l’obtention de sa licence ès arts en 1895, King termina en une année une licence en droit à Toronto. La pratique juridique ne l’intéressait cependant pas. Il envisagea une carrière dans l’Église ou en politique et, entre 1895 et 1897, écrivit pour un certain nombre de journaux de Toronto. Ses études de maîtrise à Toronto et à Harvard et les bourses en économie politique à la University of Chicago et à Harvard le menaient plus vraisemblablement à une carrière universitaire. Après avoir travaillé un été comme journaliste pour le Globe de Toronto, à écrire des articles sur les ateliers de misère, il commença à Harvard une thèse de doctorat sur les conditions de travail dans l’industrie du vêtement. Ce parcours universitaire fut interrompu en juin 1900 par un télégramme de William Mulock, maître général des Postes du Canada, également responsable d’un ministère de formation récente, celui du Travail. King avait déjà attiré l’attention de Mulock sur le lien entre les ateliers de misère et les contrats fédéraux de fabrication de sacs postaux, et Mulock lui offrait maintenant de diriger la rédaction d’un nouveau journal, la Gazette du travail. Cédant aux pressions familiales, à l’attrait de la sécurité financière et à ce qu’il voyait comme une occasion de servir la population de son pays, King accepta. Il arriva à Ottawa à la fin de juillet. Le mois suivant, Mulock lui offrit également le poste de sous-ministre du Travail, qu’il occupa officiellement à compter du 15 septembre.
King entrait au ministère à un moment crucial dans l’évolution des relations industrielles. Dans les premières années du xxe siècle, rien ne semblait pouvoir freiner les conflits entre capitalistes et ouvriers. Les syndicats offraient bien quelque possibilité d’action collective aux travailleurs, mais les patrons avaient les moyens de contrarier les syndicalistes et de briser les grèves : ils franchissaient les piquets de grève en recourant à des injonctions ou à l’intervention de la police ou de la milice. La violence semblait être la seule réponse efficace. King voyait dans la Gazette du travail un bon moyen d’améliorer les relations industrielles. Ce journal publierait des tableaux sur les grèves et les lockouts, des résumés des jugements des tribunaux, ainsi que des comptes rendus sur les conditions de travail, les règlements salariaux et le coût de la vie dans différentes régions. King savait aussi combien il était important d’être reconnu comme non partisan et, avec l’aide de son ami de l’université, Henry Albert Harper*, qu’il nomma rédacteur adjoint, il fit rapidement de la Gazette une source d’information respectée – quoique dès 1901, celle-ci subit les attaques de l’Association des manufacturiers canadiens.
Ambitieux, King ne se contenta pas de la Gazette. Il écrivit bientôt des discours pour son ministre, qui associaient Mulock et le gouvernement libéral de sir Wilfrid Laurier* à une politique de juste rémunération des fonctionnaires ; il prit également l’initiative d’offrir ses services aux patrons et aux travailleurs pour régler des grèves et des lockouts. Très vite, il fit preuve d’un remarquable don pour la médiation. D’une patience exceptionnelle, il gagnait régulièrement la confiance des dirigeants des deux camps : il les écoutait avec attention et était remarquablement sensible à leurs espoirs et à leurs craintes, sans même qu’ils les expriment. Bien des fois, il réussit à proposer des compromis acceptables par les deux parties. Un des conflits qui eut des conséquences importantes fut la grève du charbon à Lethbridge, en Alberta, en 1906 [V. Frank Henry Sherman*], qui menaçait de priver les habitants de l’Ouest de combustible à l’approche de l’hiver. Envoyé dans l’Ouest par son nouveau ministre, Rodolphe Lemieux*, King négocia une entente ; il rédigea ensuite un projet de loi établissant un protocole pour désamorcer des grèves semblables. La Loi des enquêtes en matière de différends industriels de 1907 obligeait à reporter toute grève dans un service public ou une mine tant qu’un comité de conciliation n’avait pas réglé le différend ou, sinon, publié un rapport sur les faits et proposé des conditions de règlement. La loi n’interdisait pas la grève, mais elle était originale en ce qu’elle imposait un délai de réflexion et soumettait les parties en cause aux pressions de l’opinion publique dans le but de favoriser la résolution des conflits.
Le succès de King comme conciliateur incita le gouvernement à faire appel à lui pour régler une foule de problèmes. King participa à des commissions royales chargées d’enquêter sur les conflits de travail en Colombie-Britannique (1903), à la Compagnie canadienne de téléphone Bell à Toronto (1907), dans l’industrie du coton au Québec (1908), de même que sur le problème de l’indemnisation des résidents japonais et chinois après les émeutes de Vancouver (1907–1908). Il fut même chargé d’une mission quasi diplomatique à Londres, pour transmettre les préoccupations du gouvernement canadien et du président des États-Unis Theodore Roosevelt sur la question de l’immigration japonaise en Amérique du Nord. C’était là de grandes responsabilités pour un fonctionnaire. Mais King trouvait encore frustrant de ne pas pouvoir prendre de décisions politiques et, le 21 septembre 1908, il démissionna de son poste de sous-ministre pour se consacrer à la politique active.
King avait 33 ans et, derrière lui, une remarquable carrière dans la fonction publique. Il avait aussi trouvé le temps de mener une vie sociale active. À Ottawa, bien des gens, dont le gouverneur général lord Grey*, le disaient promis à un brillant avenir. King était régulièrement invité aux dîners et aux bals de l’élite d’Ottawa. Il aimait la compagnie des femmes et s’attendait à se marier un jour – pendant ses études à Chicago, il avait demandé une infirmière en mariage – mais sa prudence, ses obligations familiales et sa réticence à l’égard de toute entrave à son ambition expliquent probablement qu’il ait fui les engagements de la vie conjugale. Il remboursa les dettes de son père et donna régulièrement à sa mère l’argent qu’elle lui demandait pour acheter des vêtements et entretenir la maison. Dans les collines de la Gatineau au Québec, au nord d’Ottawa, King faisait avec Henry Albert Harper de longues promenades ; tous deux s’émerveillaient de la beauté des abords du lac Kingsmere, lisaient de la grande littérature et discutaient de leurs préoccupations spirituelles. En décembre 1901, la mort de Harper, qui avait péri en essayant de sauver une jeune fille de la noyade, mit fin à cette relation. King écrivit un émouvant éloge, The secret of heroism ; a memoir of Henry Albert Harper, publié à New York en 1906, mais jamais plus il ne s’abandonna à une telle amitié. Avant la mort de Harper, il avait acquis une propriété à Kingsmere et construit un petit chalet, son refuge, où il allait échapper aux pressions d’Ottawa. De plus en plus, cependant, sa carrière prendrait le pas sur sa vie privée.
Aux élections fédérales d’octobre 1908, King se porta candidat libéral dans la circonscription de Waterloo North, dont Berlin faisait partie – circonscription conservatrice qu’il remporta par une faible majorité. Le 2 juin 1909, peu après la fin de la première session du Parlement, Laurier le nomma ministre du Travail. King avança avec prudence, conscient que ses collègues plus anciens le jugeaient arriviste et se méfiaient de ses opinions progressistes. Dans le domaine des relations du travail, son intervention en 1910 dans la grève à la Compagnie du chemin de fer du Grand Tronc, en raison de laquelle les travailleurs furent mis sur la liste noire et perdirent leur pension, causa du tort au gouvernement. En même temps, King présenta la Loi des enquêtes sur les coalitions de 1910, qui prévoyait un mécanisme d’enquête sur les allégations d’entrave au commerce ou de manipulation des prix, et autorisait à imposer des amendes à ceux qui agissaient de manière contraire à l’intérêt public. Il parla également de la nécessité d’un projet de loi sur la journée de travail de huit heures, mais son activité législative fut interrompue par l’entente de réciprocité et les élections fédérales de septembre 1911. Le gouvernement fut défait. Fait plus grave pour King, il perdit son siège parce que la réciprocité se révéla impopulaire auprès des industriels et des travailleurs d’usines de Berlin.
King ne renonça pas pour autant à sa carrière politique. Pour gagner sa vie, il prononça des discours, écrivit des articles et des textes politiques, et dirigea le nouveau bureau central d’informations du Parti libéral à Ottawa, travail qui comprenait la rédaction du Canadian Liberal Monthly. Puis, en 1914, il reçut une offre tout à fait inattendue. John Davison Rockefeller fils, durement critiqué pour une violente grève des mineurs au Colorado – grève dont il ne savait rien, mais dont on le blâmait parce que la mine appartenait à sa famille –, lui demanda de réaliser pour la Rockefeller Foundation une étude sur les relations industrielles. Dès leur première rencontre, les deux hommes furent mutuellement impressionnés. King voyait devant lui un homme certes naïf quant aux obligations des employeurs, mais qui semblait avoir l’esprit ouvert et désirer sincèrement des réformes ; Rockefeller découvrait un mentor capable de le guider dans le bourbier des relations industrielles. King accepta de faire l’étude en se servant de la grève du Colorado pour éprouver ses conclusions et obtint la permission de poursuivre ses activités politiques au Canada. Il se rendit au Colorado pour rencontrer d’abord les patrons et les mineurs, puis fit participer le jeune industriel à la négociation d’un accord. Cet accord réglait le différend sur les salaires et conditions de travail, et prévoyait l’élection de travailleurs à des comités de réclamations. On objecta qu’il permettait la création d’un « syndicat de boutique », plus facile à intimider par la direction qu’un syndicat indépendant. King y voyait cependant un premier pas nécessaire et on lui reconnut quelque mérite ; il avait en effet insisté pour faire accepter le droit des mineurs à la syndicalisation et le droit des organisateurs syndicaux de recruter des membres.
Le rapport de King à la Rockefeller Foundation, Industry and humanity : a study in the principles underlying industrial reconstruction, parut à Toronto en 1918. Il eut peu d’influence parce que l’analyse était laborieuse et abstraite. King tirait ses arguments de Toynbee, de James Mavor* (de la University of Toronto) et d’autres théoriciens. Néanmoins, son propos visait sérieusement à situer les relations industrielles dans un contexte social plus vaste. Réformiste sans être radical, King refusait que la lutte des classes soit inévitable. Selon lui, travailleurs, patrons et propriétaires des capitaux étaient des partenaires, non des rivaux, et les conflits survenaient quand les motifs de plainte des uns étaient mal compris des autres. Pour rétablir la paix industrielle, il fallait que les partenaires reconnaissent avoir des intérêts communs et mettent en place des structures par lesquelles ces intérêts puissent être expliqués et compris. King élargissait le débat en affirmant que la collectivité constituait un quatrième partenaire et que ses intérêts à elle aussi devaient être pris en considération. Il n’expliqua jamais clairement dans ce livre comment la collectivité pourrait faire entendre sa voix dans les négociations, mais sa théorie permettait de justifier l’intervention de l’État quand l’intérêt collectif était mis de côté. Malgré le peu d’attention qu’il retint, cet ouvrage est important parce qu’il aide à comprendre le succès ultérieur de King comme homme politique. En politique, les groupes d’intérêts étaient plus nombreux et les problèmes souvent plus complexes, mais pour King, la recherche du bien commun demeurait fondamentalement la même. Être un leader, ce n’était ni imposer des mesures ni en adopter parce qu’elles sont populaires. C’était procéder avec prudence et par étapes : permettre des discussions au cabinet et au caucus, même longues et enflammées, s’assurer que tous avaient exprimé leur point de vue et arriver à un consensus.
King pouvait se dire assez satisfait de son travail à la Rockefeller Foundation, qu’il quitta en février 1918, et des autres contrats qu’il obtint par la suite en tant que conseiller en relations du travail aux États-Unis. Au Canada, cependant, sa carrière politique se portait mal. Il avait obtenu l’investiture libérale dans York North, en Ontario, en 1913, mais passé peu de temps dans cette circonscription. Puis, en 1917, en pleine guerre, le premier ministre conservateur, sir Robert Laird Borden*, opta pour l’enrôlement obligatoire des civils dans l’armée pour le service outre-mer et proposa qu’une coalition de députés conservateurs et libéraux forment un gouvernement pour imposer la conscription. Beaucoup de Canadiens français y voyaient une manœuvre de la majorité canadienne-anglaise pour les forcer à se battre dans une guerre qui concernait surtout l’Europe. King ne voulait pas prendre position, mais quand Laurier insista pour s’opposer à la conscription, il accepta la ligne du parti. Aux élections fédérales de 1917, le nouveau gouvernement d’union, qui regroupait des conservateurs et des libéraux conscriptionnistes, remporta une écrasante majorité – les libéraux opposés à la conscription obtenant la plupart de leurs sièges au Québec. Dans York North, King fut une fois de plus défait.
Pendant cette période, la vie personnelle de King fut également bouleversée. Toujours célibataire, King s’était de plus en plus attaché à sa famille, mais cette famille se rétrécissait. Une de ses sœurs mourut en 1915 et son père, l’année suivante. Sa mère devenait de plus en plus exigeante, mais King l’idéalisait : elle était, d’après lui, la seule personne à l’apprécier et à croire en son avenir politique. À cette époque, elle était devenue invalide ; King l’installa dans son appartement d’Ottawa à la fin de 1916 et prit soin d’elle pendant qu’elle traversait une série de crises. Elle mourut le lendemain de la défaite de King dans York North, avant qu’il ne puisse rentrer à Ottawa. Évidemment, après sa mort, King se sentit terriblement seul. Il pensait souvent à elle et sentait sa présence autour de lui. Sa solitude accentua son intérêt pour l’au-delà, enraciné dans sa foi chrétienne.
La politique comblerait bientôt le vide. Laurier mourut en février 1919, peu après la fin de la guerre et avant que le Parti libéral ne se remette des déchirements causés par la conscription et l’accablante défaite électorale. En août, pour la première fois au Canada, un parti fédéral décidait de tenir un congrès à la direction plutôt que de laisser le choix de son chef au caucus. William Stevens Fielding*, longtemps ministre des Finances sous Laurier, aurait été le successeur naturel en dépit de ses 70 ans, mais il avait appuyé les unionistes, et beaucoup de libéraux, en particulier chez les Canadiens français, ne lui pardonneraient pas cette déloyauté. King avait non seulement l’avantage d’être jeune et énergique, il connaissait à fond les inquiétants problèmes sociaux et ouvriers de l’heure. Ce fut une lutte serrée, mais la fidélité de King à Laurier lui conféra l’avantage. Le 7 août, il avait l’assentiment de la plupart des représentants de la province de Québec et suffisamment d’appuis chez les délégués d’autres régions pour être élu chef au troisième tour de scrutin.
Au moment où King prit la direction du parti, l’instabilité politique au Canada était plus grande que jamais. Le gouvernement d’union n’avait aucun avenir maintenant que la guerre était terminée. Arthur Meighen*, qui succéda à Borden comme premier ministre en 1920, essayait de préparer les prochaines élections en réorganisant le Parti conservateur et en tablant sur son habituel programme de protection tarifaire. Bien des Canadiens, toutefois, ne faisaient plus confiance à la politique traditionnelle. L’inflation de la guerre et l’agitation ouvrière de l’après-guerre amenaient de nombreux travailleurs à envisager des solutions radicales : socialisme, militantisme, nouvelles formes d’organisation syndicale, nouvelles conceptions de l’ordre social et politique. L’année 1919 fut marquée par des grèves, notamment la grève générale de Winnipeg, et souvent les leaders invoquaient la lutte des classes pour justifier leurs demandes. La radicalisation était presque aussi spectaculaire chez les agriculteurs, qui voyaient les prix de leurs produits chuter et attribuaient leurs difficultés financières au coût du transport et aux tarifs. En Ontario et dans les Prairies, bien des fermiers qui avaient appuyé le gouvernement d’union rejetaient maintenant conservateurs et libéraux pour appuyer le Parti progressiste. Celui-ci serait formé à l’échelle nationale en 1920 par l’union des membres du Canadian Council of Agriculture et des dissidents libéraux dirigés par Thomas Alexander Crerar*.
La classe politique devait aussi se faire à l’idée que, en dehors des frontières du Canada, le monde avait changé. Pour la plupart des Canadiens, cela obligeait à redéfinir les relations avec la Grande-Bretagne. Le Canada était entré en guerre en tant que colonie, mais la guerre en avait convaincu beaucoup de la nécessité de rejeter le statut de colonie servile. Néanmoins, peu de gens préconisaient l’indépendance totale. Les solutions proposées allaient d’un empire britannique plus centralisé, où le Canada jouerait un rôle important, à un commonwealth de pays vaguement associés où le Canada serait autonome. Les conséquences pour le Canada étaient loin d’être claires, mais il y avait du changement dans l’air.
Le Parti libéral, qui avait choisi King comme chef, était lui-même profondément divisé. King devrait y ramener les libéraux ayant avalisé le gouvernement d’union et la conscription, et ce, sans s’aliéner les Canadiens français. En même temps, il devrait y attirer les nouveaux regroupements ouvriers et agricoles – et pour cela réduire les tarifs et augmenter l’aide financière aux moins privilégiés – tout en conservant l’appui des industriels. Les participants au congrès libéral de 1919 proposèrent, de fait, un programme progressiste ; ils préconisaient une baisse des tarifs mais sans opter pour le libre-échange, et se disaient favorable aux syndicats, à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à l’assurance publique pour les malades, les personnes âgées et les sans-emploi. Ce programme relevait cependant plus de l’intention que de l’engagement et serait adopté « dans la mesure où la situation particulière du pays le permettra[it] ». King aussi était prudent ; dans son discours d’acceptation, il décrivit ce programme comme « une feuille de route » plutôt qu’un contrat. Le nouveau chef devait bâtir un parti majoritaire dans un pays divisé et, de toute évidence, il se proposait d’y aller lentement.
King voulait entrer à la Chambre des communes le plus rapidement possible. Plusieurs circonscriptions pourraient faire l’affaire, mais dans la plupart, il aurait eu comme adversaire un candidat appuyé par les agriculteurs. Pour éviter tout affrontement, il choisit Prince, dans l’Île-du-Prince-Édouard, où il fut élu sans opposition en octobre 1919. Une fois à la Chambre, il prit soin de confier à William Stevens Fielding un rôle important dans les débats, ce qui rassurait les libéraux conscriptionnistes et lui laissait le temps d’approfondir ses dossiers. Saisissant l’occasion d’une tournée en Ontario et dans l’Ouest en 1920, il mit un point d’honneur à exprimer sa sympathie pour la cause des fermiers et courtisa les leaders progressistes en vue de battre les conservateurs, leur ennemi commun, aux prochaines élections. Les progressistes, qui avaient le vent dans les voiles, se montrèrent peu intéressés. Au provincial, les organisations agricoles furent portées au pouvoir en Ontario en 1919 – et le seraient en Alberta en 1921 – et elles étaient si fortes au Manitoba et en Saskatchewan que les libéraux de ces provinces devaient se distancier de leurs homologues fédéraux pour survivre. Fait révélateur, après avoir obtenu l’investiture dans son ancienne circonscription de York North, King eut pour adversaire aux élections le président des Fermiers unis de l’Ontario, Ralph W. E. Burnaby. Il ne serait pas facile de convaincre les fermiers que le Parti libéral avait changé.
Les élections de décembre 1921 – les premières auxquelles toutes les femmes étaient habilitées à voter – illustrèrent de manière frappante combien le pays était fragmenté. Meighen souffrait encore de l’impopularité du gouvernement d’union et de son propre rôle dans l’adoption, par la Chambre, de la loi de conscription. Sa défense des tarifs protecteurs était largement boudée au Québec, où l’on n’avait pas oublié la conscription, et peu approuvée dans l’Ouest et les Maritimes. Seulement 50 conservateurs furent élus, dont 37 en Ontario. Les progressistes remportèrent d’étonnantes victoires : 38 des 43 sièges dans les Prairies et 24 en Ontario ; parmi eux se trouvait Agnes Campbell Macphail*, première femme à être élue à la Chambre des communes au Canada. Les libéraux prirent le pouvoir avec tout juste 116 sièges ; ayant fait élire des députés dans toutes les provinces sauf en Alberta, ils étaient les seuls à pouvoir prétendre former un parti national. Néanmoins, comme 65 de ces sièges se trouvaient au Québec, leur dépendance à l’égard des électeurs canadiens-français les inquiétait beaucoup. King avait gagné les élections et devenait donc premier ministre (et, d’office, secrétaire d’État aux Affaires extérieures) ; le 3 juin 1922, il deviendrait membre du Conseil privé de la Grande-Bretagne, nomination honorifique qu’il prisait surtout parce que, selon lui, elle justifiait le « noble objectif » de son grand-père.
King était encore à l’essai. Il devrait élargir la base libérale sans s’aliéner ses propres partisans et il aurait droit à peu de marge d’erreur. Sa première décision fut cruciale. Il savait que le Parti libéral devait conserver l’appui du Canada français. Lui-même lisait le français, mais le parlait difficilement ; le problème était davantage culturel que linguistique. Pour s’assurer que son gouvernement tienne compte du point de vue des Canadiens français, il décida que son plus proche collaborateur viendrait de la province de Québec. Son choix se porta sur Ernest Lapointe, député d’arrière-ban et avocat qui s’était taillé une réputation de libéral modéré et de champion des droits des Canadiens français. King le convoqua tout de suite à Ottawa, lui expliqua le rôle qu’il voulait lui confier et lui offrit, pour confirmer ce rôle, le portefeuille de la Justice. Le personnage le plus en vue parmi les Canadiens français élus au Québec était sir Lomer Gouin*, ancien premier ministre de la province, mais King doutait de son libéralisme à cause de son penchant protectionniste et de ses liens étroits avec les milieux d’affaires montréalais. King finit par céder aux pressions politiques et confia la Justice à Gouin – Lapointe obtint la Marine et les Pêcheries – tout en faisant bien comprendre que Lapointe était son principal lieutenant. Ce statut fut publiquement confirmé en 1924 quand, après la démission de Gouin, Lapointe devint ministre de la Justice. King et Lapointe travailleraient en étroite collaboration pendant presque 20 ans, jusqu’à la mort de ce dernier en 1941.
King devait maintenant régler la question de la représentation de l’Ouest au cabinet. C’était une question importante, car il considérait le cabinet comme l’institution centrale du gouvernement, celle où se débattent et se décident les grandes orientations, où les ministres défendent les intérêts de leur région et où lui-même jouerait le rôle de médiateur. En 1921, il avait selon lui pour tâche – apparemment simple – de cimenter les forces anticonservatrices. Les partis libéral et progressiste étaient opposés aux tarifs élevés préconisés par les conservateurs et favorisaient tous deux une plus grande autonomie du Canada dans ses relations avec la Grande-Bretagne. L’entrée de leaders progressistes au cabinet permettrait de bien faire entendre le point de vue des fermiers et de voir émerger un consensus plus représentatif de toutes les régions du pays. Les divisions internes, tant au Parti libéral qu’au Parti progressiste, laissaient cependant aux chefs une bien mince marge de manœuvre. Thomas Alexander Crerar, chef progressiste et député de Marquette, au Manitoba, se laissa tenter par un poste au cabinet ; mais quand il demanda à King de s’engager sur la question des tarifs et des chemins de fer, celui-ci manifesta sa sympathie et sa compréhension, sans plus. Les progressistes plus radicaux firent alors savoir à Crerar qu’ils lui retireraient leur appui s’il entrait au gouvernement. King dut finalement avouer son échec et se tourner vers les libéraux élus pour former son cabinet.
Dans les quelques années qui suivirent, King ne perdit jamais les progressistes de vue. Toujours préoccupé par les problèmes des fermiers, il représenta de son mieux au cabinet les intérêts des absents. L’entente de la passe du Nid-du-Corbeau, qui accordait à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique des tarifs préférentiels pour transporter le grain des Prairies vers l’Est et d’autres marchandises vers l’Ouest, avait été suspendue en 1919 à cause de l’inflation provoquée par la guerre et elle fut rétablie en 1922. Le gouvernement s’engagea aussi à créer un réseau ferroviaire à partir des compagnies en faillite qu’il avait acquises durant la guerre [V. William Costello Kennedy*] et convint de terminer le Hudson Bay Railway pour calmer les fermiers qui voulaient une liaison plus courte vers la mer. Pour la plupart des agriculteurs, cependant, le véritable test serait les modifications tarifaires et, en ce domaine, la position du gouvernement demeurait ambivalente. Au cabinet, King préconisa des actions d’éclat, mais il n’obtint pas beaucoup d’appuis et Fielding, de nouveau ministre des Finances, annonça peu de réductions tarifaires dans ses budgets de mars 1922 et de mai 1923. Quelques progressistes rompirent avec leur parti pour appuyer le premier budget, mais, signe des frustrations des agriculteurs, tous les progressistes votèrent avec les conservateurs contre le deuxième.
King eut plus de succès dans l’union des forces anticonservatrices en matière internationale. L’ancien premier ministre Meighen avait continué la politique de Borden visant à préserver l’unité diplomatique de l’Empire, même si, reconnaissant les intérêts des États-Unis dans le Pacifique et souhaitant maintenir les bonnes relations canado-américaines, il s’était opposé, à la Conférence impériale de 1921, au renouvellement de l’alliance de la Grande-Bretagne avec le Japon. King savait fort bien, lui aussi, que les affaires impériales pouvaient avoir de profondes répercussions sur le Canada. La crise de Chanak, quelques mois plus tard, révélerait de nouveau, et dramatiquement, la difficulté de maintenir l’unité diplomatique de l’Empire. En septembre 1922, le gouvernement turc, répudiant son traité signé avec les puissances alliées, menaça de réoccuper la zone neutre de Chanak dans le détroit des Dardanelles (Çanakkale Boğazi). La Grande-Bretagne était résolue à l’en empêcher, par la force si nécessaire. Sans consultation préalable, elle demanda aux premiers ministres des dominions de lui fournir un soutien militaire, puis émit un communiqué de presse. King, qui n’avait pas reçu le message officiel, entendit parler de la crise par un journaliste. Après réunion du cabinet, il annonça son refus de toute participation qui ne serait pas approuvée par le Parlement canadien. Cette affirmation d’autonomie contrastait vivement avec la déclaration de Meighen, dans un discours à Toronto le 22 septembre, selon laquelle le Canada aurait dû répondre à la Grande-Bretagne : « Prêts, oui [nous sommes] prêts, nous sommes avec vous. » King prit soin de tenir Crerar au courant pendant toute la durée de la crise, et les progressistes appuyèrent ouvertement sa position. Heureusement, les Turcs cédèrent. La crise de Chanak eut néanmoins des répercussions : il ne pourrait y avoir de politique extérieure commune dans l’Empire si chaque dominion décidait de sa propre ligne de conduite.
La Conférence impériale de 1923 ne pouvait faire fi de cette question. Le gouvernement britannique, appuyé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, espérait y faire adopter une déclaration générale sur la politique extérieure. King était convaincu que toute décision tendant à lier les dominions empiéterait sur leur autonomie. Selon lui, la conférence était un mécanisme très utile pour échanger des renseignements et essayer de se comprendre, mais elle n’avait aucune autorité ; c’est aux Parlements qu’il incombait de décider. Le rapport final de la conférence, qui traduisait cette conviction de King, marqua une étape déterminante dans l’évolution du British Commonwealth of Nations (terme consacré par le traité anglo-irlandais de 1921). On admettait qu’il n’y aurait pas d’empire centralisé. On ne précisait cependant pas comment se réaliserait l’unité du Commonwealth ni même si celui-ci survivrait. Mais King n’avait aucune crainte. Il était convaincu que les nations membres autonomes partageaient les mêmes valeurs politiques et sociales de base, et qu’en l’absence de toute coercition, elles seraient d’accord sur les grandes questions. Comparant le Commonwealth à une famille, il voyait les dominions comme des enfants qui grandiraient, mais ne seraient pas tentés de claquer la porte ni de quitter la maison si l’on acceptait qu’ils soient autonomes. Pour lui, la reconnaissance de l’autonomie des dominions contribuerait à renforcer plutôt qu’à affaiblir l’unité de l’ensemble.
Oscar Douglas Skelton, politologue à la Queen’s University de Kingston et biographe de Laurier, était parmi les conseillers qui accompagnaient King à la conférence de 1923. Il attira l’attention du premier ministre par ses réflexions lucides sur l’autonomie canadienne et, après la conférence, se laissa convaincre de devenir conseiller aux Affaires extérieures en 1924, puis sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures en 1925. Ces nominations confirmèrent la sagacité de King. Skelton avait une capacité phénoménale de travail et un talent pour la documentation ainsi que pour la production de notes et de discours d’une clarté et d’une concision remarquables. Il devint vite l’homme de confiance du premier ministre. Skelton n’était pas toujours d’accord avec lui – il était, par exemple, plus sceptique quant aux avantages que le Canada tirait du Commonwealth –, mais il donnait son opinion franchement puis acceptait loyalement les décisions de son supérieur.
Les Canadiens s’intéressaient peu aux Affaires extérieures, cependant, et le rôle crucial de King à la Conférence impériale passa presque inaperçu. Heureusement, la situation politique au pays s’avérait prometteuse. L’amélioration des conditions économiques et l’affaiblissement de l’aile protectionniste du Parti libéral après le départ de Fielding et de Gouin, qui avaient tous deux démissionné pour des raisons de santé, facilitaient les concessions aux fermiers. En même temps, les divisions à l’intérieur du Parti progressiste se creusaient. En 1924, le gouvernement put abaisser certains tarifs et promettre quand même le premier surplus depuis l’avant-guerre. Quelques libéraux favorables aux tarifs élevés votèrent contre le budget mais, fait plus significatif, les progressistes modérés l’approuvèrent. Confiant que les électeurs récompenseraient ses efforts, King dissout le Parlement l’année suivante.
King avait tort. Il avait poussé son parti aussi loin que possible dans la réduction des tarifs et défendu l’autonomie canadienne à l’intérieur de l’Empire, mais il essuya un revers cuisant aux élections d’octobre 1925. La députation libérale augmenta dans l’Ouest de 18 sièges, mais cette augmentation était annulée par la perte de 10 circonscriptions en Ontario et de 19 dans les Maritimes, où l’on reprochait à King d’avoir courtisé les progressistes. Les libéraux finirent avec 99 sièges, dont 59 au Québec. Les conservateurs, en revanche, gagnèrent des sièges dans toutes les régions, pour un total de 116, soit un peu moins que la majorité. Les progressistes perdirent beaucoup, ne remportant que 24 sièges, mais ils pouvaient néanmoins se consoler en se disant qu’ils détiendraient la balance des pouvoirs dans le nouveau Parlement.
Non seulement King avait mené le Parti libéral à la défaite mais, comme huit autres ministres du cabinet, il avait été battu dans sa propre circonscription. Beaucoup d’observateurs, dont le gouverneur général lord Byng*, s’attendaient qu’il démissionne et laisse la place à Meighen. Mais King ne concéderait pas la victoire. Il insista pour réunir la Chambre, convaincu que les progressistes appuieraient son gouvernement plutôt que de le voir remplacé par un gouvernement conservateur. Pendant quelques mois fort tendus, les événements lui donnèrent raison. Les progressistes votèrent en faveur du discours du trône le 8 janvier 1926, puis en faveur du budget libéral en avril. King gagna également l’appui des deux députés travaillistes (James Shaver Woodsworth et Abraham Albert Heaps*, tous deux de Winnipeg) en présentant un projet de loi sur les pensions de vieillesse, qui serait toutefois défait au Sénat. King lui-même revint aux Communes après une élection partielle dans Prince Albert, en Saskatchewan, le 15 février. Il semblait bien que le gouvernement libéral survivrait pour la session, et peut-être même pour une ou deux sessions de plus.
Toutefois, un scandale au ministère des Douanes et Accises vint bouleverser les plans de King : une affaire de collusion entre des contrebandiers et des fonctionnaires pour faire entrer au Canada des marchandises en provenance des États-Unis. Sachant depuis quelque temps qu’il y avait des problèmes, King avait muté le ministre, Jacques Bureau*, au Sénat en septembre 1925 et chargé son successeur, Georges-Henri Boivin, de réorganiser le ministère. Les conservateurs n’étaient cependant pas impressionnés et voyaient dans cette affaire une chance de mettre les libéraux en échec, sachant que les progressistes, qui avaient fait de l’honnêteté leur cheval de bataille, pourraient difficilement soutenir le gouvernement. King évita le plus longtemps possible tout débat sur la question, mais en juin 1926, la Chambre fut saisie du rapport d’un comité parlementaire sur ce scandale. Après que les conservateurs eurent demandé une motion de censure, King proposa une série de modifications pour retarder le processus, mais il était clair que les progressistes étaient divisés et que le gouvernement serait vraisemblablement renversé au vote final.
Pour éviter un tel vote, King demanda au gouverneur général de dissoudre la Chambre et d’imposer de nouvelles élections. Byng refusa en arguant qu’il fallait donner à Arthur Meighen la possibilité de former un gouvernement. Meighen était prêt à essayer. Le 27 juin, King écrivit dans son journal, à propos des perspectives de réussite de son adversaire : « Meighen aussi héritera de situations difficiles – les provinces de l’Ouest [...] S’il essaie de continuer, je pense qu’il n’ira pas loin. [Nous avons] de bonnes chances de l’emporter dans une élection générale. Je sens que j’ai raison et [j]’en suis heureux, que Dieu me vienne en aide à chaque étape. » Le lendemain, King démissionna. Meighen réussit à former un gouvernement et à faire voter la censure, mais il ne parvint pas à clôturer la session rapidement parce que King refusa de coopérer et présenta une série de motions critiquant le nouveau gouvernement. Suffisamment de progressistes, embarrassés d’avoir à soutenir Meighen, appuyèrent les libéraux le 2 juillet dans un vote de censure qui renversa de justesse le nouveau gouvernement. Byng accepta alors l’avis de Meighen et prononça la dissolution du Parlement.
Les élections de septembre 1926 furent décisives pour la carrière de King. Sous sa direction, le Parti libéral avait perdu de sa popularité et, maintenant, le scandale aux Douanes menaçait de revenir le hanter pendant la campagne. King livra bataille énergiquement, tant à l’échelle nationale que dans Prince Albert. Il affirma que Byng avait violé la constitution en lui refusant la dissolution du Parlement alors qu’il l’avait accordée à Meighen. Sur le plan constitutionnel, Byng avait raison et King avait tort. Sur le plan politique, toutefois, King fut le gagnant. Il avait centré l’attention sur la décision de Byng même si de nombreux libéraux estimaient que les électeurs ne s’intéresseraient pas à cette question. Les résultats semblèrent confirmer que King avait été perspicace. La question constitutionnelle détourna l’attention du scandale aux Douanes, et King se posa en défenseur de l’autonomie canadienne contre un gouverneur général se mêlant de ce qui ne le regardait pas. Le vote des fermiers autrefois dissidents, dont King avait constamment cherché depuis cinq ans à regagner la confiance, fit pencher la balance. Les progressistes modérés, concluant qu’ils préféraient un gouvernement libéral plutôt que conservateur, acceptèrent de présenter un candidat libéral-progressiste dans un certain nombre de circonscriptions. Les libéraux raflèrent 116 sièges, ce qui, avec l’appui de 10 libéraux-progressistes, leur assurait une nette majorité. King fut réélu dans Prince Albert.
Les années qui suivirent furent de bonnes années pour être au pouvoir. L’économie canadienne se portait bien : la relance de l’après-guerre en Europe et la prospérité aux États-Unis augmentaient les débouchés pour les céréales, le minerai et les produits du bois canadiens, et la demande intérieure d’automobiles et d’autres biens de fabrication canadienne allait croissant. Le gouvernement fédéral put réduire les impôts et quand même diminuer sa dette et disposer d’un modeste surplus. Les gouvernements provinciaux voulaient des concessions financières, mais cela n’avait rien de nouveau et King mit encore une fois à profit ses talents de négociateur. Tard dans la décennie, l’affaiblissement des marchés du papier journal et du grain, par exemple, et la spéculation boursière excessive laissèrent présager des difficultés économiques, mais pour l’instant, l’optimisme régnait. King continuait de croire à la bonne performance de son gouvernement et à l’éventuelle gratitude des électeurs.
La Conférence impériale de 1926, cruciale pour la définition de la nature du British Commonwealth of Nations, commença deux semaines à peine après le retour de King au pouvoir en septembre. King n’y amorça pas la discussion ; il était prêt à s’accommoder de l’imprécision dans les relations avec la Grande-Bretagne, confiant de pouvoir au besoin défendre l’autonomie du Canada. Le premier ministre de l’Afrique du Sud, James Barry Munnik Hertzog, se montrait toutefois plus impatient : il menaça de quitter le Commonwealth si l’on refusait de rédiger à la conférence une déclaration affirmant l’indépendance des dominions. Il avait en cela l’appui de l’Irlande, mais non celui des premiers ministres d’Australie et de Nouvelle-Zélande. King joua un rôle important comme médiateur et proposa un compromis : une déclaration d’autonomie plutôt que d’indépendance. Après deux semaines de négociations, on s’entendit pour définir la Grande-Bretagne et les dominions comme étant « des communautés autonomes à l’intérieur de l’Empire britannique, [ayant] statut d’égalité, et [n’étant] d’aucune manière subordonnées l’une à une autre sur quelque aspect que ce soit de ses affaires intérieures ou extérieures, bien qu’elles soient unies par une allégeance commune à la couronne et librement associées en tant que membres du British Commonwealth of Nations ».
Cette définition ne mit pas fin au débat. Selon Hertzog, « librement associées » signifiait que l’Afrique du Sud pouvait, si elle le voulait, quitter le Commonwealth ; les Britanniques n’étaient pas d’accord. La définition était cependant importante. Le « statut d’égalité » signifiait que la Grande-Bretagne ne pouvait plus présumer que sa politique extérieure devrait être celle de tout le Commonwealth. Il signifiait également que le Canada, comme les autres dominions, pouvait mettre en place son propre service diplomatique et décider lui-même de sa politique étrangère. Le texte de la Conférence impériale de 1926 et le statut de Westminster qui lui apporterait une reconnaissance juridique en 1931 confirmaient que le British Commonwealth of Nations serait une association volontaire, dont la force serait déterminée par les décisions de ses membres respectifs. Le service diplomatique canadien prit rapidement forme. Charles Vincent Massey*, premier agent diplomatique plénipotentiaire du Canada à l’étranger, fut envoyé aux États-Unis en novembre 1926. Philippe Roy fut nommé en France en 1928 et Herbert Meredith Marler*, à Tokyo en 1929.
King n’avait aucune inquiétude quant à la nouvelle entente adoptée en 1926. Il savait bien que le Canada devrait continuer à se défendre avec vigilance contre une Grande-Bretagne centralisatrice, mais la reconnaissance officielle de l’autonomie des dominions lui faciliterait désormais la tâche. Pas plus qu’auparavant, il ne redoutait la disparition du Commonwealth. Les affinités ethniques et l’héritage politique commun constituaient selon lui des liens puissants. King n’envisageait pas l’indépendance, estimant sans doute que l’appartenance au Commonwealth ne nuirait pas à l’autonomie canadienne et donnerait au Canada un prestige et une sécurité qu’il ne pourrait avoir en tant que pays indépendant.
De retour au Canada, King dut faire face à l’insatisfaction constante des régions. Les gens des Maritimes étaient mécontents parce qu’ils ne bénéficiaient pas de la prospérité du reste du pays et en blâmaient les droits de douane et le prix du transport des marchandises par chemin de fer. Les premiers ministres des Prairies jugeaient discriminatoire la réticence fédérale à céder la mainmise sur leurs richesses naturelles. Ceux de l’Ontario et de la province de Québec dénonçaient la limitation de leur pouvoir à l’égard du développement hydroélectrique des voies navigables en raison de l’autorité exercée en cette matière par le fédéral. À la Conférence fédérale-provinciale de 1927, King usa de ses talents de conciliateur et accepta de faire des concessions à toutes les régions si celles-ci ne protestaient pas contre les offres faites aux autres régions. Ainsi, les Maritimes obtinrent une hausse des subventions et une baisse des tarifs de transport de marchandises par chemin de fer, les Prairies, le contrôle sur leurs richesses naturelles sans perte de la subvention compensatoire, l’Ontario et la province de Québec, le droit de distribuer l’hydroélectricité produite sur les voies navigables. Pour le moment, King avait apaisé les régions.
Cette relative harmonie politique tenait à la prospérité du milieu des années 1920, mais on peut aussi y voir la fin d’une longue époque consacrée à l’édification du pays. La Politique nationale de sir John Alexander Macdonald* avait atteint ses trois grands objectifs. La plupart des terres arables offertes aux colons des Prairies étaient maintenant occupées et, pour la première fois en un demi-siècle, on mettait en question l’aide fédérale aux agriculteurs immigrants. La politique des chemins de fer était aussi en voie de modification. Propriété de l’État, la Canadian National Railway Company avait, sous la dynamique direction de sir Henry Worth Thornton*, affecté des fonds fédéraux à la mise en place d’un réseau ferroviaire intégré. En 1928, la rentabilité de cet investissement semblait confirmée, car les revenus d’exploitation du réseau dépassaient les paiements d’intérêts sur les obligations ferroviaires. Les tarifs, troisième volet de la Politique nationale, étaient toujours controversés – les fermiers les jugeaient encore trop élevés –, mais ils n’avaient plus beaucoup d’incidence sur l’économie canadienne.
King n’avait rien de neuf à proposer pour remplacer la vieille Politique nationale. Il réinstaura les pensions de vieillesse après les élections de 1926, mais sans ajouter par la suite d’autres mesures de sécurité sociale dans ce pays de plus en plus urbanisé et industrialisé. Au lieu de dépenser les recettes supplémentaires que la prospérité apportait, le gouvernement se servit de son surplus annuel pour réduire sa dette et, en 1927–1928, il abaissa les taxes de vente et les impôts sur le revenu. King ne voyait aucune raison de mettre en doute le bien-fondé de cette frugalité. Il était certain qu’en réduisant les taxes et, par conséquent, les coûts de production, son gouvernement assurait la croissance économique du Canada et il s’attendait que l’électorat lui en soit reconnaissant.
La victoire républicaine au sud de la frontière en 1928 vint compliquer la tâche de King. Le président Herbert Clark Hoover s’était engagé à hausser les droits de douane américains sur les produits agricoles. King se servit de tous les moyens à sa disposition pour le faire changer d’avis. Il accepta d’aider les Américains à faire respecter la prohibition en rendant plus difficile la contrebande d’alcool canadien vers les États-Unis. Il essaya également de tirer profit de l’intérêt de Hoover pour une voie maritime sur le Saint-Laurent en laissant entendre que le Canada était prêt à négocier une entente. Mais Hoover ne changerait pas d’avis. Le gouvernement King répondit dans le budget fédéral de 1930 en promettant l’imposition de droits compensatoires si le gouvernement américain augmentait ses tarifs.
Le bon temps était terminé, même si les Canadiens ne s’en rendaient pas tous compte. Au Canada, les signes de ce qui serait la grande crise des années 1930 variaient selon la région et le secteur d’activité. L’économie des Maritimes était déjà tombée en déclin. Dès 1927, la surproduction de pâtes et papiers avait entraîné des mises à pied dans des localités du Nord. Le prix du blé de l’Ouest avait chuté en 1928. Ailleurs, on s’inquiétait parfois de l’avenir, même en 1930, mais les usines fonctionnaient encore. Richard Bedford Bennett, chef de l’opposition au Parlement depuis 1927, affirmait qu’il y avait une crise et exigeait que le gouvernement fasse quelque chose. King ne s’en laissait pas imposer. On s’étonne aujourd’hui qu’il n’ait fait aucune allusion, dans son journal personnel, au fameux krach boursier d’octobre 1929 ; il faudrait encore deux ans avant que le gouvernement ne soit acculé financièrement au mur. King avait placé son argent personnel dans des obligations d’État et des valeurs sûres, et il lui était facile de croire en 1929 que seuls les spéculateurs étaient frappés. Il trouvait également qu’on exagérait sur la question du chômage – en 1930, le Bureau fédéral de la statistique commençait seulement à enregistrer une baisse. Sûrement, au printemps, les prix et le nombre d’emplois augmenteraient. Le ralentissement n’était, croyait-il, que temporaire. Il fallait tout simplement être patient.
Le premier ministre passa la première partie de l’année 1930 à réfléchir à la date des prochaines élections et au budget. Le peu d’attention que King porta à la nomination, en février, de la première femme à occuper un poste au Sénat, Cairine Reay Wilson [Mackay*], lui était dicté par des considérations partisanes. Sur le front économique, son optimisme l’amena à commettre une gaffe au cours d’un débat sur le chômage le 3 avril 1930. Les conservateurs soutenaient que la crise était si grave qu’Ottawa devait offrir une aide financière aux gouvernements provinciaux, responsables de l’aide aux chômeurs. King fit remarquer qu’aucun premier ministre ne lui avait demandé de l’aide et que, en Ontario, George Howard Ferguson avait même nié que le chômage soit un problème dans sa province. Les tories fédéraux faisaient, disait-il, de la politique partisane en lui demandant de subventionner sans raison valable les gouvernements tories provinciaux, et il « ne leur accorderait pas une pièce de cinq cents ». Une telle étourderie n’était pas son genre, et l’opposition ne raterait pas une occasion de rappeler son « discours de cinq cents » après le déclenchement des élections, prévues pour juillet.
Confiant que les électeurs apprécieraient sa politique de frugalité financière, King ne nia pas le ralentissement économique pendant la campagne, mais proposa comme remèdes la prudence et le bon gouvernement. En revanche, Bennett, qui savait exploiter efficacement la radio, parla de crise et promit des mesures énergiques, notamment l’utilisation des tarifs « pour frayer le chemin jusqu’aux marchés qui [avaient] été fermés ». Dans les Prairies, où le prix du blé avait chuté, et au Québec, où les producteurs laitiers voulaient une protection contre l’importation de beurre de Nouvelle-Zélande, Bennett réussit à provoquer un revirement du vote suffisant pour donner aux conservateurs une majorité. Réélu dans Prince Albert, King passerait les cinq années suivantes dans l’opposition.
Âgé de 55 ans, King menait une vie bien établie. Célibataire endurci, il avait peu d’occupations en dehors de la politique. La maison Laurier, résidence d’Ottawa dont il avait hérité de lady Laurier et qu’il occupait depuis 1923, était une demeure confortable entretenue par un personnel comprenant un valet, un cuisinier, un chauffeur et un jardinier. L’homme d’affaires Peter Charles Larkin*, libéral convaincu, avait recueilli des fonds privés pour rénover ce bâtiment de brique jaune et payer les coûts d’entretien. Un ascenseur y avait été installé. Parfois en compagnie d’invités, King l’empruntait pour se rendre à la bibliothèque du troisième étage où il avait fait accrocher bien en évidence un portrait de sa mère. Le maître des lieux recevait parfois des gens à dîner, mais il s’agissait habituellement de réceptions officielles. En effet, King n’était pas un homme sociable et aucun de ses collègues ou amis ne lui aurait rendu visite sans invitation. Son amie la plus proche était Mary Joan Patteson, épouse de Godfroy Barkworth Patteson, banquier d’Ottawa qui s’intéressait à peu de chose. Réservée, compréhensive, Mme Patteson l’écoutait avec patience et l’importunait rarement avec ses propres problèmes. King lui parlait régulièrement au téléphone ou s’arrêtait chez elle pour lui raconter sa journée. Ni l’un ni l’autre ne faisait secret de leur amitié, et le fait que jamais aucune rumeur scandaleuse sur la nature de leur relation n’ait été prise au sérieux témoigne de la discrétion et de la transparente dignité de Mme Patteson.
La résidence d’été de Kingsmere était encore plus un refuge que la maison Laurier. King avait agrandi la propriété dans les années 1920 et 1930, et c’est là que, l’été, il allait échapper à la chaleur étouffante et aux mondanités d’Ottawa. Sur ce domaine, il louait un chalet aux Patteson et recevait parfois des invités étrangers pour le lunch, mais il n’y voyait ses collègues ou ses secrétaires que s’il leur avait expressément demandé de venir pour régler quelque affaire. En 1934, quand la maison de son grand-père à Toronto fut menacée de démolition, King eut l’idée d’aménager un jardin de ruines artificielles à Kingsmere. Il commença sa collection de ruines – qui est encore aujourd’hui l’un des éléments les plus fascinants de ce domaine – l’année suivante, en installant un châssis de fenêtre en pierre provenant de la résidence de feu Simon-Napoléon Parent* à Ottawa.
Apparemment bien installé dans cette vie ordonnée, King était néanmoins un homme bien seul et la politique ne parvenait plus à le combler. Il n’avait presque plus de famille ; sa seule sœur encore vivante, Janet (Jennie) Lindsey Lay, habitait à Barrie, en Ontario, et ils n’étaient pas très liés. Comme chef du Parti libéral, King gardait ses distances avec ses collègues, craignant que ceux-ci n’abusent de son amitié ou que les aléas de la politique ne l’obligent un jour à les larguer. Il continuait à correspondre avec des gens de l’extérieur d’Ottawa et à parler avec Mary Joan Patteson, mais cela ne suffisait pas à cet homme qui avait constamment besoin de se savoir aimé. Pat, son terrier irlandais, jouait un rôle précieux parce qu’il lui donnait de l’affection sans trop exiger de son temps. Mais King trouvait aussi du soutien émotif dans des choses plus étranges. En 1916, après s’être rendu sur les tombes de sa sœur Isabel Christina Grace et de son père à Toronto, il avait écrit dans son journal : « Pour moi, la présence spirituelle de Bell et de [mon père] était beaucoup plus réelle que les tombes que j’avais sous les yeux. » Sa conviction que sa famille (surtout sa mère) et d’autres veillaient d’une certaine façon sur lui devint de plus en plus grande à mesure que le temps passait ; il voyait régulièrement dans les coïncidences un signe de leur présence, et dans ses rêves la preuve de leur affection et de leur soutien. Cette foi n’avait, en soi, rien d’extraordinaire, mais le besoin d’obtenir des signes d’approbation du monde des esprits l’amena graduellement vers des méthodes plus excentriques. King était curieux de ce que son horoscope ou les feuilles de thé prédisaient de l’avenir ; il consultait une diseuse de bonne aventure et, pendant ses années dans l’opposition, tandis qu’il avait plus de temps libre, il essaya d’entrer en contact avec les esprits par d’autres moyens, dont la table ouija et des séances avec un médium. Parfois sceptique quant aux messages qu’il recevait – il justifiait son intérêt en le qualifiant de « recherche psychique » –, il était néanmoins fasciné par ses apparents contacts avec les défunts. Il ne leur demandait pas de conseils politiques ; ses décisions en ce domaine étaient toujours fondées sur sa propre analyse des situations. Les messages importaient moins par leur contenu que par le réconfort qu’ils lui procuraient – la preuve que les esprits étaient présents et veillaient sur lui – et cela lui donnait la force nécessaire pour faire face aux contraintes et à l’isolement de la politique. Paradoxalement, ses étranges rapports avec l’au-delà l’aidaient à supporter les pressions normales de la carrière politique.
Ces pressions s’intensifièrent après les élections de 1930 en raison des accusations de corruption portées contre les libéraux. Ce qu’on appellerait le scandale de Beauharnois avait sa source dans un projet de développement électrique prévoyant le détournement des eaux du Saint-Laurent vers le canal de Beauharnois, près de Montréal. En mars 1929, le gouvernement King avait autorisé ce détournement après qu’on lui eut confirmé qu’il ne nuirait pas à la navigation sur le fleuve. La Beauharnois Light, Heat and Power Company ne voyait toutefois dans cette autorisation qu’une première étape et espérait faire détourner la plus grande partie du fleuve vers le canal. Les profits potentiels étaient énormes. La compagnie, concluant apparemment à la nécessité de garder les libéraux au pouvoir, versèrent plus de un demi-million de dollars à leur caisse électorale en 1930. Cette contribution, révélée au public après la défaite libérale, embarrassa le parti. Ce qui troubla King encore davantage, c’est qu’on apprit qu’il était allé en vacances aux Bermudes avec le président du conseil d’administration de la Beauharnois, Wilfrid Laurier McDougald, et que sa note d’hôtel avait été payée par la Beauharnois avec le compte de frais de McDougald. Entre juin 1931 et avril 1932, des comités des Communes et du Sénat étudièrent les nombreuses allégations.
King réussit à blanchir sa réputation. McDougald expliqua avoir soumis la facture par erreur ; personne ne semblait s’inquièter du fait que King ait accepté la générosité de McDougald puisse être interprété comme un conflit d’intérêts. Le don à la caisse libérale fut plus difficile à expliquer. King pouvait prétendre que son gouvernement avait défendu l’intérêt public en permettant le détournement des eaux et qu’il n’avait fait aucune autre promesse à la compagnie, mais il savait que beaucoup de Canadiens resteraient sceptiques. Le scandale ne fit aucun dommage à long terme – et n’entraîna pas non plus de réforme majeure dans le financement du parti –, mais King concéda au Parlement le 30 juillet 1931 que les libéraux avaient traversé « la vallée de l’humiliation ». King résolut de ne plus s’occuper des finances du parti. Les solliciteurs de fonds continueraient à recueillir et à distribuer les contributions électorales ; cependant, le chef ne connaîtrait pas l’identité des donateurs, de sorte que ses décisions politiques n’en seraient pas affectées. Ainsi King aurait-il la conscience tranquille. Mais le parti demeurerait largement dépendant des contributions secrètes de l’entreprise privée.
Entre-temps, Bennett avait commencé, comme promis, une administration énergique. Au cours d’une session spéciale du Parlement, il offrit 20 millions de dollars en aide d’urgence, montant sans précédent pour le gouvernement fédéral qui n’avait aucune responsabilité constitutionnelle en matière de secours direct. Pour régler l’ensemble de la crise économique, il s’en tint à la réponse traditionnelle des conservateurs canadiens : hausse marquée des tarifs sur les produits fabriqués à l’étranger afin d’encourager la production intérieure et de créer des emplois. Malheureusement, les exportations diminuèrent, les prix des produits canadiens continuèrent à chuter et le chômage augmenta. Dès 1932, Bennett avait placé ses espoirs dans la Conférence économique impériale à Ottawa, où l’on mettait au point un certain nombre d’ententes commerciales avec la Grande-Bretagne et d’autres dominions. Négociateur efficace, il remporta quelques avantages, surtout sur le marché britannique, sans avoir à faire de concessions majeures. Fier de ses réalisations, il s’en vanta à ses compatriotes et leur promit la relance économique pour bientôt. Malheureusement, les prix mondiaux demeuraient au plus bas et les produits canadiens continuaient de se vendre mal.
Bennett, qui au début agissait également comme ministre des Finances, recevait des demandes d’aide toujours plus grandes au moment même où les recettes de l’État diminuaient. Il haussa légèrement les impôts, mais les revenus diminuaient toujours, en raison du ralentissement économique. Il ne lui servait pratiquement à rien d’augmenter les droits de douane puisqu’en raison de sa structure tarifaire le Canada était déjà presque entièrement fermé à la concurrence étrangère. Bennett n’avait d’autre choix, semble-t-il, que de réduire les dépenses, en particulier dans le domaine des secours. Il essaya de garder au minimum l’aide aux provinces en négociant ferme ; pour plus d’efficacité, il refusa même de divulguer dans la législation de 1931–1932 le montant des fonds fédéraux qui pourraient être accordés aux chômeurs et aux fermiers. Frustré de ne pouvoir régler la crise, il mit l’accent sur le respect de la loi et de l’ordre, dénonça les grèves et les manifestations, et ne cessa d’affirmer que son gouvernement faisait tout son possible.
Après s’être occupé des problèmes de la Beauharnois, King se révéla un chef de l’opposition efficace. La dépression des années 1930 était d’une gravité sans précédent au Canada. Dépendant des exportations de matières premières et de produits agricoles, les fournisseurs canadiens étaient particulièrement vulnérables dans un monde où chaque pays haussait ses tarifs pour protéger ses propres producteurs. Les fermiers de l’Ouest étaient doublement malchanceux car non seulement les prix étaient au plus bas, mais dans bien des régions, la sécheresse, la rouille et les sauterelles détruisaient les récoltes. Dans les villes, les usines fermaient parce que les consommateurs n’avaient plus les moyens d’acheter de produits. Désespérés, les Canadiens s’étaient tournés vers leurs gouvernements pour obtenir de quoi se nourrir et se loger ; ils s’en remettaient maintenant à eux pour retrouver quelque raison d’espérer. La dépression créait des conflits entre les régions et les classes, et encourageait les démagogues à proposer des politiques radicales et peu orthodoxes. Homme de compromis et de demi-mesures, réputé pour sa prudence, King ne semblait pas être le leader qu’il fallait en cette époque troublée. Dans un monde où la bataille semblait se livrer entre la gauche et la droite, entre les extrêmes du communisme et du fascisme, King paraissait indécis, terne même. Pourtant, dans cinq ans, il reprendrait le pouvoir, et avec la plus forte majorité qu’un parti ait jamais remporté jusque-là dans l’histoire du Canada. Il préserva la cohésion des libéraux, alors que le Parti conservateur se désintégrait et que de nouveaux partis voyaient le jour et s’inscrivaient sur les listes électorales. Ce n’était pas là une mince victoire. Comme il avait expliqué en 1929 à un correspondant : « Mon but premier comme chef a été de garder au Parti [libéral] des buts et des objectifs si larges qu’il serait possible d’unir, en période de crise, sous une seule bannière, ceux qui, pour une raison ou une autre, s’en sont éloignés. » Dès 1923, la plupart des progressistes seraient revenus. En 1931–1932, cependant, l’unité semblait loin : le parti était très divisé sur la question des tarifs et, parmi les porte-parole de l’opposition au Parlement, King avait peu d’alliés solides.
Comme Bennett, King mit du temps à comprendre que la dépression transformerait la politique. À son arrivée dans l’opposition, il était convaincu que son gouvernement n’avait pas mérité la défaite. L’économie avait été, selon lui, florissante parce que ce dernier avait été prudent. La récession, s’il y en avait une, était attribuable à la spéculation excessive des hommes d’affaires et aux variations climatiques. La pire erreur que le Canada et le reste du monde pouvaient faire était de hausser les tarifs et de restreindre le commerce international. Du point de vue de King, Bennett avait gagné les élections en exagérant les menaces qui pesaient sur l’économie canadienne et en promettant étourdiment de se servir des tarifs pour contrer les obstacles internationaux et météorologiques. Les électeurs, croyait-il, comprendraient vite qu’ils avaient été bernés et regretteraient les années libérales de frugalité et de libre-échange.
King ne voyait pas vraiment la nécessité de réexaminer ou de modifier ses hypothèses politiques. Le gouvernement conservateur était manifestement en difficulté et King se contentait d’attirer l’attention sur ses problèmes. Il rappelait sans cesse à la Chambre les promesses électorales de Bennett et dénonçait les déficits fédéraux, les qualifiant d’irresponsables, sans toutefois suggérer de mesures pour équilibrer les budgets. Il ne s’opposait pas à l’aide aux provinces – la nécessité en était par trop évidente –, mais il réprouvait les « chèques en blanc » pour les secours que le Parlement était appelé à autoriser et retardait l’adoption des projets de loi malgré les objections de ses députés qui craignaient que leurs commettants en concluent que les libéraux n’avaient pas de sympathie pour les pauvres. Et chaque année, après les discours du trône et du budget, il présentait des modifications jetant sur la politique tarifaire de Bennett le blâme de la crise.
King réagissait encore comme un Canadien libéral traditionnel, convaincu que la dépression ne prendrait fin qu’avec le rétablissement du commerce international et la réouverture des marchés aux produits canadiens. Certain que les tarifs élevés avaient empiré la situation, il s’encourageait à l’idée que Bennett et son gouvernement en étaient blâmés et seraient sûrement défaits. Il suffisait d’attirer l’attention sur le commerce et les tarifs jusqu’à ce que les électeurs aient la chance de corriger leur erreur. Progressivement toutefois, King se rendit compte que bien des Canadiens, y compris certains libéraux de longue date, ne voulaient plus attendre. Les parents qui ne pouvaient pas nourrir leurs enfants, les fermiers incapables d’acheter des semences ou du foin, n’avaient que faire des discours sur les tarifs. Pour eux, le capitalisme semblait être un échec et bricoler les tarifs n’y changerait rien. Autre phénomène éloquent, les électeurs auraient plus de choix aux prochaines élections. Les progressistes radicaux et les députés travaillistes aux Communes avaient formé un nouveau parti politique en 1932, la Fédération du Commonwealth coopératif, qui proposait la solution socialiste du dirigisme de l’État et de la propriété publique. La même année en Alberta, l’évangéliste William Aberhart s’était converti à la réforme monétaire du crédit social, doctrine préconisant le versement d’argent aux citoyens pour subvenir à leurs besoins ; en deux ans, il transformerait cette doctrine en programme politique. Dès 1935, des candidats du Crédit social se présenteraient aux élections fédérales, et des conservateurs dissidents formeraient un nouveau parti. Beaucoup de libéraux de l’Ouest, où la dépression se faisait le plus sentir, étaient convaincus que le parti devrait adopter des mesures plus radicales, mesures que les libéraux traditionalistes considéraient comme irresponsables.
La réponse de King traduisait son engagement fondamental à trouver un consensus parmi les Canadiens « d’esprit libéral ». Il n’espérait pas convertir les tories, qui, selon lui, étaient mariés à la grande entreprise, ni les socialistes, qui voulaient donner le pouvoir aux travailleurs. Il prenait néanmoins au sérieux les critiques de son propre caucus. Il pouvait parfois déplorer leur impatience, mais ne les mettrait pas de côté. Son rôle était de garder le parti uni. Dès 1933, il avait à regret conclu que les idées libérales traditionnelles ne suffisaient plus. Pour survivre, le parti devait faire face plus directement à la dépression et relever le défi. Son aptitude pour la conciliation serait, en cette matière, cruciale. Il inscrirait la baisse des tarifs au nouveau programme libéral, mais la question la plus controversée serait l’inflation. King et ses partisans les plus conservateurs assimilaient encore l’inflation à du vol, mais, pour les producteurs endettés surtout, elle semblait être le seul moyen de respecter leurs obligations financières. King arriva au compromis d’une « banque centrale » régie par l’État et capable d’agir sur la masse monétaire en fonction du « besoin public ». Il proposait une institution, pas une politique. Il réussit parce que les modérés voyaient dans cette banque un organisme susceptible de protéger la valeur de l’argent, et les radicaux, un organisme capable d’adopter des mesures pour endiguer l’inflation. On ne saurait minimiser l’importance de ce compromis. Il reconnaissait que l’État devait jouer un rôle concret dans l’établissement de la politique fiscale. Il supposait certainement une plus grande intervention que celle que pratiquait la Banque du Canada créée par Bennett en 1934 et conçue pour être un agent des banques à charte.
King était assez satisfait de ce nouveau programme qui plaçait le parti au centre de l’échiquier politique et l’ouvrait plus que le Parti conservateur à la réglementation des entreprises sans recourir à la panacée socialiste de l’étatisation. Fait également important pour lui, ce programme avait été approuvé en 1933 tant par les conservateurs que par les radicaux du caucus libéral. Certains, dont Charles Vincent Massey, voulaient orienter le libéralisme dans d’autres directions, et sans nécessairement garder King à la barre. Une fois l’unité du parti assurée, King attendit impatiemment le prochain scrutin. À la fin de la session de 1934, il reprocha à Bennett de s’accrocher au pouvoir sans avoir l’appui populaire et promit que s’il insistait pour convoquer une cinquième session de la Chambre, les libéraux feraient obstruction et l’obligeraient à déclencher des élections. En janvier 1935, la situation changea. Dans cinq discours à la radio, Bennett annonça son New Deal. « L’ordre ancien a disparu », déclara-t-il au grand étonnement des auditeurs. Bennett se prononçait en faveur d’une réforme radicale par l’intervention du gouvernement. À la prochaine session, promettait-il, il ferait adopter les lois appropriées. Il y avait dans ces discours plus de belles paroles que de substance et, contrairement à l’approche de King dans l’exercice de son leadership au sein du parti, Bennett n’avait pas consulté ses collègues. Confiant d’avoir l’autorité constitutionnelle nécessaire, le gouvernement fit néanmoins adopter la Loi sur le placement et les assurances sociales au début de 1935. Bennett avait certainement attiré l’attention des Canadiens qui, après cinq ans de dépression, voulaient croire qu’un leader politique pourrait mettre fin à la crise.
Rapidement, King revit sa stratégie. Il ne ferait pas obstruction quand la Chambre des communes serait convoquée. Il persuada son caucus que les discours du New Deal n’avaient rien à voir avec la réforme, mais marquaient en fait la première étape de la campagne électorale. Les libéraux ne devaient pas donner l’impression de s’opposer à la réforme. Il serait plus sage pour eux de se montrer coopératifs et d’encourager le gouvernement à présenter tout de suite les lois promises. Le gouvernement, embarrassé, n’avait rien préparé et, quand il finit par adopter des mesures, celles-ci étaient moins radicales que les discours radiodiffusés ne l’avaient laissé entendre. Le New Deal, cependant, entraînait une expansion du rôle fédéral dans la mise en marché des produits agricoles ainsi que dans la réglementation des entreprises et dans la supervision des conditions de travail. Sur le plan constitutionnel, il signifiait une intervention fédérale dans des champs supposés de compétence provinciale. King évita toute contestation directe. Il persuada le caucus que le parti devait exprimer ses réserves en matière constitutionnelle, puis voter en faveur des lois.
Cette nouvelle stratégie fonctionna. Elle garda les libéraux unis, au moins en public, et divisa profondément les conservateurs. À la fin de la session, le gouvernement ne pouvait plus prétendre être le parti de la réforme et, en juillet 1935, certains dissidents conservateurs s’étaient même alliés à Henry Herbert Stevens* pour créer une autre formation, le Parti de la reconstruction. Aux élections fédérales d’octobre, les libéraux reprirent le pouvoir avec 173 sièges – la plus forte majorité jamais enregistrée – et des députés dans chaque province, alors que les conservateurs ne parvinrent à faire élire que 40 députés. Le vote populaire témoignait cependant d’une tout autre réalité. Les libéraux n’avaient obtenu que 45 % des voix, soit à peu près le même pourcentage qu’aux élections précédentes. Le changement le plus spectaculaire était la baisse de popularité des conservateurs et l’appui de 20 % des électeurs aux nouveaux partis : la Fédération du Commonwealth coopératif et son socialisme, le Parti de la reconstruction et sa volonté de réglementer la grande entreprise, le Crédit social et sa panacée de l’inflation. S’il était vrai que les Canadiens avaient à choisir entre « King ou le chaos », ainsi que le clamait le slogan libéral, bon nombre d’entre eux se montraient prêts à risquer le chaos.
Les quatre années suivantes seraient difficiles pour le pays et elles mettraient à rude épreuve les talents politiques du premier ministre. La composition du cabinet témoignait de l’expérience et de la confiance de King. Celui-ci se réserva encore une fois les Affaires extérieures. Ernest Lapointe, toujours son plus proche collaborateur, retourna à la Justice. Charles Avery Dunning*, qui avait des idées conservatrices en matière financière, se laissa convaincre de devenir ministre des Finances et, parmi les nouveaux députés, King choisit Clarence Decatur Howe*, qui avait l’expérience des affaires, pour le nouveau portefeuille des Transports. Les membres du cabinet, disait-on, étaient compétents, et King leur donnerait beaucoup d’autonomie dans l’administration de leur ministère, mais plus que jamais, c’est lui qui menait la barque. Il établissait le programme du gouvernement et présidait les discussions du cabinet. Après une lente reprise économique, l’année 1937 marqua un nouveau recul, surtout dans les Prairies où l’été fut le plus sec jamais enregistré. La vraie relance tardait à venir, ce qui alimentait les griefs des régions. On recommença à s’en prendre au gouvernement. Aux divisions internes du Parti libéral, qui reflétaient les rivalités régionales, s’ajoutèrent une série de crises internationales menaçant d’engager le Canada dans une guerre en Europe.
Le nouveau gouvernement avait d’abord à décider de ses obligations internationales en tant que membre de la Société des nations. King avait appuyé l’adhésion du Canada – ce qui améliorait le statut du dominion en tant que nation et prouvait que le Canada favorisait le règlement pacifique des différends internationaux –, mais s’était montré peu intéressé par les débats au siège social de la société à Genève. La politique extérieure du Canada se limitait en général aux rapports avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, et King espérait traiter avec ces pays directement. Peu après les élections, toutefois, son gouvernement fut saisi d’une demande de la Société des nations, qui souhaitait imposer des sanctions économiques à l’Italie parce que celle-ci avait envahi l’Éthiopie. Le cabinet accepta d’appliquer des sanctions, mais King comprit vite que si la Société des nations demandait ensuite l’intervention militaire, cette demande diviserait profondément le cabinet et les Canadiens. Cependant, la Société des nations ne demanda pas de sanctions militaires parce que la Grande-Bretagne et la France voulaient éviter tout affrontement avec le leader fasciste de l’Italie, Benito Mussolini. King avait néanmoins appris une importante leçon : l’appartenance à la Société des nations pouvait avoir de sérieuses conséquences politiques pour le Canada. Il prit des mesures pour réduire les risques. Bien qu’il ait affirmé, aux Communes et plus tard à Genève, son appui à la société en tant qu’institution nécessaire à la résolution des conflits, il rejetait carrément l’idée que celle-ci puisse constituer une alliance militaire contre des agresseurs. Le Canada, déclara-t-il à l’assemblée de la Société des nations en 1936, n’était pas en faveur de « l’engagement automatique à utiliser la force ». Les éditorialistes de la plupart des journaux canadiens applaudirent. La foi politique de King dans la non-intervention et sa peur de diviser le pays s’exprimèrent aussi dans sa décision de tenir le Canada à l’écart de la guerre civile d’Espagne en 1937 et dans son refus de modifier les règlements sur l’immigration pour admettre les réfugiés juifs d’Europe.
King accordait priorité aux problèmes économiques du Canada plutôt qu’aux relations internationales, mais il n’avait pas de solution simple aux problèmes complexes de la grande crise. Après avoir été prêt à envisager un élargissement du rôle de l’État pour préserver l’unité du parti, il hésitait toujours à prendre de nouvelles initiatives. La lune de miel entre son gouvernement et la population fut donc de courte durée. Pendant la campagne électorale, King n’avait fait qu’une seule promesse précise : négocier un traité commercial avec les États-Unis. Bennett avait déjà amorcé les discussions, mais des intérêts politiques des deux côtés de la frontière avaient retardé le processus. En novembre 1935, soit deux semaines après son entrée en fonction, King se rendit à Washington pour conclure le meilleur accord possible. Il eut la sagesse de se gagner l’appui de Cordell Hull, secrétaire d’État américain et grand défenseur de l’expansion du commerce international. Restait cependant à convaincre le président Franklin Delano Roosevelt. Les deux chefs d’État ne trouvèrent pas de difficulté à discuter de leurs problèmes politiques. Roosevelt savait mettre ses invités à l’aise, et King connaissait bien la politique des États-Unis et les hommes politiques américains. Sur les détails du commerce, King s’était soigneusement préparé et il rentra au Canada avec un traité en poche – traité modeste, soit, mais qui donnait aux produits agricoles canadiens un accès non négligeable au marché américain.
La conférence avec les premiers ministres des provinces, tenue en décembre 1935 peu après les élections, encouragea également King. Ce dernier était confiant que son style de gouvernement ferait une différence, que son insistance sur la consultation faciliterait la bonne entente. Les provinces, qui faisaient face à une diminution de leurs recettes et à une augmentation de leurs coûts sociaux, avaient besoin de subventions et de prêts fédéraux pour réduire leur déficit. Le gouvernement national, lui-même aux prises avec un déficit, espérait limiter les demandes des provinces en éliminant les extravagances ou le versement en double des prestations d’aide sociale. À la conférence, King contenta les premiers ministres en augmentant les subventions fédérales jusqu’au printemps de 1936, mais il ne réussit pas à les intéresser à la création d’une commission fédérale chargée de superviser les prestations d’aide sociale, ni à la possibilité de modifications constitutionnelles touchant la compétence provinciale en matière de politique sociale. Il avait déjà soumis la Loi sur le placement et les assurances sociales de Bennett aux tribunaux qui, après avoir jugé qu’elle empiétait sur les pouvoirs des provinces, l’invalideraient. À ce stade, King avait pour objectif un système fédéral où chaque ordre de gouvernement pourrait payer pour ses programmes à même ses propres revenus d’impôt. Il ne pouvait préciser davantage parce qu’il n’avait aucune mesure concrète en tête et supposait que toute nouvelle répartition des pouvoirs ressortirait des discussions avec les provinces.
King vit bientôt que l’affrontement était inévitable parce que, sans augmentation de l’aide fédérale, certaines provinces seraient acculées à la faillite. William Aberhart, premier ministre de l’Alberta depuis août 1935 et chef du Crédit social, était un populiste peu soucieux des conventions. En 1936, il ne pouvait refinancer une émission d’obligations provinciales venant à échéance si le fédéral ne garantissait pas le versement des intérêts. Quand Dunning suggéra en retour une certaine supervision fédérale sur les finances provinciales, Aberhart refusa et reporta l’échéance des obligations tout en coupant les taux d’intérêt de moitié. Puis, en 1937, sous la pression de ses députés d’arrière-ban, il fit adopter une loi contraignant les banques à charte à prêter de l’argent aux Albertains. Aux journaux qui critiquaient cette mesure, Aberhart répliqua par un projet de loi leur imposant de publier les communiqués de presse dans lesquels le gouvernement donnait sa version des faits. King annula la loi d’Aberhart sur les banques à charte et renvoya le projet de loi sur les journaux à la Cour suprême du Canada, qui le déclara inconstitutionnel.
King pouvait affirmer que, en prenant la défense des banques et des journaux, il défendait les droits civils en Alberta, mais il y alla moins franchement au Québec. En 1937, Maurice Le Noblet Duplessis*, chef de l’Union nationale et premier ministre, fit adopter la Loi protégeant la province contre la propagande communiste, communément appelée loi du cadenas ; cette loi avait pour but d’intimider les chefs syndicaux et « agitateurs » en les menaçant de fermer leurs bureaux à cause d’activités prétendument communistes. Le gouvernement King, qui avait déjà abrogé la partie du Code criminel interdisant les associations illégales, envisagea de faire annuler cette loi, mais Ernest Lapointe estimait qu’un tel geste serait politiquement désastreux pour le Parti libéral au Québec. King et ses collègues canadiens-anglais ne mirent pas en doute le jugement politique de Lapointe, de sorte que King écrirait dans son journal en juillet 1938 : « nous étions prêts à accepter ce que, au nom du libéralisme, nous ne devrions jamais tolérer un seul instant ».
Aberhart et Duplessis faisaient peut-être fi des droits civils, mais le désaccord entre le fédéral et les provinces avait des racines plus profondes. Sans subventions ni prêts d’Ottawa, les provinces, qui dépendaient des revenus des impôts directs, ne pouvaient même pas fournir les services sociaux essentiels. Thomas Dufferin Pattullo*, premier ministre libéral de la Colombie-Britannique, pour qui le libéralisme signifiait aussi fournir du travail et des salaires, engagea son gouvernement dans des projets de construction pour lesquels il n’avait pas d’argent. Quand King refusa de verser des fonds pour un pont sur le fleuve Fraser, Pattullo se mit en colère. Le premier ministre libéral de l’Ontario, Mitchell Frederick Hepburn*, était lui aussi mécontent, mais pour d’autres raisons. Il s’opposait aux subventions fédérales destinées à financer les secours dans les provinces de l’Ouest parce que le gros de cet argent provenait des contribuables de l’Ontario. En 1937, il annonça qu’il n’était plus un « libéral de Mackenzie King ». D’autres premiers ministres affichaient peut-être moins ouvertement leur irritation, mais tous faisaient face à des demandes qu’il n’avaient pas les moyens de satisfaire. Il fallait donc qu’Ottawa coordonne l’aide sociale. En son for intérieur, King s’indignait du régionalisme étroit de Hepburn et de Duplessis ; il conclut néanmoins dans son journal en décembre 1937 : « mieux vaut savoir qui sont réellement ces dictateurs en herbe. La population comprendra vite qui protège ses intérêts et sa liberté [...] Nous gagnerons dans une clameur de « Canada uni ».
» King n’était pas encore prêt à risquer des changements constitutionnels qui pourraient ajouter des obligations financières au fédéral. Il s’attacha plutôt à défendre la stabilité fiscale de son gouvernement, convaincu qu’une administration plus efficace des secours par les provinces réduirait les coûts. Il demeura sceptique quand la Commission nationale de placement, créée en 1936, recommanda qu’on modifie la constitution pour transférer au fédéral la responsabilité de l’aide sociale. Voulant retarder toute décision, King forma, l’année suivante, la commission royale des relations entre le dominion et les provinces, appelée commission Rowell-Sirois, du nom de ses deux présidents. Sa conception du libéralisme, qui associait encore le dirigisme de l’État à la coercition socialiste, était renforcée par son souci d’équilibrer le budget.
Le premier ministre acceptait un certain élargissement du rôle économique de l’État quand la prudence lui dictait de tenir compte des pressions politiques. King s’était opposé à la création de la Commission canadienne du blé par Bennett en 1935, mais il avait accepté cette commission tant qu’elle écoulait le blé qu’elle avait acheté pour soutenir les prix. Dès 1938, cependant, la commission avait vendu son avoir et King proposa un retour au marché libre. Les fermiers de l’Ouest étaient révoltés. Exigeant que la commission leur garantisse un prix minimum et que toute perte encourue soit absorbée par le fédéral, ils organisèrent une campagne publique qui fut remarquée. King et le ministre de l’Agriculture James Garfield Gardiner* acceptèrent à contrecœur de prolonger le mandat de la commission et de garantir un prix minimum aux fermiers.
King accepta à contrecœur aussi une autre augmentation importante des dépenses fédérales. Dunning et lui avaient préparé un budget équilibré pour 1938, certains que l’électorat récompenserait un gouvernement financièrement responsable, mais à la surprise de King, quelques-uns de leurs collègues demeuraient sceptiques. Ils voulaient stimuler l’économie en créant des emplois. Ils trouvèrent appui dans la théorie de l’influent économiste britannique John Maynard Keynes selon laquelle, en cas de ralentissement des investissements privés, les gouvernements pouvaient augmenter le nombre d’emplois en accroissant leurs dépenses. Pour King, cependant, les arguments politiques avaient plus de poids que les arguments économiques. Afin de calmer ses collègues, il accepta de prévoir un déficit pour 1938 et un autre pour 1939. Ce financement anticyclique, qu’il acceptait avec réticence, fut pour lui un pas important vers l’utilisation du budget pour façonner la politique fiscale plutôt que pour solder les comptes.
Pour King, abaisser les barrières tarifaires semblait encore être un moyen plus sûr de relancer l’économie. La chance lui sourit quand Cordell Hull lui demanda de profiter de la Conférence impériale de 1937 pour encourager le premier ministre britannique Arthur Neville Chamberlain à négocier un accord commercial avec les États-Unis. King répondit avec enthousiasme, car il était convaincu qu’un tel accord renforcerait l’économie des plus proches alliés du Canada et amélioreraient leurs relations. Mais il savait aussi que le Canada devrait prendre part à toute négociation parce que la Grande-Bretagne ne pouvait pas réduire ses tarifs sur certains produits américains comme les pommes ou le bois d’œuvre sans que le Canada renonce à certains avantages garantis par les accords d’Ottawa en 1932. Dès le début des pourparlers, King insista sur une compensation pour les Canadiens. Il négocia serré. En 1938, après de longues négociations trilatérales, on signa un traité qui procurait des bénéfices tangibles à chaque région du Canada. Hull et Chamberlain apprirent tous deux à se méfier de l’altruisme de King.
Si frustrante qu’elle ait été, la situation économique était alors éclipsée par la menace d’une guerre en Europe. En bon libéral, King privilégiait encore le règlement des conflits internationaux par la négociation et, comme tant d’autres, il était hostile aux « marchands de mort » qui s’enrichissaient par le commerce des armes. Après avoir essayé de limiter les dépenses militaires, il avait décidé dès 1937 que son gouvernement ne fermerait plus les yeux sur son obligation de défendre le Canada « dans un monde en folie ». Même si la marine royale britannique et la doctrine de Monroe aux États-Unis pouvaient laisser croire que le dominion n’était pas la cible d’une attaque imminente, le Canada, étant autonome, devait s’occuper en partie de sa propre défense. La plupart des Canadiens reconnaîtraient qu’il était de leur devoir de protéger les côtes de leur pays, mais que dire à ceux qui soutenaient que la Grande-Bretagne constituait la première ligne de défense de ce pays ? Bien des Canadiens, dont King, acceptaient cette thèse mais à beaucoup de Canadiens français, celle-ci rappelait les mesures imposées par la majorité pendant la Grande Guerre. King décida de presque doubler le budget de la défense en 1937. Certains libéraux s’y opposaient fortement, mais devant l’insistance avec laquelle il affirmait que l’argent supplémentaire serait affecté à la marine et à l’aviation pour la garde des côtes, et non pour un corps expéditionnaire en Europe, ils cédèrent. King ne mentait pas ; il tenait simplement à n’exclure aucune possibilité. Il fallait bien sûr assurer la défense des côtes, mais King savait que le renforcement de la marine et de l’aviation serait utile aussi dans un conflit en Europe. En 1939, la guerre devenant de plus en plus probable, il passa outre encore une fois à l’opposition dans son parti pour doubler le budget de la défense. Le Canada n’était pas encore prêt pour la guerre en septembre, mais King avait été plus prévoyant que la plupart de ses collègues.
À ce moment-là, King avait déjà conclu à regret que le Canada ne pourrait pas se tenir à l’écart d’une crise en Europe. La Société des nations ne s’était jamais remise de la crise en Éthiopie, de sorte qu’en être membre ne menaçait plus d’engager le Canada dans la guerre. Être membre du Commonwealth comportait toutefois des risques qu’il n’était pas si facile de contrer. King vit le danger : celui d’une nouvelle division dans le pays et dans le Parti libéral. Sa première réaction fut de persuader le gouvernement britannique d’éviter les alliances compromettantes. L’Allemagne déclencherait peut-être une guerre, mais si la Grande-Bretagne n’y était pas entraînée, le Canada n’y participerait pas. À la Conférence impériale de 1937, King encouragea donc les Britanniques à éviter l’affrontement et à régler leurs différends avec l’Allemagne par des négociations pacifiques. Cette politique de conciliation, que l’on dénoncerait plus tard comme une soumission à l’agresseur, était considérée à l’époque comme une réponse légitime à des griefs légitimes. King lui-même rendit visite à Adolf Hitler après la conférence. Il prévint le führer que le Canada se rangerait aux côtés de la Grande-Bretagne si celle-ci était entraînée dans la guerre. Mais King demeurait optimiste. Hitler, confia-t-il à Chamberlain, avait l’air d’un homme raisonnable.
En 1938, cependant, King dut se rendre à l’évidence : la Grande-Bretagne ne pourrait pas rester à l’écart du conflit. L’événement crucial pour lui fut la signature des accords de Munich à la fin de septembre, qui cédaient une partie du territoire de la Tchécoslovaquie à l’Allemagne et que Chamberlain avait aidé à négocier. Si ces négociations avaient échoué et que la guerre s’était ensuivie, King et la plus grande partie de son gouvernement se seraient rangés aux côtés de la Grande-Bretagne, quoique certains députés auraient démissionné. Soulagé que l’accord mette fin à la crise, King reconnut néanmoins que la guerre demeurait probable et que la Grande-Bretagne y participerait. Il était certain que la plupart des Canadiens voudraient, et devraient, s’y engager aussi. Le problème politique était, selon lui, de faire accepter cette décision sans créer de sérieuses divisions. Le 20 mars 1939 aux Communes, King expliqua sa position. Son gouvernement n’avait pris aucun engagement. Si la guerre éclatait, le Parlement déciderait de la réaction appropriée, en fonction des intérêts canadiens. Voilà qui rassurait ceux qui soupçonnaient la néfaste influence de Londres. Mais King ne s’arrêta pas là. « Si jamais un agresseur lançait une attaque contre la Grande-Bretagne, déclara-t-il, et que des bombardiers faisaient pleuvoir la mort sur Londres, je n’ai aucun doute quant à la décision du peuple et du Parlement canadiens. Nous considérerions cela comme un acte d’agression menaçant la liberté dans toutes les parties du British Commonwealth. » Dix jours plus tard, il revint sur la question de la participation canadienne pour répéter qu’en aucun cas son gouvernement n’imposerait la conscription pour le service outre-mer. Le Canada français acquiesça. Il convainquit beaucoup d’autres Canadiens aussi, mais cette position rendait les préparatifs de guerre difficiles. En 1936, par exemple, la Grande-Bretagne avait proposé une association pour la fabrication de mitrailleuses Bren au Canada. King avait tergiversé parce que s’il s’engageait à fournir ces armes et que la Grande-Bretagne entrait en guerre, le Canada serait considéré comme un belligérant. Il avait toutefois fini par céder aux pressions britanniques et les contrats avaient été signés en 1938. Les Britanniques avaient également proposé de former des pilotes au Canada, ce qui était encore plus controversé. King avait rejeté ce projet en 1936 et en 1938, puis insisté pour que le Canada soit responsable de la formation, de sorte que, au moment de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne et de la déclaration de guerre, aucune décision n’était encore prise. Le Canada ne pourrait faire de planification efficace avec ses alliés du Commonwealth s’il ne prenait aucun engagement à l’avance.
Cette stratégie empêchait également le Canada d’intervenir dans la politique extérieure britannique. Bien qu’ébranlé en mars 1939 quand Chamberlain, allant à l’encontre des accords de Munich, promit de défendre les frontières de la Pologne, King n’exprima aucune objection. La Grande-Bretagne ne le consulta pas non plus avant de déclarer la guerre le 3 septembre quoique, cette fois-là au moins, elle avait l’appui de King et de son gouvernement. La déclaration de guerre du Canada fut elle-même retardée parce que King dut convoquer le Parlement et, comme promis, le laisser en décider. La Chambre des communes, en majorité libérale, se réunit pour une session d’urgence le 7 septembre et la décision qui paraissait si controversée un an plus tôt fut adoptée le 9 presque à l’unanimité. King réitéra l’engagement pris devant le Parlement en mars de ne pas imposer la conscription pour le service outre-mer. Sa stratégie comportait des inconvénients, mais elle permit néanmoins que le Canada entre en guerre sans être irrémédiablement divisé.
À 65 ans ou presque, King sentait sur lui le poids des ans. Les tensions de la grande crise et de la situation internationale l’avaient épuisé. La politique n’était plus qu’un interminable effort pour éviter les désastres ; King envisageait, écrit-il dans son journal, de prendre sa retraite après avoir remporté une élection de plus. Puis la guerre vint, qui lui redonna le sens de sa mission. Désormais, être chef signifiait davantage que conserver le pouvoir. Durant les cinq prochaines années, King devrait prendre des décisions politiques plus exigeantes et à bien des égards plus cruciales qu’auparavant, mais il cessa de parler de retraite. Il était parfois exténué ou déçu, mais il ne mit plus jamais en question l’importance de sa tâche. Et il n’avait rien perdu de son opportunisme politique. En 1940, quand Hepburn et le chef conservateur George Alexander Drew* s’allièrent, à l’Assemblée législative de l’Ontario, pour condamner l’effort de guerre d’Ottawa, il saisit l’occasion pour déclencher des élections avant toute offensive du printemps en Europe et renouvela ainsi la majorité libérale aux Communes pour cinq ans.
Le Canada dirigé par King jouerait un rôle considérable dans la Seconde Guerre mondiale. Les premiers convois de la Marine royale du Canada partirent dès septembre 1939, suivis en décembre par la 1re division canadienne de l’armée. Isolée après la chute de la France en juin 1940, la Grande-Bretagne dépendrait de la puissance industrielle et militaire de l’Amérique du Nord pour sa survie. Aux jours les plus sombres, le Canada lui fournit une bonne part de ses troupes et de ses vivres. Les États-Unis lui procureraient du matériel selon une entente de prêt-bail en 1941, avant d’entrer eux-mêmes en guerre, mais le Canada, compte tenu de sa taille, contribua davantage que son voisin américain. La production industrielle augmenta rapidement et les généreuses modalités de paiement consenties par le gouvernement permirent à la Grande-Bretagne d’acheter de la nourriture et des munitions canadiennes. L’effort de guerre fut à tous égards remarquable.
Il ne faudrait cependant pas exagérer le rôle de King. Depuis le début de la dépression, le Canada avait des terres, des ressources et des travailleurs sous-utilisés qu’il pouvait maintenant affecter à la restructuration de son économie. Il avait aussi l’avantage d’être proche de l’Europe et en même temps assez loin pour ne pas être menacé d’invasion. Ses liens économiques et culturels étroits avec la Grande-Bretagne auraient probablement fait de lui un précieux allié, quel qu’ait été son premier ministre. Les talents et l’expérience politiques de King lui conféraient néanmoins une influence qui, directement ou indirectement, façonnerait les décisions de son gouvernement en temps de guerre. Il n’y avait rien de spectaculaire dans la manière de gouverner de King. Ce dernier n’avait ni le sens de la formule de Churchill pour rallier les Canadiens, ni les talents de conteur de Roosevelt pour les intéresser aux problèmes de l’heure. En mettant l’accent sur la défense côtière, le Canada ne s’engagea d’abord qu’à une participation mitigée. Il se sentait encore géographiquement loin de l’Europe, et les divisions régionales et culturelles demeuraient, chez lui, profondes. La sensibilité politique de King, aiguisée par des décennies d’expérience, et ses talents de conciliateur convenaient cependant bien à ce Canada en guerre.
À titre de ministre des Affaires extérieures, King avait la responsabilité de maintenir le délicat équilibre entre l’autonomie du Canada et son engagement en tant qu’allié de la Grande-Bretagne. Une fois la guerre commencée, par exemple, le Canada devenait un choix logique pour la formation des équipages d’avion ; c’était un endroit sûr, qui avait une tradition aéronautique et de l’espace pour les aérodromes, et où il était possible de tirer profit des ressources industrielles et techniques nord-américaines. Mais comment bâtir et financer un programme d’entraînement pour le Commonwealth ? De nouveau, King insista pour que l’entraînement soit dirigé par les Canadiens, et le gouvernement britannique fut obligé de céder, quoique les normes et l’orientation générale furent dictées par la Royal Air Force. La Grande-Bretagne à court de dollars, le Canada finit par prendre à sa charge le gros des coûts. Le Programme d’entraînement aérien du Commonwealth, créé en vertu d’une entente signée le 17 décembre 1939 d’abord par le Canada, la Grande-Bretagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, fut un succès incontesté. La plupart des membres d’équipages d’avions du Commonwealth apprirent leur métier au Canada, ce qui constitua l’une des contributions les plus notoires du pays.
Les relations entre le Canada et les États-Unis ne suivaient plus leur cours normal, en particulier parce que ces derniers ne furent pas en guerre avant l’attaque japonaise contre Pearl Harbor en décembre 1941. Grâce à la bonne entente entre King et Roosevelt, cependant, les deux pays purent contourner certains des obstacles diplomatiques imposés par la neutralité. Ainsi, au début de septembre 1939, le Canada fut autorisé à acheter des avions américains parce que King avait assuré Roosevelt, par téléphone, que le pays n’était pas techniquement en guerre tant que le Parlement n’avait pas approuvé de déclaration officielle. Après la chute de la France en 1940, Roosevelt lança à King une invitation qui mena à la signature de l’accord d’Ogdensburg sur la formation d’un conseil mixte chargé d’étudier la défense du continent nord-américain. Les accords de Hyde Park conclus en avril 1941 résultèrent d’un appel téléphonique de King. Le Canada, expliqua le premier ministre, était en sérieuse difficulté financière parce que, faisant crédit à la Grande-Bretagne, il n’avait pas d’argent pour payer les importations américaines dont les manufacturiers canadiens avaient besoin. Roosevelt accepta d’atténuer la crise en englobant dans le prêt-bail les achats de matériel pouvant être considéré comme des composantes des munitions produites au Canada.
À quelques reprises pendant les deux premières années de la guerre, King agit en tant qu’intermédiaire entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Roosevelt, inquiet de ce qu’il adviendrait de la marine royale si la Grande-Bretagne était conquise, demanda à King d’exhorter le premier ministre britannique Churchill à annoncer que la marine chercherait alors refuge en Amérique du Nord. King fut embarrassé par cette demande, mais il accepta. Churchill, pour sa part, s’adressa de temps à autre à King pour qu’il se serve de son influence auprès de Roosevelt afin d’augmenter l’aide américaine à la Grande-Bretagne assiégée. Après l’attaque de Pearl Harbor, Churchill et Roosevelt purent se passer d’intermédiaire, et King se trouva exclu de la plupart des discussions sur la planification stratégique. Même aux conférences de Québec en août 1943 et septembre 1944, King, qui recevait pourtant les deux chefs d’État, admit qu’on ne s’attendait pas qu’il participe à leurs discussions.
Les contacts personnels de King avec Churchill et Roosevelt conservèrent néanmoins une certaine importance. Les Britanniques et les Américains étaient enclins à prendre des décisions et à compter que leurs alliés moins puissants les acceptent. C’était donc des conseils anglo-américains qui faisaient une grande partie de la planification pour la production et la distribution du matériel de guerre. Le gouvernement canadien demandait régulièrement d’être représenté aux conseils qui répartissaient le matériel produit au Canada. Les demandes de représentation à la Commission mixte des vivres, par exemple, n’étaient pas considérées. Finalement, King s’adressa personnellement à Churchill et à Roosevelt, et le Canada obtint d’y participer. Ce fut le seul conseil où il obtint un siège.
Le leadership du premier ministre dans les affaires intérieures pendant la guerre est plus difficile à évaluer parce que, même s’il mettait parfois en question les décisions de ses ministres, King les renversait rarement. Tout dépendait donc plus ou moins de ses relations avec le cabinet. À la fin des années 1930, il savait que certains de ses ministres étaient faibles ou songeaient à la retraite, mais il avait hésité à les remplacer jusqu’à ce que la guerre l’incite à renforcer son gouvernement. Il invita James Layton Ralston, libéral bien en vue de la Nouvelle-Écosse, à revenir à la politique, d’abord comme ministre des Finances (pour remplacer Dunning), puis comme ministre de la Défense nationale, où sa présence et son souci pour les simples soldats – souci qui datait de la Grande Guerre – rassureraient les troupes canadiennes. Comme successeur de Ralston aux Finances, il choisit James Lorimer Ilsley*, qui faisait parfois preuve d’entêtement avec ses collègues, mais veilla avec intégrité et détermination au contrôle des dépenses et aux finances du Canada pendant la guerre. Quittant le ministère des Transports en 1940, Howe devint le grand responsable des Munitions et Approvisionnements ; ses contacts avec les hommes d’affaires canadiens et son recours énergique à des incitations fiscales et à des investissements publics provoquèrent un spectaculaire accroissement de la production. Après la mort d’Ernest Lapointe en 1941, King persuada l’éminent avocat de Québec, Louis-Stephen St-Laurent*, d’accepter le portefeuille de la Justice et de devenir son nouveau lieutenant québécois. St-Laurent, qui n’avait pas d’expérience politique mais faisait preuve de beaucoup de jugement et d’une grande affabilité envers ses collègues même quand il n’était pas d’accord avec eux, devint rapidement le ministre le plus influent du gouvernement et le plus proche associé de King. Tous les ministres s’habituèrent, sous la direction de King, à discuter ouvertement des problèmes et à prendre les décisions en collégialité. Le cabinet de guerre se tailla une réputation de compétence et d’efficacité.
Premiers entre ses égaux, King faisait plus que choisir ses collègues et présider leurs discussions. Il cherchait constamment des mesures ou des demi-mesures acceptables par tous. De temps à autre, en cas de désaccord avec eux, il cédait ; plus rarement, il opposait un implicite veto. Ses interventions en matière financière en témoignent. Le gouvernement et ses conseillers financiers s’étaient entendus dès le départ pour éviter le genre d’inflation que le pays avait connu après la Première Guerre mondiale, et payer le plus possible les coûts de la Seconde à même les recettes fiscales. Pour ce faire, le gouvernement fédéral envisageait de s’approprier les champs de l’impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises, qui étaient du ressort des provinces, et de hausser abruptement les taux. Une conférence en 1941 indiqua que les premiers ministres des provinces n’accepteraient pas une telle modification constitutionnelle. Ilsley proposa alors de prévenir les premiers ministres provinciaux que le fédéral invoquerait la Loi sur les mesures de guerre pour s’approprier ces sources d’imposition et offrirait une compensation. Cette attitude autoritaire rendait King mal à l’aise, mais il admit que le gouvernement n’avait pas le choix. Les hausses d’impôt entreraient en vigueur, mais l’inflation constituait encore une menace, de sorte qu’Ilsley proposa ensuite des contrôles des salaires et des prix. Là encore, King avait des réserves quant à une mesure aussi radicale, mais il accepta. Plus tard cependant, quand les mineurs, affirmant que leurs salaires avaient été gelés à un niveau injuste, exigèrent une augmentation malgré les contrôles, King intervint. Ilsley objecta qu’une concession encouragerait d’autres groupes à demander la même chose, mais King affirma que le programme ne tiendrait pas s’il était trop rigide, et c’est Ilsley qui finit par céder. King intervint également quand Howe demanda une loi antigrève pour garder les ouvriers de l’acier au travail, à fabriquer des munitions. King, reconnaissant qu’à la longue des mesures arbitraires iraient à l’encontre du but recherché, insista sur le droit à la négociation collective. Ces interventions étaient exceptionnelles et portaient sur les relations du travail, domaine où le premier ministre se considérait comme un expert, mais elles montrent bien que c’est King qui tenait les rênes du gouvernement.
La question de la conscription mettrait l’autorité de King à très rude épreuve. Le premier ministre était déterminé à ce que la scission qu’elle avait provoquée en 1917 dans son parti et dans le pays ne se reproduise plus jamais. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il avait promis que seules les recrues volontaires seraient envoyées outre-mer. Les autres chefs de parti avaient appuyé cette politique pendant la campagne électorale de mars 1940, mais la chute de la France quelque mois plus tard faisait maintenant craindre pour la survie de la Grande-Bretagne. Des conservateurs influents exigèrent alors la conscription, soutenant avec quelque succès qu’elle serait plus juste et plus efficace que l’enrôlement volontaire. Toutefois, peu de Canadiens français étaient impressionnés par un tel raisonnement. King mit fin à la controverse, pour un temps, en faisant adopter la Loi sur la mobilisation des ressources nationales, qui imposait la conscription seulement pour la défense du territoire canadien. Cette loi calma les deux camps. King augmenta aussi l’effectif du contingent canadien outre-mer, mais seulement après que ses conseillers militaires lui eurent assuré qu’il y aurait suffisamment de volontaires pour ce contingent.
La crise suivante eut lieu en 1942. Les défaites des Alliés en Europe et dans le Pacifique, y compris la cruelle perte de deux bataillons canadiens au moment de la chute de Hong Kong, avaient convaincu bien des Canadiens qu’un engagement militaire complet exigeait le service obligatoire outre-mer. Comme on pouvait s’y attendre, la plupart des Canadiens français estimaient que King manquerait à sa parole s’il imposait la conscription. Le premier ministre trouva alors un compromis qui permettait de sauver la face. En janvier, il annonça la tenue d’un référendum national pour délier le gouvernement de sa promesse. Les résultats du plébiscite du 27 avril étaient inquiétants. À cause du solide appui du Canada anglais, la majorité des Canadiens se prononçait en faveur de l’enrôlement obligatoire, mais au Québec, plus de 70 % des citoyens s’y opposaient. En ce domaine, le Canada était un pays de deux cultures distinctes. Malgré tout, King fit rapidement abroger, par le projet de loi 80, la partie de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales qui limitait la conscription à la défense du territoire canadien. Le 10 juin, il expliqua comme suit sa politique aux Communes : « pas nécessairement la conscription, mais la conscription si nécessaire ». Le projet de loi fut adopté en troisième lecture en juillet.
Le référendum donna à réfléchir aux responsables politiques et l’on parla peu de conscription jusqu’à ce que le Canada subisse de lourdes pertes à la suite de l’invasion de la Normandie, en France, en 1944. Le ministre de la Défense Ralston conclut alors que seule la conscription permettrait d’envoyer les renforts nécessaires. King, ne croyant pas la conscription indispensable pour gagner la guerre, essaya désespérément de trouver un compromis. Ralston ne démordit pas et brusquement, en novembre, King décida de le remplacer par Andrew George Latta McNaughton*, général à la retraite qui, croyait-il, réussirait à attirer suffisamment de volontaires. C’est seulement après que McNaughton eut admis son échec quelques semaines plus tard que King, avec l’appui de St-Laurent, décida d’envoyer outre-mer une partie des hommes conscrits pour défendre le territoire canadien. Un décret du conseil le 23 novembre autorisait le transfert de 16 000 hommes enrôlés en vertu de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales, mais en fin de compte, seulement 2 463 seraient affectés à la 1re armée canadienne. Les délibérations au cabinet sur la conscription avaient été extrêmement pénibles pour King, d’autant plus que, le 21, certains ministres avaient menacé de démissionner. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal : « J’ai dit à St-Laurent [...] combien il a été difficile pour moi, seul à la maison Laurier, sans personne à qui parler, d’affronter pendant si longtemps le genre de situation à laquelle je dois aujourd’hui faire face. Il m’a beaucoup aidé. » Étonnamment, la plupart des Canadiens français acceptèrent en 1944 ce à quoi ils s’étaient farouchement opposés deux ans auparavant. Que s’était-il passé ? Il faut reconnaître que King y était pour beaucoup dans ce changement d’attitude. On voyait bien qu’il s’était opposé à la conscription tant qu’il avait pu. Maintenant, il était plus facile de croire que la conscription pour le service outre-mer était au moins politiquement nécessaire. King avait gagné la confiance de St-Laurent et de la plupart de ses collègues canadiens-français, et cet appui aidait à rassurer la population au Québec. Malgré leur peu d’enthousiasme, la plupart des Canadiens français concédaient au moins que King s’était montré plus sensible à leur point de vue que les chefs des autres partis fédéraux. La lutte avait été serrée, mais King avait réussi à garder le parti et le pays unis.
La fin de la guerre en Europe en mai 1945, et dans le Pacifique au mois d’août suivant, apporta son lot de nouveaux problèmes. King et son gouvernement avaient déjà commencé les préparatifs de l’après-guerre. Une planification était nécessaire, parce que la fermeture des usines de munitions et le retour de près de un million de militaires à la vie civile perturberaient bien des choses, et que le souvenir de la grande crise était encore vif. Les Canadiens reconnaissaient que le gouvernement avait bien administré le pays durant la guerre, et beaucoup d’entre eux espéraient maintenant qu’il assure la sécurité économique pendant la transition vers une économie en situation de paix.
En réponse à cette attente, King accéléra le virage à gauche. Après en avoir appelé aux tribunaux en 1935, le gouvernement avait changé d’avis en 1940 et, avec l’approbation des provinces, institué l’assurance-chômage, mesure à laquelle Ralston s’était vigoureusement opposé à cause de son coût en temps de guerre. En 1945, les conseillers financiers du gouvernement, convertis au keynésianisme, préconisaient une augmentation des dépenses publiques pour créer des emplois et recommandaient les allocations familiales et d’autres mesures sociales pour encourager la consommation. King avait des appréhensions au sujet de l’élargissement du rôle de l’État – il s’inquiétait toujours des déficits gouvernementaux –, mais il était certain que ces mesures étaient en accord avec son souci d’aider les moins fortunés. Il était aussi motivé par des raisons partisanes, quoique, en homme convaincu de ses bonnes intentions, il ne l’aurait jamais admis. Il fallait aussi tenir compte des pressions exercées sur le Parti libéral l’incitant à faire concurrence à la Fédération du Commonwealth coopératif en vue d’obtenir la faveur de l’électorat. Le premier ministre pouvait s’inquiéter de ce qu’un gouvernement interventionniste empiète sur les libertés individuelles, mais un gouvernement libéral était certainement moins maléfique qu’un gouvernement socialiste coercitif. King instaura les allocations familiales et, avant les élections de juin 1945, fit campagne pour un vaste programme de sécurité sociale. Son gouvernement était handicapé par les conséquences de la conscription qui, pour différentes raisons, avait été impopulaire dans beaucoup de régions du pays. Le programme social, toutefois, suffit pour faire légèrement pencher la balance électorale en faveur des libéraux. Défait dans Prince Albert, King devint député de Glengarry, en Ontario, à une élection partielle en août.
King ne s’adapta pas facilement au monde de l’après-guerre. Il avait assisté à la conférence de fondation de l’Organisation des Nations unies, tenue à San Francisco d’avril à juin 1945, mais n’y avait joué qu’un rôle mineur. Réaliste, il concédait que l’institution serait dominée par les grandes puissances, mais il préconisait l’application du « principe fonctionnel » qui donnerait aux moyennes puissances comme le Canada voix au chapitre en fonction de leur contribution au règlement des différends. Plus tard la même année, quand Igor Sergeievich Gouzenko, chiffreur à l’ambassade de l’Union soviétique à Ottawa, révéla l’existence d’un réseau d’espionnage soviétique au Canada, King dut faire face plus directement à la réalité d’un monde divisé. King était trop réaliste pour croire que son pays pourrait s’abstraire de la guerre froide, mais il continuait d’être mal à l’aise quand on demandait au Canada de participer à la défense de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest. Il se méfiait aussi des engagements internationaux préconisés par les diplomates canadiens ; le jeu des alliances restreindrait l’autonomie du Canada. Même le rapprochement avec les États-Unis l’inquiétait, car il craignait que le pays ne tombe dans l’orbite d’un nouvel empire. Se sentant dépassé par les Affaires extérieures, en septembre 1946, il en confia le portefeuille à St Laurent.
King n’était plus à l’aise en politique intérieure. Il admettait la nécessité de planifier les recettes fiscales et, par conséquent, la nécessité pour le fédéral de conserver les champs de l’impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises. Il craignait toutefois que ce système ne mène les gouvernements provinciaux à dépendre en grande partie des subventions fédérales ou, comme il le disait, à dépenser l’argent recueilli par Ottawa. Ses talents de conciliateur étaient encore utiles, mais les orientations étaient définies par ses ministres et, plus souvent encore, par les fonctionnaires. Heureusement, la dépression à laquelle on s’attendait après la guerre ne vint pas ; la demande jusque-là refoulée de logements et de biens de consommation facilita la transition rapide vers l’économie en situation de paix et le plein emploi.
Le poids de la politique affectait la santé de King. Usé, le premier ministre confia à St-Laurent en mai 1948 qu’il ne pouvait pas s’engager dans une autre campagne. Il démissionna de son poste de chef de parti en août et de celui de premier ministre le 15 novembre. St-Laurent lui succéda. King avait prévu écrire ses mémoires, mais il trouvait épuisant de se rappeler les périodes difficiles de sa carrière et ne réussit pas à finir de mettre de l’ordre dans ses papiers avant sa mort. Il s’éteignit le 22 juillet 1950 à Kingsmere et fut inhumé dans le lot familial au cimetière Mount Pleasant à Toronto.
Le Canada avait beaucoup changé depuis que King était devenu chef du Parti libéral en 1919. C’était maintenant un pays prospère et uni, fier de sa stabilité intérieure et de sa position de chef de file dans les affaires internationales. Le style de leadership de King avait facilité le développement du Canada en évitant ou en réduisant les affrontements et en maintenant sa cohésion politique à une époque troublée. Ce n’était pas là un mince exploit.
William Lyon Mackenzie King était essentiellement un chef de parti. Il travaillait avec son cabinet et son caucus, et, pour définir les orientations, se fiait à son jugement politique et à ses dons de conciliateur. Il assuma la direction du pays en faisant des troupes libérales un parti qui reflétait les divers intérêts régionaux, économiques et ethniques du pays. Sa manière de procéder consistait à choisir des collègues qui seraient capables de représenter et de défendre ces intérêts tout en acceptant les décisions collégiales et les compromis. Si certains groupes ou régions n’étaient pas bien représentés, King devait lui-même veiller à ce qu’on ne perde pas leurs intérêts de vue. Le respect du consensus exigeait de la patience, et donna lieu à l’adoption de mesures prudentes et progressives. King avait par ailleurs tendance à ne pas tenir compte des récriminations des groupes qui n’avaient pas de voix politique forte ; il s’intéressa fort peu au sort des autochtones ou aux droits des femmes parce que, à son époque, ces groupes ne constituaient aucune menace pour son parti. Par contre, même si les politiques libérales n’étaient pas toujours populaires, elles étaient au moins susceptibles d’être acceptées dans toutes les régions. King n’était pas un personnage coloré, mais il possédait les qualités nécessaires pour cette forme de leadership. Son libéralisme, son sens politique, ses talents de conciliateur et sa formidable ambition ont préservé l’unité du parti et du pays durant trois décennies tumultueuses. C’est grâce à son leadership que, même après sa retraite, son parti, dirigé par ses anciens collègues, conserva le pouvoir durant presque neuf ans.
On trouvera une liste exhaustive des documents d’archives ou des publications rédigés par King ou à son sujet dans G. F. Henderson, W. L. Mackenzie King : a bibliography and research guide (Toronto, 1998).
Les papiers King, MG 26, J, conservés par Bibliothèque et Arch. Canada, à Ottawa, sont remarquablement complets. Ils comprennent les journaux personnels de King, particulièrement intéressants parce qu’ils donnent des détails sur ses activités quotidiennes et sa personnalité. On peut trouver une version corrigée de ses journaux personnels pendant et après la guerre dans J. W. Pickersgill et D. F. Forster, The Mackenzie King record (4 vol., Toronto, 1960–1970). Le premier volume a été produit par Pickersgill seul. En 2003, Bibliothèque et Arch. Canada a publié une version numérisée des journaux personnels du sujet sur son site Web.
La biographie officielle de King, de R. MacG. Dawson et H. B. Neatby, a paru sous le titre William Lyon Mackenzie King : a political biography (3 vol., Toronto, 1958–1976). Dawson a écrit le premier volume, 1874–1923, et Neatby a rédigé le deuxième et le troisième, 1924–1932, The lonely heights (Toronto, 1963) et 1932–1939, The prism of unity (Toronto et Buffalo, N.Y., 1976). Dans Canada’s war : the politics of the Mackenzie King government, 1939–1945 (Toronto, 1975), J. L. Granatstein traite des années de guerre. Michael Bliss, Right honourable men : the descent of Canadian politics from Macdonald to Mulroney, publié à Toronto en 1994, présente une évaluation plus récente de King en tant que leader politique. D’autres publications traitent d’aspects précis de sa vie. Dans Charlotte Gray, Mrs. King : the life and times of Isabel Mackenzie King (Toronto, 1997), on trouve des commentaires perspicaces sur la mère de King et sur leur relation. On peut lire un compte rendu détaillé mais tendancieux sur les rapports de King avec les femmes dans C. P. Stacey, A very double life : the private world of Mackenzie King (Toronto, 1976). La carrière de King comme conseiller industriel est analysée dans Paul Craven, « An impartial umpire » : industrial relations and the Canadian state, 1900–1911 (Toronto, 1980), et dans F. A. McGregor, The fall & rise of Mackenzie King : 1911–1919 (Toronto, 1962). C. P. Stacey, Arms, men and governments : the war policies of Canada, 1939–1945 (Ottawa, 1970) traite de l’administration de King pendant la guerre.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
H. Blair Neatby, « KING, WILLIAM LYON MACKENZIE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 29 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/king_william_lyon_mackenzie_17F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/king_william_lyon_mackenzie_17F.html |
| Auteur de l'article: | H. Blair Neatby |
| Titre de l'article: | KING, WILLIAM LYON MACKENZIE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la révision: | 2005 |
| Date de consultation: | 29 avr. 2025 |