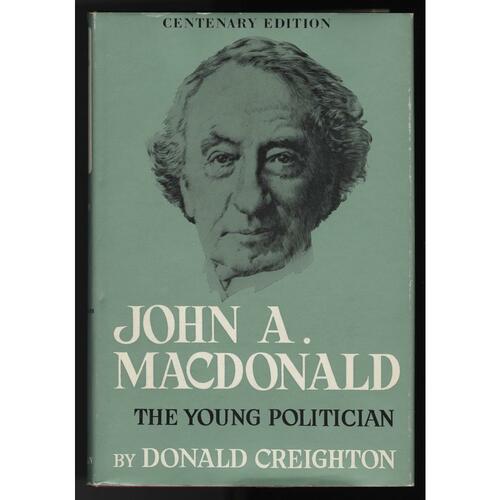Provenance : Lien
CREIGHTON, DONALD GRANT, professeur d’université, historien et auteur, né le 15 juillet 1902 à Toronto, deuxième des trois enfants du révérend William Black Creighton et de Laura Harvie ; le 23 juin 1926, il épousa à Londres Luella Sanders Bruce, et ils eurent un fils et une fille ; décédé le 19 décembre 1979 à Brooklin, Ontario.
John Creighton, arrière-arrière-grand-père de Donald Grant Creighton du côté maternel et son arrière-grand-père du côté paternel, émigra en 1832 de la paroisse de Tamlaght O’Crilly, dans le comté de Derry (Irlande du Nord). Il partit pour les raisons habituelles : la précarité de l’économie rurale en Irlande et la promesse de l’attribution d’une terre en Amérique du Nord britannique. Deux ans plus tard, trois de ses cinq enfants vinrent le rejoindre. Son fils James acheta, dans le canton de North Dorchester, dans le Haut-Canada, un lot de 100 acres qu’il transformerait au fil du temps en une ferme prospère appelée Hillside. C’est là que naquit, en 1864, le cinquième enfant de James, père de Donald Grant.
Du côté maternel, Donald Grant était un descendant de Kennedy, frère de James. Les Creighton étaient presbytériens, mais Kennedy se convertit au méthodisme et devint prédicateur itinérant. En 1861, sa fille, Eliza Jane*, épousa John Harvie*, chef de train. Au dire de tous, Lizzie, comme on l’appelait, possédait une forte personnalité – Donald Grant décrivit un jour sa grand-mère maternelle comme la seule femme dont il avait jamais eu peur – et devint chef de file du mouvement de réforme sociale à Toronto. Les enfants Harvie passaient leurs vacances d’été à Hillside. Laura et William Black Creighton s’y rencontrèrent et tombèrent amoureux. Ils se marièrent en 1895, après que William Black eut obtenu son diplôme en arts au Victoria College à Cobourg et son diplôme en théologie une fois le collège installé à Toronto. Pendant quelques années, William Black exerça des fonctions dans des régions rurales de l’Ontario, mais, en 1900, à la suite d’une laryngite qui mit en péril sa carrière de prédicateur, il fut nommé rédacteur adjoint du Christian Guardian, l’hebdomadaire publié à Toronto par l’Église méthodiste du Canada. Avec Laura et son jeune fils John Harvie, surnommé Jack, il partit vivre dans cette ville où, deux ans plus tard, Laura donna naissance à un deuxième enfant.
« Je suis né, dit un jour Donald Grant Creighton, dans un ménage où les livres – histoire, biographies, littérature – se trouvaient partout. » Son père, qui fut choisi parmi plusieurs autres ministres du culte comme rédacteur en chef du Christian Guardian en 1906, recevait des douzaines d’ouvrages d’éditeurs désireux d’en voir publier des recensions dans un périodique canadien. Des années plus tard, Creighton pourrait toujours se représenter ces livres, bien emballés dans du papier kraft, que son père apportait à la maison, dans l’ouest de Toronto. Sa mère était elle aussi une sorte de rat de bibliothèque ; elle lisait pour ses enfants quand ils étaient petits, puis avec eux lorsqu’ils étaient plus grands. Les livres de Dickens et de Tennyson étaient d’éternels favoris, ainsi que des magazines britanniques pour enfants, tels Chums, Chatterbox, Boy’s Own Paper et Little Folks. Grandir en compagnie de ces ouvrages et périodiques permettait de faire l’expérience du « monde britannique », ainsi que l’appelleraient les érudits modernes. Formée dans son enfance, la compréhension de Creighton des liens politiques, matériels, culturels et psychiques que le Canada entretenait avec la Grande-Bretagne et l’Empire britannique persisterait tout au long de sa vie et ces liens deviendraient une constante dans ses recherches.
Creighton était trop jeune pour servir pendant la Première Guerre mondiale, mais le conflit fut, dit-il, « une affaire personnelle et familiale ». Par le truchement du Christian Guardian, son père mena une croisade pour appuyer l’effort de guerre du Canada, le premier ministre, sir Robert Laird Borden*, le gouvernement d’union et la conscription. En août 1914, William Black Creighton s’adressa à ses lecteurs : « Nous sommes Britanniques ! Et nous soutiendrons la mère patrie dans la plus grande campagne de tous les temps. » Ayant obtenu une commission de lieutenant dans le 48th Highlanders, le frère aîné de Donald Grant, Jack, fut affecté outre-mer en août 1916 et participa aux batailles de Loos-en-Gohelle, de la cote 70 et de Passchendaele. Au cours de ce dernier combat, il subit une grave commotion quand il fut projeté contre un mur par l’explosion d’une bombe allemande. Au début de 1918, il rentra au Canada. Cet été-là, Donald Grant répondit à l’appel demandant de « faire sa part » en travaillant comme ouvrier dans une ferme à l’est de Toronto, fort probablement suivant le programme Soldats de la terre de la Commission canadienne du ravitaillement, qui plaçait des adolescents dans des entreprises agricoles partout au pays. Cinq décennies plus tard, Creighton avancerait l’hypothèse selon laquelle, pour comprendre la Première Guerre mondiale et « l’horrible tuerie de masse » sur le front de l’Ouest, il fallait saisir la façon dont le conflit avait été idéalisé. Non seulement le Canada, dit-il, mais aussi l’Occident tout entier « avaient considéré la Première Guerre mondiale différemment de n’importe quelle guerre du passé et considéreraient probablement différemment n’importe quelle guerre future ».
Après avoir obtenu son diplôme du Humberside Collegiate Institute en 1920, Creighton s’inscrivit à un programme d’études spécialisées de quatre années en anglais et en histoire au Victoria College, l’alma mater de son père, devenu le collège méthodiste à la University of Toronto. Il attira rapidement l’attention de ses professeurs, qui reconnurent son esprit subtil et son aisance exceptionnelle en écriture. Son premier intérêt portait sur la langue et la littérature anglaises, mais, vers sa troisième année, il commença « à pencher pour l’histoire » sous l’influence de plusieurs professeurs enthousiastes – John Bartlet Brebner*, Humphrey Hume Wrong* et George Malcolm Smith – qui, Creighton l’évoquerait plus tard, « concevaient l’histoire comme une œuvre dramatique » et « [le] convertirent à leur cause ».
Outre qu’il excellait dans ses études, Creighton fut, pendant sa dernière année, rédacteur en chef d’Acta Victoriana, magazine littéraire des étudiants de premier cycle du collège. Inspiré de Smart Set, revue littéraire d’avant-garde publiée à New York, qui se présentait comme « magazine de l’intelligence » (selon le sous-titre de la revue : a Magazine of Cleverness), et de son célèbre rédacteur en chef adjoint, Henry Louis Mencken, l’Acta Victoriana de Creighton se distinguait par la moquerie, la satire et l’irrévérence. Dans son premier éditorial, Creighton annonça un « préjugé anormal contre l’indigeste et le profond ». En d’autres termes, dit-il, les articles « lourds » sur « les mérites ou démérites de la coéducation » ou les histoires « compliquées » du Student Christian Movement n’étaient pas les bienvenus. Quelques mois plus tard, lorsqu’il apprit que, sous sa direction, l’Acta Victoriana s’était révélé capable d’« éprouver les méninges » de ses lecteurs, il publia une « simple histoire à lire au lit » à propos d’un chasseur idiot dévoré par un grizzly.
À l’automne de 1924, Creighton soumit sa candidature au programme de bourses Rhodes. Dans sa lettre de recommandation, le révérend Richard Pinch Bowles, président du Victoria College, qualifia Creighton d’« étudiant brillant ». « De l’avis de tous ses professeurs, il occupe une place de rare distinction », écrivit-il encore. « Ses talents sortent de l’ordinaire. Par sa vaste connaissance de la littérature anglaise, sa compréhension pénétrante et son appréciation des valeurs qu’elle véhicule, sa capacité de s’exprimer dans un style excellent, il est peu probable que nous ayons jamais eu meilleur étudiant. » Le comité de sélection pour l’Ontario se trouva « coincé » entre Creighton et un autre candidat de Toronto, l’humaniste Louis Alexander MacKay, chargé de cours au Victoria College. Il arrêta finalement son choix sur MacKay, le « pire » des deux, selon Wrong. Ce dernier, de concert avec des membres du département d’histoire et Charles Vincent Massey*, président du comité du prix Edward Kylie, fit en sorte que Creighton reçoive cette bourse, créée à la mémoire d’Edward Joseph Kylie*, professeur de la University of Toronto. Le prix avait pour but d’assurer que des étudiants méritants, de préférence en histoire moderne, puissent poursuivre leurs études en Grande-Bretagne. À la fin de ses études, au printemps de 1925, Creighton reçut également la Regents’ Gold Medal de son collège. Comme le voulait la tradition, ses camarades le décrivirent dans l’annuaire de l’université, Torontonensis : « Environ vingt ans d’âge, beaucoup plus en apparence et au moins deux cents en vanité. »
Ayant été admis au Balliol College à la University of Oxford en février de cette année-là, Creighton avait hâte de se reposer pendant les mois de juillet et août au chalet familial du lac Muskoka, où il passerait la plupart de ses étés. Or, de façon tout à fait inattendue, il tomba amoureux. Sa sœur, Mary Isabel, avait invité à la maison pour le lunch une amie, Luella Sanders Bruce, qui suivait Donald Grant d’une année à Victoria et qu’il connaissait assez peu. Elle était la fille de James Bruce, forgeron de Stouffville, et de Sarah Luella Sanders, morte de la fièvre puerpérale deux jours après sa naissance. Incapable de s’occuper de l’enfant, James la confia à ses grands-parents maternels, qui l’élevèrent comme leur fille. Cinq ans plus tard, James se remaria et reprit Luella Sanders ; à partir de ce moment-là, elle eut une enfance malheureuse auprès de sa belle-mère bigote. À mesure qu’elle grandissait, elle était de plus en plus décidée à fuir le harcèlement psychologique de cette femme plus âgée et le confinement culturel d’une petite ville ontarienne, à aller à l’université et à vivre la vie qu’elle aurait choisie. Elle mènerait ultérieurement une carrière d’auteure de romans et d’essais historiques.
Selon la légende familiale, ce fut Lizzie Harvie qui, la première, pensa que Donald Grant et Luella Sanders feraient un couple harmonieux. « Ne crois-tu pas que mademoiselle Bruce est gentille ? », demanda-t-elle à son petit-fils. Pour leur premier rendez-vous, les deux jeunes gens se rendirent à l’île Centre, en face du port de Toronto. Toujours selon la légende familiale, ils s’éprirent l’un de l’autre avant même d’arriver à destination : pendant les quelques moments qu’ils passèrent sur le traversier, tous les deux « savaient simplement ». Peu de temps après, le 22 août, ils se fiancèrent. « Je peux te dire bien honnêtement et sincèrement, confia Creighton à un ami, que je n’ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. »
À l’automne de 1925, Creighton partit pour Balliol, où il étudia l’histoire moderne. Son tuteur principal était Kenneth Norman Bell, qui avait été chargé de cours à la University of Toronto de 1909 à 1911 et continuait de servir en quelque sorte d’intermédiaire entre le département d’histoire de cet établissement et son collège d’Oxford. L’acteur Raymond Hart Massey* se souviendrait de Bell avec tendresse : il était « non seulement un brillant érudit, mais aussi un être humain remarquable, bienveillant, plein d’esprit et d’humour, et compréhensif ». À Oxford, à cette époque, on ne s’attendait pas à ce que les tuteurs publient ; leur tâche consistait plutôt à instruire les jeunes hommes, à leur inculquer les notions qu’un érudit avait appelées « nation, devoir, caractère et assurance ». Au dire de Massey, le professeur Bell s’était fixé pour but « non pas de transmettre des connaissances, mais de nous faire réfléchir ». Creighton réussit bien à Balliol, tant sur le plan scolaire que social. « J’ai reçu un très bon rapport de mon tuteur, annonça-t-il fièrement en novembre. Il a dit que mon travail avait été “admirable” et qu’il n’avait aucune critique à formuler. Pas si mal, hein ? » À Balliol, il ne faisait pas qu’étudier, il jouait aussi au hockey sur gazon (« tu rirais de voir le petit bâton ridicule », dit Creighton à son père), il allait se promener à Christ Church Meadow, il invitait des amis à prendre le thé de l’après-midi dans sa chambre et il profitait de l’atmosphère enivrante de l’Eights Week, course d’aviron annuelle.
Pendant ce temps, Creighton et Luella Sanders entretenaient une liaison amoureuse transatlantique. Ils échangèrent des lettres, se firent des promesses et finalisèrent leurs projets. Peu après l’obtention de son diplôme, au printemps de 1926, Luella Sanders se rendit à Londres, et le couple se maria à la chapelle Wesley de City Road, le 23 juin. Après un été merveilleusement romantique dans un petit village côtier de France, Creighton retourna à Oxford, tandis que sa femme demeura à Paris pour étudier l’histoire de l’art. Ils s’écrivaient tous les jours. Même si elle était difficile, leur séparation s’avéra « cinq fois moins dure » que celle de l’année précédente. En effet, Creighton se sentait revigoré et retrouvait sa concentration. « Cette année, je travaille deux fois mieux que l’an dernier », dit-il à sa mère.
Creighton passa le printemps de 1927 à Saujon, petit village du sud de la France, à se préparer pour ses examens écrits et oraux. « Don travaille à un rythme incroyable, écrivit Luella Sanders à sa belle-mère. Je ne sais comment il fait, et il reste encore deux mois et demi avant la fin de ce surmenage épouvantable. » Finalement, Creighton obtint son diplôme avec mention bien, et non très bien. Il obtiendrait un second baccalauréat en 1929, puis une maîtrise d’Oxford en 1931. Peu de Canadiens décrochaient une mention très bien, et certains finissaient même avec la mention passable. Ils étaient désavantagés : ils pouvaient bien faire à l’écrit, mais il leur manquait les compétences verbales de leurs camarades britanniques. Or, c’était le viva voce (examen oral) qui, en général, faisait pencher la balance.
Il est difficile de dire ce qu’Oxford signifia exactement pour Creighton. Le souvenir du temps qu’il y passa lui était assurément cher. D’un naturel sensible, voire émotif, il fut ému par la beauté antique de la ville, ses collèges et bibliothèques, son architecture et ses rues pavées. Toronto n’était pas Oxford et le Victoria College n’était pas Balliol, mais cela ne lui faisait ressentir aucun sentiment d’infériorité ni ne lui rappelait son statut de colonisé, et il n’essaya jamais outre mesure de s’intégrer. Autrement dit, il ne tenta pas de se faire plus Anglais que les Anglais en adoptant un accent factice ou en imitant leurs manières. En fait, il trouvait les Anglais « sympas », sinon un peu trop suffisants : « En particulier, lorsque je prends le thé quelque part, je voudrais faire exploser une bombe pour les réveiller tous. Ils sont gentils, mais très satisfaits d’eux-mêmes. » Selon Kenneth Norman Bell, Creighton demeura « un authentique touriste canadien », même après avoir passé une année et demie à Oxford. L’expérience confirma néanmoins son côté typiquement britannique et accrut son appréciation de la place de la Grande-Bretagne dans le monde. C’était toutefois un côté britannique canadien : non pas un trait de caractère imposé de l’extérieur, mais plutôt issu de l’intérieur. Être à la fois britannique et canadien n’était pas contradictoire mais hybride.
Creighton revint à la University of Toronto à l’automne de 1927. Il fut d’abord chargé de cours au département d’histoire, puis devint professeur adjoint cinq ans plus tard. Il avait l’intention de faire un doctorat en histoire de la France à la Sorbonne sous la direction d’Albert Mathiez, l’un des plus grands experts de la Révolution française. L’année suivante, sa femme et lui passèrent donc l’été à Paris. Sa thèse devait porter sur Jean-Marie Roland de La Platière, un des chefs des girondins pendant la Révolution. Luella Sanders songea même à écrire une biographie de Mme Roland de la Platière, qui fut, d’une certaine façon, la force intellectuelle derrière son mari. Le sujet de Creighton était un choix intéressant : les girondins représentaient les intérêts bourgeois, défendaient le droit de propriété et, au fil de la révolution, se firent les porte-parole de l’ordre et du conservatisme. Même s’il passa de longues journées étouffantes à la Bibliothèque nationale, « fouillant dans des piles de proclamations et de brochures », comme le dit un ami, Creighton ne termina pas ses recherches. À court d’argent, le couple rentra au pays en troisième classe. Comme Creighton n’avait accès à aucune subvention, il dut renoncer à son intérêt pour l’histoire de l’Europe. « J’ai donc décidé de trouver un sujet canadien », dira-t-il plus tard. « C’était un piètre substitut. J’éprouvais un véritable sentiment de privation. »
À ce moment-là, William Paul McClure Kennedy, qui enseignait le droit et les institutions politiques à la University of Toronto, suggéra à Creighton d’étudier la carrière de lord Dalhousie [Ramsay*], gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique dans les années 1820. Les Archives publiques du Canada venaient d’acquérir les documents de Dalhousie, qui contenaient peut-être une partie de l’histoire constitutionnelle du pays. Creighton était curieux. Il entrevoyait la possibilité d’écrire un ouvrage bref et, en même temps, d’obtenir un doctorat (il n’y arriverait jamais, en fait). Il passa l’été de 1930 à Ottawa, mais trouva l’entreprise laborieuse. Dalhousie était sentencieux et ennuyeux, l’histoire constitutionnelle n’intéressait pas vraiment Creighton et Ottawa n’était pas Paris. « Après Paris, dit-il, je détestais cette trop petite ville. » Plus d’une fois, il fut sur le point de boucler ses valises et de rentrer à la maison. Puis, quelque chose capta son attention. Regardant au delà du monde étroit de la politique, avec ses pétitions, ses lois et ses assemblées, Creighton releva un thème plus fondamental dans l’histoire du Canada : le développement d’un réseau commercial structuré autour du fleuve Saint-Laurent. « Je me rendis compte tout à coup que je tenais là un sujet colossal et merveilleux. Je le voyais prendre naissance au début du Régime français et se développer dans l’avenir. »
Pendant les sept années suivantes, Creighton organisa son temps avec un soin jaloux. Les exigences d’une jeune famille (son fils, Philip William Bruce, était né en 1929) et une lourde charge d’enseignement – ses étudiants se souviendraient de ses exposés soigneusement préparés et garderaient de lui le souvenir d’un « orateur théâtral » – laissaient peu de place à la recherche et à l’écriture. Évitant de céder à la tentation de rédiger des articles et des recensions, il concentra ses efforts sur un horizon plus lointain : la publication d’un livre. Il y mettrait non pas des mois, mais des années. The commercial empire of the St. Lawrence, 1760–1850 parut en 1937 dans la série du Carnegie Endowment for International Peace sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Le livre consacra la réputation de Creighton comme meilleur historien de sa génération. Inspiré par l’ouvrage de son ami Harold Adams Innis*, The fur trade in Canada […], publié en 1930, à New Haven, au Connecticut, et à Londres, et sa conclusion, selon laquelle le Canada « avait émergé non pas en dépit de sa géographie, mais grâce à elle », Creighton soutenait que le pays n’avait été réalisable qu’en raison de la présence du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. Seule voie maritime à pénétrer jusqu’au cœur de l’Amérique du Nord, le Saint-Laurent avait permis la mise en place d’un empire commercial transatlantique et transcontinental d’est en ouest et, finalement, la création du Canada. « C’était le seul grand fleuve qui menait du littoral oriental jusqu’au cœur du continent. Il possédait un monopole géographique et clamait son caractère unique aux aventuriers. Le fleuve signifiait mobilité et distance ; il invitait au voyage ; il promettait d’immenses étendues se déroulant à perte de vue vers des horizons lointains et changeants. L’Ouest tout entier, avec ses richesses, était sous la domination du fleuve. » Creighton résumait ainsi, en quelques mots, la thèse laurentienne de l’histoire du Canada : la nation était issue de la vallée du Saint-Laurent, du bassin des Grands Lacs et du Bouclier canadien.
Frappés par l’originalité et la puissance de l’argumentation et émus par la portée audacieuse de l’imagination de l’auteur, les lecteurs couvrirent d’éloges The commercial empire of the St. Lawrence. L’historien Arthur Reginald Marsden Lower*, à l’époque professeur au Wesley College de Winnipeg, qualifia l’ouvrage de brillant. « Si d’autres livres comme celui-ci étaient écrits, déclara-t-il, l’histoire du Canada risquerait de devenir intéressante. » Herbert Heaton, de la University of Minnesota, le décrivit comme « un ouvrage brillant d’analyse, de synthèse et d’interprétation ». À un banquet organisé pour le lancement, Frank Hawkins Underhill, collègue de Creighton à Toronto, prononça un discours sur l’art de l’histoire et proclama Creighton « grand espoir » de cet art. En aparté, il dit ensuite à l’auteur que son ouvrage était « le meilleur livre jamais publié sur l’histoire du Canada ».
Mais le livre souleva également la critique. L’historien militaire Charles Perry Stacey* fit remarquer qu’en raison de la perspective invariablement mercantile adoptée par Creighton pour raconter son histoire, « le lecteur peut parfois perdre de vue l’importance des intérêts opposés », en particulier ceux des Canadiens français. Gilbert Norman Tucker, de la Yale University, fut plus cinglant. Il détecta chez Creighton un manque flagrant de générosité à l’égard du Canada français. « La décision [britannique] de respecter les institutions chères aux Canadiens français, écrivit-il, passe à la moulinette de la critique négative et en ressort extrêmement diminuée […] Cette décision découl[ait] sûrement d’un élan de générosité et de tolérance qui mérit[ait] d’être souligné. »
Pour Creighton, le Canada français était une énigme. L’auteur ne pouvait faire fi de ce sujet qui, après tout, traversait l’histoire du Canada, mais il était incapable de le comprendre. Il s’en remit plutôt à une série de stéréotypes pour expliquer la région et ses habitants. Le Canada français était un vestige féodal de l’Ancien Régime en Amérique du Nord, et les Canadiens français étaient des gens « simples, dociles et dépourvus d’ambition politique », des « paysans sans instruction et obéissants », « distants, obstinés et craintifs », « renfrognés, méfiants et passifs », « intraitables, conservateurs et peu enclins aux affaires ». De plus, la conquête britannique de la Nouvelle-France ne fut pas une « suprême catastrophe », comme l’avait cru l’abbé Lionel Groulx*, historien. Creighton la considérait plutôt comme un épiphénomène. « La conquête, écrit-il, ne pouvait pas changer le Canada. » Elle ne pouvait pas modifier « le fait crucial dans l’histoire de la moitié septentrionale du continent » : le rôle joué par le fleuve Saint-Laurent, le bassin des Grands Lacs et les tentatives répétées de constituer un empire commercial et territorial. À bien des égards, l’opinion de Creighton sur le Canada français et les Canadiens français évoquait celle de lord Durham [Lambton*] qui, dans son rapport publié à Londres en 1839, avait donné une description restée célèbre de la population francophone du Bas-Canada : un peuple « sans histoire ni littérature ».
Creighton accomplit pour le Saint-Laurent ce que Thomas John (Tom) Thomson* et les peintres du groupe des Sept avaient réalisé pour le Bouclier canadien : il en fit un mythe, un élément de l’imaginaire canadien-anglais. Le « fleuve du Canada » servit d’argument constant contre le continentalisme et empêcha l’absorption du pays par les États-Unis. Il représentait le principal objectif du Canada : maintenir une existence politique indépendante sur le continent nord-américain. Mais Creighton rappelait à son auditoire que l’attrait nord-sud du continentalisme était puissant et que la Grande-Bretagne comptait pour le Canada. Ce qu’il concluait pour le xixe siècle – que « le Canada n’avait pratiquement aucun sens en dehors du lien impérial » – valait également pour le xxe.
Après la publication du livre The commercial empire of the St. Lawrence, Creighton produisit un texte de fond sur l’Amérique du Nord britannique au moment de la Confédération pour la commission royale des relations entre le dominion et les provinces, présidée d’abord par Newton Wesley Rowell*, puis par Joseph Sirois*, et écrivit Dominion of the north : a history of Canada. Publié à Boston, en 1944, l’ouvrage destiné au grand public développait la thèse laurentienne en la faisant remonter à la Nouvelle-France, puis en l’amenant jusqu’à la construction du Canada moderne. Comme Creighton le dit à son éditeur, « le but premier de ce livre » était de montrer « pourquoi le Canada [était] une nation nord-américaine distincte et souhaitera[it] le rester ». L’ouvrage reflétait également la conviction plus mûre de Creighton que l’histoire était une discipline de la littérature, et non pas une science sociale. Il résista délibérément à la tentation de fragmenter son sujet en une série de chapitres thématiques vaguement reliés. Traiter l’histoire de cette façon, dit-il, était « mauvais à la fois historiquement et artistiquement ». Le récit historique, même s’il était plus difficile à écrire, était plus fidèle au passé. Après tout, le passé n’était pas divisé en thèmes ; selon Creighton, il possédait une « unité fondamentale ».
Dominion of the north connut une réception favorable. Le New York Times lui accorda le 23 avril une recension élogieuse et décrivit son auteur comme un « homme de belle prose ». Le 21 juillet, la Gazette de Montréal le qualifia d’ouvrage d’« histoire [écrit] dans un style magistral » et souligna ses « pages brillamment construites ». Enfin, l’historien Alfred LeRoy Burt confia à Creighton que le livre était « un ouvrage capital qui devrait recevoir une large diffusion ». Même si Creighton estimait que son éditeur, Houghton Mifflin Company, aurait pu en faire une promotion plus énergique, en particulier aux États-Unis, le livre se vendit plutôt bien : entre 1944 et 1953, année où il fut épuisé, on en écoula plus de 10 000 exemplaires, qui rapportèrent à Creighton des droits d’auteur de 2 100 $. Un éditeur de Buenos Aires publia une traduction en espagnol en 1949, sous le titre El dominio del norte : historia del Canadá, et une version mise à jour et augmentée parut chez la Macmillan Company of Canada en 1957 et chez Houghton Mifflin l’année suivante, à Boston, sous le titre A history of Canada : dominion of the north, dans le but d’atteindre le marché universitaire et collégial au Canada et aux États-Unis.
La correspondance personnelle de Creighton des années 1940 ayant disparu, il est difficile de savoir précisément quelle fut sa réaction à la Deuxième Guerre mondiale. À l’époque, il appuya l’effort de guerre ; plus tard, il en viendrait toutefois à critiquer les ententes du Canada avec les États-Unis, entre autres la Commission permanente mixte de défense Canada-États-Unis, qu’il voyait comme un coup dur pour l’indépendance du Canada. En juillet 1945, au moment où le conflit approchait de son terme, il fut nommé professeur titulaire à la University of Toronto, nomination qu’il croyait mériter depuis longtemps et qu’il obtint seulement après que la McGill University de Montréal lui eut offert un poste semblable. Il amorça également un projet qui allait absorber les dix prochaines années de sa vie : la biographie du premier des premiers ministres du Canada, sir John Alexander Macdonald*. « L’histoire, soutenait l’auteur, n’est pas le produit de forces inanimées et d’automates humains ; elle est faite par des hommes et des femmes bien en vie, mus par une variété infinie d’idées et d’émotions qui peuvent être mieux comprises par une exploration des caractères, l’un des grands attributs de l’art littéraire. »
En s’inspirant du compositeur allemand Richard Wagner et de son usage du leitmotiv, thème récurrent dans la composition musicale ou littéraire, Creighton commença le premier tome de sa biographie de Macdonald là où The commercial empire of the St. Lawrence se terminait : avec le fleuve lui-même. « À cette époque, d’habitude, ils arrivaient par bateau. Seuls quelques immigrants entreprenaient le long périple depuis Montréal par l’intérieur des terres. Ceux-là cheminaient pendant plusieurs semaines à travers la forêt verte et, en cours de route, étaient obligés de s’arrêter une bonne vingtaine de fois dans certaines fermes hospitalières. La plupart de ceux qui se rendaient à l’ouest venaient par le fleuve. » Il conclut le deuxième tome à l’endroit où le premier avait commencé : « Plus loin que le quai, il y avait le port et les îles qui marquaient l’extrémité est des Grands Lacs. Et plus loin que les îles, le fleuve Saint-Laurent commençait son long périple vers la mer. » Au fil des 1 059 pages du texte anglais, un Macdonald héroïque écoute le Saint-Laurent et se bat pour remplir la promesse du fleuve et l’étendre vers l’ouest, d’un océan à l’autre, au moyen d’un chemin de fer transcontinental ; un Macdonald qui comprend que la menace qui pèse sur l’indépendance du Canada en Amérique du Nord, sur son état de séparation, vient non pas de la Grande-Bretagne, mais des États-Unis ; et, enfin, un Macdonald qui, étant le seul à pouvoir embrasser des horizons plus vastes, surmonte les objections des Néo-Brunswickois réticents, l’opposition des obscurantistes néo-écossais, les défis soulevés par les premiers ministres défendant leur province, et les révoltes armées des Métis.
Les deux volumes de la biographie, intitulés John A. Macdonald, et publiés en anglais à Toronto, respectivement en 1952 et en 1955, remportèrent tous deux le prix du gouverneur général dans la catégorie études et essais. Les deux ouvrages se vendirent exceptionnellement bien dans le grand public. En 1960, les ventes avaient déjà dépassé 11 000 exemplaires pour le premier tome et 10 000 pour le second, et Creighton avait récolté plus de 14 600 $ en droits d’auteur. Dans sa recension du premier tome, l’érudit d’Oxford Max Beloff déclara que Creighton comptait « parmi la demi-douzaine des meilleurs historiens qui écriv[aient alors] dans l’ensemble du monde anglophone ». À Oxford également, le philosophe Isaiah Berlin fit à ses étudiants la déclaration suivante : « sur la force de ce volume unique, je peux affirmer avoir passé la dernière fin de semaine en communion avec le plus grand historien de notre temps ». Le centre avait reconnu la marge.
Cependant, du chœur général de louanges surgit la critique. Creighton avait surestimé le rôle de Macdonald dans la Confédération. Il n’avait pas tenu compte de l’opposition légitime et réfléchie d’Albert James Smith* du Nouveau-Brunswick, de Joseph Howe* de la Nouvelle-Écosse et d’Antoine-Aimé Dorion* du Bas-Canada. Il avait dénigré les opposants politiques de Macdonald (Oliver Mowat* de l’Ontario, par exemple, fut décrit, affichant son triomphe comme en 1878, « tel un fabuleux seigneur de la guerre asiatique chargé d’un lourd butin et riche de conquêtes territoriales »). De plus, il avait traité Louis Riel*, le soulèvement de la Rivière-Rouge de 1869–1870 et la rébellion du Nord-Ouest de 1885 avec une insensibilité pleine d’incompréhension. En effet, Creighton n’avait jamais compris que le xxe siècle avait transformé Riel en un personnage sympathique, voire héroïque. Il confia à son collègue historien Ramsay Cook que « le mieux que l’on puisse dire de Louis Riel – étrange modèle de héros – est qu’il aurait dû être dans un asile d’aliénés ! »
La biographie de Macdonald, malgré tous ses défauts, confirma la réputation de brillant écrivain de Creighton. Bowles avait eu raison : les talents de Creighton sortaient de l’ordinaire. Il n’avait pas essayé de situer son interprétation du premier des premiers ministres du Canada dans la littérature universitaire existante, et n’avait pas surchargé son texte de références à une documentation secondaire. Il n’avait pas réduit son sujet à l’énoncé d’une thèse à la fin d’un chapitre d’introduction ni cité des autorités extérieures sur les points forts de cette théorie-ci ou les limites inévitables de cette source-là. En ce sens, la biographie se lisait comme un roman. Pour maintenir l’intérêt de son lectorat, Creighton s’était en effet servi des techniques du romancier, dont le suspense, le paroxysme et le dénouement. Il avait soigneusement ajouté des détails sur le temps ou l’orientation du soleil pour créer un décor et une ambiance. Et il avait délibérément mis en valeur les caractéristiques physiques des personnages pour en faire ressortir leur personnalité. « Je pense que c’est avec la littérature que l’histoire est en association la plus étroite, dit-il un jour. Je pense qu’un bon historien doit posséder une connaissance solide de la littérature anglaise et française, en particulier des romans où l’auteur envisage la société dans une vaste perspective et essaie – parfois dans une série d’ouvrages – de communiquer une impression d’une époque entière de l’histoire d’une nation. »
Creighton ne voyait pas la nécessité de justifier les libertés qu’il prenait à titre d’écrivain. « Les gens me disent parfois “Comment savez-vous que Macdonald pensait cela à tel moment en particulier ?” Et j’admets volontiers que je ne le sais pas. Ce que je sais, c’est qu’il avait telle opinion sur tel sujet précis et qu’en ma qualité d’historien, je peux choisir le moment où je le ferai s’expliquer lui-même. » En même temps, Creighton insistait sur « la recherche la plus rigoureuse, exhaustive et minutieuse […] Vous devez, disait-il, vous plonger dans les documents de l’époque, imprimés et écrits à la main, et vous devez continuer ainsi jusqu’à ce que vous connaissiez ces gens presque aussi bien que vos contemporains. À moins de travailler de cette façon et de rechercher jusqu’au dernier élément de preuve, vous n’avez aucun droit d’essayer de pénétrer leur pensée. » Il menait toujours ses propres recherches, car il croyait qu’il incombait à l’auteur du récit de trouver tout ce qui dépassait les données statistiques de base.
La biographie de Macdonald eut pour effet de distinguer Creighton de ses collègues historiens Underhill et Lower. Tous les deux interprétaient l’histoire du Canada comme l’histoire de son émancipation de la Grande-Bretagne. Même s’il demeurait une monarchie constitutionnelle et n’aspirait guère à devenir une république, le Canada était un pays nord-américain. Comme Underhill le fit observer, le Canada et les États-Unis n’étaient pas fondamentalement différents. « Ce ne fut pas la Déclaration d’indépendance qui fit des Américains un peuple distinct, mais l’océan Atlantique ; et le Canada est du même côté de l’Atlantique. » Lower était d’accord avec cette position. Élément révélateur, tandis que Creighton avait intitulé son histoire du Canada en un volume Dominion of the north, Lower avait publié la sienne en 1946, à Toronto, sous le titre Colony to nation […].
En 1954, Creighton avait obtenu ce qu’il voulait (et ce qu’il avait pensé lui revenir à juste titre deux ans auparavant, après le départ à la retraite de Chester Bailey Martin*, directeur du département d’histoire) lorsque Sidney Earle Smith*, recteur de la University of Toronto, lui proposa de prendre la direction du département l’année suivante. « Jour très important de ma vie », écrivit Creighton dans son journal intime. Pour lui, le titre comptait. Il hérita cependant d’un département mécontent. Les membres plus anciens désapprouvèrent cette nomination, croyant que George Williams Brown aurait fait un directeur plus efficace ; les plus jeunes ne s’opposèrent pas à Creighton, mais la précarité de leurs postes et leur faible rémunération continuèrent de les contrarier ; enfin, les deux groupes se plaignirent du fait que l’administration ne les avait pas consultés.
Pour sa part, Underhill quitta son poste peu après, sans donner de long préavis, quand il accepta de devenir conservateur de la maison Laurier à Ottawa [V. William Lyon Mackenzie King*]. Il confia à un collègue : « La perspective de continuer dans le département actuel avec Don Creighton comme directeur ne m’enchantait guère. » Les désaccords intellectuels entre ces deux géants étaient devenus personnels. D’un côté, Underhill défendait les politiques du Parti libéral et acceptait le rôle de premier plan des États-Unis dans la guerre froide, tandis que de l’autre, le tory Creighton fustigeait les libéraux pour avoir rompu les liens impériaux et s’être ralliés à l’Oncle Sam, comme tant d’autres valets de chambre. Creighton était agacé par le fait que, tandis que tous semblaient le respecter, ils adoraient Underhill. Dans un petit département, où les membres se rencontraient régulièrement l’après-midi autour d’une tasse de thé au sous-sol de la maison Flavelle [V. sir Joseph Wesley Flavelle*] et nouaient des relations grâce au Historical Club des étudiants de premier cycle, la jalousie de Creighton ne pouvait que s’accroître. Au fil du temps, il fut rongé par ce sentiment qui finit par le diminuer en tant qu’être humain.
Il s’avéra que Creighton n’était pas un meneur. Il ne pouvait diriger de fortes personnalités et il lui manquait la ruse nécessaire pour réussir dans la gouvernance d’un département. D’humeur inégale, susceptible et très difficile à vivre, il devint une sorte de paratonnerre. En plus de la gestion des politiques internes, la charge de travail était lourde : les réunions en comités, estimations budgétaires, problèmes de dotation, discussions sur les programmes, négociations salariales, congés exceptionnels, demandes de subventions, acquisitions de documents pour la bibliothèque, locaux pour les bureaux et revendications des étudiants le harassèrent pendant la majeure partie des quatre années de son mandat. « Si DGC ne fait pas attention », confia à un collègue John Tupper Saywell, membre du département, « ce travail le tuera ». En réalité, cela faillit arriver. Le stress était énorme. Creighton développa un psoriasis au cuir chevelu, problème de peau qui lui causait des démangeaisons et nécessitait des shampoings spéciaux. Condition plus sérieuse, il souffrait d’une douleur intense à l’estomac, heureusement épisodique, qui fut diagnostiquée tantôt comme un ulcère gastrique, tantôt comme une infection gastro-intestinale grave. Quelle qu’en ait été la cause, la maladie résistait à tout traitement et pouvait seulement être soulagée. L’historienne Margaret Evelyn Prang*, alors étudiante de cycle supérieur, se rappellerait avoir vu Creighton prendre, au milieu d’un séminaire, de grandes lampées d’« un affreux remède vert » afin d’atténuer la vive douleur qui lui tordait l’estomac. Sa fille, Laura Mary Cynthia (née en 1940), garderait de son père le souvenir d’une personne très malheureuse pendant son mandat de directeur. « Lorsque je rentrais de l’école, je cherchais ses couvre-chaussures. S’ils étaient là, je devais me préparer, rassembler mes forces pour affronter ce qui m’attendait. Il pouvait être d’une humeur revêche, difficile. Mais si les couvre-chaussures n’étaient pas là, je pouvais me détendre et monter voir ma mère. » Vers 1959, Creighton en eut assez et demanda « d’être soulagé de ses fonctions de directeur », selon ses propres mots. Il voulait, disait-il, se consacrer à ce qu’il faisait de mieux : l’écriture. Il fut remplacé à la direction du département par James Maurice Stockford Careless*, membre de la nouvelle génération d’après-guerre à qui il avait enseigné.
Pendant qu’il était aux prises avec les problèmes du département, Creighton se préoccupait de plus en plus du Canada, de sa place dans le monde et de sa situation en Amérique du Nord. Dans une conférence prononcée en août 1954 au congrès annuel sur les affaires publiques tenu au lac Couchiching, en Ontario, il remit en question l’hégémonie mondiale des États-Unis et la volonté du Canada « d’accepter les plus récents conseils de Washington comme des équivalents modernes de la révélation divine ». Il voyait s’affaiblir le lien de son pays avec la Grande-Bretagne et se resserrer les relations avec son voisin du sud, « changement », dit-il, « qui était, dans une large mesure, l’œuvre personnelle » du premier ministre libéral William Lyon Mackenzie King. Deux ans plus tard, les pires craintes de Creighton se confirmèrent : pendant la crise du canal de Suez, en 1956, le Canada se rangea du côté non pas de la Grande-Bretagne, mais des États-Unis. On estimerait que la décision du Canada de ne pas appuyer le militarisme d’une puissance impériale déclinante était la bonne, et l’on considèrerait la diplomatie du ministre des Affaires étrangères, Lester Bowles Pearson, comme un moment mémorable de la politique étrangère du Canada. Creighton, cependant, vit son pays abandonner la Grande-Bretagne à l’heure où elle avait le plus besoin d’appui. En termes historiques plus généraux, l’épisode fut d’une importance décisive dans le mouvement que l’historien José E. Igartua appellerait « “l’autre Révolution tranquille” : la disparition de l’auto-représentation du Canada anglophone comme nation “britannique” ».
Creighton assista à la réinvention du Canada anglais qui se produisait sous ses yeux ; par exemple, « dominion » était devenu un mot étranger. Il dénonça ce qu’il voyait comme un rejet du passé et la complicité de la profession d’historien dans ce processus. Ce fut sur cette toile de fond qu’il prononça sa conférence présidentielle à la Société historique du Canada en 1957. Il écorcha les écrits historiques canadiens du précédent demi-siècle en critiquant ce qu’il appelait leur déformation libérale. Selon l’interprétation libérale, ou la « version autorisée », l’histoire du Canada décrivait l’émancipation du pays de l’impérialisme britannique : les premiers ministres libéraux qui s’étaient succédé furent louangés pour leur contribution à cette épopée de liberté, les défenseurs des liens avec l’Empire furent condamnés et le Canada assumait sa destinée continentale en tant que nation nord-américaine. Mais cette lecture libérale et les historiens qui y avaient participé – principalement Underhill et Lower, que Creighton qualifiait en privé respectivement de « petit corniaud bedonnant » et de « pernicieux » – laissaient de côté le fait que le Canada n’était pas seulement une nation nord-américaine et que le lien impérial importait pour son indépendance. Leur interprétation niait ce que, dans le deuxième volume de sa biographie de Macdonald, Creighton avait appelé le « premier objectif » du Canada : « parvenir à une existence politique indépendante sur le continent nord-américain ».
Les changements qui s’opéraient dans le Canada anglais faisaient partie d’une réorganisation du monde beaucoup plus grande à une époque où l’Empire britannique essuyait un revers irrémédiable dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. L’Inde avait acquis son indépendance en 1947, et le processus de décolonisation en Afrique, difficile et souvent très long, était amorcé. Dans ce contexte, la Grande-Bretagne mit sur pied, en 1959, une commission consultative sur la révision de la constitution de la fédération de Rhodésie et du Nyassaland, mieux connue sous le nom de commission Monckton, d’après le nom de son président, lord Monckton. Désireuse de s’assurer une représentation du Commonwealth of Nations et une compétence en matière de fédéralisme, la Grande-Bretagne s’adressa à Creighton. Ce fut un grand honneur pour lui et, en dépit de certaines appréhensions – il ne savait rien de l’Afrique et son estomac continuait de le faire souffrir –, il accepta, car il souhaitait ardemment servir la mère patrie. Faisant appel à son sens de l’histoire, le secrétaire d’État pour le Commonwealth informa Creighton que la commission représentait un événement historique, qu’elle constituait « un exercice comparable au rapport de Durham ».
Creighton s’absenta du pays pendant huit mois, soit de février à septembre 1960. Il passa les trois premiers mois en Afrique pour rencontrer des hommes politiques, des fonctionnaires locaux, des fermiers et des étudiants. Il prenait sa mission à cœur : il écrivait des notes détaillées, posait des questions pertinentes, participait aux réunions de comités et formulait des propositions fondées sur l’expérience canadienne. La préparation du rapport final à Londres occupa les cinq mois suivants. Les commissaires recommandèrent un grand nombre de modifications importantes à la constitution de la fédération pour accommoder les sentiments nationaux des Africains, dont le droit à la sécession. Ils reconnurent qu’à moins de mettre rapidement en œuvre des changements, seule la force pourrait assurer la survie de la fédération. Le rapport de Monckton était bien différent du rapport de Durham en ce sens qu’il conviait à un avenir multiracial.
Au cours des années 1960, le nationalisme et la décolonisation en Afrique donnèrent l’idée à de nombreux Québécois francophones de demander pourquoi, si d’anciennes colonies telles que la Rhodésie du Nord étaient en train de devenir indépendantes, ils ne pourraient faire de même. La Révolution tranquille – mutation rapide de la province en un État moderne, laïque, bureaucratique – et l’émergence de l’indépendantisme transformèrent le Canada. Dès 1962, trois ans avant de faire son entrée en politique, l’intellectuel québécois Pierre Elliott Trudeau* avait prévenu les Canadiens anglais qu’ils devaient changer ou accepter les conséquences : « il faut que le nationalisme canadien-anglais consente à changer l’image qu’il s’est faite du Canada ».
Creighton, lui, refusa de changer. Il s’opposa – passionnément, voire farouchement – à ce qu’il percevait comme une stratégie massive d’apaisement de la part du Canada anglais. Par exemple, le débat entourant le projet d’un nouveau drapeau national en 1964 [V. Lester Bowles Pearson] le rendit furieux. Il reflétait, d’une part, un rejet de l’histoire du pays et, d’autre part, une tentative malencontreuse d’accommoder le Canada français. « Donald terriblement déprimé par la controverse sur le drapeau », nota sa femme le 7 mai dans son journal intime. « Croit que le Canada est une place minable, souhaiterait avoir vécu n’importe où ailleurs. » Quelques semaines plus tard, Creighton et 11 autres personnages éminents, notamment le spécialiste du droit constitutionnel Eugene Alfred Forsey*, l’historien William Lewis Morton et le politologue Denis Smith, signèrent une lettre ouverte adressée au premier ministre Pearson pour l’exhorter à ne pas changer le drapeau : la feuille d’érable proposée était « insipide » et le nouveau drapeau « saperait de manière subtile la volonté de survie du Canada ». Lorsqu’un député conservateur lui posa une question sur cette lettre à la Chambre des communes, Pearson donna une réponse laconique, teintée de mépris : « Je connais la faiblesse des professeurs d’histoire lorsqu’ils commencent à se mêler aux événements contemporains. Peut-être leur lettre en témoigne-t-elle. »
En 1965, Creighton fut invité à devenir membre de l’Ontario Advisory Committee on Confederation, groupe d’experts désintéressés qui fourniraient au premier ministre de la province, John Parmenter Robarts*, des conseils sur le fédéralisme et la constitution. Il accepta l’invitation pour un certain nombre de raisons. Il voulait d’abord se rendre utile. Ensuite, il était d’avis que, malgré les critiques de Pearson, les historiens devaient s’engager dans les affaires contemporaines. Enfin, il croyait que le Canada anglais était prêt à accommoder le nationalisme québécois au détriment de ses propres intérêts. D’ailleurs, pour Creighton, la commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, créée par Pearson en 1963 et présidée par André Laurendeau* et Arnold Davidson Dunton*, en était la preuve. Selon lui, non seulement elle ne représentait pas « les valeurs et intérêts du Canada anglais », mais elle ne respectait pas non plus « la conception de la nationalité canadienne sur laquelle la Confédération avait été basée au point de départ et sur laquelle elle continuait [de s’appuyer] depuis plus de quatre-vingt-dix ans ». Au cours de cinq années, l’Ontario advisory committee produisit un certain nombre de rapports de recherche et d’articles de fond, mais il confirma les soupçons de Creighton selon lesquels le Canada anglais était trop empressé, d’après les mots de Trudeau, de modifier l’image de ce que devait être le Canada. Par exemple, sur la question d’étendre l’éducation en français des Franco-Ontariens jusqu’au secondaire, Creighton se retrouva isolé ; il s’y opposa en raison du fait qu’une telle décision nuirait aux élèves dans un marché du travail où l’anglais dominait. Lord Durham avait brandi le même argument en recommandant l’assimilation. « La langue, les lois et le caractère du continent nord-américain sont anglais », avait-il écrit. C’était la « langue des riches et de ceux qui distribuent les emplois aux travailleurs ».
Bilinguisme, biculturalisme et nationalisme québécois ; Pearson, débat sur le drapeau et réforme constitutionnelle ; Canada, États-Unis et continentalisme. C’est dans ce contexte que Creighton écrivit son dernier ouvrage important. Dans Canada’s first century, 1867–1967, publié à Toronto en 1970, il revint à la thèse laurentienne qu’il avait élaborée plus de 30 ans auparavant. Dans The commercial empire of the St. Lawrence, Creighton avait expliqué pourquoi le fleuve Saint-Laurent était à l’origine de l’existence distincte du Canada. Mais il avait en même temps décelé « un certain défaut primaire, une certaine faiblesse fondamentale, dans la société du Saint-Laurent, dans les ressources dont elle disposait pour régler ses problèmes et dans le fleuve lui-même qui avait inspiré l’ensemble de ses efforts. Le Saint-Laurent était un cours d’eau qui se jetait contre les rochers et brisait les espoirs de ses partisans ; et tout ce long combat, qui avait commencé quand les premiers bateaux français avaient remonté le fleuve du Canada, avait servi, au bout du compte, à établir une tradition de défaite. » Les marchands de Montréal qui, en 1849, avaient souhaité l’annexion de la province du Canada aux États-Unis [V. John Redpath*] furent les premiers d’une longue succession de gens prêts à abandonner la promesse du fleuve Saint-Laurent. Ils recherchaient, disaient-ils, « une séparation amicale et pacifique du lien britannique et une union sur des bases équitables avec la grande confédération nord-américaine d’États souverains ». L’annexion n’eut pas lieu ; ce résultat retardait l’inévitable, mais ne pouvait l’empêcher.
Canada’s first century documente cette situation inéluctable et en attribue la responsabilité dans une large mesure à ceux que Creighton appelait en privé les « maudits libéraux ». L’auteur était d’avis que les premiers ministres King, Louis-Stephen St-Laurent et Pearson avaient systématiquement rejeté l’héritage britannique du Canada. Il éprouvait une animosité particulière envers King. Inspiré par l’Anneau du Nibelung de Wagner, Creighton compara l’ancien premier ministre à Alberich, ce nain hideux et minable qui renonce à l’amour pour le pouvoir. Il écrit que King était « un homme de petite taille, plutôt corpulent, au torse en forme de tonneau », dont les leçons de morale camouflaient une quête brutale de pouvoir et qui, par une série d’accords avec les États-Unis pendant la guerre, « enchaîna efficacement » le Canada à son voisin du sud. St-Laurent et Pearson terminèrent le travail : par leurs actions, ils avaient lié davantage le Canada aux États-Unis et avaient fini par rompre ses liens avec la Grande-Bretagne. Ils jouaient le rôle de Hagen, fils d’Alberich, qui, en enfonçant une épée dans le dos de Siegfried, tue le merveilleux jeune héros. La dernière phrase de Canada’s first century montre l’évolution du continentalisme « vers son triomphe ultime ». Creighton avait bouclé son propre cycle de l’anneau ; l’ouvrage de George Parkin Grant*, Est-ce la fin du Canada ? : lamentation sur l’échec du nationalisme canadien, publié en anglais à Toronto cinq ans auparavant, était pour lui un requiem pour son pays.
L’anti-américanisme de Creighton toucha une corde sensible chez de nombreux jeunes gens et la nouvelle gauche. Même si le nationalisme tory et celui de la nouvelle gauche différaient de multiples façons, ils convergeaient sur la question de l’indépendance du Canada – que Creighton appelait son état de séparation – en Amérique du Nord. Influencé par le livre révélateur du politologue de gauche James Laxer, The energy poker game : the politics of the continental resources deal, publié à Toronto en 1970, Creighton prononça, en octobre de cette année-là, une conférence à la collation des grades de l’Université laurentienne de Sudbury, en Ontario, sur la mainmise des États-Unis sur les ressources naturelles du Canada, en particulier ses ressources en énergie. Au terme de son discours, l’auditoire entonna spontanément le Ô Canada. Comme Grant, Creighton était un personnage héroïque pour les jeunes préoccupés de l’avenir du pays. L’auteur et journaliste Larry Zolf dit que l’historien et sa défense énergique du Canada « avaient enfin fait de [lui] un vrai Canadien ».
Creighton prit sa retraite de la University of Toronto en 1971, après 44 années d’enseignement. Mais il ne ralentit guère son rythme. Cette année-là, il fut l’un des trois historiens interviewés par Ramsay Cook dans un film intitulé The craft of history, qui explorait, entre autres thèmes, la relation entre l’historien et le nationalisme. L’été suivant, il voyagea de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, puis vers le nord, à Dawson, au Yukon, pour le tournage de Heroic beginnings, émission télévisée d’une heure produite par la Canadian Broadcasting Corporation en 1973, dans laquelle Creigton jouait le rôle de guide dans 11 sites historiques nationaux liés à des moments clés de l’histoire du Canada. L’ouvrage The craft of history, paru à Toronto en 1973, et celui intitulé Canada : the heroic beginnings, récit complet fondé sur 51 sites historiques, publié l’année suivante, au même endroit, par Macmillan et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et Parcs Canada, attestèrent de la renommée de Creighton comme le chef de file des historiens du Canada anglais.
Creighton continua d’écrire. Towards the discovery of Canada […], recueil d’essais, fut publié à Toronto en 1972. En 1976, il publia au même endroit The forked road : Canada, 1939–1957, son volume dans la série Canadian Centenary, dirigée par William Lewis Morton, pour laquelle il agit à titre d’éditeur-conseil. Enfin, il publia en 1978, toujours à Toronto, Takeover, roman sur le projet de vente d’une vieille distillerie canadienne à des intérêts américains. Il continua aussi de ruminer sur le Canada et son destin. À la suite de la victoire du Parti québécois, dirigé par René Lévesque*, aux élections provinciales de novembre 1976, Creighton publia une attaque ravageuse dans le magazine Maclean’s de Toronto. Le temps était venu, disait-il, de négocier la sécession. Le Canada anglais devait rejeter toute idée d’association économique avec un Québec indépendant. « Il y a quelque chose de particulièrement choquant dans la supposition sereine des dirigeants du Parti québécois que le Québec serait capable de jouir à la fois de toutes les libertés politiques résultant de l’indépendance et de tous les bienfaits économiques de l’union. » Ses amis étaient en colère (Cook qualifia l’article de « pathétique »), mais Creighton ne manifesta aucun repentir.
Focaliser l’attention sur l’homme public risque toutefois de faire oublier l’homme privé. Derrière le critique social au franc-parler et intransigeant se cachait un homme chaleureux, généreux et accueillant. En 1962, en prévision de sa retraite, Creighton et sa femme avaient acheté une maison historique dans la petite ville de Brooklin, à l’est de Toronto. Rien ne leur faisait plus plaisir que d’ouvrir la maison à leurs nombreux amis. Déjeuners, dîners et réceptions étaient des activités merveilleuses où les conversations animées portaient sur une gamme de sujets allant de la politique à la littérature, en passant par le jardinage, la musique et l’art.
Parmi ceux qui étaient les bienvenus au domicile de Creighton se trouvaient beaucoup de ses anciens étudiants. Il prenait l’enseignement à cœur, en particulier à la maîtrise et au doctorat, et il dirigea 22 candidats au doctorat, notamment les historiens Peter Busby Waite, Ramsay Cook, Henry Vivian Nelles et James Rodger Miller. Ce dernier se rappellerait que Creighton était un excellent directeur de thèse. Lorsque, jeune étudiant, il commença à lui envoyer des chapitres de sa thèse, « il était merveilleux. Il retournait un chapitre en quelques jours. Il faisait des suggestions, mais ajoutait toujours quelque chose comme “Rappelez-vous, ce sont des suggestions et non des directives”. Il me traitait vraiment comme un égal, comme un collègue. » Waite garde en mémoire que Creighton « respectait les preuves ; vous pouviez lui dire n’importe quoi si pouviez étayer vos propos par des documents ». Minutieux, il était aussi plein de sollicitude. Il se préoccupait de l’effet de la lecture prolongée de microfilms sur la vision d’un étudiant, rappelait à un autre de bien s’alimenter et de se ménager, et conseillait à un troisième de ne pas s’inquiéter de sa thèse et de s’amuser avec son bébé.
Creighton et sa femme se faisaient plaisir en voyageant. Au moins une fois par année, de la fin des années 1960 au milieu des années 1970, ils passaient leurs vacances en Europe. En septembre 1970, ils séjournèrent en France, où ils visitèrent leurs lieux de prédilection à Paris et se rendirent à Chartres pour une journée. Pendant la visite de la cathédrale, Creighton fut submergé de chagrin. Il se rappela que, 18 ans plus tôt, ils avaient amené Laura Mary Cynthia, qui avait 12 ans à l’époque, voir ce magnifique monument. L’image de leur fille baignant dans la lumière du soleil filtrée par l’un des nombreux vitraux était restée gravée dans sa mémoire pendant toutes ces années. Laura Mary Cynthia était maintenant une adulte et une trotskiste. Creighton éprouva le même sentiment, dit-il, que lorsqu’il avait lu les listes de victimes de la Grande Guerre dans de vieux journaux. Il aimait ses enfants, mais c’était un homme difficile, et sa fille, qui vivait désormais à Vancouver, s’était beaucoup éloignée de lui.
Au fil de sa longue carrière, Creighton reçut de nombreuses récompenses, entre autres la médaille J. B. Tyrrell en histoire, en 1951, décernée par la Société royale du Canada en reconnaissance d’une contribution exceptionnelle à l’histoire du Canada, la University of British Columbia President’s Medal for Biography, en 1955, et le prix Molson, en 1964, première année où le Conseil des arts du Canada décerna ce prix pour souligner une contribution remarquable au domaine des arts et des lettres. Creighton faisait partie du groupe inaugural de compagnons récipiendaires de l’ordre du Canada après sa création en 1967 et, l’année suivante, il reçut de la University of Toronto le titre de professeur d’université, deuxième personne seulement, après Herman Northrop Frye*, à obtenir cette distinction. Des établissements de partout au Canada, de la Memorial University of Newfoundland à la University of Victoria en Colombie-Britannique, lui décernèrent des doctorats honorifiques.
Le 19 décembre 1979, Creighton mourut à son domicile d’un cancer colorectal. Le lendemain, dans un éditorial, le Globe and Mail de Toronto le décrivit comme « l’un des premiers grands historiens du Canada » et assura que sa « plume rendra[it] l’histoire du Canada vivante pour les Canadiens qui n’étaient pas nés lorsqu’il l’écrivit ».
En fait, même si, au début du xxie siècle, on trouverait toujours sur le marché The empire of the St. Lawrence et la biographie de sir John Alexander Macdonald, les livres de Donald Grant Creighton seraient rarement lus ou consultés par les historiens. De plus, son thème central, la thèse laurentienne, a pratiquement été mis aux oubliettes. L’historien Fernand Ouellet, dans son Histoire économique et sociale du Québec, 1760–1850 : structures et conjoncture, publiée à Montréal en 1966, remit en question certaines assertions de l’ouvrage The empire of the St. Lawrence, celle, par exemple, que le déclin de la traite des fourrures à Montréal, aurait eu lieu dans la dernière décennie du xviiie siècle. Aspect plus important, Ouellet n’attribua pas de vision nationale aux commerçants de Montréal, tout comme son étudiant Allan Robert Greer, qui faisait remarquer, dans Habitants, marchands et seigneurs : la société rurale du bas Richelieu, 1740–1840, publié en anglais à Toronto en 1985 : « N’en déplaise à l’idéologie creightonienne, il n’y avait rien de très révolutionnaire, d’héroïque ou même de progressiste » dans l’intrusion du capital marchand dans la vallée du fleuve Saint-Laurent. Par ailleurs, selon l’historien Michael Bliss, la thèse laurentienne fut toujours une thèse à la recherche de preuves. Les marchands de Montréal, fit-il observer, n’envisageaient pas une nation nordique ; au contraire, ils « pensaient à la santé de leurs entreprises d’abord et avant tout » et affirmer autre chose relève de la fantaisie romantique. Dans une perspective ultérieure, antinationale, la quête d’une nation rend Creighton au mieux dépassé et, au pire, exclusif. Mais il était le produit de son époque et, parmi ses contemporains, aucun autre historien n’écrivit aussi bien ni n’atteignit autant de lecteurs. En 2006, la Literary Review of Canada rangea The commercial empire of the St. Lawrence et les deux volumes de la biographie de Macdonald parmi les 100 livres canadiens les plus importants.
Au moment de la publication de cet article, nous préparions une biographie plus complète de Donald Grant Creighton.
Les principales sources manuscrites sur la vie de Creighton se trouvent à Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), dans le fonds Donald Grant Creighton (R5269-0-3), et au Special Coll. Dept. de la Univ. of Waterloo Library, Ontario, dans le Luella Creighton fonds (GA 99).
La fille de Creighton, Cynthia Flood, a publié « My father took a cake to France ». Cette nouvelle est basée sur son interpretation d’un moment dans la vie de son père tel qu’il lui a raconté et se trouve dans la collection My father took a cake to France (Vancouver, 1922), 41–54.
Outre les ouvrages cités dans la biographie, Creighton a écrit Harold Adams Innis : portrait of a scholar (Toronto, 1957), The story of Canada (Toronto, 1959), et The road to confederation : the emergence of Canada, 1863–1867 (Toronto, 1964). Il est également l’auteur d’essais parus dans des recueils, ainsi que dans des périodiques savants et populaires. The commercial empire of the St. Lawrence, 1760–1850 (Toronto, 1937) a été réédité sous le titre The empire of the St. Lawrence (Toronto, 1956), et The story of Canada a également fait l’objet de rééditions (1re éd. américaine, Boston, 1960 ; nouv. éd. rév., Toronto, 1971). A long view of Canadian history [...] (Toronto, 1959) contient des conversations de Creighton avec Paul Fox sur la chaîne de télévision Canadian Broadcasting Corporation en 1959. Une liste des écrits universitaires que Creighton a fait paraître jusqu’en 1970 figure dans Character and circumstance : essays in honour of Donald Grant Creighton, J. S. Moir, édit. (Toronto, 1970), 235–239. Un recueil d’essais déjà publiés, The passionate observer : selected writings (Toronto, 1980), a paru à titre posthume.
Plusieurs ouvrages de Creighton ont été traduits en français. En voici les titres, présentés en ordre chronologique : l’Amérique britannique du Nord à l’époque de la Confédération : étude préparée pour la commission royale des relations entre le dominion et les provinces [traduction de British North America at confederation : a study prepared for the royal commission on dominion-provincial relations] (Ottawa, 1939) ; Canada : les débuts héroïques [traduction de Canada : the heroic beginnings, publiée par les Éditions Quinze, conjointement avec Parcs Canada et le Centre d’édition du gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada] (Montréal, 1979) ; et Take-over [traduction de Takeover], Jacques de Roussan, trad. (Montréal, 1980). La biographie de John Alexander Macdonald a été traduite sous le titre principal John A. Macdonald : le 1er premier ministre du Canada. Les deux volumes ont chacun un sous-titre : le Haut et le Bas-Canada et la Naissance d’un pays incertain, Ivan Steenhout, trad. (Montréal, 1981).
Bibliothèque et Arch. Canada, R2285-0-0.— Univ. of Oxford, Balliol College Arch. & mss (Angleterre), Student files, D. G. Creighton.— Univ. of Toronto Arch. and Records Management Services, B1997-0031 ; B2005-0011 ; B2006-0015.— Victoria Univ. Library, Special Coll. (Toronto), F 2021 (Victoria Univ. president’s office fonds).— Acta Victoriana (Toronto), 49, no 1 (octobre 1924) : 18 ; no 6 (mars 1925) : 21.— Allan Anderson, « Out of the turmoil comes a new awareness of ourselves » [entrevue avec D. G. Creighton], Univ. of Toronto, Graduate (Toronto), 1 (juin 1968), no 4 : 38–46.— Carl Berger, The writing of Canadian history : aspects of English-Canadian historical writing since 1900 (2e éd., Toronto, 1986).— Sarah Bonesteel, « Luella Bruce Creighton : a writer’s diary : a feminist study of the life and experiences of a twentieth century Canadian author » (mémoire de m.a., Univ. of Waterloo, 2001).— Robert Bothwell, Laying the foundation : a century of history at University of Toronto (Toronto, 1991).— Lionel Groulx, la Naissance d’une race : conférences prononcées à l’université Laval (Montréal, 1918–1919) ([Montréal], 1919).— J. E. Igartua, « “Ready, aye, ready” no more ? Canada, Britain, and the Suez crisis in the Canadian press », dans Canada and the end of empire, Phillip Buckner, édit. (Vancouver et Toronto, 2005), 47–65.— Raymond Massey, « My Oxford », dans My Oxford, Ann Thwaite, édit. (Londres, 1977), 35–58.— Philip Massolin, Canadian intellectuals, the Tory tradition, and the challenge of modernity, 1939–1970 (Toronto, 2001).— Kenneth McNaught, Conscience and history : a memoir (Toronto, 1999).— Reba Soffer, « Nation, duty, character and confidence : history at Oxford, 1850–1914 », Hist. Journal (Cambridge, Angleterre), 30 (1987) : 77–104.— Charles Taylor, Radical Tories : the conservative tradition in Canada (Toronto, 1982).— P. E. Trudeau, « la Nouvelle Trahison des clercs », dans P. E. Trudeau, À contre-courant : textes choisis, 1939–1996, Gérard Pelletier, édit., (Montréal, 1996), 157–185.— P. B. Waite, « Donald Grant Creighton, 1902–1979 », SRC, Délibérations, 4e sér., 18 (1980) : 73–77.— Donald Wright, The professionalization of history in English Canada (Toronto, 2005).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Donald Wright, « CREIGHTON, DONALD GRANT », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 20, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/creighton_donald_grant_20F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/creighton_donald_grant_20F.html |
| Auteur de l'article: | Donald Wright |
| Titre de l'article: | CREIGHTON, DONALD GRANT |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 20 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2013 |
| Année de la révision: | 2013 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |