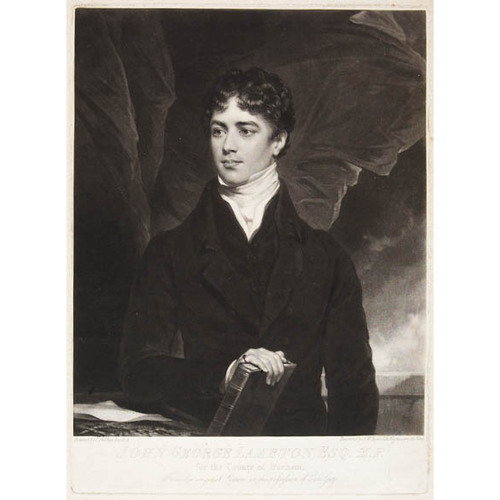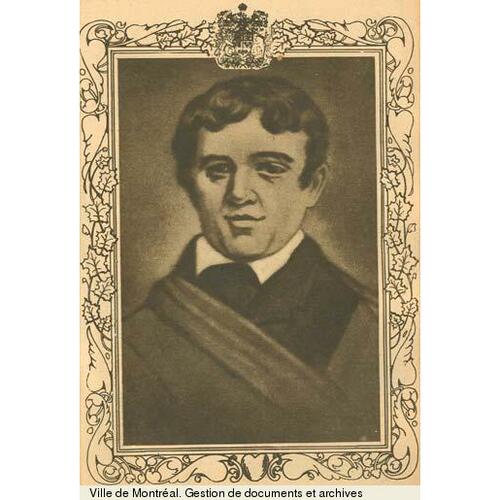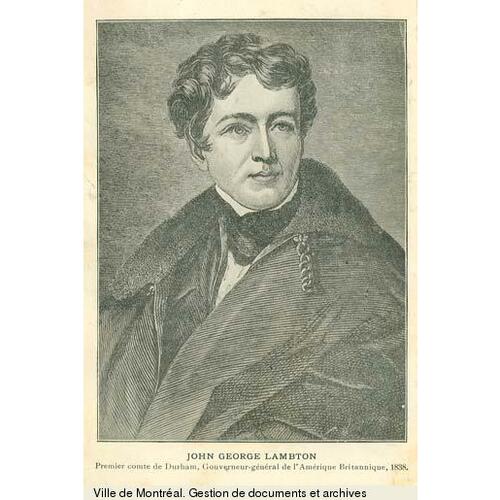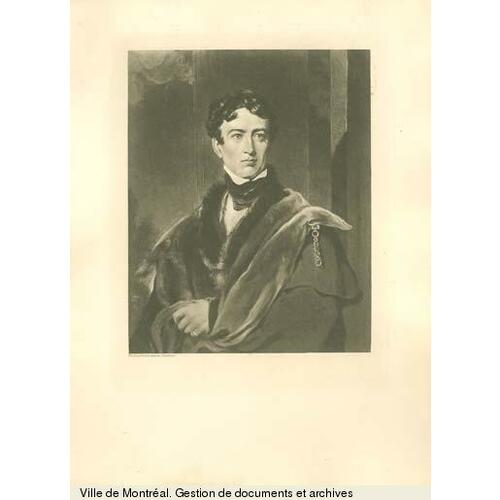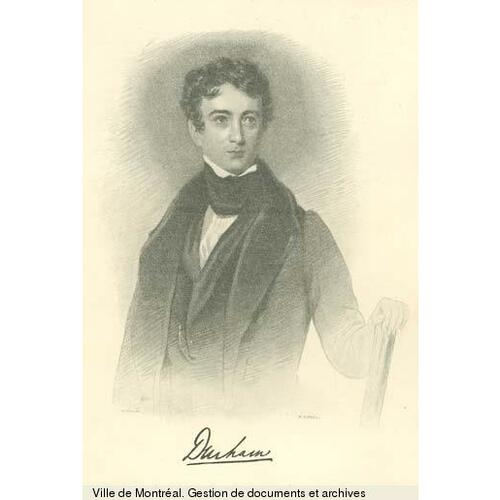Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
LAMBTON, JOHN GEORGE, 1er comte de DURHAM, administrateur colonial, né le 12 avril 1792 à Londres, fils aîné de William Henry Lambton et de lady Anne Barbara Frances Villiers, fille de George Villiers, 4e comte de Jersey ; le 1er janvier 1812, il épousa à Gretna Green, Écosse, Harriet Cholmondeley, et ils eurent trois filles, puis le 9 décembre 1816 lady Louisa Elizabeth Grey, et de ce mariage naquirent deux fils et trois filles ; décédé le 28 juillet 1840 à Cowes, île de Wight.
John George Lambton appartenait à une famille aristocratique qui habitait la vallée de la Wear, dans le nord de l’Angleterre, depuis le xiie siècle au moins. Son ancêtre le plus lointain dont la carrière peut être suffisamment documentée, le seigneur féodal Robert de Lambton, était mort en 1350. Par le jeu des alliances matrimoniales, presque toujours conclues en fonction des intérêts des familles et des affinités sociales, les Lambton s’étaient avec le temps liés aux plus grandes familles anglaises et ils s’étaient même apparentés d’une certaine façon à la royauté. Dans ce milieu privilégié, les traditions militaires et l’attrait pour la carrière politique étaient bien enracinés. C’est ainsi que, tout comme son père avant lui, William Henry Lambton avait été élu député à la chambre des Communes, où il représenta la cité de Durham de 1787 à 1797.
La famille Lambton tirait une part importante de ses revenus de l’exploitation des mines de charbon qui se trouvaient sur ses terres. Vers 1812, cette activité lui rapportait environ £80 000 (cours d’Angleterre) annuellement. En 1833, 2 400 mineurs travailleraient pour lord Durham. Les Lambton entretenaient donc à différents titres de multiples rapports avec la bourgeoisie marchande et industrielle. Et, même si l’attachement sans réserve de Lambton à l’héritage aristocratique allait de soi, cela ne l’empêchera pas de célébrer à sa façon la montée des classes moyennes et d’entretenir avec les ouvriers de sa région, les siens et les autres, des rapports qui n’étaient pas du tout habituels parmi les grands possédants. Il faut dire à cet égard que les tendances radicales n’étaient pas nouvelles dans la famille, puisque le père de John George s’était fait lui-même une réputation de jacobin : en 1792, il faisait partie des créateurs de la Society of the Friends of the People. Cette société l’avait alors chargé de présenter au Parlement une pétition dans laquelle on réclamait avec vigueur une réforme des Communes anglaises.
John George Lambton n’avait pas eu cependant tellement le temps d’être marqué par son père qui mourut de tuberculose en 1797, à l’âge de 33 ans. Le jeune garçon n’avait alors que cinq ans. Sa mère, qui se remaria peu après avec Charles William Wyndham, ne semble pas, à vrai dire, avoir eu le goût de s’occuper elle-même de ses enfants. Aussi John George et son frère William Henry allèrent habiter, jusqu’à ce que le premier ait 13 ans, chez un ami de la famille, le docteur Thomas Beddoes, scientiste aux idées radicales bien connues. John George était hypersensible, de santé fort fragile et, si l’on en croit l’historien Chester William New, il souffrit énormément à la fois de la perte de son père et de l’attitude de sa mère.
Après avoir étudié sous la direction de précepteurs, Lambton s’inscrivit en 1805 à l’Eton College et y resta quatre années. Chose surprenante de la part d’un garçon de santé aussi délicate, au lieu de se diriger vers l’université à la fin de ses études collégiales, il opta immédiatement pour la carrière militaire et, en 1809, joignit en qualité de cornette le 10th Royal Hussars. Imprévisible, il le fut également lorsque, le 1er janvier 1812, il s’enfuit à Gretna Green avec Harriet Cholmondeley qu’il épousa contre la volonté de ses tuteurs. Il faut dire que les choses s’arrangèrent malgré tout assez vite, puisque quelques semaines plus tard le couple accepta de reprendre l’exercice du commencement à la fin. Ce mariage ne dura que trois ans car Harriet mourut de tuberculose en 1815. Consterné par cet événement tragique, Lambton songea à abandonner la nouvelle carrière qu’il avait embrassée depuis son élection en septembre 1813 à titre de représentant du comté de Durham à la chambre des Communes. Il conserva toutefois son siège jusqu’en 1828.
Lambton était, dit-on, de taille légèrement supérieure à la moyenne et élégant. Comme la plupart des membres de sa classe, il adorait les courses de chevaux, la chasse et la pêche mais, plus que la moyenne d’entre eux, il aimait les arts, l’histoire et la politique. Si l’on se fie à ses nombreux détracteurs, il aurait surpassé presque tous les aristocrates par son arrogance, sa vanité et son goût de la magnificence. Pourtant, aucun de ses adversaires n’osa jeter sérieusement le moindre doute sur son exceptionnelle indépendance d’esprit, son courage, sa franchise et sa sincérité. Sir Henry Thomas Liddell qui, en lui retirant son appui politique, reprocherait à Lambton son zèle réformiste, révolutionnaire sous-entendrait-il, en sut quelque chose. En effet, celui-ci lui répliquerait sans ménagement : « Je tiens à dire que j’éprouve de la gratitude pour votre franchise, de la compassion pour vos inquiétudes, peu de crainte devant votre opposition et nul besoin de votre appui. » Lambton avait tout ce qu’il fallait pour mener une carrière de réformiste politique et d’aucuns crurent même qu’il pourrait dans un avenir prochain devenir le chef d’un parti whig renouvelé. Sa santé et bien d’autres circonstances l’empêchèrent d’entrer dans ces vues.
Lambton fut, à n’en pas douter, un authentique réformiste. New le décrit assez justement comme un whig radical et un radical modéré. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il appuya les grandes mesures réformistes de son temps : les droits des non-conformistes, l’émancipation des catholiques, la liberté du commerce, l’éducation pour tous, la création des instituts des artisans et de l’University of London. Le domaine où Lambton œuvra davantage pendant la première partie de sa carrière fut celui de la réforme parlementaire. Bien que les historiens diffèrent d’opinions quant à la nature de sa contribution à ces débats, il faut admettre qu’il a, avec lord Grey, lord John Russell et lord Brougham, une place privilégiée en ce qui concerne le Reform Bill de 1832.
Il est difficile de dire, puisqu’il ne souleva ouvertement la question de la réforme électorale qu’en 1819, quelles étaient les visées exactes de Lambton quand il entra en politique sous la bannière des whigs. Mais on peut supposer qu’en peu de temps il devint conscient de la mésadaptation du système électoral anglais, dont il connaissait sans doute les points faibles. Ce qui l’avait certainement frappé, c’est l’extraordinaire sur-représentation des bourgs par rapport aux comtés, et il savait également que ce système électoral favorisait au maximum la gentry et l’aristocratie aux dépens des classes moyennes et des milieux populaires. Le 17 avril 1821, il déposa en chambre un projet de loi, préfiguration de celui de 1832, qui visait à abolir les bourgs pourris et à étendre le droit de vote. Toutefois, l’opposition farouche des tories et les incertitudes des whigs face à ce projet contribuèrent à sa défaite. En fait, sans pour autant exclure tous les ouvriers de ce festin, c’est à un partage du pouvoir entre l’aristocratie, les classes moyennes et certaines couches populaires que Lambton invitait ses compatriotes en hissant l’emblème de la réforme. Il n’était pas encore disposé à recommander le suffrage universel, il est vrai, mais il favorisait le vote secret et appuyait l’idée d’un renouvellement plus fréquent du mandat des députés.
Lambton avait en particulier compris le rôle déterminant qu’avaient joué les classes moyennes dans l’édification de l’Angleterre industrielle et urbaine. Il en parlait avec enthousiasme et, à ce groupe social, il reconnaissait une suprématie sur le plan des richesses et une égalité quant à la compétence, au talent et à l’intelligence politique. Tous ces facteurs justifiaient pleinement à ses yeux les revendications de cette classe qui voulait participer de plein droit au pouvoir politique. Cette attitude lui valut la sympathie, la confiance et l’appui des éléments radicaux modérés, d’origine bourgeoise, qui agissaient sur l’opinion par l’entremise des journaux, des associations politiques et qui, à ce niveau, étaient en contact constant avec les éléments populaires sensibilisés à l’idée de réforme.
Lambton fut donc pour les aristocrates whigs un personnage à la fois inquiétant et indispensable. Cet aristocrate idéaliste, qui fut créé baron Durham le 29 janvier 1828, ne cessa de les inciter à aller plus loin qu’ils ne le voulaient. Par contre, surtout au moment des crises répétées qui s’échelonnèrent de 1830 à 1832, tout en les exhortant à aller aussi loin qu’ils le devaient, il s’avéra un intermédiaire fiable entre eux, les classes moyennes et les milieux populaires. Tout considéré, il n’est pas étonnant qu’après l’arrivée au pouvoir des whigs en 1830 sous la direction de lord Grey, son beau-père, on ait confié à Durham la présidence d’un comité chargé de préparer un projet de loi sur la réforme parlementaire. Pendant cette période d’extrême agitation qui se termina le 7 juin 1832 et dont l’issue resta douteuse jusqu’à la fin, le baron Durham joua un rôle qui ne laisse planer aucun doute sur la nature de son engagement. À aucun moment il n’eut tendance à accepter l’idée que l’adoption de la loi constituerait la dernière étape de la réforme parlementaire. Si, finalement, ni la bourgeoisie ni les milieux populaires ne trouvèrent vraiment leur compte ou tout leur compte dans la loi de 1832, la responsabilité en revient certes à l’aristocratie mais aussi aux craintes qu’éprouvait alors la bourgeoisie à l’endroit des milieux populaires et, faut-il ajouter, aux réactions similaires de certains membres de « l’aristocratie de la classe ouvrière ».
La période qui va de l’adoption du Reform Bill jusqu’à la nomination en 1835 de lord Durham à titre d’ambassadeur en Russie est l’une des plus difficiles dans l’existence et la carrière de ce dernier. Évidemment, les honneurs ne lui firent pas défaut : le 23 mars 1833, le baron Durham fut élevé aux rangs de vicomte Lambton et de comte de Durham. Cependant, une suite presque interminable de malheurs domestiques l’affligèrent et l’affectèrent physiquement et moralement. En effet, il eut à pleurer la mort de son fils aîné Charles William, décédé le 24 décembre 1831 à l’âge de 13 ans, et celle de sa mère, l’année suivante. Il perdit ensuite en l’espace de quatre ans tous les enfants issus de son premier mariage. À la même époque, il rompit avec des compagnons de vieille date, et sa rupture avec lord Brougham fut un événement public important. Enfin son retrait définitif du cabinet en 1833, à la suite de mésententes répétées avec lord Grey sur des questions diverses liées à l’idée de réforme, marqua certainement pour lui le début de l’isolement.
Même si on mentionna fréquemment le nom de Durham comme futur chef des whigs après 1830, il semble au contraire que ses chances d’accéder à ce poste devinrent alors de plus en plus minces. Ce ne fut pas tout à fait un hasard si, avec l’encouragement de ses chefs, sa carrière, particulièrement après 1832, prit une tournure nouvelle, davantage orientée vers les affaires extérieures. Sur la scène internationale, Durham se trouva mêlé à l’accession à l’indépendance de la Belgique et de la Grèce, à l’élévation du prince Léopold au trône de Belgique, avant de se voir confier une mission auprès du tsar en juillet 1832. De plus, lorsque lord Melbourne devint premier ministre en 1835, il s’empressa de nommer Durham ambassadeur en Russie. Celui-ci y fut décoré de l’ordre de Saint-André, de l’ordre d’Alexandre Nevski, de l’ordre de Sainte-Anne-de-Russie et de l’ordre de l’Aigle blanc de Russie. Il revint en Angleterre deux ans plus tard et on le décora de l’ordre du Bain.
Durham était à peine installé en Angleterre que Melbourne lui proposa, le 22 juillet 1837, de remplir une autre mission à l’extérieur du pays. Cette fois, il s’agissait du Canada où s’envenimait une crise qui, selon la plupart des observateurs, paraissait insoluble. Durham refusa catégoriquement. Toutefois en décembre, après la première rébellion qui frappa à la fois le Haut et le Bas-Canada, Melbourne revint à la charge en lui promettant des pouvoirs quasi dictatoriaux à titre de gouverneur en chef des colonies de l’Amérique du Nord britannique et de commissaire enquêteur. Durham se laissa convaincre.
Du jour où il accepta sa nomination, soit le 15 janvier 1838, jusqu’à son départ pour le Canada, le 24 avril suivant, Durham ne resta pas inactif. En plus de prendre connaissance des dossiers du ministère des Colonies et de discuter avec son personnel le mieux au fait de la situation des colonies, il fut directement en contact, en Angleterre même, avec des hommes engagés à différents titres dans les affaires canadiennes, comme George Moffatt*, William Badgley*, Louis-Hippolyte La Fontaine*, Edward Ellice* et John Arthur Roebuck*. Il procéda de plus à la sélection de son propre personnel, notamment Charles Buller, Edward Gibbon Wakefield* et Thomas Edward Michell Turton.
Le 27 mai 1838, le Hastings jetait l’ancre à Québec. Deux jours plus tard, Durham mettait pied à terre et s’empressait de lancer une proclamation dans laquelle il promettait à tous de faire preuve d’un esprit ouvert et de les traiter de façon juste. Le 1er juin, il dissolvait le Conseil spécial qui, avec le Conseil exécutif, avait été chargé de régler les affaires les plus urgentes depuis la suspension de la constitution le 10 février précédent. Le lendemain, il formait son propre Conseil exécutif duquel étaient exclus les membres de l’ancien corps. Buller, Turton, le colonel George Couper, Randolph Isham Routh* et Dominick Daly* y accédaient. Le 28 juin, Durham mit sur pied un nouveau Conseil spécial qui comprenait le vice-amiral sir Charles Paget, sir James Macdonell*, le lieutenant-colonel Charles Grey, Buller et Couper.
De tous les problèmes que le nouveau gouverneur eut à résoudre dans l’immédiat, aucun n’était plus urgent et délicat que le sort des prisonniers politiques bas-canadiens. En effet, 326 détenus avaient déjà été libérés par sir John Colborne*, mais il en restait toujours 161 dans les cachots, qui attendaient leur procès. Durham ne tarda pas à comprendre qu’en suivant la méthode expéditive du lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, sir George Arthur*, qui avait fait exécuter quelques prisonniers, il risquait d’envenimer la situation au point de la rendre à jamais insoluble. Il n’avait d’autre part aucun doute quant au caractère dangereux de tout exercice qui nécessiterait le recours à des jurés, car l’état des esprits était tel dans la province que le choix d’un jury impartial paraissait dans les circonstances impossible à réaliser. Pour être clément, tout en reconnaissant la gravité des gestes posés, Durham se sentit donc obligé de recourir à une stratégie dont la réussite dépendait de la capacité de ses agents d’amener les principaux détenus à reconnaître leur culpabilité. Le 26 juin, huit d’entre eux, parmi lesquels Wolfred Nelson*, Siméon Marchesseault* et Rodolphe Des Rivières, signèrent une déclaration en ce sens. Deux jours plus tard, Durham rendit publique sa décision de déporter aux Bermudes les signataires du document du 26 et d’interdire à 16 autres personnes éminentes du parti patriote, dont Louis-Joseph Papineau*, Cyrille-Hector-Octave Côté et Édouard-Étienne Rodier, toutes réfugiées aux États-Unis, de rentrer au pays sous peine de mort. Les autres détenus, à l’exception de ceux qui avaient participé à l’exécution de Joseph Armand, dit Chartrand, et du lieutenant George Weir, bénéficièrent d’une amnistie.
Les Bas-Canadiens et, dans un premier temps, les whigs eux-mêmes, y inclus ceux qui lui étaient hostiles, avaient reconnu la sagesse de la solution de Durham. Pourtant, le jour où lord Brougham se mit à dénoncer les aspects illégaux des décisions de Durham, notamment le fait d’avoir exilé, sans procès, de simples accusés, dans une colonie où il n’avait aucune juridiction, et d’avoir de plus prononcé la peine de mort contre des fugitifs, le vent se mit à tourner. Durham perdit en peu de temps l’appui des membres de son parti et celui de son chef, Melbourne, qui donna sa caution au désaveu de l’ordonnance du 28 juin. Durham n’apprit ce désaveu que le 19 septembre, dans un journal de New York. Il eut alors la certitude que, pour des raisons étrangères à sa mission, la haute direction de son parti l’avait trahi. Dès lors, sa démission devenait inévitable et irréversible. Le 9 octobre 1838, en même temps qu’il rendit publics les documents relatifs à son désaveu, Durham annonça officiellement qu’il résignait son poste et rentrait en Angleterre. Le 1er novembre, il s’embarquait sur l’Inconstant, à bord duquel il arriva à Plymouth, en Angleterre, le 26 et à Londres, le 7 décembre.
Ce geste ne marqua cependant pas le dénouement ultime de la mission de lord Durham. Car dès les premières semaines de son séjour au Canada le gouverneur avait mis au point un calendrier de travail très chargé. Celui-ci, en plus d’inclure un agenda très lourd de rencontres sociales, comportait de fréquentes entrevues avec des personnages représentatifs de la société coloniale, des voyages dans les Canadas et, surtout, la mise sur pied de commissions chargées d’enquêter sur différents aspects de la vie coloniale : la colonisation, l’immigration, l’éducation, les institutions municipales, la commutation du régime seigneurial dans l’île de Montréal, les bureaux d’enregistrement, la police et le système judiciaire. Du 18 juin au 25 août, six de ces groupes de travail avaient été créés et s’étaient mis immédiatement à l’œuvre.
Ces comités fonctionnèrent si bien que le jour où Durham quitta le Canada il avait déjà une idée assez précise du contenu de son rapport. Il ne lui restait plus qu’à le rédiger, tâche qui l’accapara jusqu’à la fin de janvier 1839. Les épreuves du rapport furent soumises aux ministres le 31 janvier, quatre jours avant que le rapport ne soit présenté au ministère des Colonies. Entre-temps, on ne sait comment, ce document commença à paraître dans le Times de Londres, de sorte que le public anglais en connut les éléments essentiels avant que le Parlement en soit officiellement saisi, le 11 février suivant.
Lorsque Durham avait quitté l’Angleterre pour accomplir sa mission canadienne, il avait le sentiment que sa tâche ne serait pas très compliquée. En effet, il croyait découvrir en Amérique du Nord, y compris dans le Bas-Canada, le type de conflits, si fréquents en Europe, auxquels lui-même avait été mêlé en Angleterre lorsqu’il s’était engagé dans le mouvement pour la réforme parlementaire. Cette crise dont il pensait déceler sans peine les manifestations serait, à n’en pas douter, d’abord politique et ensuite sociale. À telle enseigne qu’il suffirait simplement de réformer la constitution pour faire disparaître la source du mal. C’est après sa venue au Canada que Durham en arriva à la conclusion que, vue sous l’angle exclusif d’un besoin de réforme, la solution de la crise, dans le cadre des institutions britanniques, impliquait comme mesure essentielle l’instauration d’un gouvernement responsable. À l’occasion d’une visite que Durham avait faite dans le Haut-Canada, Robert* et William Warren Baldwin avaient d’ailleurs eu l’occasion d’attirer son attention sur ce point capital à leurs yeux.
La position de Durham au sujet de l’extension de la responsabilité ministérielle aux colonies n’était pas différente de celle qu’il avait adoptée à propos de la réforme parlementaire. Selon lui, le gouvernement britannique, en accordant le gouvernement responsable aux colonies, loin de les inciter à devenir indépendantes, non seulement mettrait fin aux luttes stériles et à la violence mais consacrerait la pérennité de certains liens entre l’Angleterre et ses dépendances. « J’admets, écrivit-il, que le régime que je propose placerait de fait la politique intérieure de la colonie dans les mains des colons eux-mêmes [...] La forme de gouvernement, la réglementation des relations extérieures et du commerce avec la mère patrie, les autres colonies britanniques et les nations étrangères, la concession des terres publiques, voilà les seuls points que la mère patrie a besoin de contrôler. » Si Durham avait cru que la crise qu’il avait à résoudre pouvait se réduire seulement à une lutte de classes ou à un conflit entre le pouvoir exécutif et l’Assemblée populaire, il aurait eu les mains libres pour rédiger un rapport centré sur les bienfaits du gouvernement responsable pour les six colonies. Mais en analysant la situation au Bas-Canada, où « la lutte représentée comme une lutte de classes était de fait une lutte de races », il ne pouvait alors se confiner dans un discours sur le gouvernement responsable.
En examinant de plus près la teneur du rapport de Durham, il faut bien se rendre compte que ses conclusions furent beaucoup moins le résultat de considérations ethniques que l’expression de son libéralisme et de sa grande sympathie pour le rôle historique des classes moyennes. On peut croire qu’en bon libéral il eut tendance, parce qu’il retrouva chez les Canadiens français les institutions d’Ancien Régime qui fonctionnaient comme en France autrefois, à simplement reporter sur ces derniers le mépris qu’il éprouvait pour la France absolutiste et féodale. Contrairement à la plupart des autres sociétés contemporaines, il manquait à cette société canadienne-française un ingrédient capital aux yeux de Durham : une forte classe moyenne. C’est précisément à l’absence parmi les Bas-Canadiens francophones de ce groupe qui, selon lui, avait joué un rôle prédominant dans la Révolution française, la révolution industrielle en Angleterre et qui avait imprimé au développement des États-Unis son allure progressiste, que Durham attribuait le caractère paysan de la société canadienne-française : « La société dans son ensemble montra dans le Nouveau Monde les traits propres aux paysans d’Europe. » Il est vrai aussi que Durham avait noté tant chez les francophones que chez les anglophones l’existence d’éléments qui, mis ensemble, auraient pu constituer une solide classe moyenne. Mais lorsqu’il discute les agissements des Canadiens français membres des professions libérales, loin de voir en eux des agents du progrès social, il les définit, bien qu’ils aient régulièrement utilisé le langage du libéralisme et de la démocratie, comme les principaux défenseurs de l’ordre ancien contre les forces nouvelles. Ces forces vraies du développement, il parvint néanmoins à en découvrir la présence dans le milieu anglophone. C’est parmi les marchands, obligés qu’ils furent pour se protéger de chercher un appui auprès des gouverneurs et de la métropole, qu’auraient fermenté les projets de réforme les plus susceptibles d’assurer le progrès économique et le changement social. Mais leur action se trouva, dit-il, paralysée par un conflit si profond que toute la vie coloniale en devint imprégnée. « Je m’attendais, affirme Durham, à trouver un conflit entre un gouvernement et un peuple ; je trouvai deux nations en guerre au sein d’un même État ; je trouvai une lutte, non de principes, mais de races. Je m’en aperçus : il serait vain de vouloir améliorer les lois et les institutions avant que d’avoir réussi à exterminer la haine mortelle qui maintenant divise les habitants du Bas-Canada en deux groupes hostiles : Français et Anglais. »
Durham n’avait pas voulu construire son analyse autour du concept de race, geste qu’il aurait lui-même trouvé révoltant s’il avait eu le sentiment d’avoir procédé ainsi. Mais dans son rapport, ses réactions aux oppositions nationales qui divisaient alors le milieu bas-canadien sont tellement vives qu’il en arrive finalement à presque tout ramener à l’idée de race. Ainsi envisagée, la situation lui parut à ce point irrémédiable et la société canadienne-française si figée et irrécupérable qu’il en vint à préconiser une solution aussi irréaliste et contraire aux principes libéraux que celle de leur assimilation à une culture qu’il jugeait supérieure. En tout cas, il ne fait pas de doute que c’est sa grande préoccupation au sujet de la question ethnique qui l’incita à rejeter l’idée de fédération au profit de celle d’une union législative. Cette recommandation, il est vrai, fut assortie d’une proposition ferme en faveur du gouvernement responsable. Il faut cependant ajouter que, pour réaliser l’assimilation, Durham comptait essentiellement sur le poids des forces démographiques qui, il en était sûr, jouerait en faveur des anglophones, plutôt que sur les simples contraintes légales et institutionnelles.
Cette question de l’union des Canadas, comme celle de l’autonomie des colonies, était dans l’air depuis trois décennies. Les marchands anglophones de Montréal et de Québec n’avaient cessé depuis 1810 de réclamer la réunion des Canadas sous un gouvernement unique. Après l’échec du projet d’union de 1822, sans cependant abandonner leur revendication de base, ils avaient demandé l’annexion de Montréal au Haut-Canada. C’est de l’ensemble de ces problèmes qui agitaient depuis si longtemps les sociétés coloniales et qui avaient leur résonance dans la métropole que Durham avait voulu traiter dans son rapport afin d’y proposer des solutions. Pourtant, Londres n’accepta ni l’idée d’un gouvernement responsable ni celle d’une union législative telle qu’il l’avait définie. Modifié comme il le fut par les clauses sur l’égalité de la représentation, l’Acte d’Union de 1840 ne respectait pas la priorité des principes qu’avait énoncés Durham. Cela dit, il n’en reste pas moins que le débat dans lequel il s’était engagé et dont il avait tenté, plus que tout autre avant et après lui, de faire le tour, ne devait être clos ni en 1841, avec l’union du Bas et du Haut-Canada, ni même avec l’obtention de la responsabilité ministérielle en 1848.
Depuis son enfance, John George Lambton avait été constamment menacé de tuberculose. Son père, sa première femme et quatre de ses enfants en furent avant lui les victimes. Pendant toute sa vie, lorsqu’il ne fut pas obligé à certains moments d’interrompre toutes ses activités pour cause de maladie, il dut remplir ses fonctions en éprouvant régulièrement et parfois pendant d’assez longues périodes de grandes souffrances. Sa santé, toujours chancelante, se détériora bien avant la fin de son séjour au Canada. À son retour en Angleterre, une fois son rapport rendu public, il fut encore incité à réduire son rythme de travail même si ses responsabilités au sein d’une association et d’une compagnie, toutes deux établies pour coloniser la Nouvelle-Zélande, ne l’absorbaient pas tellement. À part quelques rares sorties mondaines où l’occasion se présenta de faire la paix avec d’anciens collègues et amis, entre autres Brougham et Melbourne, il se confina de plus en plus dès février 1840 dans sa résidence de Cowes où il mourut le 28 juillet de la même année. Sa deuxième femme et quatre de leurs cinq enfants lui survécurent.
Le rapport de John George Lambton, 1er comte de Durham, a paru à Londres en 1839 sous le titre de Report on the affairs of British North America, from the Earl of Durham [...], à la fois comme les Command papers, 1839, 17, no 3 du Parlement britannique et comme publication distincte. D’autres éditions ont paru sous les titres de : Lord Durham’s report on the affairs of British North America, C. P. Lucas, édit. (3 vol., Oxford, Angl., 1912 ; réimpr., New York, 1970) ; et Lord Durham’s report, G. M. Craig, édit. (Toronto, 1963) ; et en français sous celui de Rapport de Durham, M.-P. Hamel, trad. et édit. (Montréal, 1948).
[Charles] Grey, Crisis in the Canadas : 1838–1839 ; the Grey journals and letters, William Ormsby, édit. (Toronto, 1964).— [L. E. Grey, comtesse de] Durham, Letters and diaries of Lady Durham, Patricia Godsell, édit. (Ottawa, 1979).— Burke’s peerage (1970).— Fauteux, Patriotes.— Wallace, Macmillan dict.— John Benson, British coalminers in the nineteenth century : a social history (Dublin et New York, 1980).— Michael Brock, The great Reform Act (Londres, 1973).— Buckner, Transition to responsible government.— The colonial reformers and Canada, 1830–1849, Peter Burroughs, édit. (Toronto, 1969).— Leonard Cooper, Radical Jack ; the life of John George Lambton, first Earl of Durham, 1792–1840 (Londres, 1959).— Richard Fynes, The miners of Northumberland and Durham (Wakefield, Angl., 1971).— E. J. Hobsbawm, Labouring men ; studies in the history of labour (Londres, 1975).— Mark Hovell, The Chartist movement (Manchester, Angl., 1963).— Ged Martin, The Durham report and British policy : a critical essay (Cambridge, Angl., 1972).— C. W. New, Lord Durham ; a biography of John George Lambton, first Earl of Durham (Oxford, 1929).— Ouellet, Bas-Canada ; Hist. économique.— Harold Perkin, The origins of modern English society, 1780–1880 (Londres, 1972).— Pressure from without in early Victorian England, Patricia Hollis, édit. (Londres, 1974).— Taft Manning, Revolt of French Canada.— E. P. Thompson, The making of the English working class (Londres, 1963).— Roger Viau, Lord Durham (Montréal, 1962).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Fernand Ouellet, « LAMBTON, JOHN GEORGE, 1er comte de DURHAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/lambton_john_george_7F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/lambton_john_george_7F.html |
| Auteur de l'article: | Fernand Ouellet |
| Titre de l'article: | LAMBTON, JOHN GEORGE, 1er comte de DURHAM |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1988 |
| Année de la révision: | 1988 |
| Date de consultation: | 2 mars 2026 |