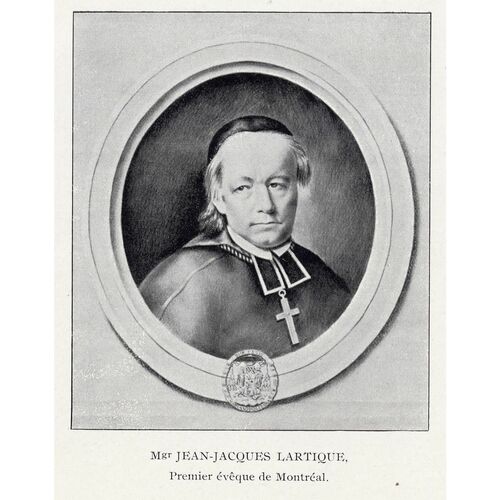Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
LARTIGUE, JEAN-JACQUES, prêtre catholique, sulpicien et évêque, né le 20 juin 1777 à Montréal, fils de Jacques Larthigue, chirurgien, et de Marie-Charlotte Cherrier ; décédé le 19 avril 1840 dans sa ville natale.
Fils unique, Jean-Jacques Lartigue appartenait à une famille distinguée de Montréal. Son père, originaire de Miradoux, en France, avait accompagné, peu avant 1757, en qualité de chirurgien, les troupes régulières envoyées en Nouvelle-France. Sa mère, native de Longueuil, était la fille de François-Pierre Cherrier*, marchand et notaire à Longueuil, puis à Saint-Denis, sur le Richelieu. Inscrit dès 1784 en classe préparatoire au collège Saint-Raphaël (qui deviendra en 1806 le petit séminaire de Montréal), Lartigue se montra un élève studieux et brillant. Sa philosophie terminée, il fréquenta en septembre 1793 l’école anglaise que dirigeaient les sulpiciens, puis fit durant trois ans un stage de clerc auprès des avocats montréalais Louis-Charles Foucher et Joseph Bédard. En compagnie de son cousin, Denis-Benjamin Viger*, et à l’exemple de ses oncles Joseph Papineau, Denis Viger* et Benjamin-Hyacinthe-Martin Cherrier, députés à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada, il développa pour la politique bas-canadienne un intérêt qui ne se démentirait jamais.
En 1797, Lartigue prit une décision qui marqua un tournant dans sa vie. Avant même d’être admis au barreau, il renonça à une carrière prometteuse et opta pour le sacerdoce. « Un événement fortuit et de bien peu d’importance, [...] un léger désagrément qu’il éprouva de la part des hommes », selon Mgr Charles La Rocque*, semble avoir été à l’origine de cette décision soudaine. Le 23 septembre 1797, l’évêque de Québec, Mgr Pierre Denaut*, lui conféra la tonsure et les ordres mineurs en l’église paroissiale de Montréal. Lartigue passa les deux années suivantes au collège Saint-Raphaël comme professeur, selon la coutume de l’époque, tout en poursuivant ses études théologiques sous la direction des sulpiciens. En septembre 1798, il consigna dans un acte public sa décision irrévocable d’avancer jusqu’au sacerdoce. Le 30 septembre 1798 et le 28 octobre 1799, il reçut respectivement le sous-diaconat et le diaconat des mains de l’évêque en l’église de Longueuil. Mgr Denaut se l’adjoignit ensuite en qualité de secrétaire à la place d’Augustin Chaboillez*, nommé curé de la paroisse de Sault-au-Récollet (Montréal-Nord).
Lartigue fut ordonné prêtre le 21 septembre 1800 à Saint-Denis, sur le Richelieu, en présence de son oncle, le curé de l’endroit, François Cherrier*, de sa mère et de nombreux parents. En dépit d’une santé chancelante, il déploya beaucoup d’énergie en joignant à sa fonction de secrétaire celle de vicaire à Longueuil, où l’évêque continuait d’exercer la charge de curé. À titre de secrétaire, il accomplit plusieurs tâches importantes, telle la refonte du rituel de Québec, et il accompagna souvent son évêque dans ses tournées pastorales. La visite des Maritimes en 1803, cette partie du diocèse la plus éloignée de l’évêché, là où aucun évêque ne s’était rendu depuis 117 ans, s’avéra la plus pénible. Épuisé et gravement malade, Lartigue faillit mourir à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Il participa aussi très activement à l’administration courante du diocèse et se révéla un conseiller judicieux en l’absence du coadjuteur, Joseph-Octave Plessis*, qui résidait à Québec, au moment où l’Église canadienne faisait face à une vaste offensive de la part du lieutenant-gouverneur sir Robert Shore Milnes et de ses acolytes, Jonathan Sewell, Herman Witsius Ryland et Jacob Mountain*.
La mort de Mgr Denaut le 17 janvier 1806 permit à Lartigue de réaliser un rêve qu’il caressait depuis longtemps : devenir sulpicien. La perspective d’une « vie plus calme, plus solitaire, plus recueillie » et d’une vie intellectuelle plus poussée l’attirait particulièrement. Le 22 février 1806, il quitta le presbytère de Longueuil et retrouva ses anciens maîtres, après qu’on l’eut agrégé quelques jours plus tôt, le 15 février. Il était le premier Canadien que recevait le séminaire de Saint-Sulpice depuis la venue en 1793 des sulpiciens français chassés par la Révolution.
Dès son arrivée au séminaire, Lartigue fut attaché au ministère paroissial et eut la responsabilité de l’un des quatre quartiers de la paroisse. Parallèlement, il fut tour à tour procureur et archiviste au séminaire, et se livra à diverses activités intellectuelles, telles la rédaction de « cahiers de cérémonies » pour la paroisse et l’élaboration d’une édition française du Nouveau Testament. Ce dernier projet, si cher au nouvel évêque de Québec, Mgr Plessis, qui s’inquiétait de l’expansion des sociétés protestantes dans la province, requerrait beaucoup de temps de la part de Lartigue, particulièrement en 1818 et 1819, où il s’adonna à cette œuvre de façon privilégiée pendant plusieurs mois.
En 1806, Mgr Plessis avait engagé Lartigue à réfuter la requête du procureur général Sewell dans la cause qui opposait le curé Joseph-Laurent Bertrand* à l’un de ses paroissiens, Pierre Lavergne, en relation avec la légalité de l’érection de nouvelles paroisses. En juillet 1812, le supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, Jean-Henry-Auguste Roux*, lui confia la tâche délicate de ramener à la soumission les habitants des régions de Pointe-Claire et de Lachine, qui avaient manifesté violemment contre la conscription. En 1815, Plessis l’invita à rédiger un nouveau catéchisme, mais il ne s’en considéra pas apte. Enfin, il accompagna à six reprises, de 1814 à 1819, le coadjuteur de l’évêque, Mgr Bernard-Claude Panet*, dans ses visites pastorales de la région de Montréal.
Aucune mission, cependant, ne devait revêtir autant d’importance que celle que Lartigue entreprit en 1819, à la demande de son supérieur, auprès du gouvernement britannique. Autant les autorités civiles qu’un certain nombre de juristes réputés contestaient depuis longtemps les titres de propriété du séminaire de Saint-Sulpice relatifs aux seigneuries de l’Île-de-Montréal, du Lac-des-Deux-Montagnes et de Saint-Sulpice. Au printemps de 1819, on avait de nouveau soulevé la question au Conseil législatif. Le danger de spoliation des biens de Saint-Sulpice s’avérait plus réel que jamais. Inquiété par les doutes sérieux du gouverneur, le duc de Richmond [Lennox*], sur la légalité des titres de propriété du séminaire, Roux résolut de porter la cause devant les autorités londoniennes. Le moment était d’autant plus propice que Mgr Plessis s’apprêtait à se rendre à Londres pour solliciter des lettres patentes en faveur du séminaire de Nicolet et obtenir l’autorisation de diviser son diocèse, beaucoup trop vaste pour un seul évêque. La présence de Plessis ne pouvait que faciliter la tâche de l’émissaire du séminaire. Le choix du supérieur se porta sur Lartigue que ses connaissances juridiques et sa maîtrise de l’anglais rendaient particulièrement apte à remplir cette mission. Le 3 juillet 1819, Lartigue s’embarqua à bord du George Symes en compagnie de Mgr Plessis et de son secrétaire Pierre-Flavien Turgeon*.
Arrivé à Londres le 14 août, Lartigue entreprit aussitôt de plaider, avec le concours de Plessis, la cause du séminaire. Il se heurta à l’insouciance des fonctionnaires et au refus répété du secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst, d’ailleurs prévenu contre lui, qui attendait, avant de se prononcer, le rapport des officiers de la couronne. Les démarches de Lartigue auprès de l’ancien gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, sir John Coape Sherbrooke*, du vicaire apostolique de Londres, William Poynter, de l’ambassadeur de France en Angleterre, le marquis de Latour-Maubourg, et d’éminents avocats londoniens ne donnèrent aucun résultat ; pendant son séjour à Paris du 23 octobre au 29 novembre, il ne réussit pas plus à convaincre les autorités françaises d’intervenir auprès du gouvernement britannique. Lorsqu’il quitta Londres pour Montréal, le 6 juin 1820, la cause du séminaire n’était guère plus avancée. Pourtant sa présence n’avait pas été inutile : les autorités britanniques avaient renoncé momentanément à s’emparer des biens de Saint-Sulpice. À son insu, Lartigue avait tout de même préparé l’accord qui allait intervenir 20 ans plus tard au profit du séminaire.
En se rendant à Londres défendre les intérêts du séminaire, Lartigue ignorait tout des desseins que Plessis avait pour lui. À défaut de la division du diocèse de Québec, ce dernier avait obtenu à Londres la reconnaissance de quatre évêques auxiliaires qui le représenteraient dans le Haut-Canada, le Nord-Ouest, les Maritimes et le district de Montréal. Le 17 septembre 1819, Lartigue avait appris que l’archevêque le destinait à ce dernier poste. D’abord réticent à se rendre aux désirs de Plessis, il répondit finalement de façon affirmative, mais à la condition d’un acquiescement de la part de ses supérieurs. Antoine de Pouget Duclaux, supérieur général de Saint-Sulpice à Paris, s’en remit au jugement de Roux. Celui-ci répondit de façon évasive en décembre 1819. Les craintes de Lartigue se confirmaient : son supérieur immédiat semblait consentir à son épiscopat s’il quittait le séminaire. En mars 1820, Lartigue reçut les lettres apostoliques qui le nommaient évêque de Telmesse, en Lycie, et auxiliaire en même temps que suffragant de Plessis. Pour Lartigue, qu’un ordre du pape contraignit peu après à accepter l’épiscopat, une tout autre vie commençait. Il ne serait plus sulpicien, mais évêque auxiliaire à Montréal. Peut-être Jean-Baptiste Thavenet avait-il prophétisé plus qu’il ne croyait lorsqu’il lui avait écrit peu auparavant : « Encore un mot sur l’épiscopat qu’on vous offre. Il me rappelle les évêques régionaires du ve siècle : vous seriez évêque non pas de Montréal mais à Montréal. Vous y seriez vicaire de l’évêque, et le grand vicaire ne serait plus rien, etc. Et si vous n’étiez pas membre du Séminaire (comme infailliblement cela vous arriverait), quelle triste existence pour vous ! »
L’ordination épiscopale de Mgr Lartigue eut lieu à l’église Notre-Dame de Montréal le 21 janvier 1821. Le nouvel évêque devenait responsable du district le plus important du Bas-Canada. Borné au nord-est par la région de Trois-Rivières, au sud par les États américains du Vermont et de New York et au sud-ouest par le Haut-Canada, le district de Montréal comptait une population de près de 200 000 habitants dont 170 000 catholiques répartis dans 72 paroisses et missions. Des 18 767 citoyens de Montréal, près des neuf dixièmes appartenaient à l’Église catholique. Les établissements religieux étaient nombreux et prospères. Outre le séminaire de Saint-Sulpice et l’église Notre-Dame, Montréal comprenait le petit séminaire, la chapelle des récollets, la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours, un couvent pour jeunes filles dirigé par les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et deux hôpitaux, l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital Général.
Plusieurs tâches importantes attendaient le nouvel évêque. L’une d’elles concernait la formation théologique et spirituelle du clergé, nettement déficiente à l’époque. Mgr Lartigue voulut y remédier rapidement. En 1825, dans les murs de l’évêché, inauguré peu auparavant, il fonda une école de théologie, le séminaire Saint-Jacques, qui devint rapidement, sous la direction de son secrétaire et bras droit, Ignace Bourget*, un foyer d’ultramontanisme. On y enseignerait l’infaillibilité du pape 40 ans avant que le concile du Vatican ne proclame cette proposition comme un dogme. À une époque où en France s’affrontaient violemment les tenants du gallicanisme et de l’ultramontanisme, Lartigue considérait l’Église comme un corps fortement hiérarchisé, étranger à toute idée démocratique du pouvoir et soumis en tout à l’autorité du pape. La primauté absolue du souverain pontife constituait l’essentiel de cette définition. « Pasteur des pasteurs » et jouissant du caractère de l’infaillibilité indépendamment de l’assentiment des évêques, le pape avait de droit divin « une juridiction pastorale sur tous les évêques du monde », qu’il pouvait déplacer et déposer à volonté.
Cette conception de l’Église et cet amour pour la personne de son chef, Lartigue les tenait en partie de l’admiration qu’il vouait à Hugues-Félicité-Robert de La Mennais, dont il avait lu avec enthousiasme l’Essai sur l’indifférence en matière de religion (Paris, 1817), à l’occasion de son voyage en Europe. Lartigue s’était nourri de façon assidue à partir de 1820 des écrits de Joseph de Maistre, de ceux de Philippe-Olympe Gerbet et de La Mennais qu’il recevait régulièrement par l’intermédiaire du libraire parisien Martin Bossange. Abonné à plusieurs journaux ménaisiens dont le Drapeau blanc, le Mémorial catholique et l’Avenir, il développa une admiration sans borne pour La Mennais, « cet écrivain supérieur et ce Papiste complet », qui faisait « aimer la religion et son chef visible sur la terre ». C’est avec douleur et la mort dans l’âme qu’il apprendrait la dénonciation, puis la condamnation en 1832 et 1834, par l’encyclique du pape Grégoire XVI, de celui dont il ne renierait jamais le système philosophique et, à plus forte raison, l’ultramontanisme.
Une autre tâche apparut tout aussi importante à Lartigue : assurer à l’Église canadienne une plus grande cohésion et stabilité. Il travailla ainsi à l’amélioration de la loi concernant la reconnaissance civile des paroisses et le droit pour les corporations et les congrégations religieuses de posséder et d’acquérir des biens immobiliers. De plus, il appuya totalement Mgr Plessis dans son projet de regroupement de tous les diocèses d’Amérique du Nord britannique. Après le décès de Plessis, il en prit lui-même l’initiative de façon telle que le projet se réaliserait en 1844, au moment de l’établissement de la première province ecclésiastique au Canada, celle de Québec.
Imbu de la suprématie de l’Église sur la société civile, Lartigue n’était pas moins soucieux de la formation chrétienne des fidèles de son diocèse. Il exigeait d’eux une docilité absolue aux directives des évêques et comptait en outre sur leur action pour conserver à l’Église ses prérogatives et assurer son rayonnement dans la société. Afin d’y parvenir, il voulut établir une presse religieuse régie par l’épiscopat, pour « former et maîtriser l’opinion publique » et la faire tourner au profit de l’Église. Son successeur, Mgr Bourget, y parviendrait en 1841, en publiant les Mélanges religieux [V. Jean-Charles Prince*].
La même préoccupation amena Lartigue à s’intéresser vivement au domaine de l’éducation. Comme il soutenait que l’enseignement était essentiellement une responsabilité de l’Église et non de l’État, il prôna un système d’écoles indépendant de l’Institution royale pour l’avancement des sciences [V. Joseph Langley Mills*] et relié aux paroisses ; il souhaita en 1824, au moment de l’adoption de la loi des écoles de fabrique, que le clergé tire le plus possible avantage de cette loi. Celle-ci autorisait les curés et les marguilliers des paroisses à acquérir des fonds pour l’établissement d’écoles élémentaires et à y consacrer une partie des revenus de la fabrique. Lartigue ne devait pas tarder à donner l’exemple. Dès son arrivée dans le nouvel évêché, il avait ouvert une école gratuite qui comptait près de 80 écoliers en 1826. Peu après, il établit une deuxième école dans une maison acquise à cette fin ; il en confia la direction à l’Association des dames bienveillantes de Saint-Jacques, organisme créé en juillet 1828 dans le but d’éduquer les filles pauvres. Que dire enfin de sa constante sollicitude pour le collège de Saint-Hyacinthe [V. Antoine Girouard*] qui, à partir de 1824, releva de sa juridiction et devint, sous la direction de Jean-Charles Prince, un véritable « collège lamennaisien ».
L’action de Lartigue se manifesta également sur le plan social. En 1827, il encouragea fortement la fondation d’une association laïque de bienfaisance, l’Association des dames de la charité, dans le but de soulager les miséreux de Montréal [V. Marie-Amable Foretier*]. Puis, à l’été de 1832, au moment de la terrible épidémie de choléra qui s’abattit sur la ville, il appuya l’association dans son projet d’ouvrir un orphelinat pour recueillir les enfants d’immigrés, pour la plupart irlandais, victimes de la maladie. Au nombre des membres les plus actifs de l’association, se trouvait Émilie Tavernier* qui avait Lartigue pour directeur spirituel et qui, à son instigation, avait mis sur pied en 1830 un refuge pour les femmes âgées, malades ou infirmes. De plus, Lartigue et le sulpicien canadien Nicolas Dufresne* avaient secondé Agathe-Henriette Huguet, dit Latour, pour établir en 1829 l’Institution charitable pour les filles repenties.
Ces réalisations prirent toutefois place au cours d’un épiscopat particulièrement tourmenté, marqué de luttes incessantes tantôt contre le séminaire de Saint-Sulpice à Montréal, tantôt contre les autorités britanniques et tantôt contre les nouveaux dirigeants laïques canadiens. En 1837, Lartigue rappellerait avec amertume ces années d’épiscopat où sa vie était « semée de vicissitudes temporelles, et presque également entremêlée de prospérités et d’adversités ». Maintes fois, l’évêque supplierait Mgr Plessis et ses successeurs de le « retirer enfin de cette galère » ; il offrirait à plusieurs reprises sa démission aux autorités romaines.
L’affrontement avec le séminaire de Saint-Sulpice marqua les 15 premières années de l’épiscopat de Lartigue. Il débuta avec la décision de l’évêque, en janvier 1821, de s’établir à Montréal plutôt que dans une paroisse de la rive sud du Saint-Laurent, comme l’aurait souhaité Roux. Celui-ci était fermement convaincu qu’en prenant le parti « d’élever à l’épiscopat un de leurs confrères », Mgr Plessis avait visé « à introduire dans le Séminaire un évêque canadien » pour diminuer l’influence des sulpiciens français et mettre l’institution sous sa dépendance. Cette conviction explique l’exclusion de Lartigue du séminaire en février 1821 – il dut trouver refuge à l’Hôtel-Dieu de Montréal – de même que le geste étonnant des marguilliers de Notre-Dame qui, en juillet, profitèrent de l’absence de Lartigue pour enlever le trône épiscopal de l’église paroissiale. Ainsi on comprend davantage leur décision, en septembre 1822, de construire une nouvelle église [V. James O’Donnell*], vraisemblablement pour contrecarrer le projet de Lartigue, engagé dans la construction de l’église Saint-Jacques.
Entre l’évêque auxiliaire et les sulpiciens, qui avaient toujours exercé une forte emprise sur Montréal depuis leur arrivée en 1657, le conflit était inévitable. Lartigue avait cru qu’en prenant soin de consulter ses supérieurs sulpiciens et en exigeant un ordre du pape pour accepter l’épiscopat il vaincrait les réticences de ses confrères. En fait, Roux ne voulait point d’un évêque canadien à Montréal, même sulpicien, de peur de modifier le caractère exclusivement français du séminaire : toute décolonisation s’opère rarement sans heurts.
Lartigue fut donc amené à condamner l’activité des sulpiciens qui tentaient à Rome comme à Londres de s’assurer un recrutement d’origine française, à dénoncer la politique de discrimination dont faisaient l’objet les sulpiciens canadiens à l’intérieur de la compagnie et à s’opposer énergiquement en 1833 aux efforts du séminaire en vue d’obtenir à Montréal un préfet apostolique sulpicien et français. Si Mgr Plessis avait mieux soutenu Lartigue, qui ne croyait pas en « une politique tortueuse qui [voulait] tout ménager » et qui « fini[ssait] par tout gâter », celui-ci aurait sûrement rappelé avec plus de vigueur aux sulpiciens qu’ils ne pouvaient constituer une Église dans l’Église et aurait sévi avec plus de fermeté contre certains curés frondeurs, tels Augustin Chaboillez, François-Xavier Pigeon et Jean-Baptiste Saint-Germain*, dévoués à Saint-Sulpice.
Un rapprochement s’effectua toutefois à partir de 1835 entre Lartigue et le séminaire. En août, Lartigue était prêt à se choisir un successeur « agréable à Saint-Sulpice ». En effet, la maladie puis la mort rapide en mai de Pierre-Antoine Tabeau*, qui devait lui succéder, l’avaient beaucoup fait réfléchir. La célébration du jubilé sacerdotal du sulpicien français Jacques-Guillaume Roque, le 24 septembre 1835, en présence de l’évêque, acheva de réconcilier les deux parties. Dès lors, la plus grande harmonie régna. En décembre 1836, Lartigue écrivit, non sans une joie évidente, au supérieur Joseph-Vincent Quiblier* : « Je puis vous assurer que j’ai oublié de bon cœur tout le reste de ce qui s’est passé pendant quinze ans pour ne songer qu’à chérir et favoriser votre Maison. » L’année suivante, le supérieur général de Saint-Sulpice à Paris, Antoine Garnier, confiait le séminaire à la protection et à la bienveillance de l’évêque.
Au nombre des objectifs que Lartigue poursuivit inlassablement au cours de son épiscopat, il faut signaler au premier chef l’indépendance absolue de l’Église. Il soutenait que l’Église canadienne était indépendante du pouvoir politique et refusait, pour sa part, d’être regardé « simplement comme un engin entre les mains de l’Exécutif » ; il s’opposa donc énergiquement aux autorités britanniques qui n’avaient pas à dominer l’Église ni à dicter aux chefs religieux leur ligne de conduite. Contrairement à Mgr Plessis, à Mgr Panet et à Mgr Joseph Signay pour qui la liberté de l’Église était fonction de leur soumission aux directives de Londres, Lartigue avait compris que l’Église, dans un pays où existaient des institutions représentatives, ne devait pas solliciter la protection des hommes politiques ; elle disposait elle-même d’un pouvoir autonome en vertu de l’autorité qu’elle exerçait sur les fidèles qui avaient également la qualité d’électeurs. Lartigue, qui enviait la liberté d’action dont jouissait Mgr Benoît-Joseph Flaget, son collègue de Bardstown, au Kentucky, s’était rendu compte qu’avec un gouvernement protestant, ombrageux et chicaneur, une seule politique s’imposait, celle du fait accompli. Il l’appliqua au moment de l’érection du diocèse de Montréal. En insistant au mois d’octobre 1835 auprès de Mgr Joseph-Norbert Provencher*, son collègue du Nord-Ouest en visite à Rome, pour que les autorités romaines ne fassent point cas « du consentement ou de l’approbation du gouvernement britannique en faveur d’un tel arrangement », et en expédiant lui-même au pape, en novembre, à l’insu du gouverneur lord Gosford [Acheson], la requête du clergé montréalais en faveur d’un évêché à Montréal, il eut, selon Marcel Trudel, « le courage de poser le premier geste d’indépendance absolue ».
Cette politique audacieuse porta fruits. Le 13 mai 1836, le pape Grégoire XVI signait la bulle d’érection du nouveau diocèse de Montréal et le bref préposant Lartigue au siège épiscopal. Mis devant le fait accompli, Londres agréa le nouvel évêque, comme Lartigue l’avait prévu : le 26 mai, le secrétaire d’État aux Colonies donna son accord. L’évêque de Montréal prit possession de son siège épiscopal le 8 septembre dans l’enthousiasme général. Peu après, Lartigue fit un second geste non moins décisif en traitant avec Rome la question de son coadjuteur sans en discuter au préalable avec le gouverneur, voire sans l’avertir. À partir de ce moment, les relations entre l’Église canadienne et l’État entrèrent dans une ère nouvelle. Les autorités britanniques interviendraient de moins en moins dans les affaires internes de l’Église, dans la nomination des évêques et dans l’établissement de nouveaux diocèses. L’évêque de Montréal avait ouvert la voie à ses confrères et successeurs. Les relations entre l’Église et l’État avaient franchi un pas capital, qui serait ratifié en 1849 sous le gouvernement responsable, quand l’Église deviendrait indépendante de l’État.
Un autre conflit opposa Lartigue aux dirigeants de la chambre d’Assemblée, notamment à son cousin Louis-Joseph Papineau*. Depuis 1791, au moment de la mise en place des institutions parlementaires dans le Bas-Canada, les nouveaux porte-parole de la collectivité canadienne n’avaient pas tardé à éveiller la méfiance des autorités ecclésiastiques. Celles-ci acceptaient mal d’être supplantées par des chefs, sinon hostiles, du moins peu enclins à accepter leurs directives. Néanmoins, en dépit de leur politique officielle de non-intervention, les représentants de l’Église appuyaient sans aucun doute la cause des Canadiens. Lartigue, pour sa part, ressentait profondément les injustices dont ses compatriotes étaient victimes et manifesta toujours un vif intérêt pour les luttes et les objectifs des chefs politiques. Sa correspondance avec son cousin Viger, bras droit de Papineau, l’atteste éloquemment, notamment en 1822 au moment de la présentation au Parlement de Londres d’un projet de loi sur l’union des deux Canadas et, en 1828, à l’occasion de la mission à Londres de Viger, d’Austin Cuvillier et de John Neilson. En 1827, il justifiait d’ailleurs en ces termes la politique non interventionniste du clergé qu’il n’avait jamais cessé de prôner : « il est important pour eux [les Canadiens] que nous ne blessions point en cette occasion la jalousie du gouvernement qui par contrecoup pourrait faire malgré eux beaucoup de mal à la religion [...], d’ailleurs, sans que nous cassions les vitres, le gouvernement en Angleterre n’ignorera pas nos véritables sentiments, et [...] il jugera bien, malgré notre silence, de ce que nous pensons, s’il voit la masse sur laquelle il sait quelle est notre influence se porter presque unanimement en plaintes contre l’administration ».
À partir de 1829, cependant, les relations entre les représentants du parti patriote et les évêques se détériorèrent rapidement. Comme il contestait les objectifs que les chefs de l’Assemblée poursuivaient, notamment dans la loi scolaire de 1829 et en 1831 dans le projet de loi sur les fabriques [V. Louis Bourdages*], où l’on devinait une influence certaine du libéralisme déiste du xviiie siècle français et une grande tendance à la démocratie, Lartigue prit la tête d’une contre-offensive ; celle-ci aurait raison des tentatives des libéraux de restreindre l’influence de l’Église sur le peuple et de définir la société canadienne autrement que par son appartenance religieuse. Inquiet en même temps de la montée croissante d’un nationalisme canadien de plus en plus agressif et revendicateur, et du ton nettement révolutionnaire qu’adoptaient des chefs politiques radicaux qui ne lui inspiraient guère confiance, il en vint à s’opposer directement à eux. Il constatait avec alarme que le mouvement d’émancipation des Canadiens se faisait désormais sans l’Église, voire contre elle, et que la liberté très limitée que l’Église canadienne avait réussi à obtenir était menacée à la fois par le gouvernement britannique et par les hommes politiques canadiens eux-mêmes. L’épreuve de force entre les deux pouvoirs eut lieu en 1837. Le 24 octobre, dans un mandement aux fidèles de son diocèse, l’évêque de Montréal condamna l’action des chefs patriotes, en se basant sur la doctrine biblique du pouvoir divin des autorités civiles légitimes. En même temps, il mettait sérieusement en doute, tout comme les tenants de l’aile modérée du parti patriote, la sagesse et le bien-fondé de la politique des radicaux qu’il jugeait aussi imprudente que néfaste. Le divorce amorcé six ans plus tôt entre l’Église et l’Assemblée était consommé.
Les événements donnèrent raison à Lartigue. Vaincus à Saint-Charles-sur-Richelieu, puis à Saint-Eustache, les patriotes perdirent foi en leurs chefs, surtout après que plusieurs d’entre eux les eurent abandonnés. En dépit des premières réactions défavorables qu’avait suscitées son intervention, même au sein d’une partie du clergé, Lartigue ne tarda pas à apparaître comme un véritable chef, indépendant, lucide, soucieux de mériter la confiance de ses compatriotes et capable de leur proposer un programme plus réaliste que celui des responsables du parti patriote. La requête en faveur des droits des Canadiens à laquelle il donna son appui le 9 novembre 1837, à la demande des curés de la vallée du Richelieu, requête que signèrent tous les prêtres du Bas-Canada, puis le soutien que l’évêque et son coadjuteur apportaient aux infortunées victimes qui remplissaient les prisons, particulièrement après la tentative d’insurrection dans la nuit du 3 au 4 novembre 1838, convainquirent les Canadiens du désintéressement de leurs chefs religieux, regroupés autour de Lartigue. Entre-temps, à la fin de janvier 1838, ce dernier était intervenu auprès de lord Gosford pour engager le gouvernement de Londres à ne point modifier la constitution du Bas-Canada ni imposer l’union des deux Canadas comme le souhaitaient ardemment les tenants de la tendance sectaire de 1822. Lorsque furent connues au printemps de 1839 les recommandations du rapport de lord Durham [Lambton] qui visaient à « anglifier » et à « décatholiciser » les Canadiens par une union législative et un système d’écoles neutres, Lartigue favorisa la signature par son clergé d’une nouvelle requête destinée à la reine et aux chambres des Lords et des Communes et qui s’opposait au projet.
À ce moment décisif de l’histoire du Canada français, alors que les Canadiens s’étaient vus abandonnés, voire trompés, par leurs chefs politiques, les dirigeants religieux étaient intervenus pour prendre la relève et se mettre au service de la nation. Du coup, l’Église canadienne recouvrit l’autorité qu’elle avait exercée sur la collectivité canadienne avant l’avènement du régime parlementaire. Désormais, elle constituait une force politique avec laquelle les nouveaux dirigeants canadiens, plus raisonnables et plus modérés, devraient compter.
Malade depuis plusieurs années, Mgr Jean-Jacques Lartigue mourut le 19 avril 1840. La presse, le Canadien en particulier, fut unanime à souligner la grandeur de son épiscopat. Plus de 10 000 personnes assistèrent à ses obsèques, le 22 avril, dans l’église Notre-Dame. Autant de fidèles furent présents le lendemain à la cathédrale Saint-Jacques, où Mgr Bourget lui rendit un ultime hommage. À la mort du premier évêque de Montréal, la réaction catholique et ultramontaine dont il avait été le principal artisan était engagée de façon irrémédiable. Son successeur, Mgr Bourget, bien préparé dans ce sens par 16 ans de secrétariat et 3 ans d’épiscopat auprès de lui, poursuivrait son œuvre.
Les lecteurs trouveront une bibliographie détaillée sur Jean-Jacques Lartigue et sur la période 1777–1840 dans : Chaussé, Jean-Jacques Lartigue ; et Lemieux, l’Établissement de la première prov. eccl.
AAQ, 1 CB, VI-VIII ; 26 CP, I-VII.— ACAM, 255.109 ; 295.101 ; .103 ; 465.101 ; 583.000 ; 780.034 ; 901.012–.018 ; .021–.025 ; .028–.029 ; .033 ; .037 ; .039 ; .041 ; .047 ; .050 ; .136–.137 ; .150 ; Rll, I-III.— APC, MG 24, B2, 1 ; 2 ; 16–21 ; B6, 1–12 ; B46 ; J15.— Arch. de la Compagnie de Jésus, prov. du Canada français (Saint-Jérôme, Québec), 2196 ; 3182–3183.— Arch. du séminaire de Saint-Sulpice (Paris), Fonds canadien, dossiers 22, 27–29, 52, 55, 59, 63, 67, 73–76, 79–89, 94, 98–99.— ASQ, Fonds Viger-Verreau, Sér. O, 0128.— ASSM, 1bis ; 21 ; 24, B ; 27.— Allaire, Dictionnaire.— F.-M. Bibaud, Dict. hist. ; le Panthéon canadien (A. et V. Bibaud ; 1891).— Desrosiers, « Inv. de la corr. de Mgr Lartigue », ANQ Rapport, 1941–1942 ; 1942–1943 ; 1943–1944 ; 1944–1945 ; 1945–1946.— G.-É. Giguère, « la Restauration de la Compagnie de Jésus au Canada, 1839–1857 » (thèse de ph.d., 2 vol., univ. de Montréal, 1965).— J.-P. Langlois, « l’Ecclésiologie mise en œuvre par Mgr Lartigue (relations Église-État) durant les troubles de 1837–1838 » (thèse de l.l., univ. de Montréal, 1976).— Anne McDermaid, « Bishop Lartigue and the first rebellion in the Montreal area » (thèse de m.a., Carleton Univ., Ottawa, 1967).— Yvette Majerus, « l’Éducation dans le diocèse de Montréal d’après la correspondance de ses deux premiers évêques, Mgr J.-J. Lartigue et Mgr I. Bourget, de 1820 à 1967 » (thèse de ph.d., McGill Univ., Montréal, 1971).— Pouliot, Mgr Bourget et son temps, 1 ; Trois Grands Artisans du diocèse de Montréal (Montréal, 1936).— L. -P. Tardif, « le Nationalisme religieux de Mgr Lartigue » (thèse de l.l., univ. Laval, 1956).— É.-J. [-A.] Auclair, « le Premier Évêque de Montréal, Mgr Lartigue », SCHEC Rapport, 12 (1944–1945) : 111–119.— François Beaudin, « l’Influence de La Mennais sur Mgr Lartigue, premier évêque de Montréal », RHAF, 25 (1971–1972) : 225–237.— J.-H. Charland, « Mgr Jean-Jacques Lartigue, 1er évêque de Montréal (1777–1840) », Rev. canadienne, 23 (1887) : 579–582.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Gilles Chaussé et Lucien Lemieux, « LARTIGUE, JEAN-JACQUES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/lartigue_jean_jacques_7F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/lartigue_jean_jacques_7F.html |
| Auteur de l'article: | Gilles Chaussé et Lucien Lemieux |
| Titre de l'article: | LARTIGUE, JEAN-JACQUES |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1988 |
| Année de la révision: | 1988 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |