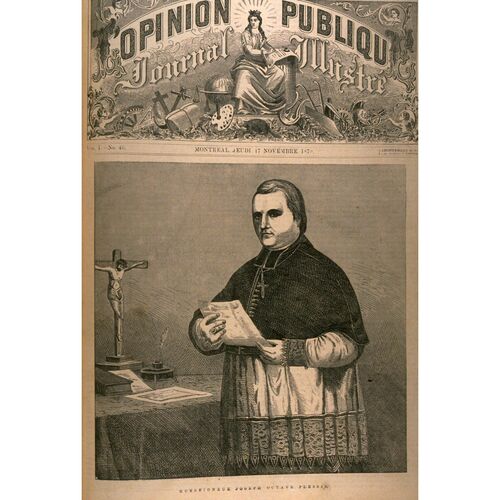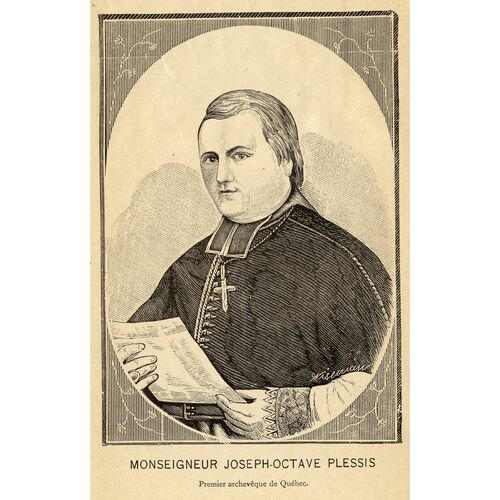Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2882492
PLESSIS, JOSEPH-OCTAVE (baptisé Joseph), prêtre catholique, archevêque, homme politique et auteur, né le 3 mars 1763 à Montréal, fils de Joseph-Amable Plessy, dit Bélair, et de Marie-Louise Mennard ; décédé le 4 décembre 1825 à Québec.
Joseph-Octave Plessis naquit un peu plus de trois semaines après que le traité de Paris eut confirmé la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne. Ses ancêtres paternels étaient partis de Metz, en France, pour s’établir dans la colonie au début du xviiie siècle. En 1713, Jean-Louis Plessy*, dit Bélair, épousa Marie-Anne Petit Boismorel ; en 1752, soit près de 40 ans plus tard, leur dix-septième enfant, Joseph-Amable, épousa Marie-Louise Mennard. Joseph-Amable Plessy exploitait une forge près de Montréal et sa prospérité fut assurée après la Conquête par l’accroissement de la demande d’objets en fer qu’avait provoqué une autre invasion britannique, celle des marchands de fourrures.
Septième des 18 enfants d’une famille où régnaient l’harmonie et la piété, Joseph-Octave Plessis était un garçon manifestement doué et conscient de son talent. À l’école primaire des sulpiciens, ce fut sans grande difficulté qu’il apprit à lire, à écrire et à compter et qu’il suivit ses leçons de catéchisme. Au terme de la première année qu’il y passa, on l’envoya à la petite école latine de Jean-Baptiste Curatteau*, curé de Longue-Pointe (Montréal). Au printemps de 1773, Mgr Jean-Olivier Briand* lui donna la confirmation. La même année, l’école de Curatteau fut relogée dans la ville et devint le collège Saint-Raphaël. Élève brillant, Plessis remporta plusieurs prix ; en 1777 ou 1778, il terminait sa classe de rhétorique.
À l’automne de 1778, avec l’aide d’une bourse, Plessis entra au petit séminaire de Québec. Le programme d’études, rigoriste et tourné vers l’exercice de la prêtrise, lui instilla une certaine austérité morale et l’amena à préférer les questions pratiques à la discussion intellectuelle. Comme d’habitude, il mena aisément ses études à terme. En outre, il manifesta des qualités de chef : reçu en octobre 1778 dans la Congrégation de la Bienheureuse-Vierge-Marie-Immaculée, il fut élu en avril 1780 au plus haut poste étudiant de cette confrérie, celui de préfet.
Plessis termina son cours classique vers juillet 1780 ; le mois suivant, il fut tonsuré par Briand et affecté au collège Saint-Raphaël comme régent. L’enseignement lui plaisait mais, à l’automne de 1783, sur le conseil des vicaires généraux Henri-François Gravé* de La Rive et Étienne Montgolfier*, Briand le rappela à Québec pour lui confier le poste de secrétaire, ordinairement réservé aux jeunes prêtres les plus prometteurs parce qu’il constituait une excellente préparation à l’administration du diocèse. Pendant qu’il occupa ce poste, soit une quinzaine d’années durant, Plessis fut si fortement influencé par Briand qu’il adopta non seulement ses principes mais aussi ses goûts et ses manières. Le 11 mars 1786, il fut ordonné prêtre par le successeur de Briand, Louis-Philippe Mariauchau* d’Esgly.
De 1787 à 1792, au printemps et en été, Plessis accompagna le coadjuteur et successeur de d’Esgly, Jean-François Hubert*, lors de ses visites pastorales dans le diocèse. Il accumula une vaste expérience de la confession et de la prédication, apprit à connaître les paroisses rurales et leurs habitants et comprit mieux les problèmes et le fonctionnement de l’administration paroissiale. En 1788, Hubert succéda à d’Esgly et, auprès du nouvel évêque qui était moins autoritaire que Briand, Plessis apprit à user davantage de psychologie dans la direction du clergé et des fidèles.
Le 31 mai 1792, sur l’avis de Gravé, Hubert, tout en gardant Plessis comme secrétaire diocésain, le nomma à la cure de Notre-Dame de Québec qui était, avec Notre-Dame de Montréal, la plus importante paroisse du diocèse. Elle englobait toute la ville, qui comptait alors 7 200 habitants. Afin d’obtenir les renseignements nécessaires à une organisation réaliste de la vie sociale et spirituelle de sa paroisse, Plessis fit cette année-là un recensement ; il répéta l’opération en 1795, 1798 et 1805 pour se tenir au fait de l’évolution de la ville. Ces recensements confirmaient l’expansion de deux faubourgs ouvriers, Saint-Roch et Saint-Jean. Plessis consacra surtout son attention au premier, où la croissance était plus rapide et la pauvreté plus criante ; plus tard, il y construisit une église, un couvent et un collège.
Ville de garnison et point de chute des marins et draveurs qui venaient de passer des mois en mer ou en forêt, Québec, en raison de l’application laxiste de la loi, voyait proliférer l’ivrognerie, les bagarres, le vol et la prostitution. Du haut de la chaire, Plessis stigmatisait la désolante moralité de la ville. Après l’avoir entendu prêcher, Elizabeth Posthuma Simcoe [Gwillim*] nota que « ses gestes étaient animés et son sermon impressionnant ». Bien qu’assez passionnés, ses prêches s’adressaient plus à l’esprit qu’au cœur. Afin d’éveiller ses paroissiens à la vie spirituelle, Plessis ranima la Confrérie de la Sainte-Famille et instaura les prières des quarante heures à la Pentecôte. Il exerçait également son ministère auprès des Irlandais, jusque-là négligés, mais il le faisait avec difficulté car il ne maîtrisa jamais très bien la prononciation anglaise. Toutefois, son œuvre pastorale était surtout axée sur l’instruction religieuse des jeunes, particulièrement dans Saint-Roch, et il ouvrit de nouvelles classes de catéchisme et une école primaire. Les garçons les plus intelligents étaient dirigés vers le petit séminaire de Québec dans l’espoir que quelques-uns deviendraient prêtres. En outre, Plessis mobilisait les fidèles chaque fois qu’un désastre social faisait des victimes. Il était toujours occupé ; ses journées commençaient vers quatre heures du matin pour se prolonger jusque vers minuit.
À titre de secrétaire, Plessis acquit la réputation d’homme fort du diocèse. Certains prêtres se mirent à lui soumettre leurs problèmes, tandis que d’autres s’irritaient de son influence. Comme Hubert n’était pas à l’aise en société, Plessis joua un rôle de premier plan en lui servant d’intermédiaire auprès des hommes politiques. C’est ainsi qu’il établit de bonnes relations avec des personnages aussi influents que le juge en chef William Osgoode, l’évêque anglican Jacob Mountain, le solliciteur général Jonathan Sewell*, le secrétaire civil Herman Witsius Ryland* ainsi que Thomas Dunn* et William Grant*, marchands engagés dans la vie politique. Leurs relations se resserrèrent durant la Révolution française, car Plessis appuya alors activement le gouvernement britannique. En 1794 par exemple, dans l’éloge funèbre qu’il fit de Briand, il vanta les mérites de ce gouvernement et dénonça l’athéisme et la sauvagerie révolutionnaires, ce qui fit bonne impression dans les cercles officiels.
En 1797, Hubert se retira en faveur de Pierre Denaut*. Les autorités ecclésiastiques préconisaient la nomination de Plessis comme coadjuteur et avaient sur ce point l’appui d’Osgoode et de Ryland. Le gouverneur Prescott* l’accepta, puis résista aux pressions du prince Edward* Augustus, qui favorisait un autre prêtre. Toutefois, en raison des désordres que la Révolution et la mort du pape provoquèrent au Vatican, les bulles de Plessis ne furent signées que le 26 avril 1800 ; il fut enfin sacré évêque de Canathe le 21 janvier 1801. Denaut demeura dans sa paroisse de Longueuil et, tout en conservant l’autorité ultime, laissa à Plessis le district de Québec et les relations avec le gouvernement. Heureusement que les deux hommes étaient bons amis, car cet arrangement singulier provoqua des frictions entre eux. Étant par nature « une forte tête », selon Gravé, et ayant l’expérience de l’administration diocésaine, Plessis s’impatientait parfois de n’être qu’un subalterne. La lenteur des communications l’empêchait parfois de consulter suffisamment Denaut sur des questions importantes. Ce fut notamment le cas en décembre 1798 et en janvier 1799, après que Prescott eut ordonné la tenue d’un jour d’action de grâces pour célébrer la victoire de l’amiral Horatio Nelson sur le Nil. À la suite d’une correspondance insatisfaisante avec Denaut, Plessis se vit contraint, sans le consulter davantage, de remplacer la lettre pastorale plutôt terne que celui-ci avait écrite pour annoncer l’événement par une autre de sa plume, qui était mieux à même de répondre « à l’enthousiasme du quartier-général ».
À l’époque, on craignait tant que des émissaires de France ne préparent la révolution dans le Bas-Canada [V. David McLane*] que même les prêtres français émigrés paraissaient suspects aux Britanniques. En 1798–1799, Plessis dut courtiser le gouvernement pour faire accepter l’émigré Jean-Henry-Auguste Roux comme supérieur des sulpiciens de Montréal. Que pareils jeux de coulisses aient été nécessaires montrait que l’évêque de Québec n’avait aucun statut légal et illustrait combien, pour gérer les affaires de l’Église, il devait compter sur la bonne volonté du gouvernement et sur sa propre force de persuasion plutôt que sur des garanties contenues dans un texte de loi. Les décisions épiscopales sur l’érection ou la division des paroisses, par exemple, pouvaient être contestées sur le terrain légal ou politique. Plessis tenta de régler ce problème en 1797 quand Thomas Coffin* présenta à la chambre d’Assemblée un projet de loi qui visait à ériger une paroisse, et qui allait ainsi à l’encontre de la volonté de Denaut. Plessis espérait transformer ce projet de loi particulier en une loi générale qui établirait les règles d’érection des paroisses de telle manière que l’érection canonique devrait précéder la reconnaissance juridique. Il obtint l’appui de Ryland, mais ne put contrer l’opposition de Sewell et d’Osgoode.
Les éléments majeurs qui déterminèrent le rôle qu’allait jouer Plessis en tant que coadjuteur – le fait que Denaut était absent de Québec, que les Britanniques se méfiaient de tout ce qui était français et que l’évêque n’avait pas de statut légal – se trouvèrent réunis pendant le mandat du lieutenant-gouverneur sir Robert Shore Milnes*. Alarmé du peu d’influence sociale – donc politique – que le pouvoir exécutif exerçait sur la population canadienne, Milnes, avec l’aide d’Osgoode, Mountain, Ryland et Sewell, dressa un plan d’ensemble pour l’accroître. Ce plan prescrivait entre autres d’amener l’Église catholique sous l’autorité de l’exécutif afin de profiter de son influence sociale. En retour, Milnes offrait la reconnaissance juridique. En avril et mai 1805, pour que Denaut consente aux restrictions proposées, Sewell entama avec Plessis une série de négociations au cours desquelles les nominations aux cures et l’érection des paroisses apparurent comme les questions les plus litigieuses. Plessis était prêt à assouplir sa position sur ces deux questions mais Denaut ne l’était pas ; Denaut accusa Plessis d’imprudence, ce qui irrita le coadjuteur. L’Église était en crise, insistait celui-ci ; elle perdait l’autorité publique dont elle avait besoin pour mener à bien sa mission spirituelle. Finalement, il convainquit Denaut de demander au roi de reconnaître officiellement son titre d’évêque, mais la pétition que ce dernier envoya en juillet 1805 n’était que le pâle reflet de celle que Plessis avait envisagée et dont il avait espéré qu’elle déboucherait sur une véritable charte des droits de l’Église. Le roi n’y répondit jamais.
La mort de Denaut en janvier 1806 offrit au gouvernement l’occasion d’obtenir l’autorité désirée en échange de la permission, pour l’Église, de nommer un autre évêque. Toutefois, Plessis déjoua tous les pronostics en persuadant l’administrateur de la province, Thomas Dunn, d’accepter inconditionnellement sa nomination comme évêque et celle de Bernard-Claude Panet comme coadjuteur. Panet était plus âgé que lui mais, en le choisissant, Plessis se ménageait du temps pour former un prêtre plus jeune, André Doucet ou Pierre-Flavien Turgeon* par exemple, en vue de sa succession.
Quand Plessis devint évêque en 1806, l’évolution qui s’était produite depuis longtemps au sein du clergé lui assurait une autorité plus grande que n’en avait eue ses prédécesseurs. Le pourcentage de prêtres canadiens s’était accru, surtout depuis la Conquête, de sorte que le clergé était plus homogène et mieux disposé envers un évêque canadien ; de plus, les membres dudit clergé venaient surtout de la petite bourgeoisie, comme Plessis. La disparition des jésuites et des récollets [V. Jean-Joseph Casot* ; Louis Demers*] avait réduit le nombre de prêtres échappant à l’autorité immédiate de l’évêque. Enfin, deux autres facteurs étaient venus favoriser la concentration du pouvoir entre les mains de l’évêque. D’abord, le chapitre de Québec [V. Charles-Ange Collet*], le séminaire des Missions étrangères et le séminaire de Saint-Sulpice à Paris [V. Henri-François Gravé de La Rive ; Jean-Henry-Auguste Roux] ne constituaient plus des forces à l’intérieur de l’Église coloniale. Ensuite, l’agitation politique et militaire en Europe avait désorganisé l’administration du Vatican. Plessis aurait souhaité de meilleures communications avec Rome, mais sa position de force face au clergé convenait à son tempérament autoritaire et décidé.
Ce clergé était toutefois nettement insuffisant en nombre, et c’était là le problème le plus urgent de l’évêque. Les demandes d’assistance qui lui parvenaient de curés surchargés de travail lui « déchiraient] le cœur », écrivait-il à l’un d’eux. Par des mesures à court terme, il ménagea la santé de ses prêtres, mais leur charge de travail continua d’augmenter. Il tenta de faire venir des prêtres de France mais en fut empêché par une interdiction des Britanniques jusqu’en 1813, puis par la pénurie qui sévissait en France même. Parallèlement, il s’efforça d’intensifier le recrutement dans la colonie, ce qui n’avait jamais été une priorité pour ses prédécesseurs. Toutefois, peu de jeunes Canadiens entreprenaient des études secondaires, et la plupart de ceux qui le faisaient préféraient se ménager une existence moins sévère en optant pour une profession libérale. Afin de multiplier les candidats à l’ordination, Plessis bloqua à toutes fins pratiques l’effectif clérical des paroisses, même s’il était déjà faible, et affecta tous les nouveaux prêtres à l’enseignement secondaire dans l’espoir que l’augmentation du nombre d’étudiants engendrerait une hausse des vocations. Le séminaire de Québec ne tarda pas à réagir négativement. À titre de succursale du séminaire des Missions étrangères de Paris, il affirmait avoir une certaine indépendance à l’égard de l’évêque, prétention que celui-ci ne pouvait tolérer de la part d’un établissement aussi vital. Plessis s’installa au séminaire de Québec en 1806, en partie pour améliorer les relations mais surtout pour affirmer la présence épiscopale. Il parvint à ses fins sur ces deux plans ; par contre, il jugeait avoir échoué à réaliser un troisième objectif qui consistait à améliorer de façon significative la formation théologique de son clergé, jusque-là assurée en bonne partie par le grand séminaire.
Pour remédier à cette situation, Plessis offrit en 1811 de faire de Saint-Sulpice, à Montréal, dont il admirait le programme de théologie, un séminaire diocésain. Pendant qu’il était coadjuteur, il avait établi d’excellentes relations avec le supérieur, l’abbé Roux, mais plusieurs désaccords surgirent entre eux après que Plessis fut devenu évêque. Rattachée à Saint-Sulpice à Paris, la communauté était résolue à demeurer aussi indépendante de Québec qu’elle avait toujours été, à préserver son caractère français aux dépens du recrutement de Canadiens et à conserver son emprise sur la vie religieuse de Montréal en empêchant l’évêché d’y exercer trop d’influence. En 1807, Roux avait fait échec à Plessis qui tentait d’installer Panet dans la région. Quatre ans plus tard, quand Plessis offrit de faire de Saint-Sulpice un séminaire diocésain, il y vit une ruse semblable au cheval de Troie et refusa poliment.
Saint-Sulpice s’opposa aussi à ce que Plessis ouvre un séminaire à Nicolet. La stagnation du recrutement à Montréal et à Québec avait décidé l’évêque à se tourner vers la région qui séparait les deux villes ; un séminaire à Nicolet amènerait des candidats qui, par ailleurs, seraient à l’abri des tentations de la vie urbaine. Il acheta la propriété de l’héritier de Denaut [V. Pierre-Michel Cressé*] et vainquit les résistances de Jean Raimbault* à accepter le poste de supérieur. De plus, il reçut pour le collège, sous forme de legs, une partie de la bibliothèque de Pierre-Joseph Compain* et la totalité de celle de François Cherrier*. Enfin, il finança l’agrandissement de l’édifice, acheta des terres et offrit des livres à remettre en prix. En retour, il exigea que l’évêché ait la haute main sur l’administration et l’enseignement.
Vers 1817, Plessis commença aussi à aider d’autres collèges classiques à s’établir dans les régions rurales. Cette année-là, il rédigea le règlement du collège de Saint-Hyacinthe, créé par Antoine Girouard, et, par la suite, obtint des lettres patentes et trouva du personnel pour cet établissement. Il encouragea aussi Pierre-Marie Mignault* à Chambly et Charles-Joseph Ducharme* à Sainte-Thérèse-de-Blainville (Sainte-Thérèse). Il tenta de recruter des candidats du milieu ouvrier à Québec en fondant un collège dans le faubourg Saint-Roch en 1818. L’affectation de jeunes ecclésiastiques dans les nouveaux collèges suscitait cependant des critiques de la part des curés, qui étaient ainsi privés d’assistants, et de la part de l’abbé Roux, selon qui cette initiative dispersait un personnel enseignant déjà clairsemé et empêchait d’améliorer la formation-théologique. Par ailleurs, Plessis encouragea les organismes fondés pour financer les études de théologie et parraina lui-même des étudiants dans le besoin. Toutefois, les résultats de tous ces efforts ne commencèrent de se faire sentir que dans les années 1830, quand le recrutement se mit à correspondre à la croissance démographique.
Plessis exerçait une influence considérable sur la formation de ses recrues en supervisant leurs études et en donnant des conférences à Québec et à Nicolet. Il inculqua à la plupart d’entre elles une foi profonde, une moralité rigoureuse, un sens de la discipline et de l’humilité, en soulignant que cette dernière qualité était particulièrement nécessaire à une époque d’effervescence démocratique. Il exigeait que chacun fasse preuve d’abnégation, mais parlait de l’ensemble du clergé comme de « cette race élue [...] ce sacerdoce royal, cette nation sainte ».
Plessis s’efforçait de nouer des liens personnels avec ses prêtres. Alexander McDonell*, dans le Haut-Canada, lui disait en 1820 : « [vous êtes] mon point d’appui, mon guide et mon soutien car, depuis que j’ai le bonheur de vivre sous votre autorité, vous avez agi envers moi comme un père et un ami plutôt que comme un supérieur ». Naturellement sociable, bon conteur, Plessis animait les réunions ecclésiastiques d’anecdotes puisées dans ses vastes lectures et dans le flot intarissable d’incidents cocasses survenus au cours de ses visites pastorales et de son voyage de 1819–1820 en Europe. Il étudiait soigneusement le profil moral et psychologique de chacun de ses prêtres et dispensait ses conseils et ses ordres en conséquence. Il abordait les problèmes qui les inquiétaient le plus, dont l’isolement ; tous étaient exhortés à lui écrire fréquemment. Affecté dans la lointaine Île-du-Prince-Édouard, Angus Bernard MacEachern lui disait : « Votre Grâce, qui a plus à faire que quiconque au Canada, est la seule personne qui m’écrive. » Quand un des membres de son clergé était injustement attaqué par des paroissiens, Plessis était là pour l’appuyer. Il demeurait fidèle aux propos rassurants qu’il adressa, tandis qu’il était coadjuteur, en 1800, à un prêtre assailli de critiques : « Vous avez une conscience et des principes. C’est tant qu’il en faut avec moi. » Grâce à sa connaissance approfondie du diocèse, il était en mesure de donner des conseils pratiques en cas de situation difficile, ce qui représentait une aide inestimable pour de jeunes prêtres occupant leur première charge. Aux plus âgés qui craignaient l’épuisement, il ne pouvait offrir que de la sollicitude et un brin d’humour : « Il meurt assez de prêtres avant terme, de côté et d’autre, sans que vous vous en mêliez », écrivait-il à l’un d’eux.
Même si peut-être la moitié des prêtres n’en faisaient pas partie, la Société ecclésiastique Saint-Michel, association cléricale d’aide mutuelle dont il avait appuyé la mise sur pied en 1799, contribuait de façon significative à promouvoir l’esprit de corps parmi le clergé. Elle lui permit par exemple de verser des pensions aux membres qui ne pouvaient remplir leurs fonctions pour des raisons de santé. Nommé président à vie en 1801, il manœuvra habilement le conseil d’administration afin d’obtenir que la société contribue financièrement aux causes qui lui tenaient à cœur, l’instruction du clergé par exemple. Cependant, la manière dont il se servait de la société et l’autorité qu’il y exerçait suscitaient des critiques de la part de quelques prêtres, Charles-François Painchaud* surtout.
À l’égard de son clergé, Plessis se montrait souple, comme l’exigeait le contexte. « N’ordonnons que dans les cas tout à fait nécessaires et indispensables », conseillait-il à son auxiliaire Jean-Jacques Lartigue* en 1824. « Partout ailleurs évitons toute expression qui ressente la domination. Nous sommes dans le siècle d’orgueil où le commandement est odieux. » Aucun aspect de l’administration du clergé ne présentait plus de difficulté que la mutation des prêtres en vue de maximiser leur utilité. Les séminaristes récemment diplômés, imbus des idéaux d’abnégation et d’obéissance que leur avait inculqués Plessis, étaient des candidats de premier ordre pour les missions ingrates des Maritimes. Quant aux prêtres établis, en général réfractaires à toute affectation qui n’avait pas l’allure d’une promotion, il les raisonnait ou les flattait, en appelait à leur sens du devoir, invoquait leur avantage personnel et allait jusqu’à user de chantage moral ; il ne commandait qu’en dernier recours. Aux yeux de Plessis, rien dans l’administration de son diocèse n’était plus crucial que l’affectation du clergé. Aussi veillait-il avec soin à bien choisir les prêtres en fonction de chaque paroisse et il s’assurait qu’ils puissent s’entendre avec leurs collègues du voisinage. Décidé à garder les mains libres, constamment préoccupé de maintenir l’autorité épiscopale, il se laissait rarement fléchir par les paroisses ou les prêtres qui lui demandaient de modifier ses plans. Quant au gouvernement colonial, même s’il projetait ou menaçait continuellement de le faire, il n’intervenait guère dans les nominations paroissiales.
Le plus souvent, c’était sur les questions de discipline que Plessis était prêt à user d’autorité, car il était convaincu que l’influence des prêtres dépendait de leur assiduité et de leur crédibilité morale. Il insistait pour qu’ils ne fassent pas de visite hors de leur paroisse, sauf pour de bonnes raisons et de préférence avec une permission seulement. Pour combattre l’isolement qui en résultait, il essayait d’organiser des retraites spirituelles, mais le clergé n’avait guère le temps d’y assister. Laissés à eux-mêmes, souvent témoins de cas désolants, leur autorité de plus en plus contestée par les membres des professions libérales de leur paroisse, certains prêtres cherchaient du réconfort dans l’alcool ou auprès d’une femme compatissante. En pareils cas, et ils n’étaient pas fréquents, Plessis se montrait à la fois dur et compréhensif. Si ses exhortations à la réforme demeuraient sans effet, il suspendait le prêtre et l’envoyait assister un collègue sûr, mais il le défroquait rarement.
Dans la direction de son clergé et le gouvernement de son diocèse, Plessis était un administrateur aussi consciencieux que déterminé. Pendant son épiscopat, le secrétariat diocésain prit une telle expansion qu’en 1820 il fallut construire un édifice de trois étages pour le loger. N’ayant pas de chapitre, l’évêque consultait fréquemment ses vicaires généraux, qui avaient des pouvoirs limités dans des districts assez vastes, avant de prendre des décisions importantes. Il recourait aussi aux archiprêtres, qui avaient des pouvoirs modestes sur un petit nombre de paroisses, et parfois au clergé ordinaire dont le travail serait touché par une décision donnée. Selon Painchaud, il consultait surtout les jeunes prêtres parce que, formés sous sa surveillance, ils partageaient ses vues. Cependant, c’était toujours Plessis qui décidait et, dans la plupart des cas, il appliquait lui-même ses décisions. Quand, en 1809, Charles-Joseph Brassard Deschenaux accepta malgré ses réserves d’être nommé vicaire général, il précisa n’avoir qu’une seule consolation, à savoir : « avec un Évêque tel que vous, un Grand Vicaire n’a presque rien à faire ».
Par sa réticence à déléguer son autorité (du moins avant la division de son diocèse en 1820), Plessis s’attira la critique de quelques prêtres, dont Painchaud. Sa réserve provenait en partie d’un désir de favoriser la standardisation des pratiques dans l’ensemble du vaste territoire qui relevait de sa compétence. Il comptait sur les jeunes prêtres pour promouvoir cette uniformité. En 1813, il annonça l’instauration d’un tarif commun pour les services dispensés dans tout le diocèse. Mais, pour éviter tout affrontement avec les prêtres établis, il attendit presque toujours, quand il y avait opposition, le moment où un jeune prêtre prenait poste dans une paroisse pour imposer le tarif.
Malgré les efforts que Plessis déployait pour se rapprocher de son clergé, sa position d’évêque le maintenait nécessairement à une certaine distance. Au début du xixe siècle, la plupart des Canadiens avaient pour horizon la vallée du Saint-Laurent et leurs préoccupations sociales avaient surtout trait à la sauvegarde de leur culture. Le bas clergé partageait cette vision des choses. Quant à Plessis, qui était évêque d’un diocèse s’étendant de l’Atlantique jusque au delà de la rivière Rouge et qui avait la responsabilité de catholiques de toutes nationalités, il avait des perspectives plus larges. Dans le Bas-Canada, on lui reprochait ses visites pastorales à l’extérieur de la colonie et les dépenses qu’il encourait pour former les missionnaires qui iraient œuvrer là-bas. Les séminaristes lui en voulaient d’exiger qu’ils apprennent l’anglais. Tandis qu’il cherchait une entente cordiale avec les Britanniques, certains prêtres du Bas-Canada appuyaient prudemment le parti canadien, d’allégeance nationaliste. Et pourtant, grâce à son prestige, à son expérience et à son caractère, Plessis insuffla au clergé bas-canadien un sentiment de solidarité et une détermination qui lui avaient manqué jusque-là.
Depuis le début du xviiie siècle, le clergé avait vu décroître son influence morale et sociale sur la colonie. Après la Conquête, son autorité avait cessé de reposer sur le droit civil. L’expansion commerciale et militaire de Québec et de Montréal, comme les tendances séculières et démocratiques issues du Siècle des lumières et des révolutions américaine et française, avaient aussi miné son ascendant. La philosophie des Lumières attirait surtout la classe des seigneurs et la bourgeoisie montante. Entre les hommes de loi et l’Église se creusait un autre fossé : en exerçant les fonctions qui supposaient la perception d’un intérêt – préparation d’obligations légales par les notaires, prêt d’argent par les tuteurs et administrateurs de succession, décisions des juges condamnant des débiteurs –, les gens de justice pouvaient se voir refuser les sacrements. Conscient que la perception de l’intérêt était un aspect vital de l’économie bas-canadienne mais incapable d’y trouver en théologie une justification acceptable, Plessis demandait d’une part aux prêtres de ne pas prêcher sur le sujet, de ne pas s’enquérir de la question au confessionnal et de ne pas exiger restitution, mais leur ordonnait d’autre part d’appliquer les punitions prévues quand la perception d’un intérêt était portée à leur connaissance. Il proposait des moyens irréprochables de faire de l’argent avec de l’argent, en achetant des rentes viagères par exemple ; par contre, il accepta aussi, pendant la guerre de 1812, l’émission de « billets de l’armée » portant intérêt.
La question de savoir qui devait assumer le leadership de la population canadienne divisait aussi la bourgeoisie et l’évêque. Par la voix du parti canadien, la bourgeoisie nationaliste se proclamait seul défenseur des droits des Canadiens contre l’oppresseur britannique. L’analyse que Plessis faisait des problèmes sociaux et politiques des Canadiens ne différait pas substantiellement de celle d’un Louis-Joseph Papineau*, un des dirigeants du parti canadien, mais les deux hommes ne proposaient pas les mêmes solutions. Tandis que Papineau devenait de plus en plus démocrate et belliqueux, Plessis tentait d’infléchir la politique britannique de l’intérieur. Cependant, en dépit de ses désaccords avec la bourgeoisie canadienne, Plessis usait de sa propre civilité pour maintenir un lien personnel avec les chefs du parti canadien et surtout avec Papineau dont l’épouse, Julie Bruneau, était une admiratrice inconditionnelle de l’évêque. De toute manière, son Église continuait d’influer sur la vie de la bourgeoisie. Pour le parti canadien, elle faisait partie des institutions traditionnelles du Canada, et Papineau pouvait écrire au sujet de Plessis : « Tout en lui reprochant ses torts politiques, l’on apprécie ce qu’il a fait pour l’avantage de l’établissement Ecclésiastique qu’il préside. » En littérature, le voltairianisme ouvertement anticlérical déclinait alors que les livres religieux constituaient une des catégories de publication les plus importantes. Les rédacteurs en chef de journaux, y compris Henry-Antoine Mézière*, qui avait fait tant de bruit dans les années 1790, se montraient rarement irrespectueux. Le théâtre canadien, qui ne pouvait se passer de l’appui de la classe moyenne, avait du mal à survivre, en partie à cause de l’opposition du clergé. Même en politique, l’Église commandait le respect. Après que Thomas Lee eut prononcé à l’Assemblée, en 1814, un discours violemment anticlérical, un autre dirigeant du parti canadien, Pierre-Stanislas Bédard, estima qu’« il a[vait] agi étourdiement et dev[ait] bien faire tous ses efforts pour réparer sa faute ». Lee fut battu en 1816. La plupart des membres des professions libérales étaient récalcitrants en matière spirituelle. Toutefois, en 1807, Plessis nota que le respect de la foi caractérisait les marchands des régions rurales ; de même, en 1821, Lartigue l’informait qu’à Montréal, « comme partout ailleurs, les gens de la moyenne classe [étaient] les plus soumis et les plus attachés à la religion et à leurs Supérieurs ecclésiastiques ». La « moyenne classe » de Lartigue se composait probablement d’artisans et de boutiquiers.
Que la personne de Plessis ait inspiré le respect aux gens des campagnes semble indubitable ; quant aux ouvriers de Saint-Roch, on peut parler de vénération dans leur cas. En général, Plessis ne rencontrait les habitants que lors de ses visites pastorales ; aussi les faisait-il assidûment. C’était de véritables missions : il s’arrêtait plusieurs jours dans chaque paroisse pour prêcher, examiner les comptes de la fabrique, observer la conduite du prêtre et des fidèles, noter l’existence de confréries religieuses et la présence de protestants. Souvent, pour aborder les problèmes particuliers de la localité, il improvisait ses sermons, avec talent.
Même si les habitants et les ouvriers respectaient pour la plupart l’Église et l’ensemble du clergé, leur attitude ne ressemblait en rien à une soumission docile. En avril 1808 par exemple, il fallut voter une loi, qui allait ensuite être reconduite annuellement, « pourvo[yant] au maintien du bon ordre, les jours de Fêtes et Dimanches ». En décembre 1810, notant que les fêtes des patrons paroissiaux étaient devenues « des jours de blasphèmes et de batailles », Plessis déclara qu’à l’avenir toutes les paroisses célébreraient leur fête le même dimanche. Les problèmes de ce genre venaient peut-être de minorités tapageuses et de voyous. Mais les paroissiens se disputaient souvent sur le mode de répartition des bancs, le lieu où devait être construite une église, la création de nouvelles paroisses ou même la nature de certains pouvoirs temporels du prêtre dans l’administration paroissiale. Ces conflits révèlent d’ailleurs l’importance que l’institution religieuse avait pour les Canadiens qui lançaient des débats passionnés sur des questions de forme ou de méthode, mais rarement sur des articles de foi. Une apparente indocilité n’était pas nécessairement signe de désaffection. En 1808, Plessis fit les remarques suivantes : « L’Église [de Saint-Esprit] n’est pas achevée, le terrain n’est pas tout payé, il n’y a point de presbytère, et de plus de 200 habitants, il n’y a que 53 qui aient payé la dime de 1808. Cependant ils demandent un curé. » La religion des habitants était peut-être superficielle, conformiste, superstitieuse, mais elle était quand même fermement ancrée dans leur vie nationale et sociale.
La moralité des fidèles préoccupait Plessis. Dans les villes de Montréal, Québec et Trois-Rivières, les normes de conduite baissaient peut-être à mesure que la population et la prospérité augmentaient mais, selon John Lambert*, les habitants des paroisses rurales étaient « universellement modestes dans leur conduite ; les femmes de par leur nature, les hommes de par la coutume ». À Québec, les ouvriers de Saint-Roch étaient une consolation pour Plessis. Peu après sa nomination, l’évêque reconnaissait qu’il y avait « un assez bon fonds de foi et de religion » dans la colonie, surtout par rapport à l’Europe. En même temps, il cherchait à vaincre l’immoralité et l’indifférence religieuse qui, selon lui, gagnaient de plus en plus de terrain ; s’il en dramatisait l’importance, c’était peut-être pour faire valoir toute la nécessité d’un coup de barre. La position qu’il prit dans ce cas précis s’explique en partie par le durcissement de son attitude avec le temps. En 1800, il dénonçait l’« adhésion littérale à des principes moraux qui ont toujours une certaine latitude et qui doivent se plier aux circonstances des temps et des lieux ». En 1823 par contre, il écrivait : « L’immoralité suit de si près la négligence de certaines précautions, qu’il y aurait une grande imprudence à accuser de rigidité des loix qui les prescrivent et que ces loix, comme la morale dont elles sont le bouclier, ne doivent jamais [...] être considérées comme pouvant varier avec les circonstances des temps et des lieux. » En s’accroissant, ce conservatisme moral inspira une croisade discrète mais déterminée. Dans les églises, les peintures devinrent plus décentes. Avant d’accorder une dispense d’empêchement de mariage dans les cas où il y avait eu relations sexuelles préconjugales, il fallait de nouveau donner des motifs, exigence que les prédécesseurs de Plessis avaient abandonnée. On faisait la guerre à l’ivrognerie et à l’alcoolisme. Le clergé était exhorté à dénoncer avec plus d’insistance les réceptions, la danse et les vêtements malséants. Mais Plessis, réaliste, s’armait de patience ; en définitive, rien ne fut probablement plus modeste que l’étendue de sa réussite.
Pour stimuler la vie spirituelle des paroisses, Plessis encourageait la formation d’associations religieuses, comme il l’avait fait à Québec. Cependant, en dernier ressort, il devait s’appuyer sur le clergé pour faire sentir l’influence de l’Église. Dans une conférence, il décrivait ainsi aux séminaristes sa vision des relations entre le clergé et les laïques : « Figurez-vous le monde divisé en deux sortes de personnes, les unes ayant besoin de leçons, les autres chargées de leur en donner ; les unes affamées, les autres chargées de les nourrir ; les unes cherchant la voie du salut, les autres chargées de les y conduire ; les unes affligées, les autres chargées de les consoler ; les unes remplies de doutes et d’inquiétudes, les autres chargées de les éclairer et de les rassurer ; les unes malades, les autres chargées de les traiter & de les guérir. » Pareille conception laissait beaucoup de place au despotisme clérical mais Plessis, pour préserver le respect qui entourait ses prêtres, veillait à ce que ce pouvoir ne se manifeste pas. Contrairement à certains membres de son clergé, il considérait la dépendance financière des prêtres à l’égard de leurs paroissiens non comme un mal mais comme un frein à l’abus d’autorité ; en outre, il défendait le droit des paroissiens à protester jusque devant les tribunaux. Les dépenses somptuaires de construction et de décoration en temps de disette le rendaient furieux ; en 1806, il somma un prêtre d’abandonner le projet de construire un nouveau presbytère, sans quoi il frapperait son église d’interdit. Il conseillait de ne recourir à des sanctions contre les paroissiens revêches que si la persuasion avait échoué. Étant donné l’incertitude du statut légal de l’Église, il n’entamait des poursuites judiciaires contre des paroissiens que s’il était presque sûr de gagner. Par ailleurs, Plessis pouvait menacer les paroisses qui ne respectaient pas leur pasteur de les frapper d’interdiction ou de les priver de prêtre. Les ecclésiastiques étant rares, cette menace permettait d’atteindre des objectifs limités, mais elle avait moins d’effet sur l’attitude des paroissiens.
Plessis savait néanmoins qu’un clergé stable avait plus de chances d’asseoir son autorité et de créer avec les paroissiens des liens de confiance. Pendant son épiscopat, de 65 à 80 % des prêtres, selon la période, restèrent dans la même paroisse durant plus de 10 ans et de 45 à 53 % durant plus de 20 ans. S’occuper du bien-être matériel des paroissiens était l’une des tâches auxquelles il leur demandait de consacrer leur énergie. En période de mauvaise récolte, les habitants attendaient de leur prêtre prières et assistance ; celle-ci s’organisait, selon l’ampleur de la crise, à l’échelle de la paroisse, du district ou du diocèse. Ce n’est que lorsque l’Église était débordée que l’on faisait appel à l’État mais, même en ce cas, Plessis et le clergé dirigeaient les opérations. Aux yeux de Plessis, le clergé, en remplissant cette mission sociale, démontrait au peuple qu’il se souciait de ses besoins et qu’il était en mesure de les satisfaire.
Avec les protestants, Plessis avait des relations qui, sur certains points, étaient moins difficiles qu’avec ses propres fidèles. Même si l’idéal de tolérance hérité du Siècle des lumières comptait peu d’adeptes dans le Bas-Canada – et Plessis n’était pas de leur nombre –, rares furent les conflits religieux qui marquèrent son épiscopat. Plessis appliquait le programme de conciliation amorcé par Briand et dont l’élément central était la séparation confessionnelle. Il refusait de partager des églises avec les membres de l’Église d’Angleterre, comme le lui proposait le gouvernement, et condamnait plus énergiquement que ses prédécesseurs les mariages mixtes. Le mariage de deux catholiques devant un ministre protestant était jugé nul, et Plessis négocia avec Mountain, avec le ministre presbytérien Alexander Spark* et avec le gouverneur sir George Prevost* (au sujet des dispenses de bans) des ententes éliminant la plupart des possibilités que pareil mariage ait lieu dans la colonie. Toutefois, il en resta assez pour compromettre ses efforts en vue de restreindre l’attribution des dispenses d’empêchement de mariage qui, selon lui, étaient accordées trop librement par ses prédécesseurs ; les couples déçus menaçaient d’aller voir un ministre protestant compréhensif ou de se rendre aux États-Unis.
Plessis se montrait prudent face au prosélytisme. Ainsi, il fit remarquer en 1809 : « Mon système est bien de ne point tourmenter les protestans pour les amener à la vraie foi ; mais s’il ne s’agit que de leur dire quelques bonnes paroles [...] de leur faire voir la porte ouverte ; ce sont là des choses faciles qui, sans compromettre un Prêtre, peuvent contribuer essentiellement à la gloire de Dieu et à l’honneur de son Église. » Il s’opposait à ce que les religieuses hospitalières tentent de faire des conversions. Toutefois, surtout après la guerre de 1812, il encouragea prudemment la production d’écrits polémiques par des gens de la colonie, tels Jean-Baptiste Boucher*, Jackson John Richard* et Stephen Burroughs. Plus souvent, il importait des ouvrages anglais qui, selon lui, risquaient moins de heurter les susceptibilités du gouvernement.
En même temps, Plessis veillait à contrer l’apostolat protestant, dont les plus ardents praticiens étaient les méthodistes. Dans les campagnes, les paroissiens curieux étaient soumis à des pressions spirituelles et sociales de la part des prêtres qui harcelaient également ministres itinérants et colporteurs : ils leur achetaient leurs lots de tracts et de bibles, ou les confisquaient à ceux qui en avaient reçu, pour les brûler ensuite. Cependant, dès 1816, Plessis était convaincu qu’il devait publier sa propre édition du Nouveau Testament pour l’opposer à celle des méthodistes et, disait-il, « pour fermer la bouche aux protestans qui se plaignent sans cesse que nous dérobons aux fidèles la connaissance des écritures ». En 1825, après avoir vaincu l’opposition des sulpiciens et l’indifférence de Lartigue, qui avait été appelé à travailler au manuscrit, Plessis dut abandonner son projet parce que Rome refusait d’autoriser la publication. De toute façon, le prosélytisme des protestants était un échec lamentable. La plupart des Canadiens assimilaient le protestantisme au conquérant et, comme le notait Lartigue, lui préféraient l’impiété et même l’athéisme. Il reste que la déconfiture de l’apostolat protestant ne saurait s’expliquer sans la vigilance du clergé et sa capacité de circonscrire tous les efforts de ceux qui le pratiquaient. Jacob Mountain, qui espérait attirer les Canadiens dans l’Église d’Angleterre en augmentant le prestige de son représentant au détriment de celui de l’Église catholique, n’eut pas plus de succès. Avant la guerre de 1812, la Grande-Bretagne n’osait pas s’aliéner la vaste majorité de la population de la colonie en cédant aux sollicitations de Mountain ; après cette guerre, elle fut obligée de reconnaître sa dette envers Plessis, dont la loyauté avait été ostensible.
Même si le protestantisme ne gagnait pas de terrain, Plessis notait que « les rapports inévitables des catholiques avec les protestants, occasionn[aient] un rapprochement d’opinion qui alt[érait] sensiblement la pûreté de la foi et donn[ait] quelques frayeurs pour l’avenir ». Par exemple, il fallait assouplir la discipline catholique sur le jeûne là où les protestants étaient nombreux. Les enfants issus des mariages mixtes, même quand ils étaient supposément catholiques, formaient « une espèce de chrétiens-bâtards qui tomb[aient] dans l’incrédulité ». D’un autre côté, Plessis brandissait la menace protestante pour justifier l’insistance avec laquelle il en appelait à redonner de la vigueur à l’instruction du clergé et au travail pastoral.
Dans sa lutte contre la montée du laïcisme et la présence protestante, Plessis visait notamment le domaine de l’enseignement primaire. Tous s’accordaient pour reconnaître que ce secteur était dans un état lamentable, mais il n’y avait pas de consensus sur le type d’individu qu’il devait produire : un bon catholique ou un bon protestant, un bon nationaliste ou un bon loyaliste ? La loi qui, en 1801, avait prévu l’établissement d’un système public d’éducation sous l’égide de l’Institution royale pour l’avancement des sciences [V. Joseph Langley Mills] s’avéra bientôt inacceptable pour le parti canadien et Plessis. L’évêque encouragea le boycottage des écoles de l’Institution royale qui, en raison de l’indifférence des Canadiens envers l’éducation institutionnelle, fut d’une efficacité impressionnante. À deux reprises, soit en 1816 et en 1818, Plessis refusa le siège qu’on lui offrait au conseil d’administration de l’Institution royale, alors sous la présidence de Mountain. Son but ultime était d’assurer aux enfants de religion catholique un système scolaire qui serait régi par l’évêque dont ils relevaient. Il promouvait donc avec force l’enseignement primaire catholique, en partie pour réfuter les accusations selon lesquelles il ne boycottait l’Institution royale que pour maintenir les Canadiens dans l’ignorance, en partie pour remplir les collèges de plus en plus nombreux, mais surtout parce qu’il croyait encore, comme lorsqu’il était curé de Notre-Dame, que l’avenir de l’Église serait assuré dans la mesure où les enfants seraient instruits dans le cadre de leur religion. Il fonda lui-même d’autres écoles dans le faubourg Saint-Roch et poussa ses prêtres à en ouvrir dans leur paroisse. Ceux qui avaient été formés sous son influence, tels Painchaud, Mignault, Ducharme, Turgeon, Thomas Maguire*, Jean-Baptiste Kelly*, Pierre-Antoine Tabeau, Narcisse-Charles Fortier* et Jean-Baptiste-Antoine Ferland*, comprirent l’urgence de la chose, mais il n’en fut généralement pas de même pour les autres. En 1815, Plessis révisa le petit catéchisme pour mieux l’adapter aux enfants des campagnes qui, affirmait-il, avaient peut-être « moins de dispositions qu’en aucun lieu du monde à saisir les choses intellectuelles ».
À compter de 1814, Plessis appuya les tentatives du parti canadien pour faire adopter une nouvelle loi scolaire. Celle-ci tarda cependant à venir car le secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst, était déterminé à utiliser cette question pour pousser le parti canadien à faire des concessions sur le contrôle des finances gouvernementales [V. sir Francis Nathaniel Burton]. Enfin, en 1824, la loi des écoles de fabrique, qui permettait de financer des écoles à même les fonds des administrations paroissiales, fut votée. Des révisions de dernière minute, négociées par Plessis, placèrent la direction du système entre les mains du clergé plutôt que de la bourgeoisie libérale, sa rivale dans la course à l’hégémonie sur l’instruction des Canadiens. Par contre, Plessis ne parvint pas à obtenir que le gouvernement finance les écoles par l’intermédiaire d’une institution royale catholique. De plus, comme la plupart des prêtres préférèrent affecter les fonds des fabriques à la construction ou à la décoration d’églises ou de presbytères, la loi des écoles de fabrique s’avéra finalement un échec et fut remplacée en 1829. En l’obtenant, Plessis avait tout de même démontré sa puissance personnelle.
En fait, les relations étroites de Plessis et de son clergé avec la classe inférieure de la population canadienne, l’échec du prosélytisme protestant et l’efficacité du boycottage de l’Institution royale renforcèrent chez les protestants la conviction que l’évêque et ses prêtres constituaient de grandes forces dans la société canadienne. Aux yeux des protestants, l’amour des Canadiens pour les manifestations extérieures de piété – les nombreuses grandes églises et les processions pittoresques du saint sacrement par exemple – révélaient une profonde dévotion envers l’Église. Selon eux, la confession auriculaire et l’ignorance des Canadiens quant aux principes de la Réforme favorisaient grandement la domination cléricale. Enfin, l’attachement tenace des Canadiens à leur langue et à leurs coutumes et les représentations stéréotypées que les Britanniques avaient d’eux en raison de la ségrégation religieuse, sociale et géographique des deux groupes, concouraient à renforcer la croyance des protestants au pouvoir des prêtres. Mountain écrivit d’ailleurs que l’ignorance des Canadiens et l’influence de l’évêque étaient telles que l’on pouvait appeler Plessis « le pape du Canada ».
Au début du xixe siècle, il n’était pas déraisonnable de tenir pour acquis que le pouvoir religieux conférait de l’influence sociale et politique. La plupart des Britanniques le faisaient, puis tentaient de composer avec les implications de cet état de choses. Mountain voulait saper l’influence du clergé catholique ; quant à Sewell, il conseillait de la mettre au service de l’État ; John Lambert affirmait que le gouvernement devait se concilier le clergé en se montrant aussi tolérant que possible. Plessis, de son côté, veillait à promouvoir cette dernière position. Quelle qu’ait été l’influence réelle du clergé, il se préoccupait beaucoup de l’image que s’en faisaient les fonctionnaires britanniques. Quand il s’adressait à eux, il évoquait sans cesse un clergé chéri par les fidèles et prêt à user de son influence en faveur du gouvernement si les autorités lui laissaient le champ libre et lui accordaient leur appui.
Plessis avait d’abord encouragé Milnes à obtenir une réponse favorable à la pétition envoyée par Denaut en 1805 mais, dès l’été de 1806, il ne craignait pas moins que son prédécesseur de voir le gouvernement imposer des contrôles en échange de la reconnaissance civile de l’évêque. Il cessa donc de parler de la pétition. En même temps, tous les efforts déployés par Milnes, Mountain et Ryland pour faire adopter diverses restrictions par le gouvernement de la métropole échouaient. Les menaces les plus sérieuses à la position de Plessis étaient peut-être les affirmations de Sewell selon lesquelles l’Église n’avait aucun statut légal dans la colonie. Cependant, les jugements favorables que Sewell décrocha en cour avec cet argument [V. Joseph-Laurent Bertrand*], quand ils ne furent pas annulés par la suite, produisirent en politique des résultats équivoques. « L’impression que ces assertions font dans les esprits des catholiques n’est point désavantageuse à leur religion », notait Plessis. « Ils en sont au contraire irrités et encouragés à la maintenir. » Les nationalistes volèrent à la défense de l’Église ; les administrateurs de la colonie et les fonctionnaires de Grande-Bretagne craignirent d’exploiter les victoires de Sewell. En février 1810, soit plus de deux ans après le début du mandat d’un gouverneur très méfiant envers le clergé, sir James Henry Craig*, Plessis pouvait avoir pour un de ses prêtres ces paroles rassurantes : « nonobstant toutes les contrariétés qu’éprouve ici le S. ministère, nous sommes néanmoins, dans le pays [...] où il y a plus de foi, et où les fonctions ecclésiastiques sont exposées à moins de déboires ».
Cependant, Plessis voyait avec appréhension s’intensifier le conflit entre Craig et l’Assemblée, qui était soutenue par le journal le Canadien. Il craignait par-dessus tout les conséquences qu’aurait pour son Église une crise opposant les fidèles aux autorités, qu’il croyait de son devoir d’appuyer. Comme l’y obligeait la loi, il fit lire en chaire la proclamation dans laquelle Craig se justifiait d’avoir, en mars 1810, saisi le Canadien et emprisonné ses fondateurs et son imprimeur, mais il ne se laissa pas intimider par Craig. Un peu plus d’un an après, soutenant que le gouvernement britannique « considérera[it] que les dix-neuf-vingtièmes des habitants de ce pays [étaient] catholiques » et ne risquerait pas de « mettre la province en feu », il résista à la fois aux offres tentantes et aux menaces que Craig lui fit au cours d’une série de discussions animées dont le but était de le pousser à démissionner ou à abandonner certains de ses pouvoirs. L’échec de la mission que Ryland était allé remplir en Angleterre à la demande de Craig, et dont un des objectifs était de réduire l’autorité de l’évêque, prouva que Plessis avait raison : le gouvernement britannique craignait de créer dans le Bas-Canada une situation semblable à celle de l’Irlande.
Durant le mandat du successeur de Craig, sir George Prévost, Plessis put abandonner une des lignes de conduite de ses prédécesseurs, à savoir la résistance passive aux empiétements du gouvernement sur les pouvoirs épiscopaux, et passer à l’offensive pour obtenir la reconnaissance légale de son autorité d’évêque. Forcé, par l’imminence d’une guerre contre les États-Unis, de gagner l’appui des Canadiens, Prévost se tourna vers Papineau et Plessis qui étaient leurs chefs les plus influents. Le gouverneur demanda à l’évêque de lui indiquer ce qu’il fallait faire, selon lui, pour donner à son poste une assise respectable. Plessis rejeta les incitations à la prudence que lui faisait Roux. Le temps était à l’audace : « Le gouverneur est bon [...] La protection décidée que les catholiques d’Irelande reçoivent de tous les protestants du Royaume, [...] les dispositions récemment manifestées par les Lords Castlereagh, Grey et Grenville, [...] les frayeurs que les succès des armes françaises donnent à la Grande-Bretagne, le désir de conserver le Canada à l’Angleterre dans un moment où les États-Unis semblent vouloir l’envahir ; tout cela concourt à faire espérer quelque succès d’une tentative que l’on se reprocherait peut-être par la suite de n’avoir pas faite. » En mai 1812, il demanda entre autres la reconnaissance civile de l’évêque et du coadjuteur. Durant la guerre de 1812, il manifesta inlassablement sa loyauté et celle du clergé. Pour diverses raisons, les Canadiens accordèrent leur appui aux Britanniques dès le début ; la loyauté de Plessis reçut donc non seulement l’approbation des autorités mais aussi celle du peuple. En 1813, le gouvernement exprima sa satisfaction en portant le salaire de l’évêque à £1 000.
Le rappel de Prévost eut lieu avant que les demandes formulées par Plessis en 1812 aient pu recevoir une réponse. L’évêque trouva cependant un autre allié, et même un ami intime, en la personne du nouveau gouverneur, sir John Coape Sherbrooke, qui apprécia d’emblée sa vaste connaissance du peuple et du pays et qui vit en lui un éventuel conseiller. Élément plus important encore, Sherbrooke avait reçu de Bathurst en juillet 1816 des instructions officielles lui indiquant de se concilier Plessis, et lui expliquant que les catholiques « form[aient] une large majorité de la population et [que] leur influence à la chambre d’Assemblée [devait] être prédominante ». Il lui écrivait également ceci : « Il nous faut viser avant tout à ne pas laisser les démagogues faire des catholiques les instruments de leurs mauvais desseins [...] c’est pourquoi vous saurez ; j’espère, vous mettre en bonne intelligence avec l’évêque catholique. Comme il a sur le clergé un très grand pouvoir, il doit, par l’intermédiaire du clergé, en avoir un très grand sur le peuple aussi [...] et il n’y a pas de moyen plus efficace (pas d’autre moyen efficace, je crois) de se concilier les laïques catholiques que de passer par le clergé. Ici, on ne se montrera pas réfractaire à leurs intérêts et à leurs désirs, même si cela doit désavantager les protestants. » La dépêche de Bathurst représentait pour Plessis le triomphe de dix années de diplomatie. En 1817, il fut nommé au Conseil législatif ce qui constituait une reconnaissance officielle de l’évêque de Québec. Admis au conseil en février 1818, il se retrouva à la tête d’un contingent fantôme de catholiques, car ses coreligionnaires s’y montraient rarement. Lui-même assista à 60 % des réunions environ ; il y était en général discret, mais s’animait quand les discussions portaient sur des questions religieuses, éducatives ou sociales.
Entre-temps, un autre problème sérieux avait progressivement accaparé l’attention de Plessis : l’étendue de son diocèse le rendait ingouvernable. Impossible de douter de l’intérêt que l’évêque portait aux catholiques vivant hors du Bas-Canada. Il leur envoyait des missionnaires aussi souvent que possible et, comme il en manquait, il ouvrit les portes du séminaire de Québec aux garçons de ces régions qui aspiraient au sacerdoce. Plus d’une fois, il participa au financement de leurs études [V. Ronald Macdonald*]. Généreux et intelligent dans sa façon de conseiller les missionnaires, il ne ménageait ni ses énergies ni son temps ; en 1811, 1812 et 1815, il avait visité les catholiques des Maritimes, évalué la situation de l’Église dans ces colonies, prêché et organisé la vie religieuse. Dans un journal, il avait pris des notes sur la géographie, l’histoire, la démographie et les activités économiques de la région. D’un oeil perspicace et souvent critique, sinon tout à fait objectif (il était bien un métropolitain en tournée dans l’arrière-pays), il observa la vie sociale. et morale des catholiques acadiens, écossais et amérindiens. À Paspébiac, centre des activités de pêche de Charles Robin en Gaspésie, il notait : « les habitans [...] sont des espèces de serfs entièrement dans [la] dépendance » des Robin parce que perdus de dettes envers eux. À l’Île-du-Prince-Édouard, il trouva que les 3 750 Acadiens et les 250 Écossais vivaient dans « la plus parfaite harmonie ». Cependant, ils ne pratiquaient pas l’exogamie, chaque groupe « tenant aux mœurs et aux allures de sa nation ». L’apathie des Micmacs du Nouveau-Brunswick le frappa : « ils voient les Anglais s’établir au milieu d’eux, piller leurs terres, enlever leur foin, s’emparer de leurs pêches à saumon, sans se donner aucun mouvement pour en obtenir justice ». Ces voyages se déroulaient dans des conditions souvent difficiles. En bateau, Plessis avait toujours le mal de mer ; à terre, la plupart des catholiques étaient si pauvres que le gîte et le couvert qu’ils lui offraient étaient souvent repoussants. À Sydney Mines, dans l’île du Cap-Breton, il dut célébrer la messe dans un grenier à foin où il faisait si chaud qu’une odeur nauséabonde montait des stalles. À ces inconvénients, il réagissait avec humour ou compassion mais jamais avec dédain. La visite pastorale qu’il fit dans le Haut-Canada en 1816 fut beaucoup moins éprouvante : sa plus désagréable expérience fut d’être pris dans une horde de touristes américains aux chutes du Niagara.
Il reste que ces visites ne pouvaient pas remplacer la direction soutenue et immédiate d’un évêque. Même si Plessis laissait beaucoup de latitude à ses vicaires généraux, Alexander McDonell dans le Haut-Canada, Edmund Burke* en Nouvelle-Écosse et Angus Bernard MacEachern à l’Île-du-Prince-Édouard, la subdivision du diocèse s’imposait à cause de la distance géographique et de l’accroissement de la population catholique qui était surtout dû à l’immigration irlandaise et écossaise. Il n’y avait pas d’autre moyen de constituer une administration ecclésiastique organisée, constante et efficace. De plus, même si en 1818 Plessis avait à peine lancé l’activité missionnaire dans le Nord-Ouest [V. Joseph-Norbert Provencher*], il était convaincu que cette région particulièrement isolée aurait tout de suite besoin d’un évêque.
Après avoir accédé à l’épiscopat en 1806, Plessis avait tenté plusieurs fois, en vain, de faire subdiviser son diocèse. Puis, en 1817, Londres et Rome s’entendirent sur la création de vicariats apostoliques en Nouvelle-Écosse, dans le Haut-Canada et à l’Île-du-Prince-Édouard ; celui de la Nouvelle-Écosse fut érigé sans délai et Burke placé à sa tête. La formation de petits vicariats apostoliques isolés qui relevaient directement de Rome heurta le sens de l’organisation de Plessis et sa conception du pouvoir institutionnel ; d’après lui, le gouvernement britannique allait diviser pour régner. Il aurait préféré, pour faciliter la planification et l’action concertée, une province ecclésiastique qui aurait été gouvernée par un archevêque à Québec et par des évêques suffragants installés dans la colonie de la Rivière-Rouge, dans le Haut-Canada, à Montréal, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Influencée par les idées de Plessis, Rome laissa tomber le reste de l’entente qu’elle avait conclue avec Londres. Le 12 janvier 1819, sans avoir davantage consulté l’évêque, Rome l’élevait à la dignité d’archevêque de Québec mais, plutôt que des postes ordinaires d’évêque suffragant, elle créait deux postes de vicaire général épiscopal suffragant et auxiliaire, l’un dans le Haut-Canada pour McDonell et l’autre à l’Île-du-Prince-Édouard pour MacEachern. Rien n’était prévu pour Montréal et la Rivière-Rouge, que Plessis aurait voulu confier respectivement à Lartigue et à Joseph-Norbert Provencher. Avant que la nouvelle de cette décision ne parvienne à Québec, Plessis était parti pour Londres afin de faire valoir son propre projet ; il n’apprit son élévation à la dignité d’archevêque qu’après son arrivée en Angleterre, début d’août 1819. Offensé que Rome ait agi unilatéralement, Bathurst, avec qui Plessis avait de toute façon prévu des négociations difficiles, se montra encore moins disposé à étudier la proposition de l’archevêque, soit la formation d’une province ecclésiastique ordinaire. Ce ne fut que grâce à sa capacité de persuasion que Plessis obtint du secrétaire d’État aux Colonies la vague permission d’employer McDonell, MacEachern, Lartigue et Provencher comme assistants et de leur conférer les pouvoirs qu’il jugerait appropriés.
Par ailleurs, Plessis mena avec Bathurst des négociations sur les biens des sulpiciens, alors menacés d’expropriation par le gouvernement, et ce même si Lartigue, qui l’accompagnait, avait reçu de ces religieux le mandat d’obtenir confirmation de leur droit de propriété. Ryland notait à ce sujet : « [les sulpiciens] sont conscients de l’avantage qu’ils tireront de la présence de ce personnage [Plessis] en Angleterre, où il aura les moyens de faire une apparition splendide, et ils se flattent, avec raison, de ce que sa subtilité et ses talents, ainsi que les pieuses professions de loyauté qui ont déjà tant fait pour eux de ce côté [...] ne peuvent pas échouer de l’autre ». L’intervention de Plessis auprès de Bathurst contribua grandement à empêcher la saisie des biens, qui était imminente, mais elle ne régla pas leur sort ultime.
De Londres, Plessis partit pour Rome en passant par la France et l’Italie. Partout où il s’arrêtait, il rencontrait l’archevêque, l’évêque ou le curé pour se renseigner sur la situation locale de la religion tout en visitant l’église ou la cathédrale. Il observait le paysage et le profil de la population, les coutumes, les activités économiques. Parvenu dans les États pontificaux, il critiqua, toujours pragmatique, la négligence que les papes et les cardinaux du passé avaient manifestée envers les services publics, leur reprochant même d’avoir englouti des sommes folles dans des œuvres d’art et des monuments (fussent-ils à la gloire du catholicisme) au lieu de promouvoir l’agriculture, le commerce et la santé de la population. Les nus des toiles et sculptures européennes le scandalisèrent plus d’une fois, particulièrement lorsqu’il s’agissait de thèmes religieux employés dans la décoration des églises. Pourtant, il était sensible au pouvoir d’édification de l’architecture et de l’art religieux : très fier de la majesté et de la beauté des églises bas-canadiennes, il s’efforçait d’améliorer la qualité de la peinture religieuse dans son diocèse. Ainsi, depuis 1817, il pressait énergiquement les communautés religieuses et les curés d’acheter des pièces de la magnifique collection d’œuvres européennes envoyées de France dans le Bas-Canada par Philippe-Jean-Louis Desjardins.
Détentrice d’une tradition catholique séculaire, Rome impressionna Plessis, mais il s’y trouvait en voyage d’affaires, non en pèlerinage. Il n’avait pas l’esprit ultramontain. Ses années de séminaire l’avaient imprégné d’influences gallicanes qui s’étaient renforcées dans les années 1790 à la faveur de ses relations particulièrement étroites avec les prêtres français émigrés qu’Hubert avait amenés dans la colonie et qui voyaient toujours en Plessis leur protecteur. Seules les circonstances le poussèrent à adopter des positions que l’on qualifia par la suite d’ultramontaines. Sous un gouvernement protestant, il lui fallait insister sur l’autonomie que l’Église devait conserver par rapport à l’État. De même, s’il répétait que le pape, guidé par la tradition, avait autorité en matière d’interprétation des Saintes Écritures, c’est que les protestants étaient là et qu’eux, disait-on, interprétaient la Bible à leur guise. Quant à la vision d’une Église gouvernée par un pontife puissant, elle lui plaisait parce qu’il avait un penchant pour les administrations unifiées et hiérarchisées.
À Rome, Plessis entendait avant tout faire accepter la concession qu’il avait arrachée à Bathurst et pousser le Vatican à négocier avec Londres la création d’une province ecclésiastique ordinaire. Selon son représentant à Rome, Robert Gradwell, cet « homme habile et sensé [...] en adoptant la manière anglaise, en a[vait] forcé plusieurs, qui étaient bien assez portés à prendre leur temps, à se remuer ». Plessis n’avait que du dédain pour le cardinal Francesco Fontana, préfet de la Propagande, qu’il qualifiait de « vieille femme dépourvue de tout sens des affaires ». Par contre, il admirait le cardinal Ercole Consalvi, maître diplomate du Congrès de Vienne, et était son émule ; en dépit de son agressivité, notait Gradwell, « aucun évêque ne joui[ssait] à Rome d’une estime aussi générale » que Plessis. Si, malgré sa forte personnalité, il ne put vaincre l’inertie du Vatican sur la plupart des points, il obtint cependant des bulles faisant de Lartigue et Provencher des vicaires généraux épiscopaux comme McDonell et MacEachern, outre des indulgences et d’autres privilèges religieux qui stimuleraient l’ardeur spirituelle des Canadiens. Il avait été reçu trois fois par Pie VII et avait été nommé comte et assistant au trône pontifical.
En février 1820, Plessis repartit pour Londres. À Paris, il eut avec Louis XVIII un entretien qui le laissa pessimiste quant à l’éventualité d’une restauration religieuse en France. Se trouvant à Londres en mai, il eut l’autorisation d’emmener 4 prêtres français au Bas-Canada ; il en avait demandé 12. Reçu par Bathurst, il se plaignit entre autres des préjugés qui empêchaient les Canadiens d’obtenir des places dans l’administration coloniale. Il transmit personnellement les salutations du pape à George IV. En juin, il s’embarqua pour New York où, suivant la demande de Pie VII, il s’enquit des dissensions qui déchiraient l’Église américaine. Le 7 août, il était à Montréal, puis il descendit le Saint-Laurent en triomphe et accosta à Québec le 14 devant une foule tumultueuse.
Plessis constata qu’en son absence, sous le gouvernement du duc de Richmond [Lennox*] et de son successeur lord Dalhousie [Ramsay*], les affrontements avaient repris entre le parti canadien et le gouvernement colonial. Au Conseil législatif, il adopta une position indépendante de celle de Dalhousie d’une part, et du parti canadien d’autre part, tout en cherchant à consolider ses récents acquis. Cependant, la polarisation politique était telle que l’indépendance était suspecte aux yeux de Dalhousie, qui en vint à le considérer comme la source d’une opposition occulte. De plus, selon Richmond et Dalhousie, la fin de la guerre avait délivré le gouvernement de la nécessité de conserver l’appui de Plessis, et ils communiquèrent ce sentiment à Bathurst. « L’horison se noircit [...] écrivait Plessis à un prêtre. Ceux qui viendront après moi, auront plus de misère que moi. N’importe, ils s’en tireront s’ils savent louvoyer. En voulant heurter de front l’autorité, ils ne gagneront rien. Je me confirme tous les jours de plus en plus dans ce système, et franchement il ne m’a pas mal réussi. » Ce fut vers le parti canadien qu’il louvoya. En mars 1821, il vota au Conseil législatif contre une résolution selon laquelle la liste civile devrait être approuvée intégralement pour toute la durée de la vie du roi, mesure rejetée depuis longtemps par le parti canadien. De 1822 à 1824, il s’opposa avec ce parti à un projet de loi sur l’union du Haut et du Bas-Canada qui contenait une clause exigeant l’assentiment du gouvernement aux nominations ecclésiastiques. L’opposition du clergé fut l’un des principaux facteurs de l’échec de ce projet.
L’appui des dirigeants du parti canadien fut utile à Plessis quand, après 1821, les sulpiciens contestèrent l’élévation de Lartigue à la dignité d’évêque suffragant de Montréal. Ces religieux soupçonnaient avec raison que Lartigue minerait leur hégémonie spirituelle sur la ville et la région. Plessis demanda à Rome de le soutenir, puis tenta de tenir le conflit en veilleuse jusqu’à ce que sa position ait été confirmée. Discrètement, il rassembla des appuis en faveur de Lartigue, persuadant Papineau et Denis-Benjamin Viger* qu’il fallait voir, dans la nomination d’un évêque à Montréal, un honneur pour le peuple canadien. Comme Lartigue était lié à de grandes familles montréalaises, l’aide matérielle ne manqua pas pour la construction de l’église Saint-Jacques ; par contre, Plessis retarda habilement un projet rival des sulpiciens qui consistait en l’agrandissement de l’église Notre-Dame. Empêcher l’homme nerveux et autoritaire qu’était Lartigue de démissionner par découragement ou de transformer, par son agressivité, la lutte en un conflit grave, était déjà un exploit. Plessis eut la situation bien en main jusqu’à ce que, en août 1823, Augustin Chaboillez, curé de Longueuil, publie une diatribe sur la nomination de Lartigue. L’ouvrage se vendait si vite que Plessis autorisa Lartigue à y répondre, mais la réplique fut si mordante qu’elle ne fit que durcir l’opposition. Plessis fut pour beaucoup dans la rédaction d’une réponse plus modérée par Louis-Marie Cadieux*, curé de Trois-Rivières, mais il opposa son veto à la publication d’une réplique de Painchaud parce qu’elle ne soutenait pas assez Lartigue et l’autorité épiscopale. Quand l’incorrigible Chaboillez revint à la charge avec un pamphlet encore plus incendiaire, Plessis ordonna de mettre un terme à cette guerre de mots. Entre-temps, la Propagande avait été neutralisée par une avalanche de mémoires envoyés par les sulpiciens et leurs alliés.
Plessis reçut peu d’appui du gouvernement, qui aurait pu réfuter l’un des principaux arguments de Chaboillez, à savoir que le ministère des Colonies n’avait pas autorisé la nomination de Lartigue à Montréal. L’indépendance que l’évêque manifestait au conseil continuait de susciter l’amertume de Dalhousie. En 1824, Plessis s’allia au parti canadien pour faire adopter la loi des écoles de fabrique ; cependant, faute de reconnaissance civile, bien des paroisses ne pouvaient pas s’en prévaloir, et tous les efforts de Plessis en vue d’obtenir pareille reconnaissance échouèrent tant que Dalhousie fut dans la colonie. Quand, la même année, ce dernier partit pour l’Angleterre en congé, Plessis profita des bonnes dispositions du lieutenant-gouverneur sir Francis Nathaniel Burton pour faire ériger la paroisse de Sainte-Claire au moyen de lettres patentes qui pourraient servir de modèle. En retour, Plessis fit en sorte que le conseil adhère au compromis élaboré par Burton et le parti canadien sur les finances gouvernementales. Dalhousie, qui accusa Burton d’avoir ainsi vendu l’indépendance financière du pouvoir exécutif colonial, ne pardonna jamais à Plessis le rôle qu’il avait joué dans cette affaire. Entre-temps, toutefois, il était devenu pratiquement impossible au gouverneur, qui rêvait de placer un jour l’évêque sous l’autorité de l’État, d’atteindre son but. Quand, en juillet 1824, il proposa de tenter encore une fois d’obtenir le pouvoir de faire les nominations ecclésiastiques, Bathurst lui répondit : « il est maintenant trop tard pour récupérer l’autorité que nous avons laissé échapper. Tenter de la reprendre engendrerait à tout le moins une lutte qui pourrait pendant bien longtemps annuler tous les effets bénéfiques qui découleraient de son obtention. » Plessis, cependant, ne s’était rapproché du parti canadien que par opportunisme. Chacun voyait l’autre comme un ennemi sur le plan idéologique et un rival sur le plan social. Les votes que Plessis enregistra au conseil sur d’autres aspects des finances gouvernementales mirent les nationalistes en colère. Les positions étaient si polarisées que Plessis ne pouvait continuer à osciller entre Dalhousie et Papineau ; des deux côtés, il fut attaqué.
Au début des années 1820, Plessis avait cependant des inquiétudes plus pressantes. Le surcroît de travail et l’ascétisme avaient miné sa forte constitution. Dès janvier 1810, il avait fait construire pour son usage exclusif une chambre de malade avec un bureau à l’Hôpital Général. Dès 1816, des fièvres et des rhumatismes ou des phlébites aux jambes et aux pieds le forcèrent à y séjourner de plus en plus souvent. Quand il le fallait, il s’appliquait, avec toute la force de sa volonté, à surmonter la douleur – « J’ai pris le parti, écrivait-il à Jean Raimbault en 1817, de ne plus considérer ma maladie que comme une indisposition. Cela me met plus au large et me donne plus de liberté. » Mais au cours du printemps et de l’été de 1825, sa santé se détériora de façon alarmante, et l’on craignit de plus en plus que Dalhousie ou les sulpiciens ne parviennent à imposer à Panet, qui allait lui succéder, un coadjuteur de leur choix. Plessis tenta de faire nommer Lartigue à ce poste mais Dalhousie l’en empêcha. À la fin de novembre 1825, de son lit d’hôpital, Plessis persuada cependant Dalhousie d’accepter, comme candidats au poste de coadjuteur de Panet, Pierre-Flavien Turgeon et Jérôme Demers* ; il n’aimait pas ce dernier mais le proposa parce qu’il était dans les bonnes grâces du clergé. Quelques jours plus tard, sa succession étant apparemment assurée, il conversait tranquillement avec son médecin, Thomas Fargues*, qui observa soudain que, « sans le moindre soupir ni la moindre convulsion, ses yeux se fermèrent, son bras tomba sur sa chaise, son menton se posa sur sa poitrine et il cessa silencieusement de respirer ».
Plessis fut exposé à l’Hôpital Général, après quoi 40 porteurs, précédés d’ecclésiastiques et d’une garde d’honneur du 79th Foot, le conduisirent à l’Hôtel-Dieu et, tout au long du trajet, la foule affluait dans les rues. Le 7 décembre au matin, les boutiques fermèrent à neuf heures trente, pour l’inhumation de Plessis à la cathédrale Notre-Dame. Conformément à son vœu, son cœur fut déposé dans l’église de Saint-Roch. S’il était mort à plus de dix milles de la cathédrale, avait-il précisé dans son testament, on aurait enterré sa dépouille dans l’église paroissiale la plus proche. Assistant aux funérailles, Dalhousie observa froidement la consternation de la population et le « très profond [...] chagrin de bien des prêtres, jeunes et vieux ».
Parmi ceux qui pleuraient la mort de Plessis se trouvait son futur biographe Louis-Édouard Bois*, alors étudiant au petit séminaire de Québec. Plessis, écrit-il, était « de taille un peu au-dessous de la moyenne, mais fort corpulent. Il avait le front large et la tête grosse, et tous les traits de la figure très proportionnés. [...] Il avait peu de barbe et des cheveux noirs, mais toujours poudrés à blanc. » On découvrit que les effets personnels de l’évêque étaient inextricablement mêlés à des biens ecclésiaux dont il était le fiduciaire ; de toute façon, tous ses legs étaient destinés à des institutions religieuses ou à des membres du clergé. Ses amis intimes, Antoine Girouard, Jean Raimbault, Philippe-Jean-Louis Desjardins, Pierre-Flavien Turgeon et Thomas Maguire par exemple, étaient tous des prêtres.
Les historiens canadiens-français ont dépeint Joseph-Octave Plessis et ses prêtres en fonction de l’idéologie de leur temps. Produits d’une époque dominée par le clergé, la plupart des auteurs du xixe et du début du xxe siècle, comme Bois, considéraient Plessis comme le premier évêque ultramontain du Québec. Par contre, les historiens contemporains, issus d’une époque marquée par le libéralisme, le nationalisme et le laïcisme, ont plutôt insisté sur la lutte qu’il avait menée contre ces forces. En fait, Plessis n’était pas un ultramontain, et la grande majorité des Canadiens demeuraient solidement attachés à leur Église, à leur clergé et à leur religion, même si celle-ci était davantage une version populaire du catholicisme que sa forme officielle. Bien sûr, les révolutions américaine et française avaient ébranlé la conception ecclésiale d’une société conforme au plan divin. Aux forces qui contestaient la place de l’Église dans la vie de la colonie, soit le gouvernement colonial, le protestantisme et les idées démocratico-libérales, ses prédécesseurs avaient opposé une résistance passive. Quant à Plessis, il planifia une contre-attaque qu’il mit à exécution. Elle consista d’une part à assurer la solidité structurelle de l’Église en augmentant le nombre de prêtres, en obtenant la reconnaissance civile et en visant la création d’une province ecclésiastique et, d’autre part, à concentrer les efforts pastoraux sur l’éducation et la réforme morale. Plessis avait assez de force de caractère pour soutenir une longue lutte et assez de souplesse pour exploiter les circonstances favorables au profit de l’avancement de sa cause ou, dans toute conjoncture difficile, éviter l’affrontement en louvoyant. Ses victoires furent souvent, il est vrai, des demi-défaites : la reconnaissance civile se limita à lui personnellement ; la subdivision de son diocèse fut loin de répondre au profil qu’il avait envisagé de donner à la province ecclésiastique ; l’augmentation de l’effectif clérical demeurait d’une lenteur décourageante ; la loi des écoles de fabrique fut abrogée après sa mort et, si le petit catéchisme fut remanié, l’adoption et la révision du grand catéchisme furent abandonnées. Néanmoins, c’était là le genre de débuts laborieux qui annoncent les grands mouvements. Ce petit ascète affable et rond, cet homme à la volonté de fer et au grand cœur inspira aux jeunes prêtres, par la force de son exemple, un sens de leur mission et un dévouement qui manquaient à leurs aînés. Il leur donna l’élan qui leur permit de traverser les tumultueuses années 1830 et les plaça à la tête de la société canadienne après que des dirigeants du mouvement laïciste, libéral et nationaliste, refusant de louvoyer, eurent mené leurs troupes à la destruction sur les rochers de la rébellion de 1837–1838.
Deux sermons de Joseph-Octave Plessis ont été publiés de son vivant : Discours à l’occasion de la victoire remportée par les forces navales de sa majesté britannique dans la Mediterranée le 1 et 2 août 1798, sur la flotte françoise prononcé dans l’église cathédrale de Québec le 10 janvier 1799 [...] (Québec, 1799) ; et Sermon prêché par l’évêque catholique de Québec dans sa cathédrale le IVe dimanche du Carême, 1er avril 1810 [...] (Québec, 1810). Deux autres ont paru au xxe siècle : « l’Oraison funèbre de Mgr Briand », BRH, 11 (1905) : 321–338, 353–358 ; et « Sermon prêché à la cathédrale de Québec [...] à l’occasion de la paix américaine [...] le jeudi, 6 avril 1815 », BRH, 35 (1929) : 161–172. Les recensements de Québec compilés par Plessis en tant que curé se trouvent dans ANQ Rapport, 1948–1949 : 1–250, sous le titre « les Dénombrements de Québec ». Les journaux de voyages de Plessis en dehors du Bas-Canada ont aussi été publiés après sa mort. Ceux des voyages de 1811 et 1812 se trouvent sous le titre de « Journal de deux voyages apostoliques dans le golfe Saint-Laurent et les provinces d’en bas, en 1811 et 1812 [...] », dans le Foyer canadien (Québec), 3 (1865) : 73–280. Le journal de 1811 a été réimprimé sous le même titre dans la Rev. d’hist. de la Gaspésie (Gaspé, Québec), 6 (1968) : 23–43, 91–115. Les journaux des trois visites aux Maritimes ont paru dans Soc. hist. acadienne, Cahiers (Moncton, N.-B.), 11 (1980), sous le titre de « le Journal des visites pastorales en Acadie de Mgr Joseph-Octave Plessis, 1811, 1812, 1815 », avec présentation et notes d’Anselme Chiasson. Le journal du voyage de 1815 avait déjà été édité, avec celui de la visite au Haut-Canada en 1816, par Henri Têtu sous le titre de Journal des visites pastorales de 1815 et 1816, par Monseigneur Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec (Québec, 1903). La même année, Têtu édita Journal d’un voyage en Europe par Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, 1819–1820 (Québec). Les mandements et lettres pastorales de Plessis se trouvent dans le volume 3 de Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec, Henri Têtu et C.-O. Gagnon, édit. (18 vol. parus, Québec, 1887– ). La correspondance de Plessis a été inventoriée par Ivanhoë Caron*, voir « Inv. de la corr. de Mgr Plessis », ANQ Rapport, 1927–1928 : 215–315 ; 1928–1929 : 89–208 ; 1932–1933 : 1–244. Sa correspondance avec les évêques américains a été éditée par Lionel St George Lindsay et publiée sous différents titres dans American Catholic Hist. Soc. of Philadelphia, Records (Philadelphie), 18 (1907) : 8–43, 182–189, 282–305, 435–467 ; 22 (1911) : 268–285. Plessis devrait être considéré comme l’auteur véritable du Petit Catéchisme du diocèse de Québec, approuvé et autorisé (Québec, 1815), dont de nouvelles éditions ont été publiées à Québec en 1816 et 1819, et coauteur de Observations sur un écrit intitulé Questions sur le gouvernement ecclésiastique du district de Montréal (Trois-Rivières, Québec, 1823) dont le premier brouillon a été fait par Louis-Marie Cadieux à qui l’ouvrage est généralement attribué.
À part un petit fonds des AAQ, 31-11 A, il n’existe pas d’archives privées de Plessis. Toutefois de nombreux fonds d’archives le concernent directement. Les plus importants sont : AAQ, 20 A, I–VII ; 210 A, II–XII ; 22 A, V–VI ; 1 CB, I–X ; CD, Diocèse de Québec, I–VIII ; 69 CD, VI–VIII ; 515 CD, I–II ; A–B ; 6 CE, I ; 7 CM, I–VI ; 10 CM, III ; 90 CM, I–II ; IV ; 60 CN, I–VII ; A ; 310 CN, I ; 311 CN, I–II ; 312 CN, I–VII ; 320 CN, I ; III–VII ; Séries TC ; TF ; ACAM, 901.013 ; 901.036 ; RCD, XXXVIII ; RLL, I–IV ; AP, Notre-Dame de Québec, Sér. 1, ms 71–76 ; APC, MG 24, J4 ; Arch. du séminaire de Nicolet (Nicolet, Québec), AO, Séminaire, III, nos 37, 58 ; Lettres de Mgr J.-O. Plessis à M. Raimbault ; Archivio della Propaganda Fide (Rome), Scritture riferite nei Congressi, America Settentrionale, 2 (1792–1830) ; Lettere della Sacra Congregazione e Biglietti di Monsignore Segretario, 297–307 (mfm aux APC) ; Arch. of the Archbishop’s House (Londres), IC, 56–57 ; ID, A-55 ; Gradwell papers, B-3 ; B-30 ; E-7 ; E-8 ; Poynter papers, VI B1 ; B2 ; ASQ, mss, 205 ; 218–219 ; 257 ; mss-m, 102 ; 978 ; Polygraphie, XI, 19 ; Séminaire, 253 ; ASSH, Sect. A, sér. A, 1.1, 4–1 ; ASSM, 21, Cartons 45–46 ; PRO, CO 42/108–211 (mfm aux APC).
Les études portant sur l’Église catholique et la situation religieuse dans la colonie dans les années 1790–1825 sont relativement nombreuses. Les plus significatives sont : Noël Baillargeon, le Séminaire de Québec de 1760 à 1800 (Québec, 1981) ; Raymond Brodeur, « Identité culturelle et Identité religieuse, étude d’un cas : le Petit Catéchisme du diocèse de Québec, approuvé et autorisé par Mgr J. O. Plessis, Québec, le 1er avril 1815 » (2 vol., thèse de ph.d., univ. de Paris-Sorbonne, 1982) ; Richard Chabot, le Curé de campagne et la Contestation locale au Québec (de 1791 aux troubles de 1837–38) : la querelle des écoles, l’affaire des fabriques et le problème des insurrections de 1837–38 (Montréal, 1975) ; Chaussé, Jean-Jacques Lartigue ; Maurice Fleurent, « l’Éducation morale au Petit séminaire de Québec, 1668–1857 » (thèse de ph.d., univ. Laval, 1971) ; Serge Gagnon et Louise Lebel-Gagnon, « le Milieu d’origine du clergé québécois, 1775–1840 : mythes et réalités », RHAF, 37 (1983–1984) : 373–397 ; Claude Galarneau, les Collèges classiques au Canada français (1620–1970) (Montréal, 1978) ; L.-E. Hamelin, « Évolution numérique séculaire du clergé catholique dans le Québec », Recherches sociographiques (Québec), 2 (1961) : 189–241 ; Laval Laurent, Québec et l’Église aux États-Unis sous Mgr Briand et Mgr Plessis (Montréal, 1945) ; Lemieux, l’Établissement de la première prov. eccl. ; J. S. Moir, The Church in the British era : from the British conquest to confederation (Toronto, 1972) ; Fernard Ouellet, « l’Enseignement primaire : responsabilité des Églises ou de l’État (1801–1836) », Recherches sociographiques, 2 : 171–187, et « Mgr Plessis et la Naissance d’une bourgeoisie canadienne », SCHEC Rapport, 23 (1955–1956) : 83–99 ; Fernand Porter, l’Institution catéchistique au Canada ; deux siècles de formation religieuse, 1633–1833 (Montréal, 1949) ; Louis Rousseau, la Prédication à Montréal de 1800 à 1830 : approche religiologique (Montréal, 1976) ; Marcel Trudel, « la Servitude de l’Église catholique du Canada français sous le Régime anglais », SCHEC Rapport, 30 (1963) : 11–33 ; et J.-P. Wallot, « l’Église canadienne et les Laïcs au début du xixe siècle », le Laïc dans l’Église canadienne-française de 1830 à nos jours (Montréal, 1972) : 87–91 ; « The Lower-Canadian clergy and the reign of terror (1810) », SCHEC Sessions d’études, 40 (1973) : 53–60 ; « Pluralisme au Québec au début du xixe siècle », le Pluralisme : symposium interdisciplinaire, Irenée Beaubien et al., édit. (Montréal, 1974) ; 57–65 ; et Wallot, Un Québec qui bougeait, 183–224.
Les oraisons funèbres constituent les premières biographies de Plessis. Celle de Jean Raimbault, publiée dans l’Écho du cabinet de lecture paroissial (Montréal), 2 (1860) : 6–11, sous le titre de « Oraison funèbre de Monseigneur J. O. Plessis, évêque de Québec, mort le 4 décembre 1825 », fut la plus significative. La bibliothèque canadienne (Montréal) publia « Notice sur la vie de feu Monseigneur J. O. Plessis, évêque de Québec » (5 (1827) : 89–96). Cette notice nécrologique fut suivie par « Notice biographique sur Mgr. J. O. Plessis » publiée dans les Mélanges religieux (Montréal), 2 (1841) : 363–366, 381–384, 396–398. Jean-Baptiste-Antoine Ferland, ancien protégé et secrétaire de Plessis, publia en 1863 dans le Foyer canadien (Québec), 1 : 70–318, sous le titre de « Notice biographique sur Monseigneur Joseph Octave Plessis, évêque de Québec », une biographie encore utile et agréable à lire. Elle fut traduite par T. B. French et publiée à Québec l’année suivante sous le titre de Biographical notice of Joseph-Octave Plessis, bishop of Québec (Québec), puis publiée de nouveau en français à Québec en 1878 sous le titre de Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec. Entre-temps, en 1872, Louis-Édouard Bois rédigea une biographie qui intéresse surtout parce qu’il fait de Plessis un ultramontain. Toujours manuscrite, cette biographie se trouve aux ASN, AP-G, L.-É. Bois, Succession, XVII, nos 19–30. À partir de cette date et jusqu’en 1883, Laurent-Olivier David* publia trois notices biographiques de Plessis qui conservent uniquement un intérêt historiographique : la première s’inspire fortement de l’idéologie libérale, mais la série complète démontre une intéressante évolution dans l’interprétation. Tout comme Bois et David, Henri Têtu est fortement endetté envers Ferland pour la présentation de la carrière de Plessis et pour l’étude de son caractère dans Notices biographiques ; les évêques de Québec (Québec, 1889 ; réimpr. en 4 vol., Québec et Tours, France, 1930), 436–525. En effet, ce n’est qu’avec Ivanhoë Caron que l’étude de la vie de Plessis dépasse la contribution de Ferland et se trouve conduite pour la première fois de façon scientifique. À sa mort, en 1941, Caron laissa inachevée une biographie manuscrite massive (AAQ, Sér. T, Papiers Ivanhoë Caron, 3) dont les cinq premiers chapitres furent publiés sous le titre de « Mgr Joseph-Octave Plessis » dans le Canada français (Québec), 2e sér., 27 (1939–1940) : 193–214, 309–320, 826–841 ; 28 (1940–1941) : 71–96, 180–195, 274–292, 784–796, 1029–1036. En outre, il publia quatre articles solidement documentés dans SRC Mémoires : « la Nomination de Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, au Conseil législatif de Québec », 3e sér., 27 (1933), sect. i : 1–32 ; « Monseigneur Joseph-Octave Plessis, archevêque de Québec, et les premiers évêques catholiques des États-Unis », 3e sér., 28 (1934), sect. i : 119–138 ; « Monseigneur Joseph-Octave Plessis : sa famille », 3e sér., 31 (1937), sect. i : 97–117 ; et « Monseigneur Joseph-Octave Plessis, curé de Notre-Dame de Québec (1792–1805) », 3e sér., 32 (1938), sect. i : 21–40. L’étude biographique de Plessis en est restée là jusqu’à l’achèvement de notre thèse « Joseph-Octave Plessis » dans laquelle on trouvera une bibliographie complète jusqu’en 1979.
Les 27 portraits connus de Plessis ont été étudiés par Lucille Rouleau Ross dans une thèse de maîtrise présentée en 1983 à l’université Concordia (Montréal) sous le titre de « les Versions connues du portrait de Monseigneur Joseph-Octave Plessis (1763–1825) et la Conjoncture des attributions pictorales au début du xixe siècle ». [j. h. l.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
James H. Lambert, « PLESSIS, JOSEPH-OCTAVE (baptisé Joseph) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 23 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/plessis_joseph_octave_6F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/plessis_joseph_octave_6F.html |
| Auteur de l'article: | James H. Lambert |
| Titre de l'article: | PLESSIS, JOSEPH-OCTAVE (baptisé Joseph) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1987 |
| Année de la révision: | 1987 |
| Date de consultation: | 23 déc. 2025 |