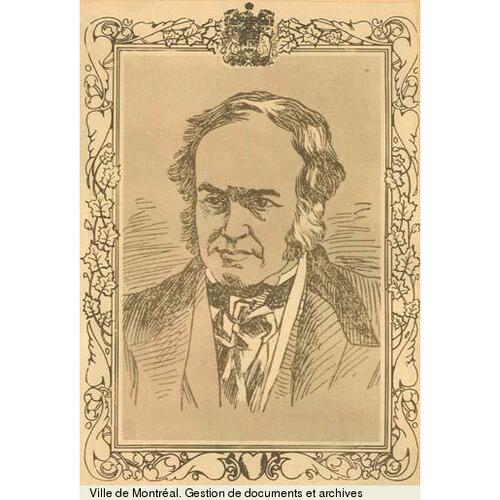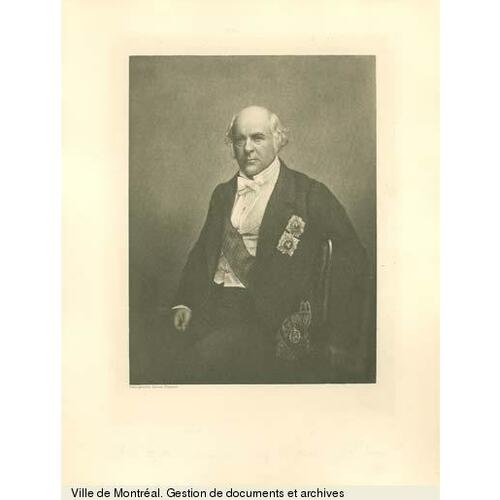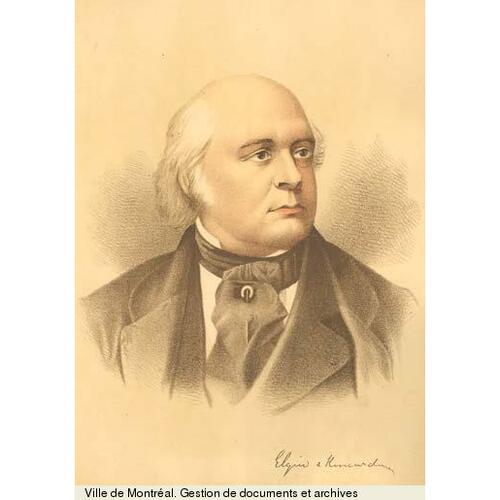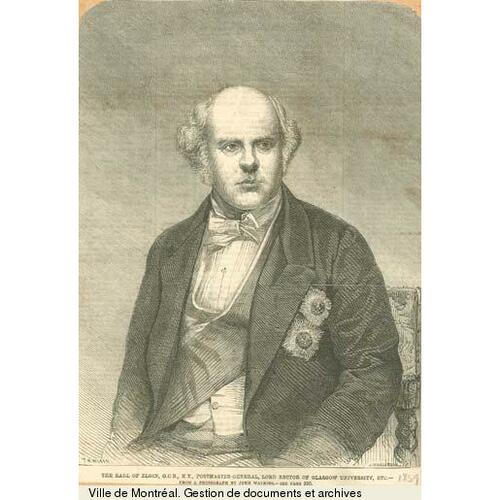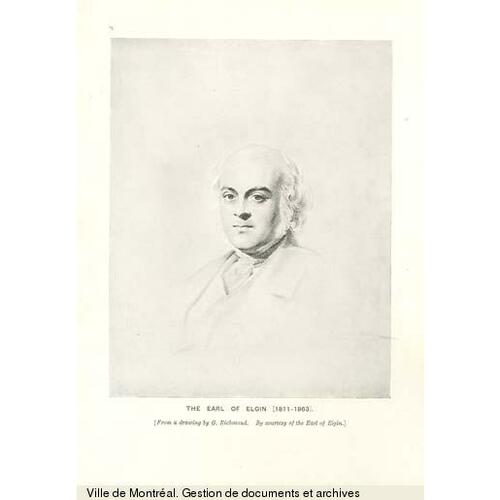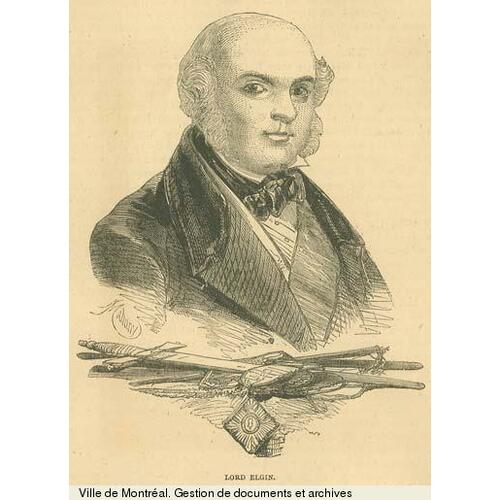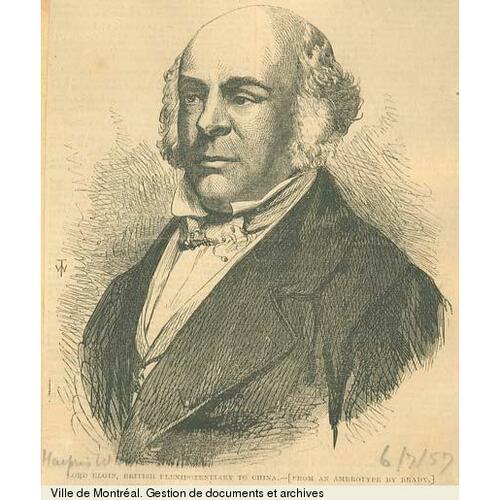Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3644739
BRUCE, JAMES, 8e comte d’ELGIN et 12e comte de KINCARDINE, administrateur colonial, né le 20 juillet 1811, à Londres, second fils de Thomas Bruce, 7e comte d’Elgin et 11e comte de Kincardine, sauveteur des « marbres d’Elgin », et d’Elizabeth Oswald, décédé le 20 novembre 1863, à Dharmsala, Inde.
James Bruce, étant le fils cadet jusqu’en 1840, dut se préparer pour travailler, et la réussite qu’il connut dans la carrière qu’il embrassa est attribuable en grande partie à son éducation et à sa préparation première à un emploi. Il fit ses études à Eton et à Christ Church, Oxford, et devint l’un des diplômés d’un groupe brillant de ces deux institutions, dont plusieurs furent, plus tard, des collaborateurs en politique et dans le service aux colonies.
Bruce étudia d’une façon intensive, à un point tel que sa santé se détériora et il dut se contenter de terminer un cours avec d’excellentes notes plutôt que deux. Néanmoins, il quitta Oxford, non seulement avec un bagage de lectures classiques, mais après avoir « maîtrisé » par lui-même, tel que son frère le rapporta, la philosophie de Samuel Taylor Coleridge. Celle-ci, avec son énoncé sur la nature organique de la société, dans laquelle les membres et les intérêts sont dépendants les uns des autres, fut une acquisition significative et intéressante pour un jeune homme qui devait diriger, avec l’abord facile et le charme sympathique qu’on lui connaissait déjà à Oxford, des sociétés inachevées et informes vers une cohérence dans l’autonomie.
Ses études terminées en 1832, Elgin retourna en Écosse pour aider à l’administration des biens familiaux et pour lire et réfléchir. Mais il envisageait une carrière politique. En 1834, il rédigea une Letter to the electors of Great Britain, dans laquelle il se montrait un libéral-conservateur à l’exemple de sir Robert Peel et manifestait une tournure d’esprit inspirée de la philosophie de Coleridge. Il échoua aux élections dans le comté de Fife en 1837 parce qu’il s’était présenté trop tard, mais en 1840 il fut élu dans Southampton. Il appuya l’amendement à l’adresse qui renversa le gouvernement de lord Melbourne en 1841. Mais, déjà, en 1840, à la mort de son frère aîné, il était devenu l’héritier du titre de comte et, à la mort de son père en 1841, il dut renoncer, en sa qualité de pair écossais, à ses espoirs d’avancement comme député à la chambre des Communes.
En 1842, cependant, il accepta la nomination de gouverneur de la Jamaïque et s’y rendit avec sa nouvelle épouse, Elizabeth Mary Cumming-Bruce. Malheureusement pour la santé de cette dernière, qui était enceinte, le navire fit naufrage en cours de route. À la Jamaïque, Elgin trouva une société affaiblie par une dépression économique à la suite de l’abolition de l’esclavage et par des conflits raciaux, à peu près semblables à ceux qu’il devait plus tard découvrir au Canada. Il y trouva aussi un modèle classique de l’ancienne constitution coloniale de laquelle les réformistes canadiens cherchaient à se sortir. Ainsi, de multiples façons, la Jamaïque lui servit de préparation pour le Canada. Elle lui fournit aussi une occasion d’utiliser son charme personnel et son sens de la diplomatie en orientant les idées vers des améliorations d’ordre pratique et des attitudes politiques modérées.
En 1846, affligé par la perte de sa femme et craignant pour sa propre santé et celle de sa fille, Elgin retourna en congé en Angleterre. Le nouveau ministre des Colonies dans le gouvernement whig de lord John Russell, lord Grey, fut impressionné par les réalisations d’ Elgin à la Jamaïque et le pressa, mais sans succès, d’y retourner. Grey invita alors Elgin à assumer les fonctions de gouverneur du Canada. L’acceptation par Elgin d’une nomination faite par un whig et la nomination d’un tory par Grey préfigurèrent le rôle impartial qu’Elgin devait jouer dans ses nouvelles fonctions. Par pure coïncidence, cette nouvelle physionomie politique d’Elgin fut soulignée par son mariage avec lady Mary Louisa Lambton, fille de lord Durham [Lambton*] et nièce de lord Grey. Ainsi, publiquement et privément, il avait tous les atouts de son côté pour remplir la mission que lui avait confiée Grey, celle d’élaborer et d’assurer la mise en place du gouvernement responsable dans les provinces de l’Amérique du Nord britannique. Dans ses importantes dépêches du 3 novembre 1846 et du 31 mars 1847, Grey avait rendu cette idée claire par son analyse des circonstances qui avaient empêché l’avènement du gouvernement responsable en Nouvelle-Écosse. La conduite d’Elgin au Canada établit dans la pratique la forme du gouvernement responsable, prélude à la naissance de la nationalité canadienne qui était alors embryonnaire. Sa correspondance privée avec Grey fut en fait un programme de ce qui devait être accompli en Amérique du Nord britannique durant la génération suivante.
Elgin arriva au Canada le 30 janvier 1847 et rencontra aussitôt le gouvernement conservateur en place. Ce dernier avait été élu en 1844, après la démission du ministère de Robert Baldwin* et de Louis-Hippolyte La Fontaine et, bien qu’engagé à appuyer le gouverneur et à résister à l’application du gouvernement responsable, il était lui-même devenu dans les faits un gouvernement de parti, sous la conduite de William Henry Draper*. On s’attendait dans certains milieux à ce qu’Elgin, comme tory, assume la direction du gouvernement ; dans d’autres milieux, on pensait qu’en sa qualité de gouverneur nommé par un gouvernement whig afin de reconnaître le gouvernement responsable, il renverrait le ministère Draper et demanderait aux réformistes de former un nouveau ministère. Elgin ne fit ni l’un ni l’autre. Il était décidé, avant son arrivée, à ne pas être « un gouverneur partisan », comme semblait l’avoir été son prédécesseur sir Charles Theophilus Metcalfe*. Il allait adopter « une position de neutralité vis-à-vis les débats de partis ». C’était le premier pas en vue de mettre sur pied ce qu’il appelait un « gouvernement constitutionnel », but premier de sa mission au Canada selon lui. Pour lui, ces deux mots signifiaient gouverner selon un ensemble complet de conventions qui présideraient à la formation et au fonctionnement du cabinet, et au rôle du gouverneur général en sa qualité de représentant de la couronne. En résumé, c’était le gouvernement monarchique parlementaire, qui était déjà confirmé par l’usage au Royaume-Uni.
En conséquence, Elgin fit clairement connaître qu’il appuierait Draper soit au cours d’une nouvelle session de la législature, soit dans ses efforts pour renforcer sa position au parlement en recherchant l’appui des partisans canadiens-français de Louis-Hippolyte La Fontaine. Elgin lui-même écrivit à Augustin-Norbert Morin pour lui suggérer d’assurer l’appui canadien-français au ministère, d’autant plus volontiers qu’il accepta l’opinion de Draper que la présente division des partis – d’une part, les tories considérés comme le parti « anglais » et, d’autre part, les réformistes considérés comme le parti « français » – n’était que provisoire. Mais Morin et ses associés, qu’Elgin considérait comme essentiellement conservateurs, déclinèrent la suggestion du gouverneur, et l’alliance ne se produisit pas, du moins à ce moment.
N’ayant pas réussi à se gagner l’appui canadien-français, le gouvernement réclama la dissolution, à la fin de 1847, et le parti réformiste remporta une victoire décisive aux élections qui suivirent. Défait en chambre, le ministère conservateur démissionna en bloc. Depuis 1841, la pratique avait été de simplement remanier les ministères en conservant quelques anciens membres dans le nouveau ministère, mais c’est à titre de chef de parti que La Fontaine fut invité par Elgin à former un ministère. Elgin, comme gouverneur impartial, accepta ainsi le premier gouvernement de l’histoire canadienne délibérément fondé sur un parti.
En se plaçant, comme représentant de la couronne, au-dessus des partis et en laissant le pouvoir de gouverner entre les mains d’un ministère formé des chefs d’un parti politique organisé et défini, Elgin révéla ce qu’il entendait par gouvernement constitutionnel. Cette nouvelle caractéristique du ministère signifiait aussi que le cabinet était collectivement responsable devant l’Assemblée, par l’entremise du premier ministre, de sa politique et de son administration. Le gouverneur ne serait plus le chef du gouvernement dans les domaines de l’administration et de la législation locales, et n’aurait plus voix en matière de favoritisme local comme Metcalfe l’avait désiré. Et afin de prévenir l’établissement d’un système de favoritisme à la Andrew Jackson, il devait s’assurer que les fonctionnaires permanents et supérieurs, étant politiquement neutres, puissent avoir la sécurité d’emploi.
À titre de fonctionnaire impérial, Elgin avait, bien entendu, des obligations, recevait des instructions spécifiques du ministre des Colonies, avait voix aux décisions concernant la défense et les relations étrangères, était responsable des Affaires indiennes et d’autres domaines dont la juridiction n’avait pas encore été transférée au gouvernement canadien ; cet ensemble de responsabilités l’empêcha de jouer un rôle totalement neutre. Elgin et Grey devaient en plus agir judicieusement et avec tact dans le remodelage des procédures gouvernementales archaïques et simples du Canada afin de les ajuster aux pratiques conventionnelles et administratives complexes d’un cabinet britannique. Elgin fut donc, derrière la scène, un gouverneur beaucoup plus actif que sa nouvelle définition de fonctions le prévoyait. Heureusement, La Fontaine, Baldwin et Francis Hincks* désiraient atteindre les mêmes fins et mirent leur confiance en lui, de sorte que la mise en place d’un gouvernement pleinement parlementaire s’effectua sans secousses. Non pas que c’était seulement une question d’organisation des fonctions ; le contrôle par un parti du « patronage » signifiait, évidemment, que des centaines de postes dans la fonction publique allaient aux Canadiens français, d’autres aux réformistes canadiens-anglais, deux groupes qui avaient eu un accès limité à la fonction publique, auparavant. Elgin mit une touche finale à la vision qu’il avait de ses fonctions à la fois en maintenant les cérémonies et les réceptions traditionnelles et en simplifiant le protocole des visites, des cérémonies officielles et des discours publics. Dans tout cela, son charme personnel et sa simplicité l’aidèrent grandement.
Le nouveau ministère réformiste, qui fut assermenté le 11 mars 1848, marqua l’arrivée au pouvoir de Canadiens français comme membres d’un parti et non pas à titre individuel et représenta aussi l’aboutissement de la longue agitation en faveur de l’autonomie de la colonie. Il eut bientôt à faire face, sous la direction et les avis d’Elgin, aux conséquences des changements économiques et extérieurs qui survinrent dans les années cruciales de 1846 à 1850.
Le premier changement avait été l’abrogation en 1846 des Corn Laws ; cette mesure avait précipité l’effondrement de l’ancien système colonial et avait poussé Russell et Grey à établir leur politique en Amérique du Nord britannique sur la reconnaissance d’un gouvernement pleinement responsable dans les questions locales. Un autre problème fut celui de l’immigration au Canada et aux États-Unis en 1847 causée par la famine en Irlande. Non seulement amena-t-elle au Canada quelque 70 000 immigrants irlandais cette année-là, dont plusieurs devaient être un fardeau par suite des ravages du choléra, mais elle donna l’occasion aux Américains irlandais de porter un coup à la Grande-Bretagne par le biais de l’Amérique du Nord britannique. Elgin eut à surveiller étroitement les organisations et les réunions irlandaises de Montréal ainsi que les agitateurs irlandais de Boston et de New York. Le mécontentement en Irlande pouvait aussi s’allier facilement à celui du Canada.
À ces préoccupations s’ajouta en 1847 la dépression commerciale et financière qui suivit l’effondrement du boom des chemins de fer dans le Royaume-Uni. Comme elle arrivait en même temps que l’abrogation des Corn Laws et la perte des marchés britanniques privilégiés pour les produits canadiens, le commerce du Canada fut totalement perturbé. La baisse du commerce, l’augmentation des faillites et la chute des valeurs de placement peuvent bien avoir été causées par la seule dépression, mais il était normal pour les hommes d’affaires canadiens de les attribuer à la disparition du système de protection auquel ils étaient habitués.
La révolution constitutionnelle canadienne de 1848 peut avoir devancé au Canada l’écho des révolutions libérales qui secouèrent l’Europe et qui commencèrent en France la même année. Qu’il existât des craintes est corroboré par la réaction suscitée par le retour d’exil de Paris de Louis-Joseph Papineau*. Il se révéla un critique éloquent et dur du « simulacre » de gouvernement responsable et se mit en campagne pour redevenir le porte-parole du sentiment national francophone. La popularité qu’il acquit presque aussitôt causa une certaine crainte parmi les partisans canadiens-français du parti réformiste. Mais les ministres de langue française, soutenus par Elgin, s’arrangèrent pour miner sa popularité et faire de lui un personnage isolé prêchant une opposition perpétuelle. Ils réussiront impitoyablement et cruellement à étouffer la révolution au Canada, bien qu’elle allait continuer de couver chez les « rouges » annexionnistes et républicains, héritiers de Papineau.
Dans la perspective de l’étape suivante de la crise canadienne, il fut heureux que Papineau fût vraisemblablement neutralisé politiquement vers la fin de 1848. Parce que, même si Papineau était réduit à l’impuissance, il y avait une mesure, commandée à la fois par l’équité et la politique, qui devait démontrer clairement aux Canadiens français que le gouvernement responsable n’était pas un simulacre mais une réalité : l’indemnisation des personnes qui avaient subi des dommages au cours de la répression de la rébellion de 1837 dans le Bas-Canada (ce qui avait été fait pour le Haut-Canada). Cette mesure avait retenu l’attention du ministère de Draper et une commission royale avait recommandé le paiement des pertes subies par ceux qui n’avaient pas été effectivement condamnés pour des actes de rébellion. Le gouvernement Draper n’y donna pas suite, mais évidemment un gouvernement dirigé par un Canadien français, recevant l’appui des députés canadiens-français de l’Assemblée et soumis aux attaques de Papineau, se devait de prendre en main cette question, aussi bien du point de vue de la justice que de la politique. Le projet de loi pour l’indemnisation des pertes subies pendant la rébellion fut voté par la majorité des députés du Haut et du Bas-Canada, malgré le tollé de l’opposition tory qui prétendait que cette loi récompensait les « rebelles ».
Pour saisir parfaitement le dilemme dans lequel se trouva Elgin en abordant cette loi, il faut comprendre que l’opposition tory, autant que le gouvernement, faisait l’expérience du gouvernement responsable et se familiarisait avec les nouveaux règlements, et qu’Elgin était son conseiller presque autant qu’il l’était pour ses ministres. Dans l’ensemble, ses membres, et particulièrement leur chef sir Allan Napier MacNab, étaient simplement des tories dépassés, craignant que le nouveau régime ne permette à un ministère de se maintenir au pouvoir d’une façon permanente, comme cela avait été le cas auparavant ; cette fois cependant, il s’agissait d’un gouvernement réformiste ayant l’appui canadien-français. Les paroles de MacNab au commencement des débats sur le projet de loi sont éloquentes à ce sujet : « Nous devons créer du désordre maintenant ou autrement nous n’accéderons jamais au pouvoir. » Il savait aussi que le gouverneur général, à titre de représentant officiel de Londres, pouvait de bon droit refuser de sanctionner le « paiement aux rebelles », et qu’il pouvait en tout cas dissoudre le parlement ou réserver le projet de loi à la décision du gouvernement impérial. MacNab tentait ainsi de forcer Elgin à utiliser les privilèges qui lui restaient sous le gouvernement responsable.
Elgin refusa d’être détourné du rôle qu’il avait assumé. Le gouvernement possédait une majorité solide ; rien n’indiquait que des élections changeraient cette situation mais on pouvait croire qu’elles provoqueraient plutôt des troubles raciaux dans le Bas-Canada. De plus, la question était de nature locale et non impériale ; elle devait par conséquent être traitée localement avec le consentement du gouverneur. Si ses supérieurs n’étaient pas d’accord, ils pourraient le rappeler. S’il réservait le projet de loi, il entraînerait simplement le gouvernement impérial dans les affaires locales et provoquerait peut-être un autre soulèvement de Papineau avec l’aide américaine et irlandaise. Il se rendit donc à l’édifice du parlement le 25 avril 1849 et donna son assentiment à la loi.
Il s’ensuivit immédiatement une attaque violente par une foule de manifestants « respectables » contre la voiture du gouverneur alors qu’il s’en retournait. Puis la même foule incendia délibérément les édifices du parlement et des bagarres éclatèrent dans les rues ; on s’attaqua aux demeures de La Fontaine et de Hincks. Montréal se trouvait à la merci d’une foule organisée et agressive de tories et d’orangistes, à laquelle des citoyens conservateurs se joignirent activement ou s’interdirent de résister. Quand Elgin retourna rencontrer le parlement le 30 mai pour recevoir une adresse, sa voiture fut de nouveau assaillie par des projectiles, et il emporta une pierre de deux livres qu’on y avait lancée. La demeure de La Fontaine fut de nouveau attaquée et un homme fut tué par ses défenseurs. Elgin demeura à l’extérieur de la ville le reste de l’été de façon à ne pas provoquer une autre explosion de colère, ou, peut-être, une flambée de violence raciale. Cette ligne de conduite, bien que condamnée par d’aucuns comme étant de la lâcheté, démontrait un grand courage moral et constituait un indice significatif de son grand sens de la mesure. Les ministres ne pouvaient pas connaître une telle quiétude. Le gouvernement resta en place, mais les troupes furent appelées et on augmenta les effectifs de police. S’inspirant de celle d’Elgin, leur ligne de conduite fut de ne pas répondre à la provocation par la provocation, mais de faire montre d’une conduite modérée afin de ridiculiser la violence arrogante. À la fin, cette politique triompha, mais seulement en subissant les accès de désespoir passionné des tories de Montréal. En octobre 1849, après de multiples indices de ce qui se préparait, apparut le Manifeste annexionniste, qui proposait l’union politique et économique du Canada et des États-Unis et était signé par un grand nombre de personnalités marquantes du monde des affaires et de la politique. C’était un geste de désespoir, le geste d’hommes dont l’univers avait été bouleversé par la disparition du protectionnisme, par la dislocation de l’empire du Saint-Laurent, dont Montréal était le centre, et par le remplacement de l’ « ascendant » britannique par la « domination française ».
Malgré ses efforts au cours des protestations et des troubles consécutifs à l’adoption de la loi pour l’indemnisation des pertes subies pendant la rébellion, MacNab ne parvint pas à contraindre Elgin, ou à forcer son rappel. Au fond, le Manifeste annexionniste fut une réplique à la fermeté d’Elgin. Étant donné que le représentant de la reine accueillait les Canadiens français au pouvoir sur un pied d’égalité avec les Anglais et convertissait le système commercial de l’ancien Empire en un nouveau système basé sur la liberté de commerce, le gouvernement local, des institutions communes et une allégeance commune, les loyalistes aigris et les hommes d’affaires de Montréal, financièrement embarrassés, pensèrent alors que l’annexion était un choix tellement judicieux qu’elle serait accordée en la demandant. Aux yeux des hommes qui restaient attachés à des théories dépassées, Elgin ne pouvait paraître qu’un traître ou un être frivole. Elgin n’était ni l’un ni l’autre. Il entrevoyait déjà une nation formée d’éléments divers et édifiée sur des institutions et des conventions dont le bon fonctionnement aurait été prudemment éprouvé. Grey et le gouvernement Russell partagèrent ces mêmes sentiments, et ce dernier témoigna son approbation en élevant Elgin à la pairie britannique avec un siège à la chambre des Lords. Ses ministres le suivirent également dans cette voie. Les signataires du Manifeste annexionniste qui détenaient des commissions de la couronne, comme c’était le cas de plusieurs tories, durent renier le manifeste ou abandonner leurs postes. Montréal, où on avait tenté de contraindre le parlement et le gouvernement de la province du Canada, fut déclarée impropre à être le siège du gouvernement.
Ces mesures freinèrent la violence des Montréalais indignés. De plus, le cours général des événements détourna l’attention des hommes d’affaires vers des occupations qui leur convenaient davantage. En 1850, la prospérité était revenue à Montréal et au Canada. En temps de prospérité, même le gouvernement responsable et la « domination française » pouvaient se tolérer. MacNab se rendit chez Elgin qui le reçut avec courtoisie. Le gouvernement responsable et tout ce qu’il signifiait – des Canadiens français en fonction, des règles de gouvernement britanniques et non américaines, l’efficacité dans les finances publiques et la fonction publique, des décisions prises au niveau local et le contrôle local du favoritisme – avait été éprouvé au milieu du désordre et sous la menace de l’annexion.
Il restait beaucoup à faire et les quatre autres années d’ Elgin au Canada exigèrent l’exercice des mêmes talents que durant l’année 1849. Il y avait des réformes locales à adopter, telles que l’abolition des « réserves » du clergé et de la tenure seigneuriale dans le Bas-Canada. Cette dernière était une question purement locale et fut traitée par le parlement canadien. Mais les réserves du clergé, régies par une loi impériale de 1840, ne pouvaient être touchées sans une loi du parlement du Royaume-Uni qui habiliterait la législature canadienne à adopter des mesures à ce sujet. La question remettait en cause le principe de l’appel à la Grande-Bretagne, comme dans le cas de l’adoption de la loi pour l’indemnisation des pertes subies pendant la rébellion, surtout que rien ne pouvait symboliser davantage un empire et une nation au-delà des mers qu’une Église établie commune. Cependant, Elgin recommanda qu’on demande au gouvernement impérial de mettre un terme à la loi de 1840 et de confier l’avenir des réserves au parlement canadien. Après l’échec de multiples efforts, par suite de l’opposition des évêques à la chambre des Lords, on passa à l’action et, en 1854, on mit fin aux réserves mais en termes qui respectaient les droits acquis. La même année, on abolit la tenure seigneuriale.
Que cette législation fût l’œuvre d’un parti de coalition anglo-français, libéral-conservateur, réjouit Elgin, parce qu’une telle union était la conséquence du régime qu’il avait rendu possible au Canada, c’est-à-dire des décisions prises au niveau local par des hommes modérés et responsables. Mais plus réjouissante, sans doute, fut la conclusion, longtemps retardée, du traité de réciprocité avec les États-Unis, l’action finale de la diplomatie personnelle d’ Elgin. Perçue dès 1846 au Canada comme l’aboutissement nécessaire du démantèlement du système protectionniste, la réciprocité avait été maintes et maintes fois rejetée par les États-Unis à cause du manque d’avantages évidents pour les intérêts économiques américains et de ses implications comme un prélude possible à l’annexion, situation qui aurait bouleversé l’équilibre entre les états esclavagistes et abolitionnistes dans la république en expansion de 1848. Les attraits de la libre navigation dans la partie canadienne du Saint-Laurent et de l’accès aux pêcheries des provinces de l’Atlantique firent disparaître les objections américaines à savoir que la réciprocité ne comportait pas d’avantages pour les États-Unis. En 1854, le gouvernement britannique reconnut la nécessité de faire des pressions sur le Congrès. Elgin se rendit à Washington et, par un tour de force diplomatique, convainquit les sénateurs du Sud que la réciprocité préviendrait et non provoquerait l’annexion. Ce fut le point culminant d’une campagne intensive de persuasion qui avait duré sept ans, pendant lesquels il avait établi les règles du gouvernement constitutionnel, monarchique et parlementaire du Canada et assuré cette prospérité sans laquelle, pensait-il à l’instar de Durham, on ne pouvait s’attendre à ce que les Canadiens préfèrent un gouvernement autonome à l’intérieur de l’Empire à l’annexion aux États-Unis.
Elgin retourna en Angleterre en décembre 1854. Malgré les avances qu’on lui fit, il demeura en dehors de la politique active. En 1857, le litige avec l’empire de Chine concernant le lorcha Arrow et les privilèges commerciaux britanniques à Canton amena le gouvernement de Palmerston à déléguer Elgin à titre d’envoyé spécial en Chine. La mission fut retardée par la nécessité d’apporter une aide à la répression de la révolte des cipayes. En 1857, cependant, de concert avec un envoyé français, Elgin se fraya un chemin par la force des armes dans la ville de Canton et, en 1858, il négocia à T’ien-tsin avec les représentants du gouvernement impérial un traité prévoyant l’envoi d’un ministre britannique en Chine, des privilèges commerciaux additionnels, la protection des missionnaires ainsi qu’une indemnité. Il se rendit ensuite au Japon où il conclut un traité commercial. Il retourna en Angleterre en 1859 et accepta, à l’exemple d’autres anciens partisans de Peel, un poste dans le nouveau gouvernement de Palmerston. Il devint ministre des Postes, ce qui n’était pas la meilleure utilisation qu’on pouvait faire de ses talents, qui étaient de nature diplomatique plutôt qu’administrative. Cependant, en 1860, par suite du refus du gouvernement de Chine de mettre en œuvre le traité de T’ien-tsin, Elgin fut de nouveau envoyé avec des forces anglo-françaises et un collègue français pour s’assurer de l’acceptation du traité. L’armée s’avança jusqu’à Pékin et, après le meurtre de captifs anglais, le palais d’été des empereurs fut incendié par ordre d’ Elgin pour venger l’offense et faire respecter la signature du traité.
En 1861, il fut nommé vice-roi et gouverneur général de l’Inde, mais deux ans plus tard le surmenage occasionné par une visite officielle provoqua une attaque cardiaque mortelle. On ne peut établir de points de ressemblance entre le séjour d’Elgin en Jamaïque et au Canada et celui qu’il fit en Extrême-Orient et en Inde. Cependant, il y fit montre du même esprit de décision et de la même habileté diplomatique. Mais ce qui fut le plus remarquable, c’est peut-être le degré inhabituel de sympathie qu’il déploya à l’égard des Chinois qu’il rencontra et la perspicacité avec laquelle il perçut les difficultés d’un Empire décadent. Il s’employa aussi à comprendre l’Inde, non pas en étudiant les particularités du régime britannique en Inde, mais en voyageant parmi le peuple. Ce fut le même désir et la même capacité de comprendre la société sur laquelle il devait gouverner qui le rendirent capable d’aider à créer au Canada un gouvernement formé de modérés et acceptable sur le plan local à des groupes opposés par la race, les partis et la tradition. Le trait le plus marquant de la carrière d’Elgin au Canada fut la rapidité et l’acuité avec laquelle il perçut son rôle, ainsi que l’esprit de création dont il fit preuve par la suite.
Coll. Elgin-Grey (Doughty).— Letters & journals of James, eighth Earl of Elgin, Theodore Walrond, édit. (Londres, 1872).— R. S. Longley, Sir Francis Hincks ; a study of Canadian politics, railways, and finance in the nineteenth century (Toronto, 1943).— D. C. Masters, The reciprocity treaty of 1854 : its history, its relation to British colonial and foreign policy and to the development of Canadian fiscal autonomy (Londres et Toronto, 1936).— Monet, Last cannon shot.— J. L. Morison, British supremacy & Canadian self government, 1839–1854 (Glasgow, 1919) ; The eighth Earl of Elgin [...] ([Londres], 1928).— G. N. Tucker, The Canadian commercial revolution, 1845–1851 (New Haven, Conn., 1936).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
W. L. Morton, « BRUCE, JAMES, 8e comte d’ELGIN et 12e comte de KINCARDINE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/bruce_james_9F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/bruce_james_9F.html |
| Auteur de l'article: | W. L. Morton |
| Titre de l'article: | BRUCE, JAMES, 8e comte d’ELGIN et 12e comte de KINCARDINE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1977 |
| Année de la révision: | 1977 |
| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |