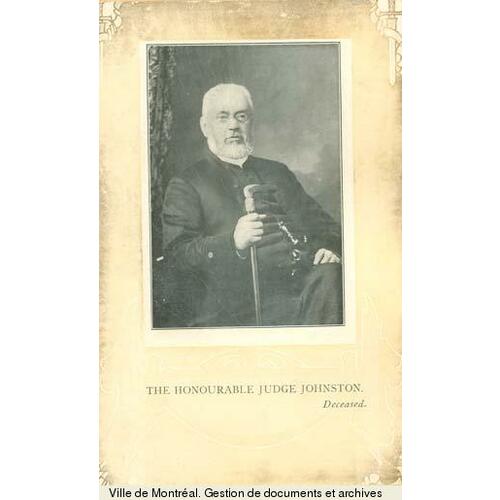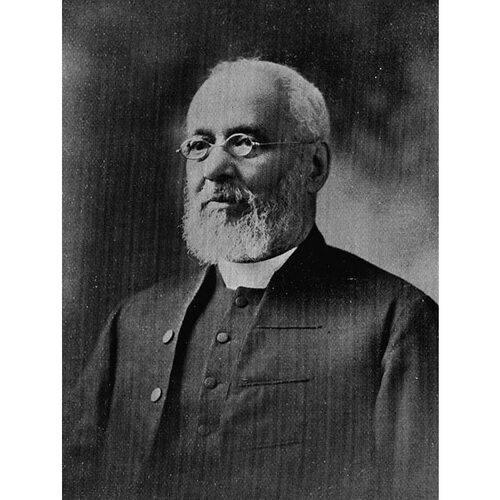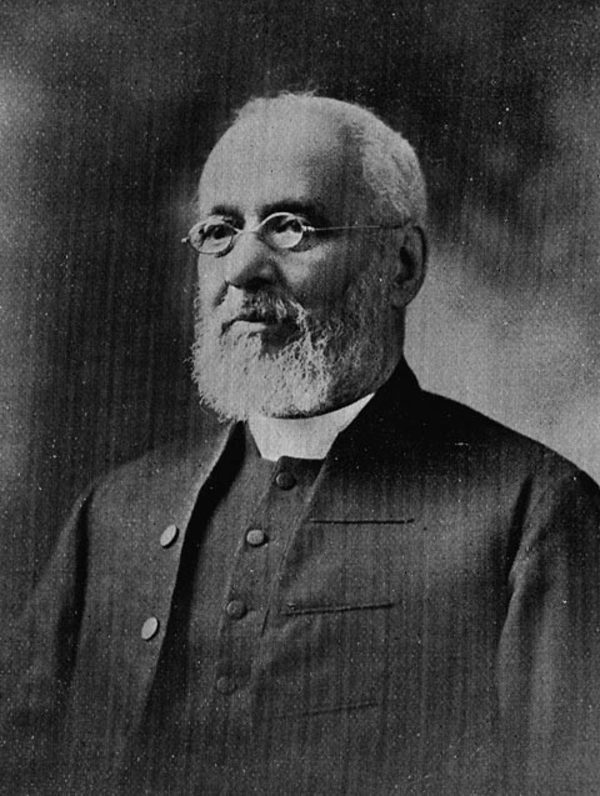
Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
JOHNSTON, JAMES WILLIAM (le nom est parfois écrit Johnstone, mais il signait Johnston), avocat, homme politique et juge, né le 29 août 1792 à la Jamaïque, décédé le 21 novembre 1873 à Cheltenham, Angl.
Au milieu du xviiie siècle, Lewis Johnston, grand-père de James W. Johnston, quitta l’Écosse pour émigrer en Georgie ; il y devint trésorier et président du conseil de Savannah. Lewis Johnston et ses fils se battirent pour l’Angleterre au cours de la guerre de l’Indépendance et, après la défaite, abandonnèrent la colonie. William Martin Johnston et son épouse, Elizabeth Lichtenstein*, se fixèrent finalement à la Jamaïque, où naquit leur benjamin, James William. Quand l’enfant eut dix ans, ses parents l’envoyèrent en Écosse où il reçut pendant plusieurs années une solide instruction que lui dispensaient des précepteurs soigneusement choisis. En 1808, peu après la mort de son père, James alla rejoindre sa mère et le reste de sa famille en Nouvelle-Écosse. Il s’installa à Annapolis Royal avec sa sœur Elizabeth et son beau-frère, Thomas Ritchie*, qui était membre de l’Assemblée provinciale. Ritchie assuma la tutelle de James, le fit entrer à son étude en qualité de clerc et, au cours de la guerre de 1812, l’enrôla sous ses ordres dans la milice locale. Quand il atteignit sa majorité en 1813, James fut admis au Barreau de la Nouvelle-Écosse et commença d’exercer sa profession à Kentville.
Peu après le retour de la paix, en 1815, dans l’espoir sans doute que sa famille jouirait en Nouvelle-Écosse du prestige qu’elle avait connu en Georgie, Mme Johnston fit venir son fils James afin qu’il s’installât avec elle à Birch Cove, en banlieue de Halifax. James s’associa alors avec un autre homme de loi, Simon Bradstreet Robie*, qui était à l’époque secrétaire provincial et orateur (président) de la chambre. Johnston avait une allure imposante : mesurant plus de six pieds, il était mince, avait le profil grec, les yeux et les cheveux noirs, la bouche grande, un menton bien dessiné, et un teint « qui avait gardé quelque chose des tropiques ». En 1821, il épousa Amelia Elizabeth Almon, fille d’un important médecin de Halifax.
Il semble bien qu’au cours de cette période de son existence Johnston se soit montré d’un caractère fier et très emporté. Peu après son arrivée à Halifax, irrité par certaines remarques que Charles Rufus Fairbanks* avait faites devant le tribunal, il provoqua ce dernier en duel et lui tira une balle dans le pied, afin, dit la rumeur, de condamner son rival à ne plus jamais danser. Les lettres de Johnston, à cette époque, trahissent toutefois la crise intellectuelle et morale que traversait le jeune homme. Après un bref engouement pour la philosophie des lumières, il en vint vite à de profondes convictions religieuses, peut-être sous l’influence de sa mère. Les relations qu’il entretenait avec un groupe d’évangélistes qui œuvraient au sein de la communauté anglicane de Halifax l’ont aussi orienté dans cette voie. Johnston prit bientôt l’habitude de se réunir, le dimanche après-midi, avec d’autres jeunes gens de la bonne société, pour prier, lire les Écritures et chanter des hymnes. Il entra dans la Poor Man’s Friend Society pour travailler comme « visiteur » chez les indigents de Halifax
En 1824, l’église St Paul, la cathédrale anglicane de Halifax, connut une crise sérieuse : l’évêque, le révérend John Inglis*, intervint contre la nomination de John Thomas Twining*, qui était de tendance évangélique, au poste, vacant depuis peu, d’administrateur ecclésiastique de la cathédrale. Johnston fut entraîné dans la controverse par les paroissiens de St Paul, qui le pressèrent de plaider leur cause contre l’évêque à la Cour de la chancellerie. Le tribunal soutint l’évêque mais ne put empêcher de nombreux membres de la congrégation d’abandonner St Paul. La majorité des rebelles adopta l’église anglicane St George, mais quelques-uns, dont Johnston, cherchèrent à s’attacher à une autre église. Ils tentèrent d’en fonder une, qui ne serait pas sous la juridiction de l’évêque et dont Twining serait le pasteur. Mais ce dernier, refusant de participer à une telle rébellion, abandonna ses anciens disciples et les laissa errer avec inquiétude d’une dénomination à l’autre sans pouvoir se fixer. L’isolement des rebelles prit fin en 1827, quand revint du Massachusetts Edmund Albern Crawley*, qui avait fait son droit sous la direction de Johnston. Il était accompagné de deux ministres baptistes renommés, de Newton Theological Seminary. Ces derniers firent une impression si favorable sur Johnston et ses amis qu’on s’entendit pour fonder une église baptiste rue Granville. Alexis Caswell, l’un des deux Bostonnais, en fut le premier pasteur.
Les fondateurs de l’église de la rue Granville comptèrent bientôt parmi les baptistes les plus influents. On recruta parmi eux de futurs ministres du culte ; ils fondèrent un journal, le Christian Messenger, et lancèrent une campagne destinée à améliorer le niveau de l’instruction dans les milieux baptistes. J. W. Johnston fut, en 1828, parmi les pionniers d’une société qui se consacra à l’éducation. Il participa également à l’administration d’un établissement d’enseignement supérieur qui fut fondé cette année-là dans la vallée d’Annapolis. En 1841, c’est à son appui qu’on dut l’obtention d’une charte pour Queen’s (Acadia) College, à Wolfville ; il fit partie du conseil d’administration de la nouvelle institution.
Pendant ce temps, Johnston réussissait fort bien dans la carrière qu’il avait choisie. Il tenait une place importante dans le monde des affaires, qui ne cessait de se développer à Halifax, et appartenait à plusieurs sociétés commerciales. En 1832, il unit ses efforts à ceux de quelques-uns des principaux négociants de la capitale et, avec eux, fonda la Bank of Nova Scotia, destinée à mettre fin au monopole de la Halifax Banking Company. En 1834, Johnston fut nommé solliciteur général de la province. À la fin des années 30, il commença à se construire une maison sur la baie de Halifax, du côté de Darmouth ; il nomma la propriété Mount Amelia en souvenir de sa femme, qui était morte peu de temps auparavant.
C’est à partir de cette époque que le mouvement réformiste provincial qui, sous la direction de Joseph Howe, commençait à saper la structure oligarchique du gouvernement, marqua de façon décisive la carrière de Johnston. En 1837, à la demande de l’Assemblée qui voulait voir la situation générale se modifier, le gouvernement britannique avait dissous le Conseil des Douze et créé deux organismes bien distincts : le Conseil exécutif et le Conseil législatif. Grâce à ses qualités d’administrateur, à la confiance que lui témoignaient les hommes d’affaires et aussi à l’aide qu’il avait apportée à la plus importante des sectes dissidentes, Johnston fut nommé membre des deux conseils. Au Conseil législatif, il donna parfois son appui aux partisans du changement. Par exemple, il insista pour qu’on attribuât aux congrégations dissidentes une part équitable des terres qui avaient été réservées à l’Église d’Angleterre. De temps en temps, Johnston proposa d’effectuer d’autres changements, toujours dans le but de rendre plus efficace l’administration de la province. Il ne lui arriva qu’une seule fois de se départir de son pragmatisme habituel. Il fit partie de la délégation qui rendit visite à lord Durham [Lambton*] à Québec, au cours de l’automne de 1838. Johnston revint en Nouvelle-Écosse converti aux idées de Durham et à son projet de former une union législative de l’Amérique du Nord britannique. Il essaya sans relâche de gagner ses collègues à cette cause malgré une hostilité quasi générale.
Johnston n’exprima des réserves à l’égard du programme de Howe qu’en 1840, quand, au bout de trois ans de remous et de troubles, l’Assemblée réclama le rappel du gouverneur, Colin Campbell*. Par sens du devoir, Johnston se vit forcer de s’élever publiquement contre ce qu’il estimait une attaque injustifiée contre le représentant du gouvernement britannique. Le 30 mars 1840, il sermonna Howe avec acrimonie sur les dangers d’une politique extrémiste. Johnston était opposé à la responsabilité ministérielle et maintenait que la Nouvelle-Écosse, qui ne connaissait pas l’équilibre social de l’Angleterre, ne pouvait adopter avec succès le régime constitutionnel de la métropole. Il prévoyait qu’une telle forme de gouvernement irait à l’encontre d’une saine administration, et inaugurerait une ère de « luttes entre les partis », dont le seul objectif serait de s’emparer du pouvoir.
Ce discours fit ressortir à quel point Johnston révérait les valeurs traditionnelles de l’ancienne société coloniale. Ses opinions étaient celles mêmes qui régnaient dans les milieux influents d’Angleterre ; aussi, fut-il l’un des premiers consultés par le gouverneur Poulett Thomson*, lorsque ce dernier vint à Halifax en juillet 1840, afin de tenter de résoudre la crise. Les discussions qui eurent lieu entre Thomson et les diverses personnalités de la colonie aboutirent à un compromis : on abandonna pour l’instant le concept de responsabilité ministérielle ; Howe et Johnston, acceptèrent de travailler ensemble au sein d’un Conseil exécutif qui représenterait une coalition politique, afin de chercher des solutions aux revendications du peuple.
La décision que prit Johnston de collaborer avec Howe l’éloigna des tories les plus endurcis. Le fossé s’élargit à mesure que la nécessité de maintenir la coalition le forçait à modifier ses sentiments antidémocratiques. Au cours d’un débat constitutionnel en 1842, Johnston, qui avait été nommé procureur général en avril 1841, admit qu’il était impossible à un Conseil exécutif de gouverner tout en défiant ouvertement les vœux exprimés par la majorité de l’Assemblée. Bien qu’il insistât sur le fait que les institutions doivent être « taillées et trempées selon les conditions qui prévalent dans le pays », il reconnaissait à présent la nécessité de faire des concessions à l’opinion publique. Le revirement du procureur général lui valut ce commentaire acide du Pictou Observer : « Hélas ! le voilà un jour schismatique, le lendemain il se fait l’avocat des conservateurs et, le jour suivant, il est devenu le champion du gouvernement responsable. »
En dépit de son attitude conciliante, Johnston ne parvint pas à faire régner l’harmonie entre réformistes et tories. Les réformes administratives de Howe éveillèrent l’animosité des détenteurs des droits acquis, et les deux factions en vinrent bientôt à se disputer âprement la suprématie. En 1843, l’animosité et la défiance régnaient à tel point au sein du Conseil exécutif qu’il ne pouvait même plus jouer son rôle régulier et prendre les décisions voulues. Dans toute cette confusion, Johnston s’efforçait de rester neutre et de sauvegarder la coalition. Il se tint à l’écart des remous créés par les ultra-conservateurs et ne cessa de soutenir le programme de restructuration administrative du gouvernement.
Johnston éprouva peut-être quelque malaise devant les intentions de Howe, mais il garda ses sentiments secrets, et peut-être se serait-il cantonné dans son silence si Howe n’avait, au cours de la session législative de 1843, soutenu une proposition de William Annand*. Cette proposition voulait retirer les subventions aux universités dirigées par les diverses sectes et consacrer des fonds publics à la création d’une université non confessionnelle. Elle risquait de compromettre l’avenir d’Acadia College et les personnalités baptistes, dont les opinions étaient en général tories, trouvèrent là une cause leur permettant de reformer leurs rangs et de se dresser en bloc contre la politique de Howe. Ce dernier avait annoncé, au cours de la même session, qu’il avait l’intention de faire tout en son pouvoir pour obtenir sans retard la responsabilité ministérielle et pour former « un cabinet composé des chefs des divers départements ». Pour Johnston, cela revenait à réclamer un gouvernement qui fût aux mains d’un parti et, dans un mémoire au gouverneur, il déclara que la mise en œuvre des principes de Howe donnerait le pouvoir aux factions politiques et « amènerait l’emploi abusif et corrupteur du népotisme ». Le procureur général estimait que le pouvoir exécutif devait être entre les mains de plusieurs groupes, réunis en une coalition : c’était là le seul moyen d’éviter les abus.
Ce furent la crainte d’une désorganisation sur le plan politique et de l’introduction d’un système d’enseignement supérieur « impie » qui amenèrent finalement Johnston à abandonner sa neutralité. En juin 1843, il assista à la réunion annuelle de l’association baptiste à Yarmouth et prononça une virulente mise en accusation des réformistes et de la ligne de conduite qu’ils suivaient en matière d’éducation. Avec l’approbation du clergé, Johnston et Edmund Crawley organisèrent des réunions sur l’éducation dans le centre et l’ouest de la Nouvelle-Écosse, pour gagner l’appui du grand public. Au début de l’automne, Howe fut obligé de défendre sa politique d’enseignement non confessionnel et les journaux abondaient en discussions sur l’enseignement supérieur. Lorsqu’il se rendit compte que ses conseillers parcouraient le pays en haranguant les foules, le gouverneur Falkland [Cary*], consterné, ordonna que l’Assemblée fût dissoute le 26 octobre 1843. Il espérait que de nouvelles élections arrangeraient tout. Johnston accueillit la nouvelle en donnant sa démission du Conseil législatif, puis il se lança activement dans la mêlée comme candidat dans le comté d’Annapolis. En même temps, le procureur général et ses alliés de diverses dénominations religieuses donnèrent plus d’ampleur à leur campagne en attaquant l’idée du gouvernement aux mains d’un parti. Cette manœuvre leur valut l’appui des tories de Halifax et des autres ennemis traditionnels de Howe. Ces partisans semblaient croire que si Johnston était en mesure de recueillir un nombre de votes considérable dans la nouvelle Assemblée, il deviendrait possible de ralentir le rythme des changements ou du moins, de rendre ces changements plus propices à leurs intérêts.
Manifestement, Johnston avait développé sa stratégie électorale autour d’une politique de statu quo. Il devint très vite apparent, toutefois, qu’il était impossible de stabiliser la situation en se fondant sur le compromis de 1840. En décembre 1843, tandis qu’on recevait les derniers résultats des élections, le gouverneur Falkland fit preuve d’un manque de sens politique et nomma Mather Byles Almon, conservateur et beau-frère de Johnston, au Conseil exécutif et au Conseil législatif. Howe, James Boyle Uniacke* et James McNab crièrent au favoritisme à l’égard du procureur général et donnèrent leur démission de la coalition.
Quand le parlement se réunit en 1844, Johnston prit la tête du gouvernement « croupion » et, après trois semaines de débats harassants, parvint à éviter de justesse le vote de non-confiance de l’Assemblée, avec une majorité de deux voix. Cette décision de l’Assemblée était d’ailleurs purement négative et représentait davantage une opposition hésitante aux idées de Howe que l’adoption enthousiaste de la politique de Johnston. Celui-ci s’en rendit compte. Il tenta donc de renforcer sa position en négociant en vue d’une nouvelle coalition des partis politiques ; mais l’opposition refusa de collaborer. Pendant trois ans, Johnston dut lutter pour conserver sa faible majorité. Quoique faible et indécis, son gouvernement décréta un ensemble de compromis : il conservait aux collèges confessionnels leurs subventions publiques, approuva une série de réformes administratives de moindre envergure, autorisa des relevés en vue de la construction d’un chemin de fer de Halifax à Québec, et passa une loi du vote simultané qui décrétait qu’à l’avenir les élections auraient lieu le même jour dans toute la province. Mais Johnston employa surtout ces années-là à renforcer son autorité et à transformer la faible coalition que formaient ses partisans en un parti bien discipliné et fort auprès du peuple. Chaque année, il consacrait l’automne à des campagnes au cours desquelles il tentait de rallier les électeurs à sa politique de réformes graduelles. En 1846, après un dernier et vain effort pour redonner de la vigueur à la coalition réunissant tous les partis, Johnston pria le nouveau gouverneur, sir John Harvey*, de dissoudre l’Assemblée et, à la tête des conservateurs, il prépara de nouvelles élections.
Tout au long de cette âpre campagne électorale, Johnston parcourut la province, déclarant que Howe avait abandonné la coalition pour s’attacher « à un système qui ne peut qu’engendrer l’anarchie ». Aux antagonismes politiques vinrent s’ajouter les dissensions sur le plan religieux. Les porte-parole des conservateurs, y compris Johnston, commencèrent à dénoncer la « suprématie accordée aux catholiques », prétendant que les alliés irlandais du parti libéral complotaient l’anéantissement du protestantisme. Des animosités raciales compliquèrent les choses : juste avant la fin de la campagne électorale, une petite émeute éclata à Halifax, mettant aux prises Noirs conservateurs et Irlandais libéraux. Les élections eurent lieu le 5 août 1847, et dès que les résultats commencèrent à être connus on se rendit compte que les libéraux étaient victorieux, sans qu’on sût toutefois quelle majorité ils avaient obtenue. Johnston refusa de concéder la victoire et d’admettre que cela traduisait le désir que le peuple avait de changements, et il resta à son poste dans l’espoir de réorganiser la coalition. Au début de 1848, par un vote qui ne permettait plus aucun doute, l’Assemblée indiqua sa non-confiance à l’égard de l’administration : Johnston donna immédiatement sa démission.
Après la défaite du gouvernement, le gouverneur Harvey offrit à son ancien procureur général de lui trouver un poste au service de l’Empire. Mais le projet fut sans lendemain, sans doute parce que Johnston ne tenait pas à quitter la Nouvelle-Écosse. Malgré la perte de son poste au gouvernement, sa compétence comme avocat et les relations d’affaires qu’il avait à Halifax lui assuraient une situation enviable et l’aisance matérielle. De plus, il venait tout juste de s’installer à Mount Amelia avec sa seconde femme, Louisa Pryor Wentworth, qu’il venait d’épouser. Et il semble bien qu’il n’ait jamais réellement aimé être un politique partisan, dont le rôle se prêtait mal à son caractère. Sa fierté ombrageuse et un certain manque d’humour à l’égard des convenances le rendaient vulnérable à la critique. Au sein de l’Assemblée, même ses partisans le trouvaient hautain et renfermé. Il voyait peu de monde, limitant presque exclusivement ses fréquentations à la bonne société de Halifax. S’il conserva toutefois son siège à l’Assemblée, c’est peut-être qu’il avait le sentiment d’être chargé d’une mission, qu’il était ambitieux et qu’il se refusait obstinément à admettre la défaite.
Comme chef de l’opposition, Johnston consacra ses premiers efforts à défendre l’ordre social établi. Par exemple, il s’opposa à l’extension du droit de vote, de peur de doter les « classes inférieures » d’une influence indue, vu leur manque de biens et de sens des responsabilités. Quoique foncièrement conservateur, Johnston se fit souvent l’apôtre de mesures radicales. Avec insistance, il dénonça la nomination des membres du Conseil législatif et des juges de paix et prôna la création d’une Chambre haute et de conseils municipaux dont les membres seraient élus. En fin de compte, il fut même partisan du suffrage universel. Pourtant s’il mit tant de zèle à réformer le système électoral, c’est qu’il en était venu à la conclusion que le droit de vote basé sur le cens électoral n’était pas satisfaisant car l’exécutif pouvait s’en servir pour manœuvrer le corps électoral à sa guise. Il déclara ouvertement qu’une Chambre haute dont les membres seraient élus arriverait à maîtriser les « remous de l’opinion publique ». Donc, le premier but que Johnston poursuivait en réclamant ces changements, c’était d’embarrasser le Conseil exécutif que dominaient les réformistes par la décentralisation du pouvoir et l’instauration de ce qu’il considérait comme un « juste équilibre » au sein du gouvernement dans le partage de l’autorité entre les diverses branches du gouvernement.
Bien entendu, les électeurs ne considéraient pas Johnston comme un partisan de la réforme. Pendant une courte période vers le milieu des années 50, il arriva à susciter l’enthousiasme populaire quand, membre influent de la ligue antialcoolique, il rallia les suffrages d’un groupe de députés des deux partis politiques sur des mesures visant à interdire l’alcool. En fin de compte, la loi ne passa pas, parce que Johnston ne put se résoudre à compter le cidre de la vallée d’Annapolis parmi les boissons prohibées.
Dans les années 50, les chemins de fer préoccupèrent vivement les habitants de la Nouvelle-Écosse. Johnston se fit l’avocat de la prudence, critiquant la plupart des projets de construction et refusant d’accorder son appui à un projet de ligne allant de Halifax à Québec tant que le gouvernement impérial ne participerait pas au financement de l’entreprise. Au début de cette décennie, il semblait être favorable à une union commerciale avec les États-Unis parce que c’était le moyen le plus sûr d’assurer à la province une réelle expansion économique. S’il fallait absolument construire un chemin de fer, insistait-il, il faudrait une ligne de Halifax à Windsor, première étape en vue de relier la Nouvelle-Écosse et les états de la Nouvelle-Angleterre en un véritable réseau ferroviaire. En 1850, Johnston assista à un congrès du chemin de fer à Portland et il promit son appui à la construction d’une ligne qui irait du Maine jusqu’en Nouvelle-Écosse [V. Poor].
Peu après le retour de Portland des délégués, Howe annonça que l’insuffisance des capitaux privés disponibles forçait le gouvernement à se charger de la construction de la section de la Nouvelle-Écosse. Johnston attaqua immédiatement la politique de Howe, prédisant que les chemins de fer construits et administrés par le gouvernement seraient ruineux et donneraient lieu au népotisme le plus flagrant. Certains intérêts régionaux et financiers que touchaient la politique ferroviaire du gouvernement appuyèrent les conservateurs lors des élections de 1851, réduisant d’autant la majorité des libéraux et retardant le début des travaux de construction. Pendant ce temps, Johnston avait entamé des pourparlers avec William Jackson, représentant d’une firme d’ingénieurs anglais, qui avait entrepris la construction de plusieurs lignes en Amérique du Nord, y compris le Grand Tronc. En 1853, Johnston annonça qu’il y avait des capitaux anglais tout prêts à financer les chemins de fer de la Nouvelle-Écosse et l’Assemblée décida de suspendre les projets de Howe et d’attendre une proposition officielle des patrons de Jackson.
Il semblait bien que le chef de l’opposition avait triomphé et, en septembre 1853, il assista avec Jackson à une fête en l’honneur du chemin de fer, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Johnston y déclara que les moyens de locomotion modernes apporteraient la prospérité aux colonies anglaises d’Amérique du Nord et « les uniraient [finalement] par des rubans métalliques en une grande confédération ». Ce bel optimiste creva comme un ballon quelques semaines plus tard : Jackson retira ses offres, alléguant que les événements d’Europe empêchaient de trouver les capitaux privés nécessaires à l’entreprise. L’Assemblée se réunit en 1854 et Howe n’eut aucun mal à obtenir l’autorisation de poursuivre ses projets. Toute cette affaire avait profondément ébranlé l’unité et le moral des conservateurs. Le Novascotian écrivit que l’on « s’était servi de Johnston – qu’on avait tiré de lui tout ce qu’on pouvait – et qu’ensuite on l’avait rejeté, comme une orange desséchée ».
Le chef de l’opposition mena une autre lutte en 1854 autour du traité de réciprocité qui donnait aux Américains accès aux bancs de pêche de la Nouvelle-Écosse. Johnston déclara à l’Assemblée que c’était là abandonner virtuellement et gratuitement les ressources naturelles de la province, ce qui était le résultat de l’isolement de la Nouvelle-Écosse et, partant, de sa faiblesse. Il saisit l’occasion d’affirmer une fois de plus sa ferme conviction que le salut de la province était dans une union de l’Amérique du Nord britannique, qui aurait un « statut national reconnu » et la force de résister à l’absorption par les États-Unis. Pour Johnston, l’union serait également un moyen de débarrasser la politique locale de la rancœur et de la corruption qui l’infestaient depuis qu’on avait obtenu la responsabilité ministérielle.
La province continua de manifester son mécontentement au sujet du traité de réciprocité mais personne n’appuya le projet d’union que préconisait Johnston. L’opinion publique considérait de plus en plus le chef de l’opposition comme « un vieil homme acerbe », qui se cramponnait aux causes irréalisables et perdues, « comme une tique à la peau d’un chien ». Après des élections qui se révélèrent désastreuses pour les conservateurs, en 1855, Johnston annonça que « son grand âge » le contraignait à « remettre les épreuves et les responsabilités qu’entraîne la politique entre les mains d’hommes plus jeunes et plus forts ». De façon générale, on considéra que la fonction de chef était dévolue à Charles Tupper* qui venait d’être élu député de Cumberland.
La position de Johnston demeura incertaine au cours des mois qui suivirent. La discorde sur le plan religieux, que suscitait la guerre de Crimée, ébranlait le gouvernement libéral de William Young*. En 1857, le groupe des députés catholiques passa au parti conservateur, et Johnston, qui venait de gagner devant les tribunaux la cause des terrassiers irlandais accusés de meurtre lors de l’émeute de Gourley’s Shanty, redevint procureur général et se trouva à la tête du nouveau gouvernement. Mais il semble qu’il n’y fut qu’en titre ; il ne put empêcher de nombreux bouleversements de se produire chez les fonctionnaires de l’ancien gouvernement et abandonna apparemment à Tupper le contrôle du « patronage ». Johnston joua toutefois un rôle important quand le gouvernement enleva le monopole du charbon à la General Mining Company. En 1857, il se rendit en Angleterre, où il négocia un accord de principe avec la compagnie, puis revint le soumettre à l’Assemblée. Si certains purent soupçonner que Johnston, ancien conseiller juridique de la compagnie, avait travaillé à l’encontre des intérêts de la province, ils se trompaient sérieusement : Adams G. Archibald*, un libéral qui avait pris part aux négociations, se trouva d’accord avec Johnston sur tous les points.
En 1859, il y eut d’autres élections qui donnèrent lieu à une lutte acharnée et les apparences indiquaient que les libéraux avaient la victoire. Tout comme en 1847, Johnston refusa de la concéder : il prétendit que plusieurs des députés libéraux n’étaient pas habilités à siéger à l’Assemblée. Ses adversaires virent là, et sans doute n’avaient-ils pas tort, une tentative désespérée pour rester au pouvoir jusqu’à la mort de Brenton Halliburton*, qui était très âgé ; Johnston aurait pu alors être nommé juge en chef. Après des mois de querelles, les conservateurs durent abandonner le pouvoir. William Young, qui devint premier ministre, caressait les mêmes ambitions que Johnston et il succéda bientôt à Halliburton. Johnston ne chercha pas à masquer sa fureur et proclama bien haut la faillite morale du régime de la responsabilité ministérielle en Nouvelle-Écosse.
Trois ans plus tard, en 1863, Charles Tupper organisa une campagne qui anéantit presque complètement un parti libéral déjà démoralisé et les conservateurs revinrent au pouvoir ; Johnston en était le chef nominal. Le nouveau gouvernement faisait ses débuts à un moment où revivait soudain l’intérêt général pour une union des colonies et, plus particulièrement, une union des provinces maritimes. Au début de 1864, Johnston déclara à l’Assemblée : « Je considère l’union des provinces maritimes comme le premier pas vers une union plus vaste. Je n’ai jamais été partisan d’une union des provinces dans une fédération, car cela ne me semblait pas le moyen d’arriver au noble but que nous nous étions tracé. Nous voulons avant tout réaliser une unité réelle – faire d’éléments aujourd’hui séparés un tout homogène – les unir dans une existence commune et des objectifs communs. » Quelques semaines plus tard, il publia une lettre dans laquelle il réitérait ses préférences pour une union législative, mais se disait prêt à accepter l’idée de fédération comme mesure temporaire.
En mai 1864, Johnston abandonna la politique pour la magistrature. Tupper avait voulu créer un second poste de juge en chef, mais ses efforts avaient été contrecarrés par les libéraux du Conseil législatif. Johnston dut se contenter d’un poste de juge à la section de l’Équité, poste inférieur à celui qu’occupait William Young. Cette nomination l’empêcha de prendre une part active aux conférences préparatoires à la Confédération. Toutefois, en 1867, il prononça plusieurs adresses devant le grand jury demandant d’accepter avec calme l’appartenance de la province au nouveau dominion. Cette prise de position fut récompensée en 1873, lorsque John A. Macdonald* proposa Johnston comme successeur à Howe au poste de lieutenant-gouverneur de la province. Le vieillard, qui était en France à ce moment-là, commença par accepter. Toutefois, en juin 1873, il se ravisa et, de Londres, écrivit à Tupper disant que son état de santé ne lui permettait pas d’assumer de nouvelles fonctions. Il mourut en Angleterre quelques mois plus tard.
Par bien des côtés, le personnage de Johnston appartient à une époque qui était déjà révolue. Il avait gardé la conception d’une société hiérarchisée, basée sur la propriété, comme on l’acceptait au xviiie siècle. Mais en même temps, un zèle religieux, qui faisait de lui l’ardent apôtre de la rédemption spirituelle de l’humanité, lui a permis de dépasser le stade de l’oligarchie et de se faire le porte-parole des dissidents qui se sentaient aliénés dans la société. Quand il se lança dans la politique dans les années 40, il réunit des hommes dont les intérêts étaient très variés et créa une sorte d’alliance d’où devait sortir le parti conservateur. Sous la direction de Johnston, la politique de son parti se tint toujours en équilibre précaire entre la réforme et la réaction. Il n’engagea jamais à fond les conservateurs au sujet de la responsabilité ministérielle ; il lui importait davantage de répandre l’idée que l’avenir de la Nouvelle-Écosse dépendait de son entrée dans une communauté économique et politique plus vaste. Après une courte idylle avec la Nouvelle-Angleterre, il revint vers 1855 à sa conviction que l’union de l’Amérique du Nord britannique était la solution qui permettrait le mieux à la province de sortir de l’isolement et de la frustration politique. Johnston, qui était vraiment un des derniers représentants de l’ancienne société coloniale, pourrait bien avoir considéré la confédération comme le suprême triomphe sur le régime démocratique instable et à caractère local qu’avait connu la Nouvelle-Écosse et qui avait si fortement troublé sa carrière politique.
PANS, Pierce Stevens Hamilton diary, 1861–1878 ; James W. Johnston letters ; Johnstone family papers ; Simon Bradstreet Robie papers ; Sir Charles Tupper papers ; White family papers ; Halifax Poor Mans Friend Society, Proceedings, 1820–1826.— PRO, CO 217/175 ; CO 218/115, 218/116, 218/119, 218/125.— Debates and proceedings of the House of Assembly of Nova Scotia, 1856–1861, 1864.— [Joseph Howe], Speeches and letters (Chisholm).— [E. L. Johnston], Recollections of a Georgia loyalist, A. W. Eaton, édit. (New York et Londres, 1901).— J. W. Johnston fils, The Crawley memorial address [...] June 4, 1889 (Halifax, 1889).— Journal and proceedings of the House of Assembly of Nova Scotia, 1836–1864.— Journal of the proceedings of the Legislative Council of Nova Scotia, 1836–1843.— Rules and regulations [of the Commercial Society] (Halifax, 1822).— Rules and regulations with a list of subscribers [of the Society for the Encouragement of Trade and Manufactures] (Halifax, 1838).— E. M. Saunders, A sketch of the origin and history of the Granville Street Baptist Church (Halifax, 1877).— Acadian Recorder (Halifax), 1850–1873.— British Colonist (Halifax), 1849–1873.— Christian Messenger (Halifax), 1840–1873.— Halifax Morning Post, 1840–1848.— Novascotian (Halifax), 1836–1873.— Pictou Observer, 1842.— Royal Gazette (Halifax), 1838.— Times (Halifax), 1840–1848.— Directory of N.S. MLAs (Fergusson).— Beck, Government of N.S.— W. A. Calnek, History of the county of Annapolis [...], A. W. Savary, édit. (Toronto, 1897), et A. W. Savary, Supplement to the history of the county of Annapolis [...] (Toronto, 1913).— Harris, Church of Saint Paul.— G. E. Levy, The Baptists of the Maritime provinces, 1753–1946 (Saint-Jean, N.-B., 1946).— W. R. Livingston, Responsible government in Nova Scotia : a study of the constitutional beginnings of the British Commonwealth (« University of Iowa studies in the social sciences », Louis Pelzer, édit., IX, no 1, Iowa City, 1930).— R. S. Longley, Acadia University, 1838–1938 (Wolfville, N.-É., 1939).— MacNutt, Atlantic Provinces.— Martin, Empire and Commonwealth.— Saunders, Three premiers of N.S.— [Charles Tupper], The life and letters of the Rt. Hon. Sir Charles Tupper, E. M. Saunders, édit. (2 vol., Londres, 1916).— J. M. Beck, The Nova Scotian « Disputed Election » of 1859 and its aftermath, CHR, XXXVI (1955) : 293–315.— John Doull, Four attorney-generals, N.S. Hist. Soc. Coll., XXVII (1947) : 1–16.— D. C. Harvey, The age of faith in Nova Scotia, MSRC, 3e sér., XL (1946), sect. ii : 1–20 ; The intellectual awakening of Nova Scotia, Dal. Rev., XIII (1933–1934) : 1–22.— G. W. Hall, History of St. Paul’s Church, N.S. Hist. Soc. Coll., III (1883) : 13–70.— Peter Lynch, Early reminiscences of Halifax – men who have passed from us, N.S. Hist. Soc. Coll., XVI (1912) : 171–204.— D. J. McDougall, Lord John Russell and the Canadian crisis, 1837–1841, CHR, XXII (1941) : 369–388.— J. Y. Payzant, James William Johnston, first premier of Nova Scotia under responsible government, N.S. Hist. Soc. Coll., XVI (1912) : 61–92.— M. C. Ritchie, The beginnings of a Canadian family, N.S. Hist. Soc. Coll., XXIV (1938) : 135–154.— Benjamin Russell, Reminiscences of the Nova Scotia judiciary, Dal. Rev., V (1925–1926) : 499–512.— Norah Story, The church and state « party » in Nova Scotia, 1749–1851, N.S. Hist. Soc. Coll., XXVII (1947) : 33–57.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
D. A. Sutherland, « JOHNSTON (Johnstone), JAMES WILLIAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/johnston_james_william_10F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/johnston_james_william_10F.html |
| Auteur de l'article: | D. A. Sutherland |
| Titre de l'article: | JOHNSTON (Johnstone), JAMES WILLIAM |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1972 |
| Année de la révision: | 1972 |
| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |