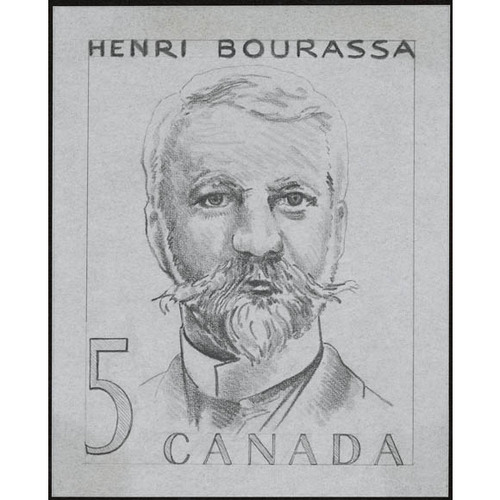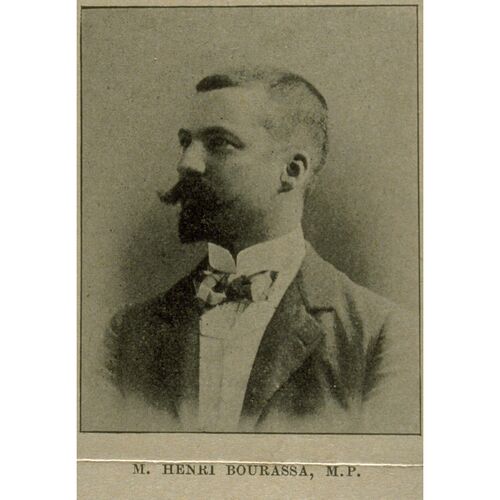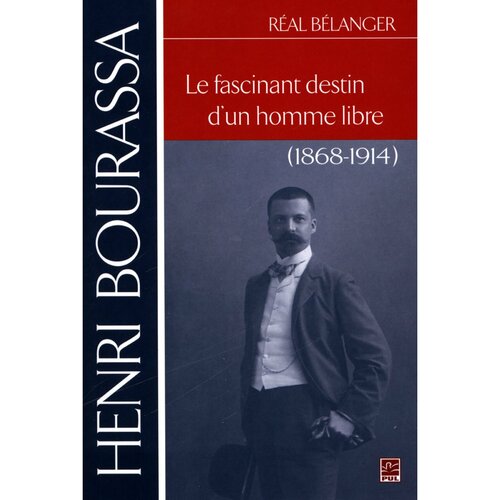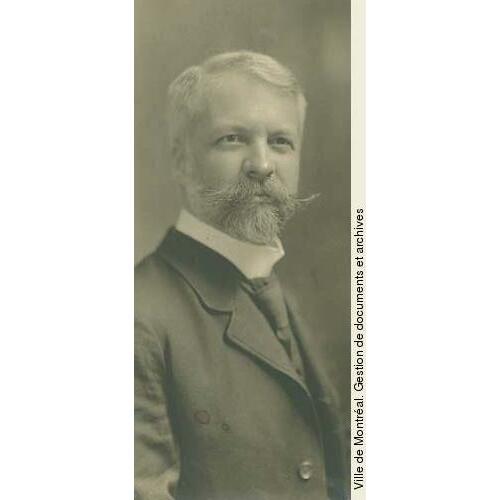Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3191881
BOURASSA, HENRI (baptisé Joseph-Henry-Napoléon), homme politique, journaliste, propriétaire, rédacteur en chef et directeur de journaux, et auteur, né le 1er septembre 1868 à Montréal, fils de Napoléon Bourassa* et d’Azélie Papineau ; le 4 septembre 1905, il épousa à Sainte-Adèle, Québec, sa petite-cousine Joséphine Papineau, et ils eurent huit enfants, dont six survécurent à leur père ; décédé le 31 août 1952 à Montréal.
Originaires du Poitou, en France, les ancêtres paternel et maternel d’Henri Bourassa sont arrivés en Nouvelle-France à la fin du xviie siècle. Selon certaines sources, ils auraient d’abord été soldats. Des générations qui se sont succédé, quelques personnages incontournables dans la vie d’Henri ont émergé. Chez les Bourassa, il faut d’abord retenir le grand-père François. Bilingue, il montre une personnalité forte qui aime la controverse ; conservateur en politique et en matière sociale, il s’est opposé vigoureusement aux patriotes en 1837. Puis trois de ses fils. L’aîné, un libéral, nommé aussi François*, se démarque dans la famille pour avoir joint les patriotes en 1838. Élu député en 1854, il le restera jusqu’en 1896. Ensuite, Augustin-Médard, missionnaire oblat auprès des Amérindiens, puis, de 1858 à 1888, curé de la seigneurie de la Petite-Nation, devenue Montebello. Cet ultramontain farouche à l’esprit caustique mettra sa bibliothèque à la disposition du jeune Henri qui y apprendra, entre autres, à lire Louis Veuillot, Joseph de Maistre et, par l’intermédiaire de son journal la Vérité, Jules-Paul Tardivel*, ses principaux maîtres à penser. « C’est là, assurera Henri le 13 octobre 1943 à l’occasion de la première conférence relatant ses « Mémoires » politiques et journalistiques, dans la bibliothèque de mon oncle et dans la lecture de L’Univers, que j’ai puisé pour toujours mes notions sur le rôle de l’Église dans la société, sur les relations qui doivent exister entre l’Église et les chefs civils. » Enfin, Napoléon, l’artiste de la famille, le père d’Henri. Il ne s’intéresse guère à la politique en 1868, ce qui ne l’empêchera pas plus tard de conseiller son fils. Ce « si bon père » lui lègue un « goût inné [...] pour les choses de l’art, pour la musique [et] la peinture ». Chez les Papineau, les caractères sont vifs et encore plus intéressants ; il y a surtout l’illustre grand-père Louis-Joseph* qui, en 1868, coule en partie ses dernières années au luxueux manoir de Montebello. Bourassa dira en 1943 tenir de lui « le tempérament oratoire et une invincible indépendance de caractère, une incapacité congénitale de dire ce [qu’il] ne pense pas et de ne pas dire ce [qu’il] pense ».
Quelque six mois après la naissance d’Henri, sa mère meurt d’une violente « fièvre cérébrale ». La vie de Napoléon et des enfants bascule. La tante Ezilda Papineau prend la relève, tantôt à Montréal, en hiver, tantôt à Montebello, en été, dans les demeures du grand-père Papineau. Après la mort de Louis-Joseph en 1871, lorsque l’été arrive, Napoléon loue de temps à autre une maison à Montebello ou des pièces au presbytère d’Augustin-Médard. Femme énergique et disciplinée, Ezilda est la première éducatrice du jeune Henri. Ultramontaine, elle l’élève dans le culte du pape Pie IX et de Mgr Ignace Bourget*, l’évêque de Montréal. Elle lui fait lire la Bible, puis sir Walter Scott et James Fenimore Cooper. À Montréal, Henri accompagne souvent son père chez des amis où l’on discute des problèmes de l’heure. L’enfant, qui a déjà lu à 9 ans l’Histoire de France d’Émile Keller et lira à 12 ans l’imposante Histoire d’Angleterre de John Lingard, se délecte à l’écoute de ces débats.
C’est en 1876–1877 qu’Henri entreprend ses études à Montréal. Après un séjour à l’Institution des sourdes-muettes cette année-là, il suit pendant deux ans des leçons particulières auprès de Jane Ducondu. En 1879, il entre à l’académie commerciale catholique de Montréal, où il restera deux ans et demi. Le système de l’école, un peu trop encadré, ne lui plaît pas, même s’il avouera en 1943 y avoir « puisé le fondement de toutes [ses] croyances et de toutes [ses] pratiques religieuses ». De 1882 à 1885, Henri reçoit son instruction de deux précepteurs, dont le plus important demeure Frédéric André, Français cultivé et excellent pédagogue qui le conduit à s’ouvrir à la nature et à des horizons nouveaux, à s’abandonner passionnément au goût de s’instruire par lui-même. Sur cet élan, en 1885, Henri s’inscrit à l’École polytechnique. Toutefois, le surmenage intellectuel, ainsi que, semble-t-il, une crise religieuse, l’amènent à quitter l’établissement après un mois. En septembre 1886, il se dirige vers le Holy Cross College de Worcester, au Massachusetts, pour parfaire son anglais et terminer des études classiques. Pour des raisons de santé, encore une fois, il part après un trimestre. À 18 ans, Henri clôt son parcours scolaire (même si le droit l’attirera de 1897 à 1903) : il ne sera donc ni professionnel ni prêtre. Déjà autodidacte, il n’a pas subi le conformisme souvent rapetissant des collèges classiques de son époque. Il a acquis le goût des lectures diversifiées, de la réflexion critique, de la discussion serrée. Dès lors, il s’engage dans une étape qui fixera les grands axes de sa vie.
Cette phase, qui dure de 1887 à 1896, oriente Henri vers trois nouvelles activités. Tout en continuant à parfaire sa culture par de nombreuses lectures, il commence en 1887 à s’occuper de la seigneurie de la Petite-Nation dont les Bourassa, ainsi que la tante Ezilda et l’oncle Louis-Joseph-Amédée Papineau, ont hérité à la mort de Louis-Joseph. Cette année-là, Napoléon lui confie le soin d’administrer la portion de la succession léguée aux enfants Bourassa. C’est l’occasion pour Henri de s’initier aux problèmes de la paysannerie, de la colonisation et des institutions locales. Il met sur pied, probablement entre 1887 et 1890, une ferme modèle qu’il exploitera jusqu’en 1898. En 1893, il gagne la médaille du Mérite agricole et devient président de la Société d’agriculture du comté d’Ottawa. Il contribue même à établir des colons sur ce qui formera la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix en 1902, est élu marguillier (1893) et syndic (1894) de la paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours. Henri, l’homme d’action, accumule les connaissances et se construit alors le tremplin politique idéal.
La politique, Henri l’a dans le sang. C’est sa deuxième activité. Dès 1885, l’affaire Riel [V. Louis Riel*] a déclenché sa passion. À l’instar du Québec francophone, il a été outré par la pendaison du chef métis et a vibré aux discours d’Honoré Mercier* et de Wilfrid Laurier* au Champ-de-Mars de Montréal, le 22 novembre. Quand ce dernier devient chef des libéraux canadiens, le 18 juin 1887, Henri lui voue déjà une grande admiration. Dès lors, il prépare son ascension vers la politique fédérale. En janvier 1890, à 21 ans, il est élu maire de Montebello, fonction qu’il occupe avec succès jusqu’au 19 février 1894. Puis il participe à des campagnes politiques où il dévoile ses dons oratoires portés par une voix forte, bien qu’un peu criarde, qu’accompagne une diction impeccable. La notoriété d’Henri se propage si rapidement qu’au cours de l’hiver ou au début du printemps de 1895 les libéraux de la circonscription de Labelle le propulsent candidat aux élections fédérales prévues pour 1896. Aussitôt, il imposerait ses vues : « Droit de voter pour ou contre [son] parti, suivant [ses] convictions » et refus absolu d’être financé par le parti. Laurier, qui le connaîtrait depuis son enfance, passe outre à son esprit plutôt libre. Cette période marque le début véritable de la rencontre entre ces deux êtres exceptionnels, fascinés l’un par l’autre, que le destin se chargera de séparer.
Pour mieux assurer ses espoirs politiques et rester en contact avec les débats publics, Henri se consacre au cours de ces années à une troisième activité : le journalisme. En 1892, il devient « éditeur-propriétaire » de l’Interprète (Montebello), hebdomadaire créé en 1886, voué aux intérêts de la circonscription de Labelle et des Franco-Ontariens [V. François-Eugène-Alfred Évanturel*]. Puis, sur ses cendres, le 11 avril 1895, il lance, avec d’autres, le Ralliement (Clarence Creek, Ontario) qu’il maintiendra jusqu’au 3 juin 1897. On décèle déjà dans ces deux journaux la profondeur de son raisonnement, son sens aigu de l’écrit et de la réplique puissante, voire ses excès de langage. L’homme de principe y émerge, soumis à l’Église catholique et voué à la défense des droits des Canadiens français, « garantis, selon lui, par les traités et les constitutions ». Un problème entre tous le passionne alors : les écoles du Manitoba [V. Thomas Greenway* ; sir Wilfrid Laurier]. Il écrit article sur article, où il décrie l’inaction des élus fédéraux depuis 1890, montre l’obligation constitutionnelle de rétablir les droits de la minorité catholique dans cette province et proclame la « sagesse » du « noble » et « digne » Laurier, même s’il reconnaît bien les ruses de son chef. Aux évêques qui s’agitent, surtout après la présentation du projet de loi réparatrice par les conservateurs le 11 février 1896, Henri rétorque qu’il est toujours disposé à les écouter dans le domaine spirituel mais que, en matières politiques et civiles, il demeure libre de ses choix.
Le soir du 23 juin 1896, après une intense campagne où il a discuté entre autres des écoles du Manitoba, Bourassa partage la victoire des libéraux de Laurier : à 27 ans, il est élu dans Labelle par 469 voix de majorité. L’homme vit des moments d’extase. Protégé de son chef, doté d’un don oratoire exceptionnel, bilingue, il possède le talent, la culture, l’esprit de travail pour réussir. Même s’il s’affiche ultramontain, il s’affirme aussi franchement libéral, appartenant au libéralisme modéré propagé par Laurier depuis 1877. Un « castor rouge », voilà comment le premier ministre le caricaturera. Il a de l’aplomb. Vivant des revenus de l’agriculture et de ses terres, ainsi que de l’héritage des Papineau évalué à quelque 24 000 $ en 1894, il jouit d’une relative aisance à Papineauville, où il demeure depuis cette année-là et dont il sera aussi le maire de 1896 à 1898 (il y lancera une scierie avec des associés en 1898). De taille moyenne, les cheveux noirs en brosse, portant une grosse moustache et une barbiche en pointe, l’homme a fière allure : il montre une élégance raffinée, une prestance quelque peu solennelle. Ses yeux perçants, intimidants, révèlent un individu déterminé, prêt à assumer tout destin.
Bourassa ne peut espérer un poste dans le cabinet Laurier. Le premier ministre lui prodigue bientôt trois marques de confiance. D’abord, il l’envoie au Manitoba avec Joseph-Israël Tarte*, ministre des Travaux publics, pour négocier une entente sur la délicate question scolaire. Laurier compte ainsi lier Bourassa à l’accord espéré. Lorsque le règlement Laurier-Greenway, qui n’offre que des miettes à la minorité, est rendu public, le 19 novembre 1896, Bourassa ne peut trop s’en distancier. Il l’accepte comme un compromis honorable, « un pas dans la voie de la justice ». Devant le tollé des évêques, il rédigerait pour Laurier une requête à Rome afin qu’un délégué vienne étudier la question sur place. Ce que fait Mgr Rafael Merry del Val à partir de mars 1897 ; il rencontre alors le jeune député, à qui il confie un devoir de vigilance aux Communes. En décembre, l’encyclique Affari vos entérinera avec nuances le compromis Laurier-Greenway. Bourassa estime alors que ses opinions ont été confirmées par Rome, mais les suites de ce dossier le désespéreront. La deuxième marque de confiance de Laurier envers son député concerne son métier de journaliste. En début de 1897, par l’entremise de Tarte, nouveau propriétaire de la Patrie de Montréal, il le fait nommer directeur de cet influent quotidien dont il souhaite tempérer le libéralisme radical. Flatté, le jeune élu choisit d’en faire une feuille ultramontaine défendant en politique les idées libérales modérées. Très rapidement, toutefois, cet espoir de concilier son ultramontanisme, son indépendance et son appartenance au Parti libéral échoue. Après seulement huit jours, et un seul éditorial, il démissionne : la révolte de la vieille garde du parti et un différend avec Tarte l’y conduisent. Cette déception, à laquelle surtout s’ajoute la précédente, le porte à prendre une décision déterminante, tel qu’il l’affirmera en 1930 : en toutes matières, « je pris dès ce moment la résolution d’obéir au Pape ». L’ultramontain l’emporte pour toujours sur le libéral. Reste le troisième geste de Laurier. En 1898, le premier ministre, dans le but évident d’initier son jeune espoir aux questions internationales, lui confie l’un des postes de secrétaire de la haute commission mixte anglo-américaine pour régler des conflits entre le Canada et les États-Unis, dont celui des frontières de l’Alaska. Bourassa découvre alors le jeu feutré de la diplomatie, les mondanités, son intérêt pour les questions internationales et les hommes qui en dirigent les destinées. Même si les discussions achoppent sur l’intransigeance des Américains le 20 février 1899, s’amorce pour Bourassa une passion qui ne le laissera jamais. Puis en avril, il prononce une conférence à Ottawa, qu’il répétera à Montréal en mai, dans laquelle il flagelle le féminisme naissant et incite la femme à se détourner des charges publiques pour se consacrer au foyer familial.
Et voilà que le 13 octobre 1899, sans avoir consulté le Parlement, sir Wilfrid Laurier accepte d’envoyer des volontaires canadiens en Afrique du Sud pour soutenir la Grande-Bretagne en guerre contre les Boers. La participation canadienne pose pleinement la question du statut du Canada dans l’Empire et de sa contribution aux guerres impériales. En toile de fond se dresse l’impérialisme britannique qui aiguillonne deux visions de l’avenir du pays [V. sir Wilfrid Laurier]. Que fera Bourassa ? Appuyé sur sa conscience religieuse hostile aux concessions, il démissionne de ses fonctions de député le 18 octobre. L’envoi de troupes établit, selon lui, un précédent qui bafoue les relations politiques traditionnelles entre le Canada et l’Empire. Pire, en dérogeant à la constitution, le gouvernement a relégué la nation au rang d’une simple colonie dépendante de l’Angleterre. Toute participation aux guerres de l’Empire ne doit se faire que si le Canada est représenté dans ses conseils, si le Parlement et l’électorat canadiens sont consultés et si le pays est menacé. D’un coup, c’est la crise à Ottawa. Laurier essaie d’en appeler à sa logique pour le dissuader. Rien n’y fait. En dépit d’une affection réelle et réciproque, leurs relations s’assombrissent. Bourassa parcourt ensuite sa circonscription pour présenter son point de vue et s’y faire réélire comme indépendant, sans concurrent, le 18 janvier 1900. Le 13 mars suivant, il reprend avec force son argumentation dans son premier grand discours aux Communes. Laurier lui répond brillamment et produit assez d’effet sur les députés pour qu’ils abattent facilement la proposition de Bourassa, synthèse de son raisonnement depuis le 18 octobre. Un fait demeure toutefois : une étoile politique est née. Désormais, Bourassa, qui conserve son siège aux élections générales du 7 novembre 1900, se donne une mission : former une opinion publique éclairée en transmettant aux Canadiens une compréhension plus nette des relations du Canada avec l’Empire et de la nature des rapports entre la majorité canadienne-anglaise protestante et la minorité canadienne-française catholique du pays.
Pragmatique, Bourassa élabore pour y parvenir une stratégie qui témoigne de son sens politique : se créer un réseau d’amis, promouvoir des campagnes politiques, s’informer pour produire écrits et conférences, utiliser la presse. Parmi ses supporteurs, un homme émerge, Jules-Paul Tardivel, avec qui il échange une correspondance soutenue. Tardivel lui ouvre les colonnes de la Vérité. Les deux envisagent même à partir de mars 1900 la fondation d’un troisième parti, anti-impérialiste et indépendant ; l’idée, irréaliste, sera abandonnée par le député. Au delà de Tardivel et de personnalités comme l’Ontarien Goldwin Smith*, Bourassa séduit les jeunes francophones de la province de Québec, las des vieux partis. Certains, aux idées avancées, œuvrent aux Débats (Montréal) jusqu’en 1903. D’autres, toujours en 1903, mettent sur pied l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française et, surtout, la Ligue nationaliste canadienne avec à sa tête Olivar Asselin*, Armand La Vergne* et Omer Héroux*, que Bourassa aide particulièrement. Naît alors un mouvement d’éducation populaire, le mouvement nationaliste, qui véhicule un programme précis [V. Olivar Asselin] et organise la campagne politique du député de Labelle. Soucieux de maintenir son indépendance et individualiste, Bourassa ne sera ni membre ni chef de ces phalanges.
Pendant ces années, Bourassa parfait ses connaissances sur l’Empire britannique. En 1901, il se rend à Londres, où il rencontre des personnalités pro ou anti-impérialistes, puis en Irlande et en Écosse. Le 20 octobre, peu après son retour, il prononce à Montréal un discours sur la Grande-Bretagne et le Canada dans lequel il fustige l’impérialisme britannique ; il refuse toutefois d’opter pour l’indépendance du Canada, en raison du manque d’unité entre les deux races, ou pour l’annexion aux États-Unis, suggérant plutôt de « fortifier et d’élargir [le] patriotisme » canadien. Dans une autre conférence, donnée le 27 avril 1902 à Montréal, reprise dans la Revue canadienne (Montréal) et intitulée « le Patriotisme canadien-français : ce qu’il est, ce qu’il doit être », Bourassa ajoute de nouveaux contours à son nationalisme naissant. Il avance d’abord que l’amour des Canadiens français doit se porter vers le Canada, selon lui une « absurdité géographique » qu’il faut pourtant protéger contre toute velléité de séparation de ses parties constituantes. Il les enjoint de respecter le double contrat de 1867 passé avec les Canadiens anglais : l’un, national, qui a fait des Canadiens français et anglais « des associés à droits égaux » ; l’autre, politique, « qui avait pour but de réunir les colonies éparses de l’Amérique Britannique du Nord ». C’est la première fois qu’il parle ouvertement de ce pacte depuis 1895. Puis, il identifie les traits distinctifs de la race canadienne-française à sauvegarder : la religion catholique, centre de tout, la langue française, les traditions, l’histoire et les institutions. Il touche à des aspects sociaux d’où ressort son conservatisme : l’importance de l’élite, le poids moral de la masse qui ne doit ni parler anglais, ni trop s’instruire, ni gagner beaucoup d’argent. Quelque peu progressiste, il appelle à la mise à jour des programmes d’enseignement et à la création d’écoles secondaires de métiers ou de commerce. Le 3 avril 1904, lors d’une divergence de vues entre la Vérité de Tardivel et l’organe de la Ligue nationaliste canadienne, le Nationaliste, il se résume : « La patrie, pour nous, c’est le Canada tout entier, c’est-à-dire une fédération de races distinctes et de provinces autonomes. La nation [...], c’est la nation canadienne, composée des Canadiens-français et des Canadiens-anglais. » C’est le cœur de sa pensée nationaliste qu’il complétera petit à petit, surtout dans sa dimension sociale. Il en est imprégné à la veille des élections de 1904, tandis que Laurier, redevenu son chef, célèbre sa politique de développement du pays. Bourassa, réélu en novembre dans ce Canada transformé, s’apprête pourtant à connaître un autre cauchemar.
En début de 1905, Bourassa est désormais un homme politique de haute stature. Dans sa province, on le voit même comme ministre à Québec, voire chef du gouvernement. Il espère plutôt les fonctions de vice-président des Communes ou de maître de poste à Montréal, où il demeure maintenant. Toutefois, Laurier a besoin de lui pour le projet majeur de son troisième mandat : la création de l’Alberta et de la Saskatchewan à même les Territoires du Nord-Ouest. L’entreprise recèle un problème de taille : le système d’éducation à donner aux deux provinces. Le premier ministre veut sauvegarder les écoles séparées de la petite minorité catholique. À l’insu des principaux ministres anglophones, il prépare un projet de loi avec son ministre de la Justice et procureur général, Charles Fitzpatrick*, et il consulte Bourassa. Le 21 février, il dépose un projet qui concrétise ses volontés. C’est la joie chez Bourassa et chez La Vergne. C’est la crise dans le Canada anglophone. Le puissant Clifford Sifton* démissionne, d’autres ministres menacent de l’imiter. Laurier tergiverse tandis que Bourassa l’engage à maintenir ses positions. Le premier ministre opte pour le compromis, ce qui détruit en pratique le système d’écoles séparées. Bourassa s’insurge ouvertement à la Chambre et propose ou appuie amendement sur amendement, tous battus. Il tient une assemblée monstre à Montréal le 17 avril. Il s’impose alors en chef d’une minorité en quête de justice et d’appui moral. L’image de Laurier est atteinte. Les efforts de Bourassa rapportent toutefois bien peu à la minorité sacrifiée. Il en ressort meurtri, déçu de son chef – de qui il s’éloigne une autre fois –, mais particulièrement de la députation libérale et des journaux libéraux. S’il reste à Ottawa jusqu’en octobre 1907 pour y critiquer principalement la politique d’immigration, c’est la scène provinciale qui l’attire désormais.
Ce passage à la scène provinciale, « l’erreur capitale de [sa] vie publique », affirmera Bourassa dans ses « Mémoires », s’inscrit surtout dans une prise de conscience des problèmes économiques et sociaux que connaît alors la province de Québec, qui s’industrialise et s’urbanise, tandis que le gouvernement libéral de Lomer Gouin*, plutôt affairiste, sombre à l’occasion dans la corruption. Soutenu à fond par le Nationaliste, secondé par La Vergne, qui est en train de devenir son disciple principal, Bourassa dénonce à l’été de 1907 la mauvaise administration de la colonisation et des ressources naturelles. Il multiplie les assemblées et promène un slogan : La terre libre au colon libre. Il divulgue des éléments de sa pensée économique : opposition aux monopoles comme au socialisme et au communisme, acceptation de la libre entreprise et même des trusts, dont les pratiques doivent être balisées, propriété et contrôle gouvernementaux des services d’utilités publiques en lien avec l’entreprise privée, tarifs modérés pour aider les industries, appui aux caisses populaires d’Alphonse Desjardins*. Il vante la vie rurale des fermiers autour de l’église paroissiale et critique l’atmosphère malsaine des villes. Il s’adresse aux ouvriers et veut implanter une chambre syndicale où, avec les patrons, ils discuteront de leurs droits et intérêts respectifs. Il se braque surtout contre Adélard Turgeon*, ministre des Terres et des Forêts, et contre Jean Prévost*, ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries. Turgeon le défie de se présenter dans sa circonscription de Bellechasse pour régler leurs différends. Bourassa accepte. Le 4 novembre, Turgeon l’écrase par 749 voix de majorité. Aussitôt, des conservateurs proposent à Bourassa une alliance tacite pour les prochaines élections provinciales. En retour de leur appui dans la mise en place d’un journal conforme à ses vues, Bourassa agrée. Il se hasarde dans deux circonscriptions, Saint-Hyacinthe et Montréal, division no 2, où il affronte le premier ministre Gouin. Le 8 juin 1908, il triomphe de justesse aux deux places.
Allié au chef conservateur Joseph-Mathias Tellier et à La Vergne, Bourassa se jette sur Gouin (qui s’est fait élire dans Portneuf) à la session de 1909. Quand il discourt, les galeries se remplissent, les journalistes accourent. Il ne s’illustre vraiment qu’à cette première session. Il touche à quantité de sujets. Gouin répond du tac au tac : entre les deux hommes, la lutte est égale. Progressivement, Bourassa se désintéresse de l’Assemblée législative. Et en 1912, il quitte Québec : le mouvement nationaliste, qu’il refuse de transformer en parti dont il assumerait la direction, cesse d’être une force en politique provinciale. Entre-temps, il a amené le gouvernement à mieux contrôler la spéculation, à louer les chutes d’eau par bail emphytéotique plutôt que de les vendre, à créer une commission pour réglementer la concession des ressources hydrauliques, à imposer un embargo sur l’exportation du bois à pâte coupé sur les terres de la couronne afin de le transformer au Québec.
La première préoccupation de Bourassa demeure la création d’un journal quotidien. Depuis les élections de 1908, il s’y consacre avec d’autres, dont Asselin, après avoir reçu l’accord de Mgr Paul Bruchési*, archevêque de Montréal. Pragmatique, il exige de ceux qui l’appuient financièrement, surtout des conservateurs, de lui céder le contrôle de 50 % plus une des actions de la compagnie avec pleine direction du journal et indépendance totale. Le Devoir, avec sa devise Fais ce que dois, paraît le 10 janvier 1910. Quotidien d’idées et de principes, organe de combat, cette force morale sera avant tout catholique et nationaliste. Dans son premier éditorial, Bourassa indique clairement sa manière de travailler : « nous prendrons les hommes et les faits corps à corps et nous les jugerons à la lumière de nos principes ». Le directeur s’entoure d’une équipe solide et expérimentée : Asselin, Héroux, La Vergne, Georges Pelletier* et Jules Fournier*, entre autres. Ils signent leurs articles qui paraissent d’abord dans les 4, puis 6, 8, 10 et 12 pages du journal, dont le tirage se situe à 12 529 en 1910 et à 13 504 en 1930.
Dans les crises diverses qu’il connaîtra, le Devoir se maintiendra grâce aux efforts considérables de son directeur, en lien avec des hommes d’affaires comme Guillaume-Narcisse Ducharme*, président de la Compagnie d’assurance sur la vie La Sauvegarde, dont Bourassa a été le secrétaire-trésorier de 1903 à 1908. Jusqu’au 2 août 1932, date à laquelle il quittera volontairement le journal, Bourassa conservera l’autorité sur l’œuvre, bien qu’à partir de 1918 il en confiera souvent l’administration et la direction à Héroux et à Pelletier. Dès le départ, il touche un traitement inférieur à celui de journalistes qu’il engage, soit un peu moins de 1 820 $ par année. En général, il entretient un lien amical avec ses employés, sans déborder dans la familiarité. Peu payé, le personnel se donne sans compter à la cause du Devoir. Par la rigueur de sa pensée et la qualité de son style limpide, direct et concis, Bourassa en fait l’un des plus prestigieux et des plus influents journaux de la province. Indéniablement, le Devoir constitue l’accomplissement majeur de Bourassa qui devient l’intellectuel le plus important de la province. Il y transporte quasi intégralement les idées qu’il a émises depuis son entrée dans la vie publique. En dépit de pointes progressistes, une caractéristique les rassemble : leur conservatisme.
Dès la parution du Devoir, Bourassa s’engage dans la lutte contre la création d’une marine de guerre canadienne, projet que Laurier dépose aux Communes le 12 janvier 1910. Le 20 janvier, il convoque une assemblée monstre à Montréal pour dénoncer cette marine, non canadienne, qui coûtera beaucoup plus cher que prévu et mènera à la participation aux guerres de la Grande-Bretagne, au gouffre du militarisme et, pire, à la conscription. Pour Bourassa, c’est la résurgence de l’impérialisme britannique. Il faut, selon lui, consulter les Canadiens par plébiscite. Puis en mai, il accepte de lier son mouvement nationaliste à Frederick Debartzch Monk*, le chef des conservateurs fédéraux de la province de Québec opposés sur cette question tant à leur chef Robert Laird Borden* qu’à Laurier. Ainsi naît une coalition qui deviendra le Parti autonomiste ou l’alliance conservatrice-nationaliste. Les deux leaders tiennent une multitude d’assemblées au Québec à l’été de 1910. Bourassa accroît sa réputation quand, le 10 septembre à l’église Notre-Dame de Montréal, il réplique à l’archevêque de Westminster, Mgr Francis Alphonsus Bourne, qui affirme qu’au Canada il faudrait allier la religion catholique à la langue anglaise : « Nous ne sommes qu’une poignée c’est vrai ; mais nous comptons pour ce que nous sommes, et nous avons le droit de vivre. » C’est l’euphorie ! Pour arrêter la progression de Bourassa, Laurier annonce une élection partielle dans Drummond et Arthabaska, circonscription de tradition libérale. Le 3 novembre, les libéraux s’inclinent. Par candidats interposés, Bourassa a battu Laurier, voilà ce que retient la province de Québec.
En 1911, Bourassa poursuit le combat aux côtés de Monk même si un autre projet de Laurier, la réciprocité commerciale avec les États-Unis, qu’il favorise, aurait pu nuire à leur entente en raison de l’opposition de son associé. Monk et son groupe acceptent alors tous les principes fondamentaux du mouvement nationaliste. Quand le premier ministre, exacerbé par la résistance à la réciprocité, déclenche des élections pour le 21 septembre 1911, le Parti autonomiste est prêt. Sa stratégie est simple : faire élire à Ottawa suffisamment de députés indépendants pour détenir la balance du pouvoir. Bourassa noue une scabreuse alliance électorale avec Borden, qui l’aide financièrement dans sa bataille au Québec. Bourassa et La Vergne ne se présentent pas, mais ils dirigent les attaques à la fois contre la politique navale de Laurier et même contre celle de Borden. Le 21 septembre, Laurier est battu, par la réciprocité surtout. Bourassa et Monk font élire 17 candidats. Le directeur du Devoir est au zénith de sa gloire.
Avec sa majorité de 47 sièges, Borden peut conduire le pays à sa guise. Bourassa reconnaît les limites de ses succès électoraux. S’il refuse un poste dans le cabinet Borden, il accepte que trois de ses alliés conservateurs québécois, dont Monk, y accèdent. Il se réserve la surveillance de ces ministres et des autres députés conservateurs-nationalistes. Deux dossiers lui tiendront particulièrement à cœur jusqu’en 1913. D’abord, l’extension des frontières du Manitoba par l’ajout d’une partie du district de Keewatin [V. George Robson Coldwell*]. Le 27 février 1912, le gouvernement Borden décide de procéder sans tenir compte de la minorité catholique qui perdra ainsi ses écoles séparées. Bourassa proteste et demande aux ministres et députés conservateurs-nationalistes de se comporter en nationalistes. Sauf sept, tous se rallient à Borden. C’est la première défaite de Bourassa impliquant ses alliés de 1911. Puis, quand Borden choisit, le 5 décembre 1912, d’octroyer 35 millions de dollars à l’Angleterre pour construire trois cuirassés, seulement 8 députés conservateurs-nationalistes, dont Monk, s’opposent au premier ministre. Bourassa multiplie les articles dans le Devoir, mais comme la majorité des députés conservateurs-nationalistes désavoue ses discours de 1911, il rompt avec eux. Le mouvement nationaliste devient dès lors la risée de Laurier. Le Sénat, en majorité libérale, écartera le projet Borden en mai 1913, mais, quoi qu’en dise Bourassa qui s’en attribue abusivement la gloire, il vient de perdre la face. Il paye le prix pour ne pas avoir joué à fond les règles du système partisan et pour avoir laissé ses associés à eux-mêmes en ayant refusé de se présenter en 1911.
Bourassa n’est pas pour autant dépouillé de sa crédibilité personnelle au cours de ces années. Il prononce plusieurs conférences jusqu’en Ontario, dans l’Ouest et aux États-Unis. Il y défend, entre autres, la langue française, gardienne de la foi et de la Confédération. En 1913, il trace la base de la politique étrangère canadienne : le règlement des conflits par l’arbitrage international. L’intellectuel qu’il est exerce une autorité morale considérable. Il n’hésite pas à défendre la cause des Franco-Ontariens, privés en grande partie de leurs droits à l’enseignement en français par le Règlement 17, édicté en 1912 par leur gouvernement provincial [V. sir James Pliny Whitney*]. Il entreprend le 21 mai 1914 un autre voyage d’études en Europe où il rencontre entre autres Winston Churchill et David Lloyd George. Le 1er août, au moment où les menaces de guerre s’intensifient en Europe, il est à Strasbourg (France), ville alors sous domination allemande. Il parvient à rejoindre Paris deux jours plus tard, in extremis. Le 4 août, la Grande Guerre éclate. Il rentre au pays le 21 août. S’annonce pour lui une période des plus agitées.
Au début du conflit, le Canada, automatiquement en guerre de par son statut de colonie de l’Empire britannique, vibre d’enthousiasme. Les partis politiques s’entendent pour aider la mère patrie et envoyer outre-mer des soldats volontaires, tandis que les francophones et les anglophones appuient ces mesures. Pourfendeur des décisions de 1899, de 1910 et de 1912, Bourassa doit réagir publiquement. Le 8 septembre dans le Devoir, il accepte – « avec répugnance », dira-t-il plus tard – l’engagement du Canada comme nation, dans la mesure de ses forces et par les moyens d’action qui lui sont propres. En clair, Bourassa répudie son passé et essaie de se blottir dans l’atmosphère ambiante. Toutefois, dès après son éditorial, il multiplie les articles percutants dans lesquels il partage les responsabilités entre les belligérants, dévoile les ambitions pécuniaires cachées de l’Angleterre et son égoïsme, les excès de zèle du gouvernement canadien, les risques économiques de la participation, le trop grand nombre de volontaires sous les drapeaux. Qui plus est, il interpelle les « Prussiens d’Ontario » qui y persécutent les écoles françaises. C’en est trop pour ses adversaires au Québec comme au Canada anglais, et pour des évêques comme Mgr Bruchési. Ce « traître » à la nation, ce fomenteur de troubles, engendre la tempête. C’est pire en 1915, quand la guerre se prolonge, exigeant toujours plus de soldats, quand la crise ontarienne se poursuit. Ses articles au Devoir, ses conférences, son livre Que devons-nous à l’Angleterre ? : la défense nationale, la révolution impérialiste, le tribut à l’Empire, publié à Montréal cette année-là, tout concourt à susciter les débats. Il devient l’ennemi public des Canadiens anglais qui demandent la suppression du Devoir et l’arrestation de son directeur. L’ascendant de Bourassa sur les siens fait craindre le pire aux autorités politiques et religieuses.
Bourassa en remet en 1916 et avoue être revenu au « nationalisme intégral ». Champion de la minorité franco-ontarienne, il en fait le combat de l’Amérique du Nord française avant même celui de l’Europe. Son ascendant se fait sentir chez les francophones, qui, soumis aussi à d’autres influences, ne s’enrôlent pratiquement plus. Quand Borden propose la conscription en mai 1917, la province de Québec est prête à la violence. Le prestige de Bourassa est à son comble, même l’épiscopat s’affirme bourassiste. Il pourrait d’un coup s’emparer de la province, comme le craignent Laurier et Borden. Responsable, il appelle à la résistance par les moyens constitutionnels et se range à la solution de Laurier : le référendum (qu’il nomme aussi plébiscite). Il refuse le gouvernement d’union créé à l’automne par Borden et se lie à Laurier pour le vaincre aux élections du 17 décembre. Ensemble, ils balaient la province de Québec en colère, mais ils sont écrasés au Canada anglais. Dans ce pays scindé en deux, Bourassa incline à l’isolement des Canadiens français mais non à leur séparation du reste du Canada ; sa correspondance montre en effet qu’il s’oppose à la motion sécessionniste du député libéral Joseph-Napoléon Francœur, présentée à l’Assemblée législative de Québec en décembre 1917 [V. sir Lomer Gouin]. Muselé par la censure de guerre renforcée par Borden, Bourassa range en avril 1918 ses articles cinglants. Auparavant, il a eu le temps de dénoncer le droit de vote octroyé aux femmes par Borden et les responsables des émeutes meurtrières de Québec [V. Georges Demeule*]. Surtout, il a discuté de la paix à venir, « la paix chrétienne », au centre de laquelle il a situé la médiation du pape Benoît XV. Peut-être encore plus qu’avant, Bourassa envisage la politique en fonction de la religion. Il en est là à la fin de la guerre, en train d’amorcer un autre tournant dans sa carrière.
L’homme a atteint la cinquantaine. Blanchi, usé, empreint d’un certain mysticisme, Bourassa est frappé de plein fouet en 1919. Sa femme succombe à une longue maladie le 26 janvier. Il reste seul avec huit enfants, dont l’aînée n’a que 12 ans. Peu après, c’est Laurier qui s’éteint, l’être admiré, honni, dont il a toujours reconnu l’importance dans sa vie. L’ex-premier ministre était différent de lui par la formation, par les rapports entretenus avec l’Église, le système de partis, les compromis et le réalisme politique, par le caractère. Laurier, moins cassant, montrait plus d’affabilité tout en répugnant aux situations tranchées que prisait Bourassa. Nul doute, ces deux grands humanistes se ressemblaient aussi par certains côtés : même sensibilité face à la culture, à la connaissance, à l’homme en général, même rationalité, même attrait pour le libéralisme classique, le conservatisme social et les institutions britanniques, enfin, même nationalisme canadien et même amour de leurs compatriotes bien que les moyens pour les déployer les aient profondément éloignés dès 1899. C’est la fin d’une époque. La guerre aussi a fait ses ravages. Que de dangers Bourassa constate au Canada : le bolchévisme, le socialisme, le féminisme, le syndicalisme neutre, les grèves à bases révolutionnaires, l’égoïsme individuel, le matérialisme poussé, la rivalité des classes, la faillite du parlementarisme. L’ordre social catholique est menacé par l’individu qui veut prendre la place de Dieu. Il décide alors de faire valoir un programme d’action sociale catholique qui s’attaquera aux racines du mal.
Bourassa, l’ultramontain de toujours, conduit ainsi à leur terme ses réflexions sociales d’hier. Le doctrinaire et le moraliste prévaudront désormais sur le politique et le journaliste, sans toutefois les remplacer totalement. Pour réussir son programme, il trace une hiérarchie des devoirs typiquement ultramontaine. Ainsi, écrit-il en 1921 dans son importante brochure la Presse catholique et nationale, « que la religion précède le patriotisme, que la préservation de la foi et des mœurs importe plus que la conservation de la langue, que le maintien des traditions nationales, des vertus familiales surtout, prime les exigences du haut enseignement ou la production des œuvres littéraires ». Sur ces fondements, il rédige maints articles et brochures, et prononce de nombreuses conférences, à saveur d’homélie passionnée, au Québec, puis en Ontario, en Acadie et dans l’Ouest. Il s’en prend notamment à l’urbanisation et à l’industrialisme croissants, à l’État qui propose l’assistance publique, aux trusts et monopoles, vante l’agriculture, la colonisation et les syndicats catholiques. Il inscrit ses activités dans celles de la promotion de la presse catholique, dont l’objectif est aussi de remplir les coffres vides du Devoir.
Dans le même esprit, Bourassa rejette le projet que certains intellectuels, regroupés autour de l’abbé Lionel Groulx*, directeur de la revue l’Action française (Montréal), soumettent à leurs compatriotes en 1922 comme un idéal à atteindre : la mise en place d’une Laurentie séparée du Canada. Bourassa, qui n’a pas été consulté par Groulx, mais qui a évoqué cette idée en décembre 1921, réplique le 23 novembre 1923 dans un discours dont il tire une autre brochure célèbre, intitulée Patriotisme, Nationalisme, Impérialisme [...] et publiée à Montréal la même année. Il s’appuie notamment sur l’encyclique Ubi arcano Dei de Pie XI écrite en 1922, qui condamne le « nationalisme immodéré ». Associant subtilement ce rêve séparatiste au nationalisme outrancier, dont il réitère la menace, il proclame son attachement au patriotisme et au nationalisme chrétiens, les seuls « vrai patriotisme » et « vrai nationalisme ». Puis, il analyse l’option séparatiste : « Ce rêve est-il réalisable ? Je ne le pense pas. Est-il désirable ? Je ne le crois pas davantage, ni au point de vue français, ni, encore moins, au point de vue catholique, qui prime à mes yeux l’intérêt français. » Il conclut : « La conservation de la foi [...] import[e] plus que la conservation de n’importe quelle langue, que le triomphe de toute cause humaine. » Le maître, encore auréolé de son prestige, vient d’asséner un dur coup au rêve séparatiste.
L’entreprise de régénération morale de Bourassa trouve son couronnement le 18 novembre 1926 quand il rencontre Pie XI en audience privée d’une heure. Les propos du pape rejoignent en substance la thèse de Patriotisme, Nationalisme, Impérialisme. Dans ses « Mémoires », Bourassa racontera sa réaction : « je suis sorti de là raffermi, réconforté, éclairé pour le reste de mes jours ». Il croit dès lors être chargé par Pie XI de la mission de faire mieux connaître et accepter sa pensée au Canada.
À son retour d’Europe, Bourassa plonge en plein cœur des débats politiques. C’est que, en 1925, il s’est représenté à titre d’indépendant dans la circonscription fédérale de Labelle, où il a été élu le 29 octobre par 2 079 voix de majorité, puis de nouveau aux élections générales du 14 septembre 1926, où il a été réélu par 6 322 voix de majorité. Au Parlement, il suscite la curiosité en raison de sa réputation. Il remplit ses fonctions de député, le plus souvent aux côtés des libéraux de William Lyon Mackenzie King* reportés au pouvoir. Assez isolé parmi la cohorte de parlementaires qu’il ne connaît pas, il se rapproche d’anciens adversaires, tel Rodolphe Lemieux*, ou apprend à en apprécier d’autres, tel le socialiste James Shaver Woodsworth*. S’assignant progressivement le rôle de conscience de la Chambre, il méprise le favoritisme pour se concentrer sur la grande politique, nationale comme internationale. Jusqu’en 1930, il discute, entre autres, du programme des pensions de vieillesse, auquel il s’oppose, des budgets du gouvernement, de la cause du français et du bilinguisme au pays, des ressources naturelles de l’Ouest, de la loi sur le divorce. Il aborde également des sujets comme la paix mondiale et les relations du Canada avec l’Empire britannique. Il accueille de manière mitigée les résultats de la Conférence impériale de 1926, qui a reconnu la Grande-Bretagne et les dominions comme des communautés autonomes, égales en droit, aucunement subordonnées l’une à l’autre et librement associées à titre de membres du British Commonwealth of Nations. Pour lui, il s’agit simplement de la reconnaissance d’un état de fait. Il s’en prend, entre autres, au principe de la solidarité dans les obligations impériales qui, s’il est maintenu, empêche l’affranchissement national. Aux élections générales du 28 juillet 1930, il est élu sans concurrent dans Labelle, tandis que le conservateur Richard Bedford Bennett* supplante King à la tête du pays.
Pendant ces années, Bourassa agit aussi à l’extérieur de la Chambre. Il rédige des articles sur des sujets d’actualité tant nationaux qu’internationaux, prononce plusieurs discours retentissants, notamment à Montréal pour le soixantième anniversaire de la Confédération, ou dans l’Ouest canadien, peu après, au moment d’une tournée d’enseignement patriotique. Sa prise de position la plus importante touche l’agitation sentinelliste. Cette crise oppose des Franco-Américains et leur journal la Sentinelle (Woonsocket, Rhode Island) à l’évêque irlandais de Providence, Mgr William Hickey, qui veut prélever des fonds chez les catholiques de son diocèse pour construire des écoles secondaires catholiques anglophones. L’affaire, suivie de près par l’élite nationaliste, le clergé et les francophones de la province de Québec, se rend jusqu’à Pie XI qui, en 1928, approuve Mgr Hickey, condamne la Sentinelle et excommunie les rebelles. Ces derniers ne désarment pas. Ils parlent même de schisme en 1929. C’est à ce moment que Bourassa, grand défenseur des minorités depuis longtemps intéressé à ces Canadiens français émigrés aux États-Unis, intervient. À partir du 15 janvier 1929, il publie cinq articles dévastateurs pour la cause sentinelliste : il appelle à la soumission en expliquant qu’il faut préserver l’autorité essentielle de l’Église et éviter la subordination du catholicisme au nationalisme. L’impact est considérable. Aussitôt, la crise se dénoue aux États-Unis. Au Québec, les réactions pleuvent. Parmi les plus déçus figurent les nationalistes de la Ligue d’action canadienne-française qui ne reconnaissent plus leur mentor. Groulx en tête, ils n’acceptent pas cette séparation du nationalisme et du catholicisme si chère à Bourassa. Le maître est en train de détruire son passé. Bourassa leur répond dans une conférence le 3 février 1930 : « sur le fond du problème national et religieux, je loge à la même enseigne qu’il y a dix, vingt ou trente ans ». Il a raison. « Quand la conscience commande, renchérit-il, [... l’éveilleur de l’opinion] doit parler. » Tout Bourassa est là.
Durant les années 1930 à 1935, Bourassa, aux Communes, se tient de façon générale au-dessus de la mêlée. Il aborde les hommes et les choses du haut de ses principes, glorifiant souvent le pape et commentant les encycliques. Le 30 juin 1931, par exemple, il accueille favorablement le statut de Westminster, qui octroie une indépendance partielle au Canada, mais regrette que la séparation du pays et de la Grande-Bretagne ne soit pas complète. En 1934, il s’en prend à l’antisémitisme et au racisme qu’il avait déjà répudiés, en particulier en 1930 en soutenant le principe de la mise en place d’un système d’écoles juives à Montréal. De même en 1934, il discute de la crise économique : ses considérations économico-religieuses, peu originales, reprennent plusieurs de ses dogmes du passé. En 1935, il a de bons mots pour le programme dit du New Deal de Bennett et il s’agite pour la sauvegarde de la paix mondiale.
Bourassa conduit ces combats au Devoir et y ajoute d’autres sujets. En 1931, il analyse la loi provinciale des accidents du travail : « Un monstre... bien intentionné » de l’étatisme québécois, qu’il appuie tout de même sur le fond. Il aborde aussi le rôle positif de l’Allemagne pour barrer la route à l’expansion du bolchévisme. Au Devoir – et ailleurs –, cependant, Bourassa avance des propos qui blessent à l’occasion la clientèle du journal. En plus des nationalistes de tout acabit, d’autres groupes, tels les membres du clergé, sont aussi touchés. Le 4 mars 1932, dans une conférence intitulée « Honnêtes ou canailles ? », reprise dans le Devoir le 7, Bourassa les accuse de s’enrichir indûment à partir des biens de l’Église. Heurtés, plusieurs supporteurs naturels du Devoir se désabonnent. La crise économique amplifiant les difficultés financières, le journal se retrouve au bord du gouffre. D’immenses tensions assaillent la direction du quotidien et son conseil d’administration. Conscient de toutes ces réalités, Bourassa échappe le mot « démission » au printemps de 1932. Les administrateurs le prennent au mot en mai. La démission de Bourassa devient effective le 2 août suivant. La nouvelle, qui fait l’objet d’un simple entrefilet, crée un événement. Plusieurs personnes s’interrogent sur les dessous de cette affaire, tandis que certaines parlent abusivement de congédiement. Bourassa, maussade, profondément bouleversé, se terre aux Communes et songe à se retirer de la vie publique. Une page, sans doute la plus importante de sa vie, vient de se tourner. Le 7 décembre 1933, l’abbé Groulx, dans une lettre à Armand La Vergne, donne un aperçu de la hargne que lui voue alors le milieu nationaliste canadien-français : « Quelle tristesse que certaines fins de vie ! [...] Serait-ce cette fois pure évolution intellectuelle ? N’y aurait-il pas aussi évolution cérébrale ? [...] Pour me résumer : [...] personne ici ne pense plus à lui. Et c’est bien là, en la destinée de cet homme, le côté tragique, qu’encore vivant, il soit traité comme mort. »
Pourtant, Bourassa fera encore du bruit à Montréal et provoquera à nouveau la fureur des nationalistes de Groulx. En avril et mai 1935, il donne trois conférences sur le nationalisme. D’entrée de jeu, il pose une question : « Le nationalisme est-il un péché ? » S’il légitime d’abord le nationalisme canadien, celui de la réaction à l’impérialisme et au colonialisme, celui de la protection des droits des minorités, il admet avoir commis cinq péchés, dont le plus important serait certainement celui d’avoir tenu des paroles qui auraient pu faire croire que la langue l’emportait sur la foi. Puis, il se déclare « en désaccord avec le néo-nationalisme inauguré par L’Action Française de Montréal, prolongé et accentué par Jeune-Canada », et se moque des séparatistes. Il voit chez eux une « déviation du sens national et du sens religieux » et les désigne comme des « fomenteurs de haines de race ». Il décrie par la suite le nationalisme religieux, « l’antithèse du catholicisme », trop présent au Canada. Il fustige l’antisémitisme qui sévit au Québec et ailleurs. Ces conférences, pourtant dans la continuité de la pensée de Bourassa, sèment la colère chez Groulx qui lui réplique aussitôt dans le numéro de mai de l’Action nationale (Montréal). C’est un éreintement en règle de l’ancien mentor « qui a saccagé l’idéal d’une génération » et qui « n’est plus un maître ». Les propos, crus et injustes, montrent le mur de solitude entre les deux hommes. Bourassa en prend acte et se tait. L’automne venu, il se laisse convaincre et sollicite un nouveau mandat de député fédéral. Maurice Lalonde, jeune avocat libéral, décide de lui faire la lutte et, le soir du 14 octobre 1935, obtient 1 869 voix de majorité. « À part la très légère piqûre d’amour-propre, écrit Bourassa à sa fille Anne, je me sens soulagé d’un grand poids et même enchanté. »
À 67 ans, Bourassa commence une longue retraite. Jusqu’en 1938, malgré une vie publique réduite, il donne quelques conférences sur les affaires canadiennes et reprend plusieurs de ses idées pour semer la colère chez les nationalistes canadiens-français. En fait, il a surtout les yeux tournés vers l’Europe, embourbée dans l’angoisse d’une autre guerre mondiale. Il y effectue même deux voyages, l’un en 1936 et l’autre en 1938. Bourassa craint par-dessus tout la Russie communiste parce qu’elle menace Dieu, la famille et la propriété. Il n’aime pas plus l’Allemagne et le nazisme, qui exaltent « le culte de la race » et la haine des Juifs, mais il admet que l’Allemagne, nation instable, bafouée par le traité de Versailles, « est la seule force capable de mettre de l’ordre dans le chaos slave ». Il souhaite une entente France-Allemagne qui impliquerait l’Italie de Benito Mussolini, qu’il a rencontré une deuxième fois en 1936. Il appelle, enfin, les puissances à s’en remettre aux lumières du pape.
Puis, pendant près de trois ans, c’est le silence complet. De plus en plus religieux, Bourassa vit sereinement sa solitude. Fin causeur en privé, il reçoit à l’occasion des visiteurs avec qui il discute des affaires canadiennes et européennes. Sa santé est encore bonne. Il fait de longues marches tout en égrenant son chapelet ; il se distrait en jouant aux échecs ou aux cartes, sa pipe de plâtre à la bouche. Et il lit abondamment, jusqu’à ce que des problèmes aux yeux l’en empêchent, à son grand regret. En mai 1941, il accepte de prononcer une conférence à Montréal pour soutenir une œuvre religieuse. Le revoilà, à près de 73 ans, sur la place publique. C’est le début de ses prises de position officielles sur la guerre, qui se prolonge indûment. Jusqu’en 1944, Bourassa renouera avec l’objet et les arguments mêmes de ses luttes nationalistes d’hier. S’il décrie l’Axe, dominé par l’Allemagne nazie, il témoigne de la sympathie pour la France du maréchal Philippe Pétain et pour l’Italie chrétienne. Il désire franchement que le Canada se retire de cette guerre qui devrait se terminer par un règlement négocié. Avant tout, il réclame l’établissement d’un ordre social chrétien. C’est dans ce contexte que s’établit, dès la fin de 1941, un rapprochement avec les nationalistes canadiens-français. Les retrouvailles, amorcées par eux, sont marquées par le respect mutuel. Résistant, comme lui, à l’impérialisme et à la conscription dont ils craignent de plus en plus la mise en place par le premier ministre King, ils fondent en février 1942 la Ligue pour la défense du Canada puis, le 8 septembre suivant, un parti, le Bloc populaire canadien : ils raniment la flamme du nationalisme canadien de l’ancien leader. Bourassa, sans faire partie de ces deux regroupements, les accompagne et soutient leurs objectifs. Opposé, entre autres, au plébiscite du 27 avril 1942 qui vise à relever le gouvernement King de sa promesse de ne pas imposer la conscription, il participe à plusieurs de leurs assemblées politiques et électorales jusqu’en 1944.
Pendant ce temps, soit du 13 octobre 1943 au 15 mars 1944, Bourassa, sur l’avis de quelques nationalistes dont Jean Drapeau* et André Laurendeau*, raconte ses « Mémoires » à l’auditorium Le Plateau à Montréal. Au cours de dix conférences, qui attirent une foule fidèle et dont l’une est enregistrée sur disques, il repasse sa vie avec une mémoire prodigieuse et une jeunesse d’expression. Il veut montrer l’unité de sa pensée et de son action qui puisent, malgré les parcours complexes, à ses deux atavismes, celui des Papineau et celui des Bourassa. Malgré les oublis et les omissions, les accents d’autocélébration, l’entremêlement de souvenirs personnels et de digressions, qui affaiblissent l’argumentation, les « Mémoires » demeureront une remarquable source d’information.
À l’automne de 1944, à 76 ans, Bourassa subit une thrombose coronaire. Sa retraite devient absolue. Même s’il se remet, il reste fragile et souffre régulièrement de malaises. Il a tout de même eu le bonheur de recouvrer entre-temps une vue suffisante pour lire. Il se prépare à la mort selon un rituel quotidien et digne d’un religieux : lecture de la messe du jour, du propre du bréviaire, de la vie des saints, de l’Imitation de Jésus-Christ, récitation du rosaire, chemin de la croix, prière en famille. Il y ajoute les petits plaisirs que lui procurent sa pipe, ses cigares, ses jeux en famille, la visite d’amis et le dépouillement du Devoir. La veille de ses 84 ans, Bourassa se lève plus en forme que d’habitude. Mais brusquement, une douleur atroce au cœur le foudroie. À sa demande, son fils François, jésuite, lui donne l’absolution. Entouré des siens, conscient jusqu’au bout, Bourassa rend l’âme le 31 août 1952.
Dès lors, l’histoire s’empare du personnage et de son œuvre. L’un et l’autre ne seront pas faciles à apprécier. Le journaliste André Laurendeau avoue même en 1954 : « On n’enferme pas un être comme Bourassa dans une formule : il dépasse toujours par un côté ou par un autre. » Qu’a donc laissé Henri Bourassa à la postérité ? Sans doute le souvenir, chez les Canadiens, d’un nom prestigieux que rappellent constamment les rues, boulevards, circonscriptions électorales, commission scolaire régionale, écoles, station de métro, édifices divers désignés en son honneur. À la fois louangeurs et critiques, les livres, thèses et articles qui lui ont été consacrés sont devenus autant de témoignages sur une époque. Le petit-fils de Papineau demeure une présence qui symbolise une contribution notoire à la construction du pays. Bourassa n’était cependant pas un grand politique ; incapable, par caractère et par principe, de composer avec le pouvoir sous toutes ses formes, il n’a pas su évoluer à l’aise à l’intérieur de ses cadres restrictifs et en a subi les conséquences. Sa voie véritable, il l’a trouvée dans le journalisme catholique de combat. Il a été en premier lieu un intellectuel engagé, doué d’un charisme et d’une culture incomparables. Entre 1899 et 1920, surtout, il a amené les esprits parmi les plus éveillés de ses compatriotes à s’intéresser à la chose publique et à s’impliquer, par la réflexion et l’action, dans les débats sur l’avenir de leur société et de leur nation. Le renouveau nationaliste qu’a connu le Québec au début du xxe siècle lui appartient.
Bourassa était aussi un précurseur. En 1954, la revue l’Action nationale a écrit : « aujourd’hui, la plus grande partie du programme politique qu’il a soutenu, presque envers et contre tous, est devenu celui de la plupart des Canadiens et sert à assurer le prestige de nos grands partis » ; ainsi en est-il de sa défense acharnée de l’autonomie et de l’indépendance du Canada, comme du respect des minorités et du caractère biculturel du pays. Il a été, en quelque sorte, le premier à œuvrer à la mise en place réfléchie et ordonnée d’une philosophie politique capable d’éclairer les problèmes canadiens au début du xxe siècle. Il a donné à ses compatriotes une compréhension plus précise de la nature des relations du Canada avec l’Empire et des rapports entre la majorité et la minorité. Il a été, en outre, l’instigateur, du moins au Québec, d’une réflexion étayée sur la paix et les questions internationales. Il n’est pas étonnant qu’il détienne le titre de père de la pensée politique indépendante au Canada français. Tributaires de son ultramontanisme et de son époque, ses opinions dans les domaines social et économique n’étaient cependant guère progressistes et originales, en dépit de pointes réformistes. Il s’en dégage une vision parfois anachronique et plutôt étriquée des choses et des hommes, des femmes surtout, dont il a contribué à retarder l’émancipation. Membre d’une élite petite-bourgeoise, il a compté parmi ses porte-parole les plus éminents : la vigueur et la logique de son expression dépassaient celles de ses contemporains.
Homme de devoir, perçu à l’occasion comme la conscience de son peuple, Henri Bourassa était avant tout un grand catholique soumis aux directives du pape. Il s’y est attaché tôt dans sa carrière, et elles ont orienté sa pensée et ses actions jusqu’à la fin de ses jours. Son attitude, mal comprise, lui a aliéné quantité de supporteurs jusqu’à ses plus fidèles disciples nationalistes. Dans ses Mémoires, l’abbé Groulx rappelle les dommages que Bourassa a causés au nationalisme canadien-français. Le ton ainsi donné, la génération nationaliste québécoise des années 1960 s’est elle aussi éloignée des idées bourassistes jugées trop franchement canadiennes. En même temps, cependant, d’autres Québécois, tel Pierre Elliott Trudeau*, ont propagé des aspects essentiels de leur contenu. Enfin, l’ensemble de la pensée de Bourassa n’a pas plu à la majorité de ses compatriotes canadiens-anglais protestants qui l’ont abusivement traité de destructeur de l’unité canadienne, de diviseur des races, de trouble-fête. Certes, la vive expression de son catholicisme intransigeant n’avait rien pour les attirer au type de nationalisme qu’il défendait. Mais Bourassa a-t-il tous les torts ? Les Canadiens anglais de son époque, puis plusieurs de leurs historiens par la suite, ne se sont pas suffisamment mis à son écoute et n’ont pas tenté de saisir pleinement le sens de ses luttes. S’ils l’avaient fait, ils auraient découvert en Bourassa ce que constatent aujourd’hui un certain nombre d’historiens canadiens-anglais plus avertis : un fier adepte de l’esprit et de la lettre de la constitution canadienne, un nationaliste canadien dévoué au Canada, sa seule patrie. En somme, un penseur courageux qui, à maints égards, peut encore inspirer les Canadiens.
Nous tenons à remercier Mme Michèle Brassard, qui a effectué pour nous des recherches indispensables.
Les sources d’information essentielles pour cette biographie restent la correspondance et les écrits même d’Henri Bourassa. Ses fonds d’archives principaux sont conservés à Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), R8069-0-5 (fonds Henri Bourassa) et au Centre de recherche Lionel-Groulx (Outremont, Québec), P65 (fonds Famille Bourassa). Il faut reconnaître la patience et la rigueur de Mme Anne Bourassa, sa fille, qui a minutieusement préservé la mémoire de son père. Nous nous sommes entretenus à de nombreuses reprises avec elle au sujet de son père. D’autres fonds d’archives, notamment d’hommes politiques et de journalistes, ont éclairé plusieurs aspects de sa carrière. Mentionnons, à Bibliothèque et Arch. Canada, ceux de sir Wilfrid Laurier (R10811-0-X), de la Famille Armand Lavergne (R6172-0-1), de Frederick Debartzch Monk (MG 27, II, D10A) et, à la Ville de Montréal, Section des arch., celui d’Olivar Asselin (BM55). Nous détenons aussi quelques correspondances inédites au centre desquelles figure Henri Bourassa. L’acte de baptême de ce dernier se trouve à Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, CE601-S51, 2 sept. 1868.
Henri Bourassa a écrit de nombreux ouvrages et brochures dont on peut retracer les titres dans André Bergevin et al., Henri Bourassa : biographie, index des écrits, index de la correspondance publique, 1895–1924 (Montréal, 1966). Ils ont tous été consultés. Quelques-uns d’entre eux ont été cités dans la biographie. Ces publications sont incontournables pour cerner l’évolution de la pensée de cet intellectuel engagé. Il en est de même de l’œuvre journalistique de Bourassa qui tient principalement dans les journaux qu’il a dirigés ou fondés : l’Interprète, le Ralliement et le Devoir, qui furent tous compulsés ; ses articles dans le Devoir, de 1910 à 1932, ont été reproduits sur microfilm. D’autres journaux de l’époque, en particulier ceux dans lesquels écrivaient ses amis et ses adversaires politiques au Québec et au Canada, ont permis de mieux saisir les réactions que provoquait Bourassa. Soulignons, à titre d’exemples, la Vérité et le Soleil de Québec ainsi que le Canada de Montréal. Deux sources ont contribué à l’évaluation du rôle joué par le député aux parlements d’Ottawa et de Québec : Canada, Chambre des communes, Débats, 1896–1907, 1926–1935 et Québec, Assemblée législative, Débats, 1909–1912. À tous ces documents, il faut ajouter le contenu de mémoires de personnages de l’époque, dont les plus pertinents restent ceux de Bourassa lui-même conservés au Centre de recherche Lionel-Groulx, P65/B9, 2-11, d’Armand La Vergne publiés sous le titre Trente ans de vie nationale (Montréal, 1934) et du chanoine Lionel Groulx intitulés Mes mémoires (4 vol., Montréal, 1970–1974).
Des études spécialisées, thèses de doctorat, mémoires de maîtrise et articles scientifiques ont permis d’approfondir des aspects de la carrière et de la pensée du leader nationaliste. Même si plusieurs de ces ouvrages commencent à dater, leur contribution mérite d’être soulignée. Parmi eux, notons la biographie de l’historien Robert Rumilly, Henri Bourassa : la vie publique d’un grand Canadien (Montréal, 1953). Grande chronique de la vie de Bourassa élaborée sans accompagnement scientifique, elle couvre sa vie entière et renferme quantité d’informations de diverses natures. L’historien Joseph Levitt a consacré à Bourassa plusieurs ouvrages incontournables dont Henri Bourassa on imperialism and biculturalism, 1900–1918 (Toronto, 1970), Henri Bourassa and the golden calf : the social program of the nationalists of Quebec, 1900–1914 (2e éd., Ottawa, 1972) et Henri Bourassa : critique catholique, Andrée Désilets, trad. (Ottawa, 1977). Il en est de même de l’historien René Durocher qui a signé deux solides articles : « Henri Bourassa, les évêques et la guerre de 1914–1918 », Soc. hist. du Canada, Communications hist. (Ottawa), 1971 : 248-275, et « Un journaliste catholique au XXe siècle : Henri Bourassa », dans Pierre Hurtubise et al., le Laïc dans l’Église canadienne-française de 1830 à nos jours (Montréal, 1972), 185-213.
On peut ajouter l’article pénétrant du journaliste André Laurendeau, « le Nationalisme de Bourassa », l’Action nationale (Montréal), 43 (1954) : 9-56, et des œuvres de l’historienne Susan Mann : Action française : French Canadian nationalism in the twenties (Toronto, 1975) ; « Variations on a nationalist theme : Henri Bourassa and Abbé Groulx in the 1920’s », Soc. hist. du Canada, Communications hist., 1970 : 109-119 ; et « Henri Bourassa et la question des femmes », dans Marie Lavigne et Yolande Pinard, les Femmes dans la société québécoise : aspects historiques (Montréal, 1977), 109-124. Il faut leur joindre le livre Hommage à Henri Bourassa (Montréal, [1952 ?]) reproduit du numéro souvenir paru dans le Devoir du 25 novembre 1952, qui recèle quantité de témoignages d’amis, et l’essai de l’historien Ramsay Cook, le Sphinx parle français : un Canadien anglais s’interroge sur le problème québécois, François Rinfret, trad. ([Montréal, 1968]). De grandes synthèses sur l’histoire canadienne ont été consultées avec profit ; la meilleure eu égard à Bourassa et à son époque demeure toujours celle des historiens R. C. Brown et Ramsay Cook, Canada, 1896–1921 : a nation transformed (Toronto, 1974). Sur le Devoir, on peut lire : Pierre Dandurand, « Analyse de l’idéologie d’un journal nationaliste canadien-français, le Devoir, 1911–1956 » (mémoire de M.A., univ. de Montréal, 1961) ; Le Devoir : un journal indépendant (1910–1995), sous la dir. de Robert Comeau et Luc Desrochers (Sainte-Foy [Québec], 1996) ; Le Devoir : reflet du Québec au 20e siècle, sous la dir. de Robert Lahaise (LaSalle [Montréal], 1994) ; P.-P. Gingras, le Devoir (Montréal, 1985) ; et Pierre Anctil, Le Devoir, les Juifs et l’Immigration : de Bourassa à Laurendeau (Québec, 1988). Plusieurs articles nécrologiques ont été consacrés à Bourassa dans le Devoir du 2 septembre 1952.
Parmi les publications récentes, mentionnons celle, remarquable, d’Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar Asselin et son temps (2 vol. parus, [Montréal], 1996– ) puis ces autres de Sylvie Lacombe, la Rencontre de deux peuples élus : comparaison des ambitions nationale et impériale au Canada entre 1896 et 1920 (Québec, 2002) et d’Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec (2 vol. parus, Saint-Laurent, Québec, 2000– ), 2. Enfin, toute œuvre consacrée à Bourassa doit tenir compte des biographies d’hommes politiques ou d’intellectuels canadiens qui ont pu avoir une influence sur sa carrière : elles ont toutes été parcourues. De même le fut l’ensemble des études portant sur les thèmes et sujets qui ont dominé la vie canadienne de 1868 à 1952.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Réal Bélanger, « BOURASSA, HENRI (baptisé Joseph-Henry-Napoléon) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/bourassa_henri_18F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/bourassa_henri_18F.html |
| Auteur de l'article: | Réal Bélanger |
| Titre de l'article: | BOURASSA, HENRI (baptisé Joseph-Henry-Napoléon) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2009 |
| Année de la révision: | 2009 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |