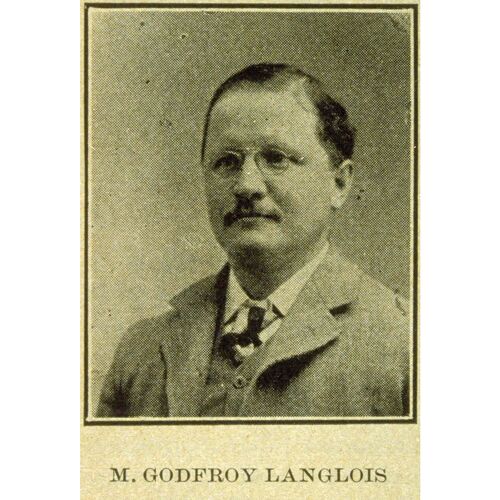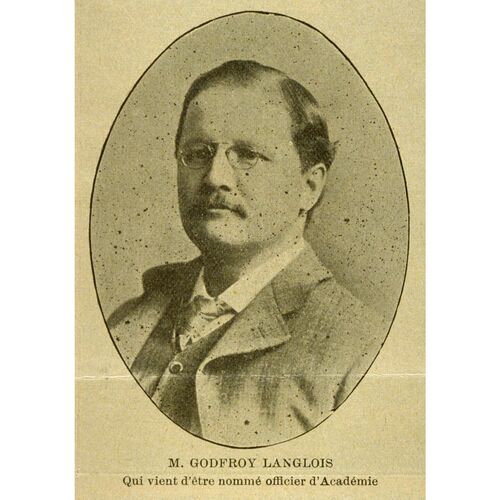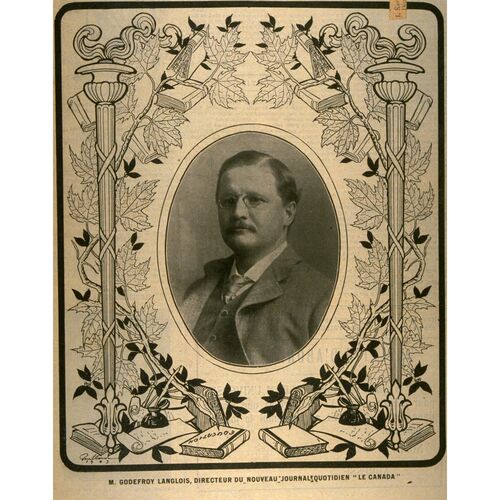Provenance : Lien
LANGLOIS, GODFROY (baptisé Joseph-Ernest-Godefroi), journaliste, rédacteur en chef, franc-maçon, homme politique et agent général de la province de Québec à Bruxelles, né le 26 décembre 1866 à Sainte-Scholastique (Mirabel, Québec), fils de Joseph Langlois et d’Olympe Clément (Proulx, dit Clément) ; le 24 janvier 1900, il épousa à Montréal Marie-Louise Hirbour, et ils eurent une fille ; décédé le 6 avril 1928 à Bruxelles et inhumé le 28 juillet à Sainte-Scholastique.
Godfroy Langlois était le fils d’un marchand et homme politique très important à Sainte-Scholastique. À l’automne de 1881, après ses études élémentaires, il entra au petit séminaire de Sainte-Thérèse. Pour des raisons obscures, il le quitta en juin 1884 pour le collège de Saint-Laurent, près de Montréal, où il obtint son diplôme avec médaille d’or en juin 1887. En septembre, il entreprit des études à l’école de droit de l’université Laval à Montréal, mais, ennuyé par l’approche académique de la matière, il choisit de poursuivre sa formation en devenant clerc au prestigieux cabinet de Raymond Préfontaine* et Pierre-Eugène Lafontaine*. Quelques mois plus tard, il fut admis au cabinet d’un « rouge » bien connu, Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme*.
L’influence de Laflamme s’avéra déterminante puisque c’est lui qui conseilla à Langlois d’abandonner le droit pour faire plutôt carrière en journalisme. En décembre 1889, Langlois lança le Clairon à Montréal avec trois autres collaborateurs. Cet hebdomadaire ne tarda pas à attirer l’attention, mais il ne parvint pas à se trouver un créneau et cessa de paraître dès mars 1890.
Tout de suite après, sur l’invitation d’Honoré Beaugrand*, Langlois accepta de travailler à la Patrie. Il y était encore employé lorsque, le 6 novembre, il lança l’Écho des Deux-Montagnes à Sainte-Scholastique avec l’avocat Joseph-Dominique Leduc. Sa conception audacieuse du libéralisme s’épanouit dans cet hebdomadaire, où il définit plus nettement son « radicalisme » en abordant des sujets tels l’annexionnisme, la réforme scolaire, la politique et les abus du clergé. L’archevêque de Montréal, Édouard-Charles Fabre*, réagit à son hostilité croissante en bannissant l’Écho le 11 novembre 1892. Deux semaines plus tard, Langlois, obstiné, fonda à Sainte-Scholastique un nouveau journal, la Liberté, en tous points semblable à l’Écho : même maquette, même nombre de pages, mêmes commanditaires, mêmes signatures. La réforme de l’instruction, une de ses priorités tout au long de sa carrière, acquit une importance prépondérante dans la Liberté. « Il faut éclairer les masses, écrivait-il, les tenir au courant du progrès et les outiller pour la concurrence. »
Langlois continua de travailler à la Patrie jusqu’en décembre 1893, puis accepta le poste de rédacteur en chef adjoint au Monde de Montréal. Un groupe d’hommes d’affaires avaient acheté ce quotidien de tradition ultramontaine en vue d’en modifier l’orientation. Sous cette nouvelle administration, les commentaires éditoriaux se firent rares et modérés, ce qui ne correspondait guère au style de Langlois, mais l’expérience administrative qu’il acquit au Monde lui fut utile.
La Liberté parut pour la dernière fois le 24 octobre 1895. Le lendemain, Beaugrand annonça la nomination de Langlois au poste de directeur de la rédaction à la Patrie. Félix-Gabriel Marchand*, chef de l’opposition libérale à Québec, accueillit la nouvelle avec colère. Le chef des libéraux fédéraux, Wilfrid Laurier*, d’autant plus inquiet de la montée du radicalisme que les élections approchaient, exprima lui aussi un vif mécontentement. Toutefois, Beaugrand tint bon et Langlois resta en poste.
Langlois trouva aussi dans la franc-maçonnerie un terreau fertile pour son libéralisme avancé. Il fut admis à la Cœurs Unis Lodge No. 45 à Montréal en décembre 1895. À l’époque, dans la province de Québec, la franc-maçonnerie était dominée par la Grand Lodge of Canada et la Grand Lodge of Quebec, toutes deux affiliées à la franc-maçonnerie britannique. La loge des Cœurs Unis était un chapitre de l’organisation provinciale. Le 12 avril 1896, elle se réunit en vue de demander à s’affilier au Grand Orient de France. Langlois s’inscrivit au comité qui réclamait une nouvelle constitution et proposa que la nouvelle loge s’appelle « L’Émancipation », ce qui fut accepté immédiatement.
Bien que la loge ait suscité beaucoup d’enthousiasme dans sa première année, ses membres, peu nombreux, ne se réunirent que sporadiquement après 1899. Langlois en demeura cependant un membre actif et accéda à la présidence en 1901. Un rapport d’inspection soumis au Grand Orient au début de 1903 signalait en particulier son « énergie » et sa « conviction profonde ». En public, on l’accusait souvent d’être franc-maçon ; il ne nia jamais ce fait et se moqua fréquemment de ces accusations. Mais, tout franc-maçon qu’il ait été, il se maria selon le rite catholique et fit baptiser son enfant dans la même religion.
Le 4 février 1897, Joseph-Israël Tarte* avait acheté la Patrie à Beaugrand. Quatre jours plus tard, Langlois y signait son premier article en qualité de rédacteur en chef. Enhardi par sa promotion, il s’inscrivit à l’assemblée de mise en candidature des libéraux dans Deux-Montagnes. Les leaders libéraux de cette circonscription provinciale le soutenaient, mais Marchand intervint et prit position contre lui. Environ deux mois après lui avoir confié le poste de rédacteur en chef à la Patrie, Tarte lui demanda de céder la place à l’étoile montante des libéraux, Henri Bourassa*. Les opinions du nouveau rédacteur en chef étaient fort différentes de celles de Langlois, mais les partisans de celui-ci se regroupèrent et Bourassa dut partir au bout de quelques jours. Manifestement, Langlois avait assez d’envergure pour être l’un des principaux porte-parole de l’aile progressiste, officieuse, du Parti libéral.
Un des collègues de Langlois, Charles Robillard, a laissé ce témoignage à son sujet : « D’une grande simplicité, accueillant, aimable et obligeant, ami de la blague qui ignore les propos licencieux, il savait donner une tournure gaie à nos entretiens familiers. Certes, il ne manquait ni de finesse, ni d’humour. Son rire franc et ouvert nous mettait à l’aise […] Les confrères oubliaient vite, da[n]s l’intimité, l’intransigeance de ses principes pour ne voir devant eux que le plus humble et le plus charmant des hommes. » D’une taille à peine supérieure à cinq pieds, Langlois fut toujours un peu corpulent. Il avait les yeux bleu clair et arborait un pince-nez depuis le début de la vingtaine. Dès qu’il l’avait pu, il s’était laissé pousser la moustache.
En novembre 1901, Langlois exposa la nécessité de créer un organisme qui prônerait une réforme de l’instruction. La Ligue de l’enseignement vit le jour à Montréal le 9 octobre 1902. Son nom évoquait délibérément celui de la Ligue française de l’enseignement et ses membres venaient surtout de l’aile progressiste du Parti libéral. Langlois en fut nommé vice-président et secrétaire. Le programme qu’il soumit, et qui fut approuvé le 21 novembre 1902, préconisait une hausse des salaires des enseignants et l’amélioration de leur qualification, l’augmentation des subventions gouvernementales, l’application des lois en vigueur sur l’instruction, la construction d’écoles « sanitaires » et la centralisation de l’administration du réseau scolaire catholique.
En janvier 1903, Tarte rompit les liens entre la Patrie et le Parti libéral. Laurier prévoyait depuis longtemps la perte de ce quotidien et, après que Tarte avait quitté le cabinet, en octobre 1902, il avait confié à un comité le mandat d’étudier la possibilité de lancer un nouveau journal. Le sénateur Frédéric-Ligori Béïque* offrit le capital nécessaire. Après bien des délibérations, Laurier rencontra Langlois afin de discuter du ton et de l’orientation du futur périodique. Beaucoup de membres du parti s’opposaient à la nomination de Langlois, mais, une fois que ce dernier l’eut assuré de la loyauté du journal, Laurier donna son aval au lancement d’un quotidien du matin qui s’intitulerait le Canada.
Le journal commença de paraître en avril 1903. Sans tarder, Langlois le voua à la réforme scolaire et municipale, et se mit à dénoncer les privilèges de la Montreal Light, Heat and Power Company [V. Louis-Joseph Forget*]. À l’automne de 1904, pendant la campagne électorale, il porta au sein même du Parti libéral provincial sa croisade en faveur d’un bon gouvernement. Le Canada remplit son devoir en manifestant, dans son éditorial du 7 novembre, son appui au premier ministre Simon-Napoléon Parent*, mais, le soir même, Langlois mobilisa ses partisans contre le gouvernement. Les libéraux de la division no 3 à Montréal se réunirent en vue de réaffirmer la candidature du député sortant, Henri-Benjamin Rainville, bête noire de tous les progressistes libéraux. À la fin de l’assemblée, les participants étaient dans une impasse ; réunis de nouveau le lendemain soir, ils choisirent Langlois comme candidat. « Je me présente comme le champion des droits populaires, contre les trusts qui nous écrasent et nous pressurent », dit-il, tout en promettant de s’intéresser particulièrement à la colonisation et à l’instruction publique.
Langlois mena une campagne telle que le gouvernement Parent en fut ébranlé jusqu’à la base. Il remporta la victoire contre Rainville, qui s’était présenté comme libéral indépendant. Le Parti libéral était en déroute. En février 1905, Langlois soutint les trois ministres qui démissionnèrent pour protester contre l’autoritarisme de Parent – Lomer Gouin, William Alexander Weir et Adélard Turgeon – et qui, ce faisant, précipitèrent le départ du premier ministre Parent le mois suivant.
Langlois assuma son rôle de parlementaire avec beaucoup d’enthousiasme. Il pressa le nouveau gouvernement libéral, dirigé par Gouin, de mettre en œuvre des réformes dans le domaine de l’éducation et des affaires montréalaises. Il détiendrait son siège (rebaptisé Montréal en Saint-Louis en 1912) jusqu’en 1914. Au fil des ans, certaines de ses propositions seraient appliquées : la création d’une commission des services publics, l’ajout d’un bureau de contrôle à la structure administrative de Montréal (comme il le suggéra, un référendum eut lieu sur la question) et la nomination d’une commission royale d’enquête sur l’administration de Montréal [V. Lawrence John Cannon].
Les revendications de Langlois en matière d’instruction étaient vastes et donnèrent lieu, à l’Assemblée, à des débats houleux entre Bourassa et lui. Il réclamait en particulier l’unification des commissions scolaires catholiques de l’île de Montréal, l’élection des commissaires d’école et la formation d’une commission royale d’enquête sur l’éducation. En juillet 1909, Gouin ordonna la création d’une commission royale concernant les écoles catholiques de Montréal et en confia la présidence à Raoul Dandurand*.
En même temps, dans le Canada, Langlois s’orientait résolument vers la gauche. Francophile convaincu, il cherchait en France l’inspiration nécessaire pour repenser le libéralisme canadien. À l’époque, le libéralisme français était gagné par le « solidarisme », doctrine où se mêlaient des croyances dans le capitalisme et dans une forme limitée d’État-providence et où la réforme de l’instruction occupait une place de choix. La pensée de Langlois ressemblait beaucoup à cette idéologie. « Les sentiers battus lui répugnaient, a écrit Robillard. Il s’aventura dans des voies nouvelles, audacieuses, au risque d’effrayer des groupes importants du parti qu’il voulait servir. »
Les critiques inlassables de Langlois contre le système d’éducation de la province, dominé par l’Église, irritaient l’archevêque Paul Bruchési*, qui ne manquait pas de le faire savoir à Laurier. Les hautes instances du Parti libéral étaient de plus en plus exaspérées de voir Langlois semer la discorde sur la scène provinciale et municipale. En 1909, Béïque, amer, dit à Laurier : « [Le Canada] a cessé d’être l’organe du parti à Ottawa et à Québec ; il est devenu davantage de jour en jour l’organe de Langlois. » Laurier acquiesça mais confia à Béïque « une certaine hésitation à rompre avec le groupe radical [du] parti ».
Finalement, une entente survint la veille de Noël 1909. Une semaine plus tard, Langlois fut démis de ses fonctions de rédacteur en chef du Canada. Nommé secrétaire de la Commission mixte internationale [V. sir George Christie Gibbons*], il n’assuma jamais officiellement ce poste et choisit plutôt de fonder un nouvel hebdomadaire pour promouvoir la réforme scolaire et municipale. Au moment même où Bourassa lançait le Devoir, à la mi-janvier 1910, le Pays de Langlois, ainsi nommé en l’honneur de l’ancien journal rouge, arrivait dans les kiosques.
Langlois éprouvait une profonde déception à l’endroit de la direction du Parti libéral et en était venu à la conclusion que l’action radicale s’imposait. Les mesures temporaires et les réformes partielles ne faisaient que menacer l’avènement de changements réels. Poussé dans ses derniers retranchements, Langlois avait fondé le Pays pour réaffirmer des principes qui, aux yeux de la majorité, n’avaient aucune chance de l’emporter. Il continua d’y exprimer des idées inspirées du progressisme libéral, comme il l’avait fait dans le Canada, mais défendit aussi des positions nouvelles. Ainsi, il épousa la cause du mouvement ouvrier comme jamais auparavant, réclama un débat libre sur le socialisme, rejeta l’autorité de l’Église et dénonça le nationalisme comme une construction artificielle, produite par des réactionnaires. Ouvert à l’idée que le libéralisme avait beaucoup à apprendre de certaines autres idéologies, il s’appliquait à étudier les solutions de rechange tout en invitant ses lecteurs à en faire autant. Ses conclusions étaient, en fin de compte, prévisibles : pour survivre, le libéralisme devait être radical.
Le 29 septembre 1913, Mgr Bruchési interdit officiellement aux catholiques de lire le Pays. La réplique du journal, « Toujours debout », résumait la pensée de Langlois et parut ensuite sous forme d’opuscule en français et en anglais. Langlois y attaquait l’hégémonie de la pensée clérico-nationaliste et, se moquant des paroles de Bruchési, il continua à publier le Pays.
La tension régnait entre Gouin et Langlois, car Gouin cherchait le moyen d’éloigner ce radical invétéré. Finalement, la solution se présenta quand le gouvernement de la province de Québec décida d’ouvrir un bureau à Bruxelles pour encourager le commerce avec les pays francophones et que Langlois se déclara intéressé à représenter la province. La nomination de Langlois au poste d’agent général de la province de Québec à Bruxelles fut confirmée le 14 mai 1914 ; son salaire annuel serait de 6 000 $. Il quitta le Pays et démissionna de son siège à l’Assemblée législative. Le 22 juin, le Club canadien tint un banquet en son honneur. Peu après, il quitta Montréal avec sa famille.
Comme l’Europe glissait vers la guerre, Langlois s’entendit avec le gouvernement de Québec pour habiter quelque temps à Paris. Ses relations avec les autorités gouvernementales furent réduites au strict minimum au moins jusqu’en 1917. En novembre de cette année-là, Laurier, mettant de côté leurs vieilles querelles, demanda à Langlois de représenter l’opposition à titre de surveillant des élections canadiennes outre-mer. Langlois accepta. Il assuma officiellement ses fonctions à l’agence de Bruxelles en 1919 et ne revint au Canada qu’en 1921 pour un court séjour.
Tombé malade à la fin de 1927, Langlois succomba à une cirrhose du foie un peu plus de trois mois après, à Bruxelles. Un an plus tôt, il avait révisé son testament et réaffirmé sa renonciation au catholicisme en demandant d’être incinéré. Son vœu ne se réalisa pas. Sa dépouille fut rapportée au Canada et inhumée au cimetière de Sainte-Scholastique après des funérailles tenues en l’église de cette localité.
Godfroy Langlois fut l’un des journalistes les plus importants de sa génération et l’un des penseurs les plus progressistes du Parti libéral au Québec. Il prôna l’avènement d’une démocratie ouverte aux idées nouvelles et travailla dans ce but. Sa campagne pour la réforme de l’administration municipale et de l’éducation et sa lutte contre les trusts hydroélectriques le plaçaient à l’avant-garde d’un groupe peu nombreux mais influent de militants qui avaient la conviction que seule l’intervention vigoureuse de l’État dans les secteurs clés garantirait l’avenir de la province de Québec.
Godfroy Langlois a écrit quelques brochures sur des questions qui l’intéressaient, notamment : la République de 1848 (Montréal, 1897) ; Sus au Sénat ([Montréal], 1898) ; l’Uniformité des livres : deux discours [...] ([Québec ?, 1908 ?]) ; et Toujours debout : le mandement de Mgr Bruchési et la réponse du Pays (Montréal, 1913), traduit sous le titre de Still on deck : the answer of Le Pays to Archbishop Bruchesi’s mandement (Montréal, 1913). La biographie de Langlois repose sur notre étude, Devil’s advocate : Godfroy Langlois and the politics of Liberal progressivism in Laurier’s Quebec (Montréal et Toronto, 1994), traduite sous le titre de l’Avocat du diable : Godfroy Langlois et la politique du libéralisme progressiste à l’époque de Laurier, Madeleine Hébert, trad. (Montréal, 1995). [p. a. d.]
ANQ-M, CE606-S22, 30 déc. 1866.— Charles Robillard, « Réminiscences d’un vieux journaliste ; Galerie nationale : Godfroy Langlois », la Patrie (Montréal), 10 janv. 1943.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Patrice A. Dutil, « LANGLOIS, GODFROY (baptisé Joseph-Ernest-Godefroi) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/langlois_godfroy_15F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/langlois_godfroy_15F.html |
| Auteur de l'article: | Patrice A. Dutil |
| Titre de l'article: | LANGLOIS, GODFROY (baptisé Joseph-Ernest-Godefroi) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2005 |
| Année de la révision: | 2005 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |