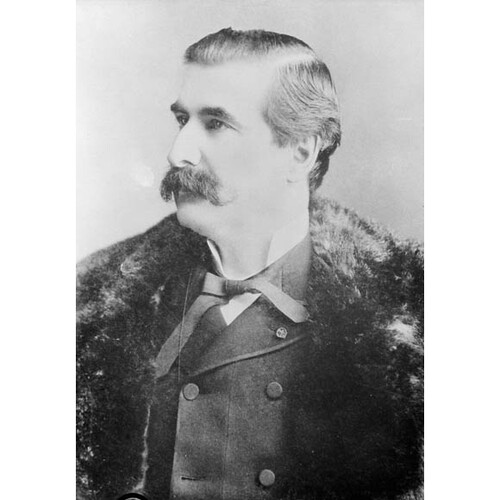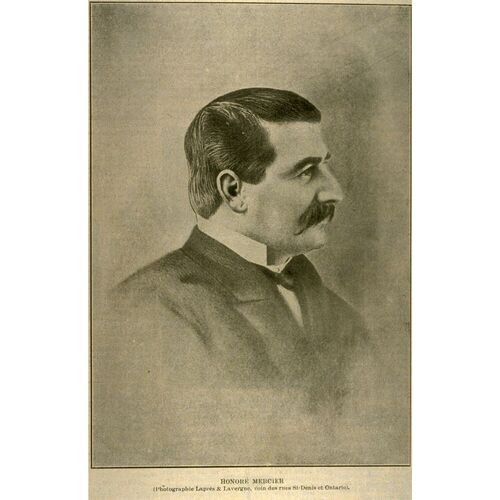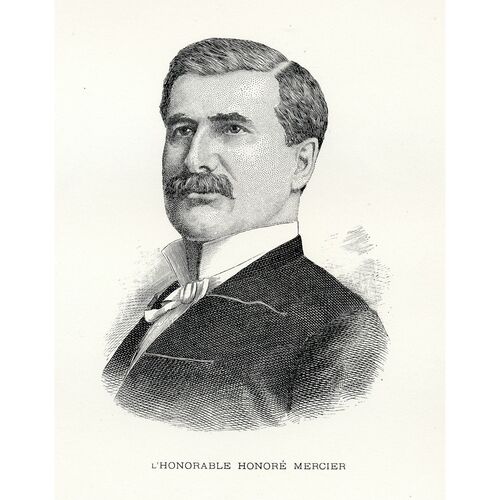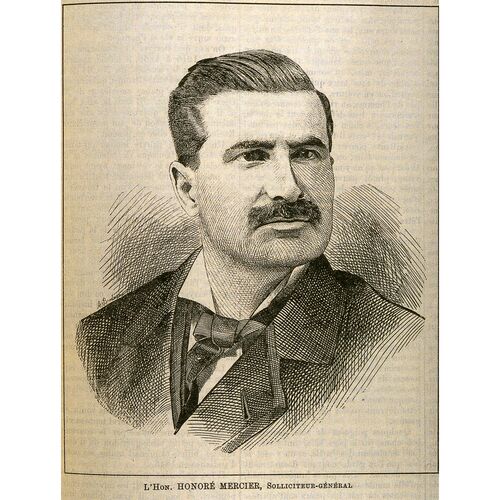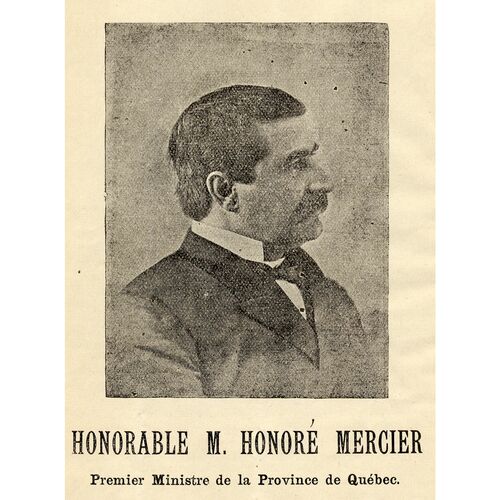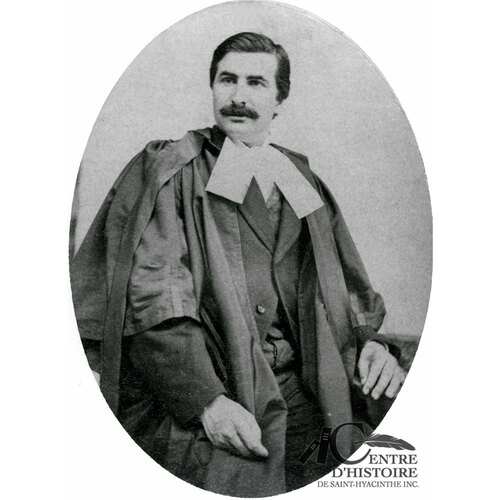MERCIER, HONORÉ, journaliste, avocat et homme politique, né le 15 octobre 1840 à Saint-Athanase (Iberville, Québec), fils de Jean-Baptiste Mercier, cultivateur, et de Marie-Catherine Timineur (Kemeneur) ; le 29 mai 1866, il épousa à Saint-Hyacinthe, Bas-Canada, Léopoldine Boivin puis le 9 mai 1871, au même endroit, Virginie Saint-Denis ; décédé le 30 octobre 1894 à Montréal.
Honoré Mercier descend d’une famille percheronne originaire de Tourouvre dont l’ancêtre, Julien Mercier, s’établit à Québec en 1647. De père en fils, les Mercier ont cultivé la terre. Jean-Baptiste Mercier, papineauiste inconditionnel, a été emprisonné pour avoir aidé deux patriotes à s’enfuir aux États-Unis. Les ans n’ont pas calmé son ardeur patriotique. Sa maison est un foyer libéral que fréquentent des « rouges » de toutes les teintes. Le jeune Honoré est élevé dans la mystique des événements de 1837–1838.
Le 23 septembre 1854, Mercier est inscrit au collège Sainte-Marie, à Montréal, où l’on dispense le cours d’études encore en vigueur dans les collèges jésuites européens. Tantôt externe, tantôt pensionnaire, Mercier travaille avec régularité et se maintient dans le peloton de tête des bons étudiants. On l’admet en mai 1857 dans la Congrégation de la Très Sainte Vierge et, l’année suivante, on le désigne « conservateur des jeux ». II révèle d’étonnantes qualités d’organisateur qui lui valent, à l’automne de 1860, d’être le commandant d’un corps d’une trentaine de miliciens. Un camarade a dépeint sa physionomie dans le journal du collège : « une figure pâle », « des yeux gris perçants », « une démarche gracieuse » et des « manières engageantes ». Au dire de ses intimes, il rassemble par son verbe et sa rectitude morale ; il s’impose par sa logique, son énergie, sa vivacité d’esprit ; il réussit par son inclination naturelle à faire confiance à des amis sûrs. Le père Jean-Baptiste-Adolphe Larcher, son professeur de latin puis de rhétorique, avec qui il se lie d’une profonde amitié, s’efforce de mettre en valeur ses dons d’orateur dans l’Académie française du collège. Il lui inculque un attachement profond à l’Église, à la France et au Bas-Canada, cette province mère protectrice de tous les Canadiens français disséminés en Amérique du Nord. L’honneur, l’union, la loyauté sont des thèmes récurrents dans les discours du jeune orateur.
À l’été de 1861, Mercier tient son journal et s’interroge sur le choix d’une carrière. La vie lui semble une vallée « dont les douleurs [...] remplissent presque tout le cours ». Il compte sur Dieu pour le guider dans son choix qui consistera « à s’attacher à une des nécessités de la vie, travailler au bien de la patrie dans tel et tel état de vie, aider ses compatriotes dans tel ou tel emploi ». Il examine quatre professions : artiste, avocat, militaire, prêtre ; il semble plus attiré par le droit mais n’arrive pas à arrêter son choix. De retour au collège en septembre, il vit dans un état de tension nerveuse où les moments d’hyperactivité alternent avec les périodes d’affaissement. Ses maîtres jugent qu’il souffre de surmenage. Il s’alite le 15 décembre, va se reposer un temps dans sa famille, puis quitte définitivement le collège le 10 février 1862. Il porte en lui une foi profonde et des rêves de grandeur au service des autres. Il a acquis de bonnes habitudes de travail et pris en horreur la médiocrité. Il voue à la Compagnie de Jésus, et au père Larcher en particulier, un attachement filial.
À l’âge de 21 ans, Mercier entreprend un stage en droit dans le bureau de Maurice Laframboise* et d’Augustin-Cyrille Papineau, à Saint-Hyacinthe, petite ville de province où les prêtres du séminaire et le seigneur Louis-Antoine Dessaulles polarisent la vie intellectuelle et politique. Il prend pension avec deux étudiants : Louis Tellier et Paul de Cazes. Il se lie d’amitié avec un intellectuel nationaliste influent auprès de la jeunesse, l’abbé François Tétreau. Ses patrons l’introduisent dans les cercles libéraux. Il s’éprend aussi d’amour pour Léopoldine Boivin, dont le tuteur pose une condition pour qu’elle convole en justes noces : l’assurance d’un emploi stable pour Mercier. Pressé d’arriver, happé par l’effervescence politique qui agite les élites locales, dévoré d’ambition, Mercier néglige ses études et accepte en juillet 1862 de succéder à Raphaël-Ernest Fontaine à la rédaction du Courrier de Saint-Hyacinthe, journal de tendance libérale-conservatrice. Mercier, qui ne rate aucun débat, fait montre d’une grande indépendance d’esprit. À l’occasion de la discussion du projet de loi sur la milice, la même année, il subordonne le maintien du lien colonial à l’aide que la Grande-Bretagne voudra bien consentir dans la défense militaire du pays. Il dénonce le principe de la représentation proportionnelle à la population (« Rep. by Pop. »), qui « entraînerait la mort sociale du peuple canadien-français ». Il préconise un crédit agricole pour enrayer le mouvement migratoire vers les États-Unis. Dans la foulée du député de Saint-Hyacinthe, Louis-Victor Sicotte*, il s’efforce de concilier sentiment national et idées libérales. En mai 1863, le premier ministre de la province du Canada John Sandfield Macdonald* délaisse le principe de la double majorité comme système de gouvernement, abandonne Sicotte et choisit Antoine-Aimé Dorion comme bras droit. Mercier refuse son appui aux rouges qu’il estime trop anticléricaux et pas assez nationaux, mais il promet d’évaluer le nouveau ministère à ses actes. En juin et en juillet, les électeurs reconduisent au pouvoir le ministère de Macdonald et de Dorion, donc George Brown* et les tenants de la « Rep. by Pop. ». Mercier en tire un constat : l’esprit de parti qui divise les Canadiens français fait le jeu des Canadiens anglais. Il en déduit une stratégie qui vise à regrouper libéraux et conservateurs dans une formation patriotique qui, par-delà « les ressentiments du passé et les jalousies du présent », fera front commun contre les rouges alliés aux grits. Le Journal de Québec reproduit et endosse la thèse de Mercier et celui-ci s’efforce de la populariser. Il pourfend les rouges dans le Courrier ; il affronte sur les tribunes électorales Maurice Laframboise qui brigue les suffrages durant l’été dans une élection partielle ; dans des conférences publiques, il oppose les thèses chrétiennes traditionnelles au darwinisme philosophique de Louis-Antoine Dessaulles ; enfin, il blâme son ancien chef Sicotte de délaisser l’arène politique pour une niche douillette à la Cour supérieure. À l’automne, il fait campagne pour Rémi Raymond, frère de Joseph-Sabin*, le grand vicaire du diocèse, et candidat du séminaire de Saint-Hyacinthe, contre Augustin-Cyrille Papineau, un disciple de Dorion.
Au moment où s’enclenche le débat sur la Confédération canadienne en 1864, Mercier est une vedette locale, mais il n’a aucune situation stable. Afin d’assurer son avenir et de mériter la main de Léopoldine, il se rend à Montréal, au printemps, poursuivre des études en droit qu’il compte financer par une collaboration irrégulière au Courrier. Sommé par les propriétaires de ce journal d’appuyer le projet confédératif que lui-même considère comme une machine à broyer les Canadiens français, il quitte le Courrier le 4 mai. Commencent alors des jours difficiles. Mercier travaille comme un forcené, s’ennuie de sa fiancée et vit d’expédients, tout spécialement de petits emprunts contractés à droite et à gauche. Il suit au collège Sainte-Marie le cours de droit de François-Maximilien Bibaud* et accepte, à l’occasion, de prononcer un discours contre le projet d’une confédération canadienne. Le 3 avril 1865, il est enfin reçu avocat.
Mercier s’installe à Saint-Hyacinthe. Il y retrouve sa fiancée, l’abbé Tétreau, ses amis Pierre Boucher* de La Bruère, Paul de Cazes et Michel-Esdras Bernier. Et la vie reprend comme autrefois, toujours aussi trépidante. Mercier mène de front ses amours, le droit, les luttes politiques et les joutes intellectuelles. À l’instar de l’épiscopat, il se rallie à la Confédération. Il préside l’Union catholique de Saint-Hyacinthe, cercle d’études doté d’une bibliothèque et d’une salle de lecture, où jeunes et vieux s’affrontent dans des débats publics. L’Union catholique est un calque de l’Institut canadien – sauf qu’elle a un aumônier, l’abbé Tétreau. En février 1866, Mercier et ses trois amis entrent au Courrier de Saint-Hyacinthe qui appuie le tandem George-Étienne Cartier*–John Alexander Macdonald. Cependant, le désir de Cartier de recourir à l’arbitrage impérial pour régler le différend qui oppose les Maritimes et le Canada amène Mercier à laisser le journal le 23 mai. À ses yeux, le recours à Londres perpétue un état colonial désuet et constitue un précédent dangereux pour l’autonomie des futures provinces.
Décidément, le joug des partis pèse à Mercier. Il a plus de succès comme avocat, car il passe pour le meilleur criminaliste de la région. Cette notoriété, et sans doute les écus sonnants qui l’accompagnent, fléchit le tuteur de Léopoldine. Le 29 mai 1866, Mercier se marie dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Un premier enfant, Élisa, naît en 1867. Bonheur familial de courte durée : Léopoldine, dont la santé a toujours été fragile, meurt le 16 septembre 1869. Mercier se réfugie alors dans le travail et s’active dans la vie publique. Il est de ceux qui donnent des conférences et des concerts au profit des blessés français et chantent la Marseillaise dans la rue à l’annonce de la victoire de la Prusse sur la France. Il trouve un certain réconfort dans le foyer de son ami de Cazes. Il y rencontre Virginie Saint-Denis, de 13 ans sa cadette, la belle-sœur de son ami. Une idylle se noue, et Mercier convole en secondes noces le 9 mai 1871. Il a graduellement retrouvé sa stabilité affective, sa joie de vivre et son goût pour une grande aventure politique.
À la fin de 1871, l’occasion se présente sous la forme du parti national que Louis-Amable Jetté* et Frédéric-Ligori Béique* sont en voie de mettre sur pied. En principe, le parti doit rassembler des conservateurs et des libéraux désireux de « placer l’intérêt national » au-dessus de celui du parti. C’est là une idée chère à Mercier qui collabore activement à l’élaboration du programme, accepte le poste de secrétaire et se fait élire, le 28 août 1872, dans Rouville, grâce à l’appui du curé de Saint-Césaire. Un Mercier tout feu tout flammes s’installe à Ottawa, peut-être trop peu conscient que le parti national, qui n’a recruté qu’un petit nombre de conservateurs, ne dispose d’aucune organisation et siège parmi les libéraux sous le leadership d’Alexander Mackenzie et d’Antoine-Aimé Dorion, n’est au fond qu’une doublure électorale du parti libéral. Cette année-là, la motion présentée par John Costigan* qui réclame la non-reconnaissance de la loi scolaire votée au Nouveau-Brunswick en 1871 et la mise sur pied d’écoles catholiques financées par des fonds publics lui fournit l’occasion de prononcer son premier discours. C’est un plaidoyer pour la suprématie des droits des minorités sur les majorités parlementaires éphémères, un avertissement à la majorité protestante qu’elle pourrait bien un jour être minoritaire, une mercuriale contre la mollesse d’Hector-Louis Langevin* et un appel à l’union sacrée des Canadiens français et des catholiques. Ce fier discours, émaillé d’une allusion à l’indépendance du Canada, déplaît tout autant au premier ministre sir John Alexander Macdonald qu’aux leaders de l’opposition. Le premier se tire d’embarras en convainquant Mgr John Sweeney*, l’évêque catholique de Saint-Jean, que la question des écoles devrait être refilée au Conseil privé ; les seconds avertissent Mercier de s’en tenir à la pensée du parti et d’en respecter la discipline. Mercier prend l’avertissement de haut. Quand le gouvernement Macdonald trébuche sur le scandale du Pacifique [V. sir John Alexander Macdonald ; sir Hugh Allan*], Mackenzie forme un cabinet qui n’inclut aucun membre du parti national et, au moment des élections de 1874, les éminences du parti libéral font savoir à Mercier qu’il est persona non grata au sein de leur parti. Mercier n’insiste pas et ne brigue pas les suffrages.
Déçu et conscient qu’il n’y a guère de place en politique pour les esprits indépendants, Mercier se réfugie dans la pratique du droit et concentre son affection sur sa famille. Des enfants naissent : Iberville né en 1872 ne survit pas, Héva naît le 7 juin 1873 et Honoré le 20 mars 1875. Mercier s’intéresse aussi au développement de Saint-Hyacinthe. En 1872, il investit dans une manufacture de rubans et de galons et, deux ans plus tard, il participe à la fondation de la Compagnie d’aqueduc de Saint-Hyacinthe. Toutefois, Mercier ne peut oublier la politique et il attend son heure. Le départ de Dorion qui accepte en 1874 un poste de juge, l’évolution du parti libéral vers des positions plus conciliantes envers l’Église l’amènent à effectuer un retour à la politique au sein du parti libéral. Mais il doit, comme un jeune débutant, gagner ses épaulettes et faire montre de souplesse. En avril 1876, il amorce son retour par une conférence devant les membres du Club national, fondé en 1875 par Maurice Laframboise pour faire contrepoids au Club Cartier où brille Joseph-Adolphe Chapleau. Puis il met son verbe au service du parti. Il soutient la candidature de Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, avocat de la veuve de Joseph Guibord*, dans l’élection partielle de Jacques-Cartier le 28 novembre 1876, celle de Wilfrid Laurier* dans Drummond et Arthabaska, puis dans Québec-Est en 1877, et la cause du parti pendant les élections générales du 1er mai 1878, à la suite du renvoi d’office du gouvernement de Charles-Eugène Boucher* de Boucherville par le lieutenant-gouverneur Luc Letellier* de Saint-Just. Au soir des élections, conservateurs et libéraux se retrouvent nez à nez. La majorité parlementaire du gouvernement que s’apprête à former le chef libéral, Henri-Gustave Joly*, tiendra à quelques voix, sinon à celle d’Henri-René-Arthur Turcotte*, député indépendant de Trois-Rivières. Mercier estime qu’il a droit à la reconnaissance du parti et, sans doute pistonné par Laurier et Laflamme, il se présente dans Saint-Hyacinthe aux élections générales fédérales du 17 septembre 1878. Battu de justesse, il a droit au charivari d’usage et à la suspension d’un crêpe au-dessus de sa porte. Ses adversaires du Courrier croient avoir eu sa peau. C’est oublier le destin !
Pierre Bachand*, député de Saint-Hyacinthe, trésorier dans le gouvernement Joly et clé de voûte du cabinet, meurt subitement le 3 novembre 1878. Le premier ministre est en quête d’un homme fort, d’un tribun capable de tenir tête en chambre et sur les estrades électorales à Chapleau, l’étoile montante du parti conservateur et l’un des grands orateurs de sa génération. Chapleau, souvent emphatique, est un rhéteur aux amples périodes bien cadencées. Quant à Mercier, plus proche des petites gens, plus sensible aux frustrations nationales, c’est un logicien qui enchaîne son argumentation en de courtes phrases lestées de chiffres et de faits. Le premier cherche à plaire et le second, à convaincre. Le choix de Mercier s’impose à Joly. Le 1er mai 1879, Mercier est nommé solliciteur général dans le gouvernement Joly. Le mois suivant, appuyé par tous les ténors du parti, il est élu dans Saint-Hyacinthe.
Mercier siège dans une chambre en pleine crise. En toile de fond : le coup d’État du lieutenant-gouverneur Letellier de Saint-Just qui a porté inopinément les libéraux au pouvoir. Les conservateurs, qui dominent le Conseil législatif, cherchent leur revanche. Ils procèdent en trois temps. Le premier ministre Macdonald, reporté au pouvoir en 1878, destitue Letellier de Saint-Just et le remplace, le 26 juillet 1879, par un conservateur de vieille souche, Théodore Robitaille. En août, le Conseil législatif paralyse le gouvernement en refusant de voter le budget. Pendant que les libéraux orchestrent une campagne populaire contre le conseil, Chapleau négocie en coulisses la défection des libéraux mécontents ou ambitieux, afin de former un gouvernement fort. Chapleau en gagne cinq à sa cause et, du coup, Joly perd sa majorité parlementaire. Le lieutenant-gouverneur appelle Chapleau à former un gouvernement ; Mercier n’est plus que simple député et reprend à Saint-Hyacinthe la pratique du droit en société avec Odilon Desmarais.
À peine la crise suscitée par le coup d’État est-elle résorbée, qu’une autre, de plus vaste amplitude, fait surface. Conservateurs et libéraux sont débordés, les premiers sur leur droite et les seconds, sur leur gauche. Chapleau n’arrive pas à brider l’aile ultramontaine qui demande la tête de ses amis et conseillers Louis-Adélard Senécal* et Clément-Arthur Dansereau*. Chez les libéraux, Joly voit avec inquiétude Honoré Beaugrand* et le sénateur Joseph-Rosaire Thibaudeau lancer à Montréal en 1879 le journal la Patrie, nouveau foyer de rougisme. De fait, ultramontains et radicaux veulent tenir leur parti respectif en tutelle. Les centristes des deux partis, pour échapper à la domination des extrêmes, songent à une coalition. Ne sont-ils pas d’accord sur les questions fondamentales : le maintien des arrangements socio-politiques avec l’Église, la réforme de la loi électorale, l’ouverture du système scolaire à l’enseignement technique et professionnel, la réorganisation de la fonction publique ? Seules les séparent les questions de personnalité, les antipathies individuelles, la discipline des partis. En février 1880, Chapleau prend l’initiative par personne interposée de sonder Mercier, l’étoile montante du parti libéral. Mercier pose comme conditions l’abolition du Conseil législatif et une équitable répartition des portefeuilles ministériels. Une fuite provoque l’ire des radicaux et des ultramontains, ce qui met fin aux négociations. Chapleau se concentre sur l’administration de la province et, par un emprunt sur le marché français et la constitution en société du Crédit foncier franco-canadien en 1880, il consolide son emprise dans l’opinion publique. Mercier poursuit ses rêves de coalition. En passe de supplanter Joly en popularité au sein du parti et de l’opinion publique, il prépare l’avenir. Par deux fois, au printemps de 1881, à l’occasion d’une convention libérale puis au cours d’un banquet offert à Edward Blake*, il répudie « toutes les doctrines impies, révolutionnaires ou socialistes, qui bouleversent le monde ». Il ajoute : « Nos ennemis [...] nous ont prêté des principes que nous ne professons pas, et ils nous ont reproché des idées que nous n’avons jamais émises. » Et Mercier et Chapleau de poursuivre en secret, sous l’œil bienveillant du curé François-Xavier-Antoine Labelle, des négociations que de nouvelles indiscrétions font achopper. De guerre lasse, sur l’avis de Macdonald, lui-même peu porté vers les coalitions, Chapleau change sa stratégie. Au faîte de sa popularité, il déclenche des élections générales à l’automne de 1881, au cours desquelles il balaie les libéraux, puis règle l’épineux problème du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental à la satisfaction de son ami Senécal, et met enfin toute son influence au service de Macdonald aux élections du 20 juin 1882. En juillet, il abat ses cartes : Joseph-Alfred Mousseau*, secrétaire d’État dans le gouvernement Macdonald, devient premier ministre de la province et lui-même s’en va occuper le poste de Mousseau à Ottawa, dans l’espoir d’y supplanter Langevin, d’administrer la province de Québec par personne interposée et de faire rentrer les ultramontains dans le rang. Ces grandes manœuvres décontenancent les libéraux. Au début de 1881, Mercier a installé sa famille à Montréal et s’est associé avec les avocats Cléophas Beausoleil* et Paul Martineau, bien résolu à laisser son siège de député aux prochaines élections et à ne vivre que de la basoche.
Mais les événements échappent encore à l’emprise des hommes. Les ultramontains ne sont pas dupes des manigances de Chapleau et ils continuent leur opposition à Mousseau. Amis et électeurs convainquent Mercier de rester dans la lutte. Le voilà à nouveau en négociation, avec Mousseau cette fois, à nouveau mis en échec par les extrêmes des deux partis. Blessé par ces tractations qui s’effectuent à son insu, un peu désabusé et sans doute fatigué, Joly remet sa démission comme chef du parti et désigne le 18 janvier 1883 son successeur : Honoré Mercier. Dès l’ouverture de la session, celui-ci annonce ses couleurs sur deux questions fondamentales, de façon à rassurer et l’Église et le peuple. Dans le domaine de l’éducation, le parti libéral entend « assurer [aux] enfants une instruction pratique et chrétienne [...] Et pour obtenir ce résultat, précise-t-il, ne craignons pas d’accepter avec déférence, mais sans abdication de nos droits, les avis sages et prudents [du] Conseil de l’Instruction publique. » Face au déficit budgétaire, il propose pour restaurer les finances publiques une hausse du subside annuel du gouvernement fédéral plutôt que la taxation directe, ce qui, à ses yeux, serait une juste compensation pour les droits d’accise et de douane que les provinces lui ont cédés au moment de l’entrée dans la Confédération. En dehors de la chambre, il mène une guerre ouverte à la Patrie. Ces gestes de bonne volonté rassurent les ultramontains, toujours refoulés hors du pouvoir par Mousseau. Mercier y voit des signes d’un temps nouveau. Son esprit pragmatique et son appétit du pouvoir l’inclinent maintenant à rechercher un terrain d’entente avec les ultramontains. En juillet 1883, il a fondé à Montréal un journal, le Temps, pour bien se démarquer des radicaux. Le même mois, à l’occasion d’un ralliement politique dans la circonscription de Saint-Laurent, il a fait avec François-Xavier-Anselme Trudel*, le leader ultramontain, le procès de l’ancien triumvirat Chapleau, Senécal, Dansereau. Ce rapprochement avec les ultramontains, tandis que les conservateurs modérés cherchent encore à s’entendre avec Mercier, risque de changer l’échiquier politique. À Ottawa, Langevin qui tire les ficelles prend les choses en main. Mousseau démissionne le 10 janvier 1884. John Jones Ross*, vieux routier en politique, ni chair, ni poisson, forme un ministère où l’ultramontain Louis-Olivier Taillon* s’avère le pivot de la combinaison. La stratégie de Mercier a tout simplement forcé les conservateurs à refaire l’unité de leur parti.
Mercier se doit maintenant de réussir le même exploit. Oliver Mowat*, premier ministre de l’Ontario, qui mène contre le gouvernement fédéral une lutte acharnée sur les prérogatives des provinces, lui suggère un thème propre à refaire l’unité de son parti. Mercier l’apprête à la sauce québécoise : la conspiration du gouvernement fédéral contre l’autonomie des provinces. Macdonald est un centralisateur ; ses ministres Chapleau et Langevin administrent le Québec par personnes interposées ; le gouvernement central prélève des revenus au Québec qu’il redistribue allègrement dans les autres provinces. La thèse du juge Thomas-Jean-Jacques Loranger* fournit à Mercier les assises juridiques pour fonder l’autonomie provinciale : la Confédération canadienne est un pacte entre les provinces qui demeurent titulaires de la véritable souveraineté. Ce thème rejoint la tradition des rouges qui avaient combattu en 1865 pour l’autonomie des provinces, que Mercier s’efforce maintenant de réhabiliter dans l’opinion publique. Le 10 décembre 1884, dans une conférence consacrée à Charles Laberge*, il affirme péremptoirement qu’« il n’y a pas d’impies ni d’athées dans les rangs du parti libéral ; il peut y avoir quelques hommes que les luttes injustes et les calomnies calculées de l’école politico-religieuse [lire : les ultramontains] ont poussés vers l’indifférence, mais ce sont de très rares exceptions ». Quelque temps plus tard, il appuie la candidature d’Honoré Beaugrand, rédacteur de la Patrie, à la mairie de Montréal. L’unité du parti libéral semble scellée.
Cette unité repose sur des bases circonstancielles. Son chef subit plus qu’il n’accepte les radicaux dont l’anticléricalisme heurte ses convictions intimes et, dans une province où l’Église exerce une grande influence sur les électeurs, lui barre la route du pouvoir. Le soulèvement des Métis au printemps de 1885 [V. Louis Riel*] vient montrer la fragilité des assises partisanes. L’opinion publique canadienne-française condamne ce soulèvement, mais les Canadiens français lui trouvent des raisons qui le rendent excusable. Riel, qui s’est aliéné la sympathie de l’épiscopat catholique par son rêve messianique, conserve par les liens du sang et de la culture celle de la masse des Canadiens français. Sa reddition en mai, son procès en juillet et sa condamnation à mort le 1er août suscitent une grande effervescence, d’autant plus que William Henry Jackson* et Thomas Scott, accusés d’attentat à la sûreté de l’État, ont été acquittés. On forme des comités, on tient des assemblées publiques, on expédie des pétitions aux ministres francophones du cabinet de Macdonald. Cette activité, dont le but est d’obtenir que le gouverneur général lord Lansdowne [Petty-Fitzmaurice*] sur l’avis du cabinet gracie Riel, ravive l’âpre lutte entre catholiques et protestants, entre Canadiens français et anglais. De crainte qu’une trop grande politisation du débat ne nuise à Riel, Mercier demeure officiellement en retrait de cette agitation politique. Confidentiellement, il supplie Chapleau de démissionner si Riel n’est pas gracié et de venir prendre la tête du mouvement favorable à ce dernier : « Je serai à tes côtés pour t’aider de mes faibles efforts et bénir ton nom avec notre frère Riel, sauvé de l’échafaud. » Plutôt que de risquer une guerre civile, Chapleau demeure à son poste. Riel est pendu le 16 novembre. Dans la province de Québec, les drapeaux sont en berne et les patriotes portent le crêpe. Spontanément, bleus et rouges fraternisent dans un mouvement politique pour abattre le gouvernement Macdonald. Le 22 novembre 1885, devant la foule massée sur le Champ-de-Mars, à Montréal, François-Xavier-Anselme Trudel clame : « le devoir national nous oblige à rompre des alliances de plus de vingt ans, à condamner des chefs sous qui nous avons été fiers de marcher ». Mercier plaide l’union de tous les vrais patriotes pour « punir les coupables » et cherche, à l’évidence, à muer ce mouvement en un parti national. Quand, à la mi-décembre, le mouvement s’affadit dans les rigueurs du froid, la désapprobation du clergé et les mises en garde du journaliste Joseph-Israël Tarte*, Mercier et Trudel continuent d’entretenir l’agitation. En janvier 1886, les conservateurs nationaux – en rupture de ban avec le parti conservateur à la suite de l’affaire Riel – fondent à Québec leur journal, la Justice. À l’Assemblée législative, Mercier évoque toujours la fraternité du sang, l’appel de la race, l’exemple des patriotes, l’obligation historique pour la province de Québec de fédérer et de protéger les minorités françaises à la grandeur de l’Amérique. En juin, il lance un manifeste-programme en prévision des prochaines élections. C’est un appel à l’union de tous les patriotes pour raffermir la position de la province de Québec au sein de la Confédération. Mercier y reprend les thèmes fondamentaux de l’idéologie élaborée par les élites rurales cléricales mais n’en demeure pas moins ouvert sur les réalités nouvelles issues du mouvement d’industrialisation et d’urbanisation. Ses principaux articles concernent : l’affirmation de l’autonomie des provinces ; la décentralisation de l’administration provinciale ; le maintien d’un système scolaire confessionnel qui, cependant, s’ouvrirait à l’enseignement technique et professionnel ; la garantie des droits des minorités ; le redressement des finances publiques ; des amendements à la législation sur les terres de la couronne dans un sens favorable aux colons ; une meilleure réglementation sur les heures de travail et une réforme du système judiciaire. Les libéraux, les conservateurs nationaux et les ultramontains, moins ceux du diocèse de Trois-Rivières, se rallient à Mercier. La campagne dure plus de trois mois. Mercier la mène tambour battant et tient une centaine d’assemblées. Libéraux et conservateurs finissent sur un pied d’égalité ; les cinq conservateurs nationaux ralliés à Mercier détiennent la balance du pouvoir. En vain, le premier ministre Ross, puis son remplaçant, Louis-Olivier Taillon, s’accrochent au pouvoir en nourrissant l’espoir de les rallier. Le 27 janvier 1887, Taillon est battu lorsqu’on choisit le président de l’Assemblée et, le 29, Mercier est assermenté premier ministre. La coalition gouvernementale comprend huit ministres, dont deux conservateurs nationaux : Pierre Garneau* et Georges Duhamel.
Mercier ouvre la session le 16 mars avec en tête deux priorités : consolider les assises du parti national qui n’est encore qu’une coalition dont les éléments disparates s’imbriquent mal les uns dans les autres, puis mettre en œuvre le programme déjà énoncé. Consolider le parti est une affaire à moyen terme. Dans l’immédiat, Mercier procède aux destitutions et nominations d’usage, poursuit des négociations en vue de renforcer sa majorité parlementaire et, se rappelant sans doute la mésaventure du parti national de 1872, confie à Ernest Pacaud* et à Cléophas Beausoleil l’organisation et le financement du parti. À moyen terme, il espère par son verbe et son charisme personnel rallier la masse des électeurs sous sa bannière, ce qui le rendrait indépendant des ultramontains, des radicaux et des conservateurs nationaux. D’où certains traits fondamentaux de son administration, caractérisée par un style de leadership personnel, autoritaire, ponctué de discours populaires, de coups d’éclat et de mises en garde contre des ennemis extérieurs pour cimenter la cohésion. Mercier a un sens inné de la publicité et il est le premier chef politique canadien à utiliser systématiquement la presse populaire en émergence pour rallier les masses. Née d’un sentiment patriotique, cette coalition vivra par l’expression de ce sentiment.
Un autre trait de l’administration de Mercier est l’élan qu’il imprime à l’appareil gouvernemental, et qui tient surtout au tempérament de l’homme, travailleur acharné et d’une rare efficacité d’exécution. Le 16 mars 1887, le discours du trône annonce un train de mesures, dont la révision entière des finances de la province et la tenue d’une conférence interprovinciale. Le premier projet de loi que soumet Mercier concerne la reconnaissance civile de la Compagnie de Jésus que George III, au lendemain du traité de Paris de 1763, avait mise sur la voie de l’extinction en lui interdisant de recruter de nouveaux sujets. À ses yeux, c’est à la fois un acte de justice, un geste de gratitude personnel et une manière de s’attacher les ultramontains montréalais qui souhaitent que les jésuites établissent une université à Montréal. Cette reconnaissance civile, qui permettrait aux jésuites d’ouvrir des maisons d’enseignement à la grandeur de la province, divise la hiérarchie catholique. Le cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau craint pour le monopole de l’université Laval. Devant le comité des bills privés, on s’entend sur un compromis : les jésuites pourront ouvrir des maisons d’éducation dans les diocèses de Montréal, d’Ottawa et de Trois-Rivières, mais ils devront obtenir l’assentiment de l’ordinaire du lieu pour s’établir ailleurs. Ce succès incite Mercier à examiner la question des biens des jésuites. En vertu du droit d’aubaine, le gouvernement avait mis la main sur les propriétés – seigneuries, lots urbains, édifices – de la Compagnie de Jésus en 1800, à la mort du dernier jésuite. En 1831, il les avait confiées à la chambre d’Assemblée pour financer l’instruction supérieure. Cependant, depuis les années 1850, les jésuites qui sont revenus au Canada en 1842 [V. Jean-Pierre Chazelle*] et qui se trouvent forts de l’appui des ultramontains réclament une indemnité à titre de propriétaires spoliés [V. Antoine-Nicolas Braun*]. Mgr Taschereau s’appuie sur le droit canonique pour revendiquer que l’on verse cette indemnité à l’Église catholique tout entière. De leur côté, les protestants affirment que la loi de 1831 leur a donné, à eux aussi, des droits sur ces biens. Mercier s’estime assez fort pour régler cette question qui empoisonne le climat politique, divise les catholiques et freine le développement urbain. Il prend sur lui de court-circuiter l’épiscopat, de négocier en coulisses directement avec les jésuites et le Vatican et de présenter un projet de loi qui prévoit une allocation de 60 000 $ aux écoles protestantes et une indemnité de 400 000 $ qu’il appartiendra au pape de redistribuer à sa guise au sein de l’Église catholique québécoise. Mercier exige que le pape ratifie l’arrangement afin d’éviter dans l’avenir toute dispute entre catholiques sur cette question. L’Acte relatif au règlement de la question des biens des jésuites sera sanctionné en juillet 1888. En janvier 1889, Léon XIII répartira l’indemnité gouvernementale de la façon suivante : 160 000 $ aux jésuites, 100 000 $ à l’université Laval, 40 000 $ à la succursale de l’université Laval à Montréal, 20 000 $ à la préfecture apostolique du Golfe-Saint-Laurent et 10 000 $ à chaque diocèse.
Que la question des biens des jésuites soit en voie de règlement plaît aux ultramontains, et la Conférence interprovinciale qui se tient à Québec du 20 au 28 octobre 1887 donne du lustre au régime. Toutes les provinces y sont représentées, à l’exception de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard qui n’ont osé déplaire à sir John Alexander Macdonald, premier ministre du Canada. Au total, 20 ministres, dont 5 premiers ministres, participent aux discussions. Oliver Mowat, premier ministre de l’Ontario, préside les délibérations. Mercier a préparé l’ordre du jour : 22 sujets qui, directement ou indirectement, concernent l’autonomie des provinces. Les délégués s’entendent sur 26 propositions. Certaines s’opposent au droit d’intervention que détient le gouvernement fédéral à l’égard des lois provinciales, à la nomination à vie des sénateurs, au maintien du Conseil législatif dans les provinces de Québec et du Manitoba. D’autres réclament une augmentation des subsides versés aux provinces par le gouvernement fédéral, la reconnaissance de la juridiction des provinces dans des matières non énumérées dans la constitution, des pouvoirs accrus aux lieutenants-gouverneurs, un certain nombre de sénateurs nommés par les provinces et la réciprocité commerciale avec les États-Unis. Macdonald reçoit froidement Mowat qui se rend à Ottawa lui faire un compte rendu de cette rencontre mémorable, et il ne donne pas suite aux propositions. Cependant, Mercier a forgé, peut-être à son insu, un mécanisme qui à la longue fera participer les premiers ministres provinciaux à l’administration du pays. Mowat rend ce témoignage : « Mercier nous dépasse tous de la tête et des épaules. »
Mercier rencontre plus de difficultés dans l’emprunt des 3,5 millions de dollars que le Parlement l’a autorisé à négocier pour consolider les finances publiques. Il essuie un échec sur le marché de New York où des émissaires du gouvernement canadien ne lui font pas bonne presse. Il fait entamer secrètement des pourparlers, par des personnes sûres, avec le Crédit lyonnais, puis en janvier 1888 se rend à Paris conclure l’affaire et à Rome discuter des biens des jésuites.
De retour à Montréal depuis le 16 mars, Mercier fait le point, le 10 avril, sur sa première année d’administration au cours de laquelle on a terminé la construction du chemin de fer de Québec et du lac Saint-Jean, nommé une commission d’enquête sur l’agriculture, une autre sur les asiles d’aliénés, créé le Conseil d’hygiène et ouvert un bureau d’immigration à Montréal. Il en profite pour dénoncer le projet d’une fédération impériale « qui [...] condamnerait [la province] à l’impôt forcé du sang et de l’argent, et [lui] arracherait [ses] fils pour les jeter dans des guerres lointaines et sanglantes ». De retour à Québec, il remanie son cabinet. Il garde pour lui le département de l’Agriculture et de la Colonisation et charge le curé Labelle, qui aura rang de sous-commissaire, de l’organiser. Le 9 mai, par un arrêté en conseil, il nomme les trois premiers inspecteurs des manufactures, mais ce n’est que le 19 juin qu’il définit les règlements des manufactures, mettant ainsi en œuvre une loi sanctionnée en 1885 et relative au travail des enfants et à l’hygiène dans les manufactures.
Ouverte le 15 mai, cette deuxième session est axée sur le développement économique. Le gouvernement Mercier fonde des écoles du soir pour les ouvriers, continue de subventionner des chemins de fer, amorce la modernisation du réseau routier pour soutenir l’expansion de la colonisation et de l’industrie laitière. Il fait adopter une nouvelle loi sur les forêts qui supprime une réserve forestière créée en 1883, interdit l’octroi de concessions forestières dans les endroits habités et rend le colon usufruitier perpétuel de sa terre, avec droit de coupe et de vente du bois, moyennant une redevance à l’État. Il débloque des crédits pour des études préparatoires à la construction du pont de Québec. À la fin de juin 1888, Mercier délègue Laurent-Olivier David* et Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice au dix-septième congrès des Canadiens français qui se tient à Nashua, dans le New Hampshire, en arguant que la province de Québec a « les droits et les devoirs » d’une mère patrie. Cette session est marquée au coin du travail, mais aussi de la chance et de la grandeur. Deux échecs cependant : le veto de la Banque de Montréal sur le projet de la conversion de la dette et le refus du Conseil législatif d’adopter un projet de loi qui aurait fixé au quart la portion du salaire ouvrier qu’un créancier peut faire saisir.
La troisième session, ouverte le 9 janvier 1889, continue les réformes amorcées, mais Mercier reporte à plus tard le règlement de l’administration des asiles dont l’enjeu est le contrôle médical par l’État. Il doit par ailleurs subir la lenteur que met Macdonald à régler la frontière nord du Québec : Mercier la situe sur la rive sud de la rivière Eastmain, mais Macdonald préfère le 52° de latitude nord.
Mercier est en pleine possession de ses moyens. Il fascine le peuple. Ses partisans l’encensent et ses amis flattent sa vanité. Il vit à Montréal dans une magnifique résidence en pierre, rue Saint-Pierre, que fréquentent Louis-Honoré Fréchette*, Laurent-Olivier David, Félix-Gabriel Marchand, Lomer Gouin* et l’élite du parti libéral. À Sainte-Anne-de-la-Pérade (La Pérade), il a acquis le manoir reconstruit du seigneur Pierre-Thomas Tarieu de La Pérade. Il l’a rebaptisé Tourouvre et pourvu d’un haras. Il a réduit l’opposition parlementaire à moins de 15 voix et, par diverses manœuvres, renforcé ses positions au Conseil législatif et au Conseil de l’Instruction publique. Il devient autoritaire et cassant. En 1889, il fait destituer Pierre Boucher de La Bruère de son poste de président du Conseil législatif et brise Alphonse Desjardins*, l’éditeur des Débats de l’Assemblée législative de la province de Québec, qui refuse de modifier le texte d’un discours qu’il a prononcé. Toutefois, au sein de la coalition, les tensions demeurent. Les radicaux de la Patrie se gaussent de son conservatisme. Des jeunes libéraux de Québec, regroupés autour d’un journal, l’Union libérale, fondé en 1888, demandent de rompre avec les conservateurs nationaux. Les ultramontains s’indignent du trafic d’influence d’Ernest Pacaud et s’alarment des rumeurs de scandales qui s’intensifient.
Ces tensions sont normales et Mercier les maîtrise. Les relations avec le gouvernement fédéral et avec les groupes d’anglophones protestants s’annoncent plus difficiles. Macdonald n’a pas pardonné à Mercier la tenue d’une conférence interprovinciale. Le projet de conversion de la dette a mécontenté les financiers anglophones montréalais. Le trafic d’influence politique suscite le mépris des puritains. Les sociétés évangélistes, émues par la pénétration des Canadiens français dans les Cantons-de-l’Est, dans l’est et le nord de l’Ontario et par l’ambition d’un curé Labelle de rapatrier dans l’Ouest canadien les Franco-Américains, perçoivent l’arbitrage de Léon XIII comme une autre agression catholique romaine. Mercier ostensiblement catholique, ostensiblement français et ostensiblement canadien-français inquiète la minorité anglophone de la province de Québec. Dès l’été de 1888, la presse des Cantons-de-l’Est a montré des signes d’inquiétude et signifié son désaccord avec les modalités du règlement de la question des biens des jésuites. L’Evangelical Alliance et la Protestant Ministerial Association de Montréal ont réclamé durant l’automne la non-reconnaissance de cette loi. En mars 1889, le refus des Communes de voter une telle mesure déclenche une vive agitation en Ontario qui débouche sur la formation de l’Equal Rights Association [V. D’Alton McCarthy]. De nouveau, l’identité canadienne est au cœur des débats et Mercier, au centre d’une tempête politique. En public, il fait montre de fermeté. Le 24 juin 1889, en la fête de la Saint-Jean-Baptiste, il déploie ses couleurs : « Cette province de Québec est catholique et française, et elle restera catholique et française. Tout en protestant de notre respect et de notre amitié pour les représentants des autres races ou des autres religions, tout en nous déclarant prêts à leur donner leur part légitime en tout et partout [...] nous déclarons solennellement que nous ne renoncerons jamais aux droits qui nous sont garantis par les traités, par la loi et la constitution [...] Que notre cri de ralliement soit à l’avenir ces mots qui seront notre force : Cessons nos luttes fratricides ; unissons-nous ! » Dans les coulisses, Mercier tient parole. Il négocie avec le comité protestant du Conseil de l’Instruction publique et pratique une politique d’apaisement. Au début de 1890, il fait amender la loi sur les biens des jésuites et appuie le projet de loi, si cher aux protestants, qui reconnaît la licence ès arts suffisante pour être admis à l’étude des professions libérales (avocat, notaire, médecin). Au printemps, l’ouragan s’essouffle. L’Equal Rights Association est isolée. Mercier a reconquis la confiance des électeurs protestants et de la finance montréalaise. Il a l’appui du Grand Tronc. Les circonstances sont favorables à un recours au peuple.
Mercier, qui s’est présenté dans la circonscription de Bonaventure en Gaspésie, remporte une éclatante victoire électorale le 17 juin 1890. Cependant, à Ottawa, Joseph-Israël Tarte a commencé à dévoiler le scandale McGreevy [V. Thomas McGreevy], qui met Hector-Louis Langevin et le cabinet Macdonald en difficulté. Le 4 novembre 1890, le discours du trône annonce une session chargée. Mercier opte pour un contrôle médical des aliénés par des médecins employés et payés par l’État, ce qui déplait aux ultramontains et sera, plus tard, un facteur non négligeable dans sa défaite électorale. Encore avec l’appui des autorités romaines, il fait adopter le projet de fusion de l’école de médecine et de chirurgie de Montréal avec la faculté de médecine de la succursale de l’université Laval à Montréal. En janvier 1891, il fait résilier la charte de la Compagnie du chemin de fer de la baie des Chaleurs, que préside le sénateur Théodore Robitaille et dont l’entrepreneur est Charles Newhouse Armstrong. Mercier prétend que la compagnie, en ne respectant pas ses engagements, retarde indûment le développement de la Gaspésie et gaspille les fonds publics. En février, il met son prestige et son organisation électorale au service de Laurier à l’occasion des élections fédérales. Macdonald l’emporte, mais la province de Québec pour la première fois donne 11 sièges de majorité aux libéraux. Mercier s’embarque ensuite pour la France et y demeurera plus de trois mois. Il fait en France, en Belgique ainsi qu’à Rome une tournée triomphale où il se présente comme le chef d’une province française et catholique. Mais le gouvernement canadien torpille son projet d’emprunter 10 millions de dollars ; il devra se contenter de 4 millions.
À son retour le 18 juillet 1891, Mercier trouve un pays en pleine effervescence. Macdonald est mort. Tarte, qui a porté 63 chefs d’accusation contre Langevin, McGreevy et le ministère des Travaux publics, est en passe de culbuter le nouveau cabinet dirigé par John Joseph Caldwell Abbott. Des rumeurs de corruption dans l’entourage de Mercier s’intensifient. Le 21 août, le comité des chemins de fer du Sénat précise ces rumeurs. En l’absence de Mercier, Pacaud a fait verser 175 000 $ à l’entrepreneur Armstrong pour payer des travaux effectués pour la Compagnie du chemin de fer de la baie des Chaleurs. Armstrong a, de cette somme, remis 100 000 $ à Pacaud. « C’est le commencement de la fin », écrit la Vérité de Québec. Et, de fait, c’est la fin. Mercier se retrouve seul face à la puissante machine conservatrice, qui dispose de partisans bien en place dans l’appareil administratif et judiciaire du pays, et qui est avide d’occulter le scandale McGreevy et surtout d’abattre l’homme qui a sorti la province de Québec de son emprise. Face aussi à la hargne d’individus qu’il a bousculés, tel Philippe Landry*, propriétaire de l’asile de Beauport et gros fournisseur de la caisse conservatrice. Face encore à la méfiance d’un épiscopat catholique qui n’apprécie pas sa manière de négocier directement avec le Vatican et de le voir peupler de ses créatures le Conseil législatif et le Conseil de l’Instruction publique. Mercier, qui ignore ce qui se trame contre lui, tarde à se défendre et se défend mal devant le lieutenant-gouverneur Auguste-Réal Angers*. Ce dernier, le 7 septembre, abat ses cartes : il limite l’action gouvernementale à des actes d’administration urgente. Puis il impose à Mercier la mise sur pied d’une commission royale d’enquête le 18 septembre et, sans attendre le rapport final de cette commission, le révoque comme premier ministre le 16 décembre. Il confie alors à Charles-Eugène Boucher de Boucherville le soin de former un ministère, même si celui-ci ne jouit pas d’une majorité parlementaire. Dès lors, les dés sont jetés. Pendant que le président de la commission royale rédige son rapport, les conservateurs déclenchent des élections. Ils forment aussi une autre commission chargée d’enquêter sur le gouvernement Mercier et de publier, au jour le jour, des témoignages incriminants. Le 8 mars 1892, au terme d’une campagne de salissage d’une rare violence, les conservateurs remportent 52 sièges, et les merciéristes 18, auxquels s’ajoute celui d’un indépendant. Rendu public, le rapport du président précise « qu’il n’y a pas de preuve qu’aucun des ministres ait eu connaissance de [la] convention [Pacaud-Armstrong] ». Puis l’on s’acharne. Le 20 avril, le procureur Thomas Chase Casgrain* traîne Mercier en justice, sous l’accusation d’avoir fraudé de 60 000 $ le trésor public au moment de l’octroi d’un contrat au libraire Joseph-Alfred Langlais. En octobre, Mercier, commandeur de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre de Léopold, grand-croix de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, comte palatin, comparaît devant les assises criminelles, à Québec. Il est acquitté. Tant d’acharnement de la part de ses adversaires lui vaut un regain de sympathie. De retour à Montréal, on le porte en triomphe de la gare à sa résidence.
Mercier est de nouveau ovationné mais, financièrement et physiquement, il est ruiné. Le 7 juin, il fait cession de ses biens à deux fidéicommissaires. Avec deux jeunes avocats, Rodolphe Lemieux* et Lomer Gouin, il s’est remis à la pratique du droit ; de fait, ses associés pourvoient à sa subsistance. À la fin de septembre, il déclare faillite. La vente de ses biens rapporte 20 660 $, mais il devait 83 163 $ ! Le diabète qui le ronge éteint l’éclat de son regard et émacie ses traits. Il va passer l’hiver en Europe, sans doute pour soigner son diabète, puis le 3 février 1893 il reprend son siège à l’Assemblée. Félix-Gabriel Marchand dirige désormais le parti libéral. Mercier retrouve un regain d’énergie et semble songer à un retour au pouvoir. Il cherche une cause et, de nouveau, l’Ouest canadien, où la bataille des écoles du Manitoba fait rage, la lui fournit. Le Conseil privé, qui vient d’émettre un avis suggérant le rejet d’un jugement de la Cour suprême favorable aux catholiques, le remet en selle. Le 4 avril, au parc Sohmer, il prononce une conférence devant 6 000 personnes venues entendre divers exposés sur l’avenir du Canada. Il présente un plaidoyer pour l’émancipation coloniale, une évocation du devenir d’« un grand peuple, reconnu et respecté parmi les nations libres ». Le succès qu’il remporte et un concours de circonstances l’amènent à mûrir son idée et sa stratégie : susciter un mouvement populaire qui, avec le concours matériel et moral des États-Unis et de la France, ferait accéder le Canada au rang de république indépendante. Et Mercier de partir en croisade. En juillet, il effectue une tournée des centres franco-américains. À Providence, au Rhode Island, il préconise une vaste alliance, avec siège à Paris, pour la protection de tous les peuples de race française. En d’autres lieux, il prône l’idée d’une république canadienne qui, si le peuple le désire, pourrait bien s’annexer aux États-Unis.
Cette croisade entraîne Mercier dans de nouvelles polémiques – on le soupçonne non sans raison de rêver à une république canadienne-française indépendante. Et sa santé ne cesse de se détériorer. Au début d’août, il quitte son étude pour s’aliter. On le transporte une quinzaine de jours plus tard à l’hôpital Notre-Dame, où il meurt le 30 octobre 1894. Plus de 70 000 personnes le conduisent à son dernier repos.
La vie de Mercier, qui est perçu comme une victime et un martyr par les uns et comme un chef prodigue et concussionnaire par les autres, comporte les ingrédients dont on fait les héros. À peine ses cendres refroidies, la mémoire populaire alimentée par les idéologues, les hommes politiques et les historiens commence à tracer une image de lui qui donne sens au présent. Puis s’installe l’habitude d’un pèlerinage sur sa tombe à la Toussaint ; 25 000 personnes vont s’y recueillir en 1898. Au fur et à mesure que s’éteignent ses adversaires et s’apaisent les rancœurs, sa stature grandit. Les libéraux adeptes de l’instruction obligatoire évoquent les « écoles de Mercier » et les partisans d’un autre transcontinental rappellent sa vision patriotique et celle de Labelle. Joseph-Israël Tarte, à la Saint-Jean-Baptiste de 1901, élève Mercier au rang de personnage national. Henri Bourassa* évoque la coalition nationale pour combattre Lomer Gouin, premier ministre et gendre de Mercier. Le 25 juin 1912, jour du dévoilement du monument érigé à la mémoire de Mercier dans les jardins du Parlement à Québec, les traits de la légende sont fixés : « Et vous qui passez devant cette statue de bronze, saluez-la, c’est l’âme de la patrie, c’est Mercier. » Cette fête du patriotisme est tout à la fois la réhabilitation (geste de restitution des droits perdus à l’estime publique) et l’apothéose (la déification) de Mercier. Ayant passé le test de l’impartialité de l’histoire et de l’infaillibilité du peuple, Mercier devient digne d’incarner le patriotisme canadien-français dont il avait été l’exemple vivant. Les orateurs ne cherchent pas avant tout à décrire Mercier tel qu’il a été, mais plutôt à fixer une image du personnage en fonction d’une vérité présente : c’est le patriotisme qui permettra à la race canadienne-française de survivre et de grandir. Le mot d’ordre « Cessons nos luttes fratricides ; unissons-nous ! » est hissé au rang de valeur sacramentelle propre à exorciser les dangers de l’avenir.
Jusque dans les années 1940, la mémoire collective ne cesse d’exalter ce symbole. Le souvenir de Mercier est évoqué à toutes les fêtes patriotiques. Le quarantième anniversaire de sa mort est commémoré par une messe au Gesù, à Montréal, et un pèlerinage sur son tombeau. Le centenaire de sa naissance est souligné par une émission à Radio-Canada, la parution d’écrits qui relatent ses faits et gestes, des biographies dans la presse écrite. À la fondation de l’Union nationale en 1935, ou du Bloc populaire en 1942, et au moment de la crise conscriptionniste en 1944, ou de l’adoption du drapeau québécois en 1948, le « grand Mercier » est toujours là qui inspire, exhorte, exorcise, applaudit. Mais il s’est cléricalisé. On met en relief son respect de l’Église, son amour des hommes. Le règlement des biens des jésuites est sa plus importante mesure et sa politique d’agriculture et de colonisation, sa plus grande œuvre. C’est qu’avec l’acculturation des Franco-Américains, la déconfiture des minorités francophones dans l’Ouest canadien, la longue dépression des années 1930, l’imaginaire des Québécois francophones s’est ratatiné. Le Mercier des années 1910 était porteur d’une vision messianique qui projetait à l’avant-plan le Québec dans la Confédération canadienne et les Canadiens français dans l’Amérique du Nord. Il pointait du doigt l’avenir. Le Mercier de la Crise, d’ailleurs comme le Samuel de Champlain* et le Jos Montferrand [Joseph Montferrand*, dit Favre] des élites cléricales, est un agriculturiste qui pointe sa charrue vers le passé. Mercier invite désormais au repli sur soi pour sauvegarder les acquis catholiques et français. Le « Cessons nos luttes fratricides » veut « maintenir un devenu » et non plus « faire éclore un devenir ».
Le mythe d’Honoré Mercier éclate et se dissout dans les années 1960. Seuls de rares indépendantistes évoquent son souvenir à l’occasion et projettent leurs rêves à travers lui. « Mais son rêve d’un État français libre persiste », assure Marcel Chaput en 1977. À l’heure de la Révolution tranquille, les historiens esquissent trois portraits de Mercier : un Mercier patriote, qui incarne toujours l’âme de tout un peuple ; un Mercier nationaliste, tantôt conservateur ou libéral, tantôt fédéraliste ou indépendantiste, qui ne représente plus les aspirations que d’une fraction du peuple ; et un Mercier petit-bourgeois dont « la politique de grandeur » « occulte la lutte des classes et le développement sauvage du capitalisme ».
Les actes de baptême, de mariage et de sépulture d’Honoré Mercier sont conservés aux ANQ-M, sous les cotes CE4-3, 16 oct. 1840 ; CE2-1, 29 mai 1866, 9 mai 1871 ; CE1-51, 2 nov. 1894.
Pierre Dufour a relevé dans sa thèse de doctorat intitulée « l’Administration Mercier, 1887–1891 : anatomie d’une légende » (univ. d’Ottawa, 1980) la bibliographie des études historiques sur Mercier. Par ailleurs, on trouve dans Francine Hudon, Inventaire des fonds d’archives relatifs aux parlementaires québécois (Québec, 1980), la description des fonds d’archives relatifs à Mercier. Nous avons consulté trois sources imprimées : Biographie, discours, conférences, etc. de l’honorable Honoré Mercier [...], J.-O. Pelland, édit. (Montréal, 1890) ; Devant la statue de Mercier ; discours et récits de l’inauguration du. monument, Philippe Roy, compil. (Québec, 1912) ; et J.-I. Tarte, 1892, procès Mercier : les causes qui l’ont provoqué, quelques faits pour l’histoire (Montréal, 1892). Nous avons utilisé d’une façon spéciale les études suivantes : Avila Bédard, Honoré Mercier, patriote et homme d’action (Montmagny, Québec, 1935).— C.-P. Choquette, Histoire de la ville de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe, Québec, 1930) ; Hist. du séminaire de Saint-Hyacinthe.— R. C. Dalton, The Jesuits’ estates question, 1760–1888 : a study of the background for the agitation of 1889 (Toronto, 1968).— Paul Desjardins et L.-M. Gouin, Deux aspects d’Honoré Mercier : le collégien, l’ancien élève (Montréal, 1940).— L.-A. Rivet, Honoré Mercier, patriote et homme d’État (Montréal, 1922).— Rumilly, Mercier et son temps.— J. R. Miller, « Honoré Mercier, la minorité protestante du Québec et la loi relative au règlement de la question des biens des jésuites », RHAF, 27 (1973–1974) : 483–507.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Pierre Dufour et Jean Hamelin, « MERCIER, HONORÉ (1840-1894) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/mercier_honore_12F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mercier_honore_12F.html |
| Auteur de l'article: | Pierre Dufour et Jean Hamelin |
| Titre de l'article: | MERCIER, HONORÉ (1840-1894) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1990 |
| Année de la révision: | 1990 |
| Date de consultation: | 2 janv. 2026 |


![Hon. Honoré Mercier, Q. C. [image fixe] Titre original : Hon. Honoré Mercier, Q. C. [image fixe]](/bioimages/w600.749.jpg)