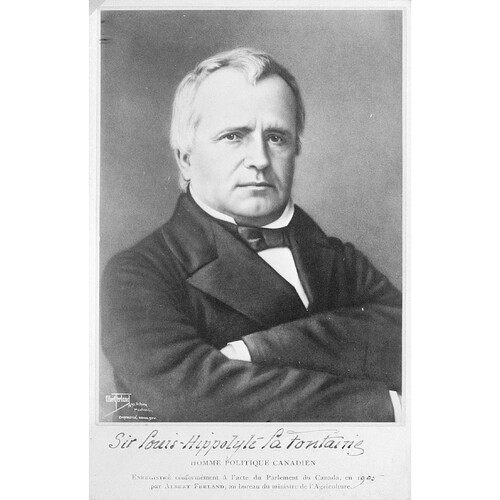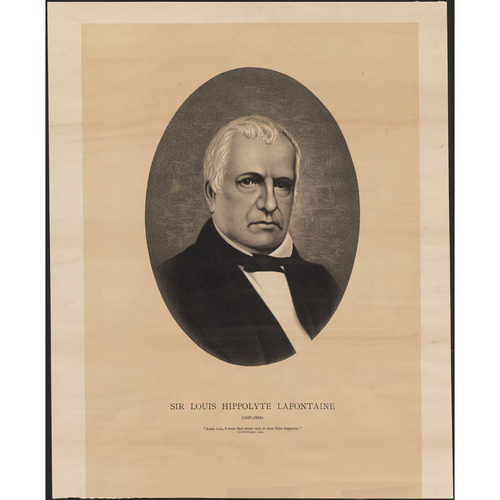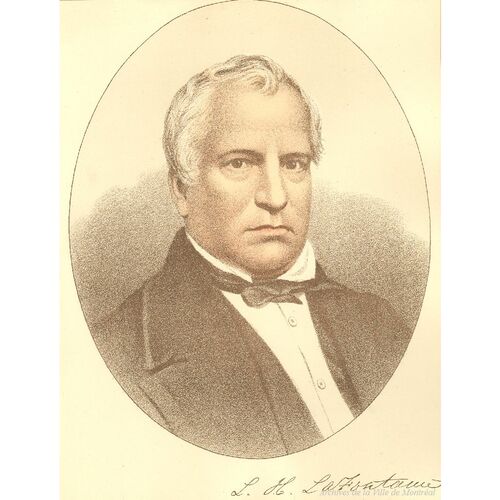Provenance : Lien
LA FONTAINE (Ménard, dit La Fontaine), sir LOUIS-HIPPOLYTE (il signait LaFontaine ; dans certains actes, notamment dans son acte de baptême, son second prénom est orthographié Hyppolite), homme politique et juge, né à Boucherville, Bas-Canada, le 4 octobre 1807, troisième fils d’Antoine Ménard, dit La Fontaine, menuisier, et de Marie-Josephte Fontaine, dit Bienvenue, décédé à Montréal le 26 février 1864 et inhumé le 29 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, dans la même ville.
Louis-Hippolyte La Fontaine commença jeune à se faire remarquer. Au collège de Montréal, où il entreprit ses études classiques en 1820, il se distingua rapidement par son amour du travail et sa prodigieuse mémoire. Ses condisciples l’appelaient « la grosse tête ». Il passait pour le plus doué, même s’il resta toujours deuxième de sa classe. Une histoire souvent racontée plus tard veut qu’un dénommé Louis-Joseph Plessis, le premier de classe qu’il ne put jamais supplanter, tomba dans l’ivrognerie et vécut aux crochets de La Fontaine pendant plusieurs années. En récréation, La Fontaine était reconnu comme le plus énergique et le plus adroit, surtout au jeu de paume où il ne connaissait pas de rival. À cause de sa forte personnalité et de son esprit contestataire, il ne put cependant endurer longtemps le régime du collège. Il le quitta après les belles-lettres pour s’engager comme clerc au bureau de l’avocat François Roy.
Reçu au barreau en 1828, La Fontaine se créa rapidement une enviable clientèle et s’acquit une belle réputation pour ses talents de plaideur. Il fit à cette époque un mariage très avantageux. Le 9 juillet 1831, dans la paroisse Notre-Dame de Québec, il épousa Adèle, fille d’Amable Berthelot*, riche avocat, bibliophile, collectionneur et homme politique. La Fontaine jeta ainsi les bases d’une fortune et d’une carrière juridique qui deviendront intéressantes. Déjà, étudiant en droit, il s’intéressait à la politique. Répondant à la demande de ses amis Ludger Duvernay* et Augustin-Norbert Morin, il publia dans la Minerve ses critiques politiques et judiciaires. Aussi ne faut-il pas s’étonner de le voir participer aux campagnes électorales de la fin des années 1820. En 1830, il entra en politique active et se fit facilement élire député de Terrebonne à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada ; il y sera réélu aussi facilement en 1834.
À l’Assemblée, le jeune député fut vite connu pour le solide appui qu’il apportait aux chefs les plus passionnés, Louis Bourdages* et Louis-Joseph Papineau*. Lors de l’émeute qui marqua l’élection de Daniel Tracey* à Montréal le 21 mai 1832, il accompagna Papineau au cœur de l’agitation sur la place d’Armes ; et, en 1834, après l’acceptation d’un poste au Conseil exécutif par le député Dominique Mondelet et l’opposition de son frère Charles Mondelet* aux Quatre-vingt-douze Résolutions, La Fontaine se fit le porte-parole du parti patriote dans un violent pamphlet : les Deux Girouettes, ou l’hypocrisie démasquée. Jusqu’au début de l’insurrection en 1837, il accompagna fidèlement Papineau aux assemblées les plus houleuses et parut à Québec habillé à la mode patriote, en veste d’étoffe du pays. En même temps, il se faisait connaître comme l’un des députés les plus anticléricaux ; son pamphlet, Notes sur l’inamovibilité des curés dans le Bas-Canada, publié en 1837, rappela à Mgr Joseph Signay*, évêque de Québec, les écrits les plus vifs des précurseurs de la Révolution française. L’approche des hostilités semble cependant avoir produit chez lui un revirement tout à fait inattendu sur lequel il ne s’est jamais expliqué. Certains y voient de l’opportunisme politique, mais il est plus probable que La Fontaine, homme politique pragmatique, n’avait plus confiance à ce moment-là ni dans la stratégie ni dans certains objectifs du parti. Il avait été agressif et turbulent ; à partir de novembre 1837, il se révélera d’une habileté étonnante pour la manœuvre politique et pour le compromis. Bien plus, il fera preuve d’une profonde intelligence des principes de la constitution britannique et de leur importance pour la survivance des Canadiens français.
Quatre jours avant que n’éclate la violence armée à Saint-Denis, le 23 novembre 1837, La Fontaine écrivit au gouverneur lord Gosford [Acheson*] pour l’engager à convoquer d’urgence le parlement. Puis, après être descendu à Québec en compagnie de son collègue James Leslie* pour une entrevue personnelle avec le gouverneur le 5 décembre, il fit parvenir à celui-ci une nouvelle demande signée cette fois par 13 autres députés, dont son beau-père, Amable Berthelot, et son ami Augustin-Norbert Morin. Devant le refus de Gosford, il partit pour Londres où il arriva à la fin de décembre. Avant de passer à Paris en mars 1838, il s’entretint fréquemment avec les députés du groupe réformiste anglais, Edward Ellice et Joseph Hume. De retour en Amérique, le 11 juin 1838, il s’arrêta à Saratoga, New York, pour saluer Papineau avant de rentrer à Montréal le 23 juin. Il y retrouva son épouse qui se dévouait depuis six mois à visiter les anciens collègues de son mari, incarcérés depuis son départ, et, au coût de sacrifices assez considérables, à subvenir aux besoins matériels de leurs familles. Lors de la reprise des hostilités en novembre, il fut lui-même emprisonné avec son ami et associé Joseph-Amable Berthelot et plusieurs autres hommes politiques dont Denis-Benjamin Viger, Jean-Joseph Girouard* et Charles Mondelet. Après interrogatoire, il fut cependant relâché le 13 décembre sans qu’aucune accusation ne soit portée contre lui.
Pendant tous ces événements, La Fontaine s’était montré incontestablement l’homme du compromis et l’adroit porte-parole autant des Patriotes emprisonnés que des anciens modérés qui avaient mis leur foi dans la souplesse des institutions britanniques et qui considéraient le voyage de La Fontaine à Londres comme une ultime tentative d’obtenir une solution constitutionnelle aux problèmes du Bas-Canada. Il s’était acquis la confiance des hommes politiques canadiens et le respect du gouvernement. C’est lui qui fut choisi comme conseiller juridique des prisonniers amnistiés par lord Durham [Lambton*] en juin 1838 et qui servit d’intermédiaire entre le gouvernement et les déportés aux Bermudes. C’est lui aussi qui se mit à la disposition des secrétaires du gouverneur, Charles Buller* et Edward Gibbon Wakefield, pour des échanges sur la conjoncture politique. Enfin, c’est lui qui rédigea les documents qui amenèrent les autorités à le libérer, lui et ses amis, à la fin de 1838. Surtout, c’est lui qui, au fil de ses communications avec lord Gosford, Edward Ellice, Joseph Hume, Charles Buller et Edward Gibbon Wakefield, proposa l’analyse la plus lucide de la situation des Canadiens français et exposa le plus clairement les remèdes à leurs maux. Ce faisant, il traça son programme de la décennie à venir.
Dans l’immédiat, La Fontaine insistait sur deux points : une amnistie générale pour les coupables de la rébellion et une indemnité pour ses victimes. Aucun jury impartial, selon lui, ne pouvant juger les rebelles, le gouvernement britannique y gagnerait à user de clémence. Et si, en outre, le gouvernement impérial acceptait d’indemniser les innocents, il pourrait peut-être même amener les Canadiens français à oublier la répression. La question de l’amnistie et celle des indemnités seront les priorités du jeune chef canadien, et leur règlement comptera parmi ses principales réalisations. Comme plusieurs de ses lettres à Ellice sur ces questions se retrouvent parmi les papiers de lord Durham, il est permis de supposer que son avis fut pour quelque chose dans l’amnistie partielle proclamée par le gouverneur en 1838 ; de même, ce sera lui qui, en 1842, entreprendra les premières démarches qui aboutiront au pardon des exilés en 1845. Il sera responsable, également, du nolle prosequi en faveur de Papineau au mois de juillet 1843 ; et ce sera lui, enfin, qui proposera en 1849 le célèbre « bill des indemnités » qui marquera dans le drame et la violence son accession au faîte du pouvoir politique.
Au cours des années 1837–1838, La Fontaine précise également sa pensée politique. Pour lui, « les Canadiens sont devenus par les traités, sujets anglais. Ils doivent donc être traités comme tels ». En tant que sujets britanniques, les Canadiens français ont droit à l’Assemblée. Le jeune politicien insiste donc sur la restauration de cette législature, supprimée en mars 1838. « Sans elle, écrit-il à son ami Berthelot, nous deviendrons à coup sûr de vrais Acadiens », incapables légalement de réformer leurs institutions et d’influencer leur destin. Sujets britanniques, les Canadiens français avaient donc le droit, à l’Assemblée, d’exercer leur influence prépondérante et majoritaire sur le gouvernement. Selon lui, si le parti canadien avait été admis au conseil du gouverneur, les troubles auraient été évités et l’harmonie politique et la paix sociale maintenues aisément. « C’est une grande erreur, affirme-t-il dans une lettre à Ellice, de croire qu’il n’y a pas de moyen de rapprochement entre les deux partis. [...] Je n’hésite pas à répéter ce que j’ai si souvent dit, en Canada comme en Angleterre, qu’il est facile de rétablir l’harmonie dans les masses des deux partis politiques, car leurs intérêts sont les mêmes. C’est même un besoin senti depuis longtemps. Que l’administration locale cesse, dans tous ses rapports administratifs ou sociaux, de faire et de soutenir des distinctions de race, et qu’elle marche franchement vers une politique libérale, mais ferme, et aussi des actes de favoritisme envers des classes privilégiées. Vous verrez l’harmonie se rétablir plus vite qu’on ne le pense. » La Fontaine est d’ailleurs convaincu que c’est en réunissant en un seul parti les Bas-Canadiens français et anglais que se réalisera la transformation libérale des institutions, dans le meilleur intérêt des Canadiens et de la Grande-Bretagne. Les « troubles politiques » étant dus à une habitude discriminatoire du gouvernement, leur suppression proviendra de l’application intégrale des principes de la constitution britannique selon laquelle des distinctions politiques sont fondées dans les « opinions » plutôt que dans les « origines ». Alors, comme le « gouvernement bâtard, contre nature » d’avant 1837 avait encouragé les chefs canadiens à regarder vers les institutions républicaines des États-Unis, ainsi à l’avenir, « la plus saine politique est de nous laisser rien à leur envier ».
En soulignant la priorité des « opinions » plutôt que des « origines » ethniques dans la formation des partis, La Fontaine rencontrait, sans le savoir, les vues du réformiste haut-canadien Francis Hincks*. Mais entre-temps, au printemps de 1839, c’est le rapport Durham qui avait capté l’attention de La Fontaine et de l’opinion canadienne. Ce rapport définissait le mode de gouvernement que La Fontaine, sans le nommer, avait décrit dans ses lettres à Ellice, c’est-à-dire une administration selon laquelle le gouverneur devait s’engager à suivre les directives de son Conseil exécutif, qui serait, lui, toujours « responsable » devant la chambre élue. La responsabilité ministérielle, appliquée au seul Bas-Canada, aurait signifié que la voix des Canadiens français serait devenue prépondérante dans l’administration de la colonie. La Fontaine se devait donc de l’accepter. Mais, en plus du , Durham recommandait l’union du Haut et du Bas-Canada. Cette mesure, beaucoup moins acceptable aux « nationalistes » des deux colonies, était frappée d’anathème dans le Bas-Canada. Presque tous les chefs politiques, et surtout Papineau, l’avaient combattue depuis 1822, et lord Durham la proposait en 1839 dans un but nettement assimilateur. Avec son sens aigu des réalités, La Fontaine était en mesure de comprendre que l’union pouvait aider les siens, du fait qu’elle amènerait des solutions intéressantes aux problèmes économiques et sociaux de la colonie et qu’elle apporterait, plus particulièrement avec la responsabilité ministérielle, les instruments politiques nécessaires à la réforme des institutions du Bas-Canada qui s’apparentaient encore aux structures absolutistes et arbitraires de l’Ancien Régime. Il était donc prêt à y consentir, comme il le rappellera 12 ans plus tard : « Après avoir bien examiné par la suite cette verge que l’on avait voulu forger contre mes compatriotes, je priai quelques uns des plus influents d’entre eux de me permettre de me servir de cette verge pour sauver ceux qu’elle était destinée à perdre, pour mettre mes compatriotes dans une position meilleure que jamais ils n’en avaient occupée. Je vis que cette mesure renfermait en elle le moyen de donner au peuple le contrôle qu’il devait avoir sur le gouvernement. »
Il lui fallait du courage, car au cours des mois qui suivirent la publication du rapport Durham, l’opinion au Bas-Canada se montra hostile aux recommandations. Tout concourait à tourner les Canadiens français contre l’Union : les mesures provocantes du gouverneur Charles Edward Poulett Thomson*, l’attitude injurieuse des députés du Haut-Canada lors du débat sur l’Union à la chambre d’Assemblée de Toronto, et, plus encore, le fait capital que les dispositions du projet adopté par le parlement impérial durant l’été de 1840 ne reconnaissaient pas la responsabilité ministérielle. La Fontaine résuma lui-même les principales objections à la loi : « Elle est un acte d’injustice et de despotisme, en ce qu’elle nous est imposée sans notre consentement, en ce qu’elle prive le Bas-Canada du nombre légitime de ses Représentants, en ce qu’elle nous prive de l’usage de notre langue dans les procédés de la Législature, contre la foi des traités et la parole du Gouverneur Général, en ce qu’elle nous fait payer, sans notre consentement, une dette que nous n’avons pas contractée, en ce qu’elle permet à l’Exécutif de s’emparer illégalement, sous le nom de liste civile, et sans le vote des Représentants du peuple, d’une partie énorme des revenus du pays. »
Les principaux leaders de l’opinion, les journalistes et hommes politiques, surtout John Neilson* à Québec et Denis-Benjamin Viger à Montréal, refusaient carrément l’Union et militaient en faveur de son rappel. « Nous trouvant seuls, racontera La Fontaine plus tard, nous [ne] pûmes nous dissimuler qu’il était impossible de mouvoir et la ville et les campagnes, tant était grand le découragement où les avaient jetés les évènements. »
Le 28 août 1840, moins de dix jours après l’arrivée de la nouvelle que l’Union avait reçu la sanction royale, La Fontaine publia son « Adresse aux électeurs de Terrebonne », dans laquelle il se révèle un politique réaliste et adroit en apportant les distinctions suivantes sur le projet d’Union. Si certains la repoussent, écrit-il, « s’ensuit-il que les Représentants du Bas Canada doivent s’engager d’avance, et sans garanties, à demander le rappel de l’Union ? Non, ils ne doivent pas le faire. Ils doivent attendre, avant d’adopter une détermination dont le résultat immédiat serait peut-être de nous rejeter, pour un tems indéfini, sous la législation liberticide d’un Conseil Spécial, et de nous laisser sans représentation aucune. » Selon La Fontaine, l’Union permettra la fondation d’un parti basé plutôt sur des principes réformistes que sur la nationalité : « Les Réformistes, dans les deux provinces, forment une majorité immense [...]. Ils [ceux du Haut-Canada] doivent réclamer contre des dispositions qui asservissent leurs intérêts politiques et les nôtres aux caprices de l’Exécutif. S’ils ne le faisaient, ils mettraient les Réformistes du Bas Canada dans une fausse position à leur égard, et s’exposeraient ainsi à retarder les progrès de la réforme pendant de longues années. Eux, comme nous, auraient à souffrir des divisions intestines qu’un pareil état de choses ferait inévitablement naître. Cependant notre cause est commune. Il est de l’intérêt des Réformistes des deux provinces de se rencontrer sur le terrein législatif, dans un esprit de paix, d’union, d’amitié et de fraternité. L’unité d’action est nécessaire plus que jamais. » C’est l’Union aussi qui rendra possible la responsabilité ministérielle, promise au Haut-Canada, mais refusée au Bas-Canada. « Pour moi, ajoute La Fontaine, je n’hésite pas à dire que je suis en faveur de ce principe anglais de gouvernement responsable. Je vois, dans son opération, les seules garanties que nous puissions avoir d’un bon gouvernement constitutionnel et effectif. Les colons doivent avoir la conduite de leurs propres affaires. Ils doivent diriger tous leurs efforts dans ce but ; et pour y parvenir, il faut que l’administration coloniale soit formée et dirigée par et avec la majorité des Représentants du peuple. » La conclusion était nette : l’Union était le prix qu’il fallait payer pour obtenir le gouvernement responsable, « principal moteur de la constitution anglaise », et le moyen pour les Canadiens français de regagner tout ce que les recommandations moins acceptables du rapport voulaient leur enlever. Elle était ensuite la condition d’une transformation des institutions qui se ferait dans l’ordre, dans la paix, dans la liberté, et dans le respect des institutions parlementaires auxquelles les Canadiens français s’étaient habitués.
La Fontaine avait fait valoir les mêmes idées dans sa correspondance avec Francis Hincks. Entre le 12 avril 1839 et le 30 janvier 1840, les deux réformistes avaient échangé une dizaine de lettres dans lesquelles ils exprimaient tous les deux l’idée qu’un parti politique devait être basé sur des principes communs plutôt que sur des intérêts de classe ou d’origine, et la conviction qu’ensemble ils pouvaient y arriver. Le Torontois savait qu’il n’avait pas la majorité suffisante pour faire accepter ses projets de réforme dans le Haut-Canada sans l’appui des députés canadiens-français ; La Fontaine savait aussi qu’il lui fallait l’influence haut-canadienne pour vaincre à la fois les forces conservatrices encore très vives au sein du Bas-Canada et les préventions de Londres contre ses compatriotes. Le 17 juin 1840, Hincks résumait ainsi sa pensée dans une lettre à La Fontaine : « Vos compatriotes n’obtiendront jamais leurs droits dans une législature bas-canadienne. Vous avez besoin de notre aide autant que nous avons besoin de la vôtre. [...] Seule l’Union peut garantir le respect de nos libertés. » Il restait à La Fontaine la tâche de convaincre ses compatriotes.
Il était prêt. Avocat recherché, il avait une clientèle nombreuse et influente. Il passait pour riche. En 1840, il l’était suffisamment pour autoriser des amis parisiens à consentir du crédit à Louis-Joseph Papineau. La même année, il était déjà propriétaire, en société avec Lewis Thomas Drummond*, d’un important pâté de maisons et de magasins au coin des rues Saint-Jacques et Saint-Lambert à Montréal, et deux ans plus tard il achetait au prix de £5 200 des terrains sur la rue Lagauchetière. De plus, ses activités durant les rébellions lui avaient mérité la réputation d’être pragmatique et décidé. C’était vrai, il avait le tempérament des hommes pratiques, capables de résoudre facilement les difficultés. Sa correspondance nous le montre habile à distinguer rapidement l’important de l’accessoire. Il aime les points de droit, les données précises d’un problème, se méfie de la théorie et ne prise ni la philosophie, qu’il n’avait jamais étudiée, ni le roman, ni la poésie. Il n’était pas un penseur. Dans sa vie privée, il était sévère, renfermé, avait peu d’amis, sortait rarement et fuyait les réunions mondaines. Dans sa vie publique, il parlait sans passion, sans envolée. En fait, c’était sa physionomie qui l’aidait à s’imposer. De taille un peu au-dessus de la moyenne, il avait une démarche lente et mesurée. Ses yeux noirs, son air calme et immobile lui donnaient un regard sûr. Certains le trouvaient prétentieux. D’une étonnante ressemblance avec Napoléon Ier, il se peignait à la manière de l’empereur et avait pris l’habitude de se tenir les doigts de la main droite entre les boutons de sa veste. Certains le disaient ambitieux. Mais par son habileté il imposait à tous le respect. Un mélange d’ambition et d’opiniâtreté le rendit capable d’un effort extraordinaire de constance et de mesure ; son caractère difficile et froid lui conférait un air de mystère qui, pour ses partisans, passait pour du désintéressement.
La Fontaine consacrera les dix années suivantes à atteindre ses objectifs. Premièrement, il fallait faire accepter l’Union. Déjà un chef à 32 ans, il dut manœuvrer habilement face aux vieux routiers de la politique. Il savait d’ailleurs l’importance de ne pas diviser les hommes politiques en temps de crise. Il se montra donc solidaire de ses aînés en tout ce qui n’était pas contraire à sa tactique d’accepter l’Union pour obtenir par là la responsabilité ministérielle. À Québec, il participa aux assemblées, et en organisa lui-même à Montréal, pour protester contre l’Union telle que projetée par Londres. En avril 1840, il signifia nettement sa désapprobation en refusant le poste de solliciteur général que le gouverneur Thomson lui offrait. En même temps, il travaillait à faire passer les idées de son « Adresse [...] ». Après l’annonce des premières élections du nouveau régime, il s’occupa de susciter des candidatures qui l’appuieraient. En juillet 1840, il se rendit à Toronto faire la connaissance de ses alliés du Haut-Canada, puis en septembre il reçut Hincks chez lui à Montréal. En outre, il fit plusieurs voyages à Québec pour y coordonner les efforts d’Étienne Parent* et de Morin en faveur de l’Union. Sa prise de position ne lui fit pas que des amis. Lorsque les bureaux de votation furent ouverts dans Terrebonne en mars 1841, il se retira de la lutte cédant la place au docteur Michael McCulloch, qui avait non seulement l’appui des partisans du gouverneur Thomson mais aussi des Patriotes qui se rangeaient du côté de Neilson et de Viger. Malgré cet échec personnel dû autant à son désir d’éviter de compromettre son leadership par une défaite électorale qu’à la crainte que la présence dans les deux camps de nombreux fiers-à-bras ne dégénère en violence, les résultats des élections à travers la province lui apportèrent une certaine satisfaction. Il avait réussi à convaincre l’ensemble des Canadiens français de participer au vote et il pouvait compter sur le soutien d’une bonne demi-douzaine de députés. De plus, sa défaite dans Terrebonne lui permit d’éprouver l’esprit de solidarité de ses alliés.
Robert Baldwin*, chef du parti dans le Haut-Canada, avait été élu dans deux comtés. En apprenant la défaite de La Fontaine, il résigna son siège d’York et l’offrit au chef bas-canadien. La Fontaine fut élu facilement le 23 septembre 1841, après avoir séjourné trois semaines parmi les Torontois en compagnie d’Étienne Parent. Des liens d’une profonde amitié l’attachèrent désormais à Baldwin. Il le consultera sur tout ce qui touchait à la politique et à la constitution et lui racontera tous les événements de sa vie personnelle. Les échanges entre les deux hommes se prolongèrent jusqu’à la mort de Baldwin en 1858. Mis à part Joseph-Amable Berthelot, les papiers La Fontaine ne révèlent aucun autre personnage avec qui il eut des relations amicales aussi intimes.
Une fois élu député, La Fontaine continua sa campagne de persuasion en faveur de l’Union sur un ton plus assuré. À chaque élection partielle qui suivit, il s’occupa de faire mettre en candidature des hommes favorables à ses idées. De plus, il sut gagner la confiance de plusieurs députés élus sous la bannière de Neilson. Il travailla aussi à renforcer son message auprès de la population. En 1841, il fit offrir des conditions avantageuses à Ludger Duvernay afin que celui-ci revienne d’exil pour relancer la Minerve. Ce journal reprendra vite sa place prépondérante dans la région de Montréal et sera tout à fait dévoué aux intérêts de La Fontaine. Il encouragea aussi la fondation du Journal de Québec, dont le rédacteur Joseph Cauchon* lui fut toujours fidèle.
Durant l’été de 1842, la conjoncture politique était devenue telle que le nouveau gouverneur, sir Charles Bagot*, se rendit compte qu’il ne pouvait plus agir en harmonie avec le parlement sans faire appel à La Fontaine. Après deux semaines de négociations difficiles, le jeune chef prêtait serment comme procureur général du Bas-Canada et chef du gouvernement. C’était le 16 septembre 1842. Avec La Fontaine, et sur sa recommandation, entraient au ministère Augustin-Norbert Morin, Robert Baldwin et l’avocat québécois Thomas Cushing Aylwin*. Un vote de 55 à 5 exprima la confiance de l’Assemblée. Parmi les députés du Bas-Canada, seul John Neilson s’était opposé.
La Fontaine était maintenant en mesure de prouver que l’Union pouvait servir les intérêts des Canadiens français. Il se mit résolument à l’œuvre. En moins d’un an, il avait fait rappeler ou amender les mesures du régime Sydenham qui avaient le plus mécontenté les Canadiens français. Entre autres, il fit modifier la loi électorale pour établir un bureau de votation dans chaque paroisse et ainsi diminuer la violence durant les élections. Pour augmenter l’influence de ses compatriotes, il fit adopter une refonte de la carte électorale du Bas-Canada, particulièrement dans les faubourgs de Montréal et de Québec. Il fit transférer la capitale de Kingston à Montréal, commença ses nombreuses démarches pour amnistier les condamnés de 1837–1838 et faire rétablir l’usage officiel de la langue française dans les actes de la législature et des tribunaux. La Fontaine s’occupa surtout de « patronage ». Il savait que c’était ainsi qu’il pourrait probablement le mieux démontrer aux siens que l’Union pouvait servir leurs intérêts. Dans les hauts postes de l’administration, il fit entrer des hommes comme Étienne Parent et René-Édouard Caron*, nommés respectivement greffier et président des conseils exécutif et législatif. Puis il ouvrit des carrières et des emplois à tous les niveaux et pour toutes les classes, depuis celle des bien-nantis qu’il appela au Conseil législatif jusqu’à celle du pauvre habitant qu’il fit nommer agent des terres ou commissaire de recensement. « Le patronage c’est le pouvoir », écrivit le député haut-canadien James Hervey Price* à Baldwin le 6 février 1843, et La Fontaine entendait bien montrer que les Canadiens français étaient arrivés.
C’est précisément sur cette question du patronage qu’il se heurta au gouverneur sir Charles Theophilus Metcalfe*, qui avait remplacé sir Charles Bagot au mois de mars 1843. Metcalfe ne comprenait pas le gouvernement responsable à la manière de La Fontaine. Il refusa de s’engager à suivre les directives du conseil et de son chef, et comme La Fontaine insistait, on en vint, en novembre 1843, à ce que les journalistes du temps appelèrent « la crise Metcalfe ». La Fontaine et tout son ministère, à l’exception du secrétaire provincial Dominick Daly, démissionnèrent en bloc. La chambre les appuya, et le gouverneur dut se mettre à la recherche d’autres conseillers.
C’est durant les années 1843 à 1847, alors qu’il agissait comme chef de l’opposition, que La Fontaine connut ses jours les plus difficiles. Sa santé se détériora à un point tel qu’il dut s’aliter à plusieurs reprises pour une semaine ou deux. À la fin de novembre 1846, le rhumatisme dont il souffrait nécessita une intervention chirurgicale qui le laissa très faible pendant trois mois. À l’été de 1847, il alla se faire soigner à Newport, Rhode Island. En janvier 1848, il était encore une fois sous les traitements du médecin. Durant ces mêmes années, Adèle La Fontaine fut assez malade également. Tous deux eurent aussi la douleur de perdre leur nièce et fille adoptive, Corine Wilbrenner, qui décéda le 4 novembre 1844 à l’âge de 13 ans. « Vous avez des enfants, écrivit alors La Fontaine à Baldwin, nous n’en avons pas. Corine était notre fille adoptive. Sa mort influencera grandement, je le crains, mes plans et mes projets. »
Sur le plan politique, La Fontaine devait s’assurer la fidélité des siens sans avoir à sa disposition l’exercice du patronage et, après la défaite des réformistes en 1844, sans l’espoir de le reprendre bientôt. En fait, les résultats des élections semblaient donner raison à ceux qui s’étaient opposés à l’union des Canadas et à l’union des réformistes. Le Haut-Canada donna une majorité favorable au gouverneur Metcalfe et à son nouveau ministère dirigé par William Henry Draper* ; le Bas-Canada, pour sa part, avait élu quelque 29 députés sur 42 qui étaient partisans de La Fontaine. Les deux Canadas étaient donc presque également divisés, et deux Canadiens français, Denis-Benjamin Viger et Denis-Benjamin Papineau*, étaient entrés au Conseil exécutif afin de rallier leurs compatriotes aux vues du gouverneur. Ils préconisaient une collaboration de surface avec le Haut-Canada et recouraient au principe de la double majorité. Ce principe, qui évoluera par la suite, favorisait une alliance temporaire du parti majoritaire dans le Bas-Canada avec le parti majoritaire dans le Haut-Canada quel qu’il fût et aussi longtemps que les partis y trouvaient satisfaction. La Fontaine s’opposait à ce principe pour des raisons théoriques et pratiques. La solidarité ministérielle était pour lui une des conditions essentielles de la responsabilité ; et de plus, il était convaincu que même si la responsabilité avait pu en théorie s’exercer sans la solidarité, lord Metcalfe n’accepterait jamais en fait de s’engager à suivre les directives de son conseil. Quels que puissent être les raisonnements de théoriciens sur le principe, La Fontaine avait raison sur le caractère de Metcalfe. De plus, ni le premier ministre de la Grande-Bretagne, sir Robert Peel, ni le ministre des Colonies, lord Stanley, n’acceptaient le principe de la responsabilité ministérielle pour le Canada. La Fontaine savait qu’il faudrait leur arracher la concession. « Je sais que vous pensez que nous n’obtiendrons jamais la responsabilité ministérielle », lui écrivait Hincks le 17 juin 1840, « que le ministère nous déçoit – je vous le concède – mais nous le forcerons à nous l’accorder qu’il le veuille ou non. »
La Fontaine s’appliqua donc à maintenir devant les électeurs son attachement au gouvernement responsable. Dans le contexte, le défi, qui ne fut pas toujours relevé avec succès, était d’éviter la démagogie, la violence et la compromission. Dès la fin de 1843, La Fontaine commença à identifier le gouvernement responsable à la survivance. Ce n’était pas difficile ; le contrôle de l’exécutif par les porte-parole de la majorité constituait précisément la meilleure garantie que les institutions nationales des Canadiens français, menacées par les conclusions du rapport Durham, seraient dorénavant protégées. Le bref passage de La Fontaine au pouvoir en 1842 et 1843 l’avait démontré. Et pour reprendre le pouvoir, il fallait absolument garder l’unité. « Ce que nos compatriotes doivent craindre le plus dans les circonstances actuelles, et dans tous les temps, proclamait-il en tête de son programme pour 1844, c’est de se diviser. On ne saurait trop se pénétrer de cette grande vérité que l’Union fait la Force. Que ce mot soit pour eux, dans ce moment surtout, leur cri de ralliement. » Tous devaient être solidaires les uns des autres et les « traîtres » et « vendus » étaient ceux qui s’appliquaient à diviser les Canadiens français. La Fontaine était habile. En utilisant le thème de l’unité, il faisait bénéficier son parti de l’habitude qu’avaient les Canadiens français de voter en bloc. De plus, il usait de l’ironie. Lui qui était le champion du parlementarisme britannique et de l’Union était à faire coller sur le frère et le cousin du principal nationaliste de sa génération l’étiquette du « vendu ».
Cette idée que la survivance n’était assurée que si les Canadiens français votaient en bloc dans un effort collectif est demeurée, on le sait, un principe d’une importance presque capitale dans l’idéologie nationaliste québécoise.
L’habileté politique de La Fontaine apparaît également dans l’utilisation qu’il fit de la question linguistique. La proscription du français comme langue officielle par l’Acte d’Union avait été l’un des points les plus importants de la politique impériale d’assimilation et elle était probablement la mesure qui offensait le plus les Canadiens français. Conscient de l’inquiétude de ceux-ci, La Fontaine s’efforça d’associer son parti à la question de la langue et réussit ainsi à se gagner l’appui le plus complet de ses partisans. Il est vrai que si l’Acte d’Union n’autorisait pas l’usage officiel du français, les francophones se rendaient compte que, dans leurs activités quotidiennes, la loi avait peu d’effet. Ils continuaient de parler le français, de l’enseigner dans leurs écoles et leurs journaux l’utilisaient. En outre, bien que la langue française n’était pas reconnue officiellement au parlement, des fonctionnaires bilingues comme Étienne Parent, à l’instar de La Fontaine, rédigeaient leurs rapports en français, tandis que des notables tels que les évêques de Québec et de Montréal écrivaient dans leur langue maternelle au gouverneur général en poste et à son secrétaire. Plusieurs hommes politiques francophones prononcèrent leur premier discours au parlement en français. Et lorsque s’ouvrit la seconde législature de l’Union, en 1844, sir Charles Metcalfe restaura une vieille coutume du Bas-Canada en faisant lire par le greffier du Conseil législatif une version française officielle du discours du trône. Ce fut cette année-là que La Fontaine, chef de l’opposition, entreprit de mettre en évidence le problème linguistique – dans l’intention, dirent ses ennemis, de « s’attirer des applaudissements ».
Les partisans et les journaux pro-La Fontaine lui emboîtèrent le pas en rappelant le premier discours que le leader avait prononcé au parlement de la province du Canada, à Kingston, le 13 septembre 1842. Ayant commencé son allocution en français, La Fontaine avait été interrompu au bout de quelques phrases par un député qui lui demandait de s’exprimer en anglais. Après un moment de réflexion, il avait eu cette belle réplique : « A-t-il [ce député] oublié déjà que j’appartiens à cette origine si horriblement maltraitée par l’acte d’Union ? [...] Il me demande à prononcer dans une autre langue, que ma langue maternelle, le premier discours que j’ai à prononcer dans cette chambre ! Je me défie de mes forces à parler la langue anglaise. Mais [...] quand même la connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française, je n’en ferais pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes canadiens-français, ne fûsse que pour protester solennellement contre cette cruelle injustice de cette partie de l’acte d’Union qui tend à proscrire la langue maternelle d’une moitié de la population du Canada. Je le dois à mes compatriotes, je me le dois à moi-même. » À l’époque, l’incident n’avait guère retenu l’attention. Mais deux ans plus tard, les propagandistes de La Fontaine firent en sorte que pas un électeur canadien ne pût jamais l’oublier. Le chef de l’opposition ne rata aucune occasion de faire ressortir le problème de la langue. Jusqu’à la fin de la décennie, il parvint à faire dévier presque tous les débats de la chambre de telle manière qu’un vote en faveur de ses adversaires devenait un vote contre le français. Au milieu de l’année 1848, La Fontaine avait réussi à identifier son parti avec la question linguistique ; le nouveau gouverneur général, lord Elgin [Bruce], se plaignait même qu’il ne parlait d’aucun autre sujet. Lorsqu’il arriva enfin au pouvoir, il décida d’inaugurer son mandat en annonçant une nouvelle politique linguistique. À cette fin, il demanda à lord Elgin de lire le discours du trône en français à l’ouverture de la législature, le 18 janvier 1849.
La Fontaine était sans doute sincère. Dans ses lettres des grandes circonstances comme dans ses communications officielles qui n’étaient pas publiques, il se faisait un devoir d’utiliser le français. Ses rapports en tant que procureur général étaient bilingues, de même que ses lettres de démission comme chef du gouvernement en 1843 et en 1851 et sa lettre de remerciement à lord Elgin lors de sa nomination comme baronnet. Graduellement, il en vint au nationalisme, d’abord par esprit de parti, surtout lorsqu’il se retrouva dans l’opposition, et, après quelques années, par ambition personnelle. Dans sa correspondance des années 1837 et 1838, dans son « Adresse aux électeurs de Terrebonne », puis dans ses échanges avec Hincks, il se montre soucieux d’obtenir des réformes devant satisfaire et servir les deux Canadas. C’était en termes strictement politiques qu’il avait analysé les problèmes des Canadiens français. Mais, en 1854, il en viendra à confondre le politique et le social avec le national... et avec ses intérêts personnels. En acceptant son titre de baronnet, il écrira à lord Elgin une lettre où les distinctions d’antan se seront bien amenuisées : « Je serai le premier Canadien-français auquel cette dignité aura été conférée. Je suis également le premier, et de plus, le seul, canadien-français qui ait été fait Procureur-Général et Juge-en-Chef de mon pays natal. [...] Soyez convaincu, My Lord, que je sais apprécier les motifs qui vous ont fait agir en cette occasion comme dans bien d’autres, le désir de prouver à mes compatriotes d’origine française qu’il n’y a plus pour eux d’infériorité politique ou sociale, et que toutes les portes lui sont ouvertes comme à leurs concitoyents d’autre origine. » Il semble cependant avoir eu certaines réticences à prendre des positions nationalistes. Quelques semaines après sa démission en 1851, alors que le Journal de Québec adoptait un style nettement nationaliste sur une question administrative, il rappela à Joseph Cauchon certaines réprimandes du passé. Celui-ci répondit : « Je me rappelle ce que vous m’avez dit par rapport à la question nationale ; mais je vous répondais que c’était la seule corde qu’il était possible de faire vibrer avec succès. » Et La Fontaine, avec son sens aigu des réalités, accepta l’inévitable... et son titre héréditaire de baronnet.
C’est sans doute le même réalisme qui le porta à structurer la machine électorale de son parti. Il savait comment se gagnaient les élections. Étant dans l’opposition, il avait mis sur pied un réseau d’agents qui, dans chaque comté, pouvait à tout moment le tenir au courant des opinions, des préjugés, des besoins et des désirs de la population. En période électorale, ces agents se transformaient facilement en orateurs et en candidats. Durant les premiers mois de 1844, il pria Hincks de venir s’installer à Montréal pour coordonner les opérations. Avec l’aide d’organisateurs comme Joseph Cauchon pour la région de Québec et George-Étienne Cartier* à Montréal, le réformiste haut-canadien monta une équipe toujours prête, durant les bagarres et les émeutes, à acclamer les « bons » candidats, à investir les bureaux de votation et à assommer les adversaires. L’équipe fit ses preuves lors d’une élection partielle à Montréal en avril 1844, et, plus tard, durant les élections générales de 1844 et de 1847–1848. Composée de Canadiens français et d’Irlandais, cette équipe donna aux luttes électorales une atmosphère de champ de bataille, surtout à Montréal où les tories avaient précédemment remporté leurs plus belles victoires.
L’équipe de Canadiens français et d’Irlandais était aussi catholique. Doucement, et peut-être par inadvertance, La Fontaine se retrouva, vers la fin de ses années d’opposition, à la tête d’un parti qui s’appuyait de plus en plus sur les milieux cléricaux. Après 1843, ses partisans avaient commencé à se rapprocher du clergé qui en était venu graduellement à voir d’un meilleur œil les hommes politiques. Tout comme ces derniers avaient besoin de l’appui clérical auprès des électeurs, le clergé savait quant à lui qu’il devait abandonner ses vieilles manières d’agir. L’Union avait marqué la fin de ce style courtois et aristocratique par lequel les évêques de Québec et les gouverneurs britanniques avaient si soigneusement fusionné les intérêts de l’autel et du trône. Maintenant que le véritable pouvoir politique était en train de glisser des mains du gouverneur à celles des électeurs, le clergé, s’il voulait que l’Église continue d’exercer l’influence qu’il croyait sincèrement lui être due, devait commencer à traiter directement avec les électeurs et avec les hommes politiques. Ces derniers étaient donc reçus de plus en plus cordialement au séminaire et à l’évêché, et La Fontaine lui-même gagna la considération de l’épiscopat, en particulier du nouvel évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget*.
Malgré un premier mouvement de méfiance, Mgr Bourget et La Fontaine étaient nés pour s’entendre. Leaders autoritaires et sévères, ils avaient tous deux le même caractère opiniâtre, le même sens profond du devoir et la même habileté à manœuvrer. En 1845 et 1846, le débat sur les projets de loi relatifs à l’éducation et aux biens des jésuites amena les partisans de La Fontaine et le clergé à s’allier définitivement. C’est grâce à l’opposition de La Fontaine que la loi sur l’éducation donna satisfaction aux ultramontains. La discussion autour des biens des jésuites contribua à élargir le fossé existant entre les partisans de Denis-Benjamin Viger et du clan Papineau d’une part, et ceux des clercs et de La Fontaine d’autre part. Viger s’appuyait sur la doctrine libérale pour revendiquer le droit de l’État de disposer comme il lui plairait des biens des jésuites tandis que La Fontaine et ses partisans soutenaient que ces revenus appartenaient de droit à l’Église. Après 1846, le clergé sera l’une des grandes forces sociales favorables au principe du gouvernement responsable.
Dans quelle mesure La Fontaine avait-il dû transiger avec sa conscience ? C’est difficile à dire. Jeune, il avait la réputation d’être un anticlérical. Mais en même temps il semble avoir rempli régulièrement ses devoirs religieux. Dans les dîners officiels, il faisait un grand signe de la croix avant de s’asseoir à table ; et il lui est arrivé de se prosterner en pleine rue devant le Saint-Sacrement que l’on portait publiquement pour la communion des malades. En 1855, il accepta le titre de chevalier commandeur dans l’ordre pontifical de Saint-Sylvestre que Mgr Bourget lui fit décerner par Pie IX. La Fontaine reçut cependant cette décoration avec une pointe d’humour qui laisserait croire que sa pratique religieuse publique n’était peut-être pas tout à fait sincère. « Quant à moi, confia-t-il à son ami, l’historien français Pierre Margry, je ne saurais vous dire à quoi je dois attribuer mon parchemin et mes deux croix, si ce n’est à ma dévotion bien connue, ce dont vous ne vous seriez jamais douté, je pense. » Lors de sa mort en 1864, un autre ami, le pieux abbé Étienne-Michel Faillon, écrira au même Margry : « Voilà comment il est mort, après avoir renvoyé de jour en jour son retour à Dieu [...]. Il s’est sacrifié pour les autres, n’a laissé que fort peu de biens ; et avec tout cela, n’a rien fait pour Dieu et s’est présenté devant lui les mains vides. »
De toute manière, La Fontaine, chef de l’opposition, subit les pressions à la fois de ses adversaires et de ses partisans. Il se trouva graduellement impliqué dans une alliance avec l’Église. Il avait voulu rompre avec le nationalisme particulariste et républicain des Patriotes et, en 1840, il avait dénoncé les dangers de la nation fermée sur elle-même. En 1848, il se retrouva à la tête d’un parti qu’il avait unifié et bien structuré, mais qui s’orientait à nouveau vers un particularisme tout aussi rigide que celui des républicains des années 1830.
Lors des élections de 1847–1848, La Fontaine et ses partisans remportèrent une victoire éclatante. Il fut lui-même élu à Montréal avec une majorité de 1 400 voix et, dans l’ensemble du Bas-Canada, ses partisans recueillirent quelque 32 comtés sur 40. Dans le Haut-Canada, les réformistes de Baldwin firent élire 23 des leurs. Le nouveau gouverneur, lord Elgin, reconnut qu’il fallait enfin instaurer la responsabilité ministérielle. Il acceptait de confier la direction du gouvernement au chef du parti majoritaire en chambre et de s’engager à suivre ses directives. Au début de mars 1848, La Fontaine fut donc assermenté comme procureur général. Il était le premier Canadien à devenir premier ministre et le premier Canadien français élu par les siens pour diriger leurs aspirations nationales.
Arrivé au pouvoir, La Fontaine poursuivit donc le travail interrompu lors de sa démission en 1843. Les exilés bas-canadiens étaient maintenant de retour au pays ; plusieurs d’entre eux étaient même venus le remercier personnellement de ses efforts en leur faveur. Il restait les indemnités à payer aux victimes de la soldatesque de sir John Colborne.
Pour La Fontaine, le projet de loi visant à indemniser ceux qui avaient subi des pertes durant la rébellion n’était que justice. Il s’agissait de dissiper enfin l’amertume de 1837 en posant un geste libéral et généreux. Toutefois, parmi les commerçants de Montréal, déjà éprouvés par une sérieuse crise économique, et les hommes politiques du parti tory qui venaient de perdre la direction politique du Bas-Canada pour la première fois depuis 1791, nombreux étaient ceux pour qui la question prit un caractère symbolique. Ils réagirent avec la fureur primitive et déchaînée qui est le propre des gens qui viennent d’être dépossédés. Lorsque lord Elgin donna la sanction royale au projet de loi, le 25 avril 1849, une bande d’émeutiers fit irruption dans l’édifice du parlement et y mit le feu. Le lendemain, les émeutiers se précipitèrent chez La Fontaine, forcèrent l’entrée de la maison, brisèrent les boiseries et le riche mobilier de style, arrachèrent les appuis des fenêtres et les volets, éventrèrent les planchers et fracassèrent les articles de porcelaine et de verre. Ils mirent le feu aux écuries, brûlèrent plusieurs voitures et déracinèrent une douzaine de jeunes arbres du verger. Plus tard, en août, quelques adversaires de La Fontaine furent arrêtés et la bande revint à la demeure du procureur général. Cette fois, il était prêt : dans l’obscurité de la maison, plusieurs de ses amis, dont Étienne-Paschal Taché et Charles-Joseph Coursol*, étaient aux aguets derrière les volets, armés de fusils. Au moment où la foule en désordre se dirigeait vers la porte d’entrée, des coups de feu retentirent de part et d’autre ; avant que les émeutiers n’aient pris la fuite, il y eut parmi eux six blessés et un mort, William Mason. Le bruit courut dans la ville que La Fontaine allait être assassiné. On l’attaqua par deux fois dans la rue et on mit le feu à l’hôtel Cyrus pendant qu’il faisait une déposition à l’enquête tenue au sujet de la mort de Mason.
Aux yeux de La Fontaine, les émeutes de 1849 étaient manifestement la contrepartie de la rébellion qui avait éclaté dix ans plus tôt. Si l’on considère non pas tant les pertes de vie que l’amertume de la population et les dommages à la propriété, il appert, en effet, que la réaction des anglophones de Montréal était comparable à plusieurs égards aux actes violents de 1837–1838. Ces émeutes entraînèrent même des demandes d’indemnités ; les partisans de La Fontaine réclamèrent les montants suivants pour la perte de leurs biens : Morin et Francis Hincks, £34 chacun, les sœurs grises, £65, et La Fontaine lui-même, £716. Cependant, ils n’adressèrent pas leurs demandes au gouvernement provincial, mais à l’administration municipale de Montréal que dirigeait Édouard-Raymond Fabre*, adversaire politique de La Fontaine. À l’automne, le calme était revenu. Mais ces outrages contre sa personne et ses biens ne firent évidemment qu’ajouter au prestige du premier ministre.
Durant son administration, de mars 1848 à octobre 1851, La Fontaine confia les questions économiques et commerciales à Hincks, et la réforme judiciaire ainsi que l’exploitation des terres dans le Haut-Canada à Baldwin. Il se réserva la responsabilité des tribunaux et la distribution des faveurs politiques dans le Bas-Canada. Aussi, dès la première session du nouveau parlement, il présenta des projets instituant une cour d’appel de quatre juges, la Cour du banc de la reine. Il créa en outre la Cour supérieure comme tribunal de première instance et une Cour de circuit pour les petites causes. C’est en 1849–1850 que les grandes lignes de l’organisation judiciaire du Bas-Canada furent tracées.
Dans la gérance du patronage, le premier ministre utilisa son réseau d’agents et s’appuya sur les conseils de ses organisateurs, Caron, Cauchon, Cartier et Drummond. Par une judicieuse distribution de postes, il voulait s’assurer que tous les Canadiens français soient impliqués d’une façon permanente dans le nouveau régime politique autonome. Pendant deux générations, les membres des professions libérales canadiennes-françaises avaient lutté pour obtenir un moyen de réaliser leurs ambitions ; dès lors, tels des bactéries, ils se mirent à envahir tous les organismes essentiels du gouvernement ; des centaines d’entre eux devinrent juges, conseillers de la reine, juges de paix, examinateurs en médecine, inspecteurs d’écoles, capitaines de milice, commis des postes et postillons. Et à mesure que les privilèges et les salaires attachés à ces fonctions s’étendirent aux autres classes de la société, les Canadiens français purent se rendre compte que le gouvernement responsable n’était plus seulement un idéal à atteindre : c’était aussi une réalité profitable. Ainsi, grâce à La Fontaine, tous les Canadiens français obtenaient une chance d’accéder aux plus hautes sphères de la politique.
Le premier ministre eut aussi à subir des échecs. Trois fois, en 1849, en 1850 et en 1851, il soumit à la chambre un projet de loi visant à augmenter le nombre des députés de 42 à 75 pour chacune des sections de la province. Il tenait à ce que la représentation du Haut et du Bas-Canada demeure égale, et il voulait qu’à l’intérieur de chacune des sections, les localités soient également représentées. Son projet ne recueillit jamais la majorité des deux tiers des voix. En 1850 et en 1851, La Fontaine se retrouva encore en minorité sur les questions des « réserves » du clergé et de la tenure seigneuriale. Il était absolument décidé à respecter les droits acquis. Il savait que ses partisans ultramontains craignaient que le mouvement de sécularisation en vigueur au Haut-Canada ne se répande dans le Bas-Canada. « Comme l’appétit vient en mangeant, lui écrivit Drummond au sujet des laïcisants du Haut-Canada, ces sectaires affamés, après avoir partagé les biens du clergé, n’hésiteront peut-être pas à porter une main sacrilège sur les propriétés privées de nos communautés religieuses. »
Au sujet du régime seigneurial, La Fontaine était tout à fait favorable à sa réforme, voire à son abolition. C’est ce qu’il avait déjà proposé dans son « Adresse aux électeurs de Terrebonne » en 1840. Mais depuis ce temps, ses alliances l’avaient mené au conservatisme. Il insista donc pour que les seigneurs soient indemnisés. Le 14 juin 1850, il proposa à la chambre la création d’un comité, présidé par Drummond, avec mandat de préparer un projet de loi. L’année suivante, quand le comité proposa de racheter les droits des seigneurs en les contraignant d’accepter un montant fixé par la législature, La Fontaine allégua qu’il s’agissait là d’un acte de confiscation. Finalement, il réussit à faire remettre cette question-là aussi ; mais, entre-temps, sur une question de procédure, il se retrouva pour la première fois depuis l’Union dans la minorité des Canadiens français. Huit députés seulement votèrent avec lui, alors que ses meilleurs alliés, dont Drummond, Cauchon et Cartier, étaient dans la majorité.
Autoritaire, il accepta difficilement la défaite. Aussi résolut-il de donner sa démission. Depuis plusieurs mois, d’ailleurs, il était fatigué et malade. L’humidité des hivers torontois, qu’il devait supporter depuis que la capitale avait été retransférée dans le Haut-Canada en 1850, avait aggravé son rhumatisme. Il était surchargé de travail et affligé par l’insomnie et des maux de tête. Déjà, le 6 mars 1850, il écrivait à Joseph-Amable Berthelot que si le paradis était acquis à ceux qui n’éprouvent que des tribulations en cette vie, il obtiendrait sûrement son passeport. En novembre 1850, il confia à lord Elgin qu’il était dégoûté de la vie publique. Puis, durant l’hiver de 1851, son épouse commença elle aussi à se plaindre de rhumatisme. La démission de Baldwin le 27 juin 1851, puis celle de Hincks le 15 septembre l’accablèrent profondément. Après une dernière réunion du Conseil exécutif, tenue exceptionnellement aux chutes Niagara, il remit sa démission à lord Elgin, le 26 septembre 1851.
Il avait atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés dans les années 1837–1840. L’Union était acceptée ; les rebelles étaient amnistiés et les victimes, indemnisées ; la responsabilité ministérielle obtenue. Il avait mis en place les structures qui allaient permettre à Jean-Baptiste Meilleur* d’entreprendre la réforme de l’éducation, à Morin d’effectuer la transformation du régime seigneurial et d’obtenir l’électivité du Conseil législatif, et au clergé d’organiser des mouvements de colonisation. Il avait réussi à stimuler et à coordonner l’activité de ses collègues. Et son plus grand succès avait été de traduire dans les institutions l’espoir social de la bourgeoisie libérale.
À Montréal, La Fontaine retourna à la pratique du droit avec son ancien associé Joseph-Amable Berthelot. Sa réputation d’orateur logique, ferme et précis le précéda en cour où les étudiants en droit et les jeunes avocats se rendaient souvent l’entendre plaider. On admirait son sang-froid, sa maîtrise de soi : il persuadait par la force de ses idées plutôt que par la sonorité de ses phrases ou par l’élan de sa parole. Son influence s’exerça aussi dans les milieux d’affaires. Lors du grand feu de Montréal en 1852, c’est lui qui fut choisi par la corporation de la ville pour négocier un emprunt. Puis, après la mort de sir James Stuart*, il fut nommé, le 13 août 1853, juge en chef de la Cour du banc de la reine, tribunal qu’il avait lui-même restructuré en 1849. Il y siégea pour la première fois, le 1er juillet 1854.
Durant toute la dernière décennie de sa vie, la maladie devait cependant l’accabler. « À 40 ans, on est encore jeune, écrivit-il à Pierre Margry le 4 novembre 1859 ; à 52, avec une santé qu’affaiblit de jour en jour une vie trop sédentaire qui a déjà ruiné la constitution la plus forte qu’il fut donné à un pauvre mortel de posséder, l’on s’aperçoit que les années sont comptées. » Ses cheveux étaient devenus blancs, et il commençait à prendre du poids. Au début des années 1860, son obésité lui était devenue pénible.
Pour rétablir sa santé, il voyagea. Pendant presque un an, de l’été de 1853 jusqu’au printemps de 1854, il fit « le grand tour », s’arrêtant à Londres où il séjourna avec lord Elgin, à Florence et à Rome où il fut reçu en audience par Pie IX. Il se fixa plusieurs mois à Paris, visitant les musées et les galeries. C’est lors de ce séjour que sa ressemblance avec Napoléon Ier provoqua l’émotion des vieux grognards des Invalides. C’est également lors de ce voyage qu’il se lia d’amitié avec l’historien Pierre Margry, qui deviendra un correspondant fidèle et intéressant. En 1862–1863, il effectua un second séjour de dix mois à Paris pour s’y faire soigner ; son beau-frère, Charles-François-Calixte Morrison, curé de Napierville, l’accompagnait. Entre-temps, en 1855, 1856, 1857 et 1859, il avait dû s’aliter à la suite d’attaques de rhumatisme, « un vilain compagnon qui persiste à me faire des visites ». Mais c’est lady La Fontaine qui mourut avant lui. Âgée de 46 ans, elle décéda le 27 mai 1859 après une longue maladie.
Le 30 janvier 1861, il se remaria dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce (Montréal), avec Julie-Élizabeth-Geneviève (Jane) Morrison, âgée de 39 ans, veuve de Thomas Kinton, officier du génie dans l’armée britannique, et mère de trois filles âgées de 10, 8 et 6 ans. Elle était originaire de Maskinongé et descendante des premiers Boucher. La Fontaine, qui depuis sa retraite de la vie politique s’intéressait à la généalogie, écrivit à Margry : « Ainsi elle et moi, nous avons un ancêtre commun. » La nouvelle lady La Fontaine soigna son époux durant ses dernières années : il parlera d’elle comme de sa « sœur de charité ». Elle lui donna aussi la joie d’être père. Le 11 juillet 1862 naîtra un fils, Louis-Hippolyte.
Appelé à présider le tribunal spécial de 13 juges formé en 1855 pour juger les réclamations qui suivirent la loi de 1854 relative au régime seigneurial, La Fontaine commença à se passionner pour l’histoire de la féodalité et du droit civil au Canada. Il caressa l’espoir de publier une étude scientifique sur les coutumes de la Nouvelle-France et du Bas-Canada. Sa correspondance témoigne des nombreuses démarches effectuées auprès des généalogistes et archivistes de France, d’Angleterre et du Canada. « Je tourne et retourne, écrivit-il à Margry le 4 novembre 1859, les Régistres des paroisses de Québec, Montréal, et 3 Rivières. » De la politique, il était tout à fait las. Déjà, en 1853, il manifestait son désenchantement. En visite à Florence, il avait rencontré le peintre Napoléon Bourassa*. « Votre sortie de la politique, demanda le jeune homme, a dû susciter en notre pays un profond mouvement ? » « En fait de mouvement, mon jeune ami, avait répondu La Fontaine, je n’ai vu que celui des gens qui s’en venaient prendre ma place. »
Il commença à fréquenter des historiens et des littéraires comme l’abbé Faillon, Jacques Viger*, Georges-Barthélemi Faribault et François-Xavier Garneau. En 1859, il publia un essai sur l’esclavage au Canada et, entre 1860 et 1864, plusieurs articles non signés sur la généalogie. Il collaborait régulièrement à la Minerve et aux Annales de la Société historique de Montréal. Son histoire du droit devait cependant demeurer inachevée.
Le 25 février 1864, La Fontaine fut frappé d’apoplexie dans la chambre des juges. Transporté chez lui, il prit son fils dans ses bras, fit un signe de la croix et perdit connaissance. Il reçut l’extrême-onction des mains du grand vicaire, Alexis-Frédéric Truteau*, et expira durant la nuit. Ses funérailles, présidées par Mgr Bourget, rassemblèrent quelque 12 000 personnes. Lady La Fontaine accoucha d’un deuxième fils le 15 juillet suivant mais il devait mourir en 1865 ; son frère aîné, Louis-Hippolyte, le suivit dans la tombe en 1867. Lady La Fontaine vécut jusqu’en 1905.
Pour les Canadiens français, l’action de La Fontaine mit un terme à l’époque des revendications stériles du nationalisme à la Papineau. Elle ouvrit des voies nouvelles dans les domaines de l’administration, du droit, de l’éducation, du peuplement et de la politique. Elle prouva la puissance de l’unité nationale et de la collaboration de ceux que l’histoire et la géographie avaient rassemblés. Malgré l’Acte d’Union nettement dirigé contre les Canadiens français, La Fontaine sut démontrer que la survivance culturelle dépendait non de textes constitutionnels mais d’abord du vouloir-vivre collectif et de l’enthousiasme engendré par la réforme. Convaincu de l’interdépendance des deux Canadas et refusant de suivre ceux qu’il jugeait mal comprendre la vraie grandeur, il traduisit dans les faits et fit passer aux générations futures sa confiance que leur épanouissement culturel se trouvait rattaché à la vitalité et à la souplesse du système parlementaire de la Grande-Bretagne. Grâce à lui est né un espoir immense et nouveau.
Parce qu’il choisit d’affirmer ses aspirations nationales en mettant à profit le système parlementaire britannique, La Fontaine fit mieux que d’assurer la survivance culturelle des Canadiens français. Il devint également l’un des fondateurs du futur Commonwealth des nations. En effet, moins d’un siècle après que les Canadiens français eurent résolu leur problème national au moyen de l’évolution politique plutôt que de la révolte armée, d’autres peuples sur des continents dont les habitants du Canada des années 1830 et 1840 connaissaient à peine le nom adoptèrent le même processus en vue d’accomplir leur destin national et, comme les Canadiens français, parvinrent non seulement à obtenir collectivement leur liberté en vertu des propres principes de leurs maîtres, mais purent aussi passer d’une manière pacifique de l’état de gouvernés à celui de gouvernants. C’est ainsi que les diverses étapes de la carrière de La Fontaine – nationalisme radical, emprisonnement pour cause de rébellion, attitude plus modérée et accession au poste de premier ministre d’une nation autonome – devinrent, un siècle plus tard, le cheminement caractéristique des leaders coloniaux dans la plupart des pays du Commonwealth.
Le Canada tout entier lui est redevable d’une tradition qui subsiste toujours : la démocratie parlementaire dont il est l’un des précurseurs ou, mieux encore, le Fons et origo (Source et origine) – pour reprendre la devise qu’il avait choisie, en s’inspirant de son nom de famille, quand il avait été fait baronnet.
Il fut un personnage étrange : obstiné, introverti, pragmatique, ambitieux. Il eut peu d’amis. Il aima cependant son pays non pas d’une passion impétueuse, mais d’une affection solide et soutenue. On pouvait difficilement l’aimer, mais il était encore plus difficile de ne pas l’admirer.
Les documents les plus importants sur Louis-Hippolyte La Fontaine se trouvent dans la Collection La Fontaine, conservée à la Bibliothèque nationale du Québec (Montréal), dans les Robert Baldwin papers, à la MTCL, et dans les papiers de Henry Vignaud à la William L. Clements Library (University of Michigan, Ann Arbor), où sont déposées les lettres adressées à Pierre Margry.
D’autres fonds d’archives renferment aussi des documents significatifs sur la vie et l’œuvre de La Fontaine : aux APC, la correspondance des gouverneurs (MG 24), particulièrement les Elgin-Grey papers (MG 24, A 10, 21–37) ; aux ANQ-Q, la Collection Papineau (AP-G–417) et les papiers Langevin (AP-G–134) ; aux AAQ et aux ACAM, la correspondance des évêques Signay, Lartigue et Bourget. De plus, les journaux de l’époque contiennent une multitude de renseignements et de détails sur l’activité de La Fontaine.
La Fontaine est l’auteur de : les Deux Girouettes, ou l’hypocrisie démasquée (Montréal, 1834) ; Notes sur l’inamovibilité des curés dans le Bas-Canada (Montréal, 1837) ; Analyse de l’ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d’hypothèques [...] (Montréal, [1842]). En collaboration avec Jacques Viger, il rédigea aussi De l’esclavage en Canada (Montréal, 1859).
Les biographies de La Fontaine par L.-O. David, Sir Ls. H. Lafontaine (Montréal, 1872), par A.-D. De Celles, Lafontaine et son temps (Montréal, 1907) et par S. B. Leacock, Baldwin, Lafontaine, Hincks ; responsible government (Toronto, 1907) sont maintenant dépassées par les travaux plus récents de W. G. Ormsby, The emergence of the federal concept in Canada, 1839–1845 (Toronto, 1969), de [M.] E. [Abbott] Nish, Double majority : concept, practice and negotiations, 1840–1848 (thèse de m.a., McGill University, Montréal, 1966) et de Jacques Monet, Last cannon shot. On trouvera, dans ce dernier ouvrage, une bibliographie plus détaillée sur Louis-Hippolyte La Fontaine. [j. m.]
Correspondence between the Hon. W. H. Draper and the Hon. R. E. Caron ; and, between the Hon. R. E. Caron, and the Honbles. L. H. Lafontaine and A. N. Morin [...] (Montréal, 1846).— Hommages à La Fontaine ; recueil des discours prononcés au dévoilement du monument de sir Louis Hippolyte La Fontaine en septembre 1930 [...], Clarence Hogue, édit. (Montréal, 1931).— Lettres à Pierre Margry de 1844 à 1886 (Papineau, Lafontaine, Faillon, Leprohon et autres), L.-P. Cormier, édit. (Québec, 1968), 13–55.— Catalogue de la bibliothèque de feu sir L. H. Lafontaine baronnet, juge en chef, etc. [...] (Montréal, [1864]).— Réjane Soucy, Bio-bibliographie de sir Louis-Hippolyte Lafontaine, bart. (thèse de bibliothéconomie, université de Montréal, 1947).— Olivier Maurault, Louis-Hippolyte La Fontaine à travers ses lettres à Amable Berthelot, Cahiers des Dix, 19 (1954) : 129–160.
Bibliographie de la version modifiée :
Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, CE601-S6, 31 janv. 1861 ; CE601-S22, 4 oct. 1807 ; CE601-S51, 29 fév. 1864 ; Centre d’arch. de Québec, CE301-S1, 9 juill. 1831.— L’Aurore des Canadas (Montréal), 28 août 1840.— Canada Gazette (Kingston), 17 sept. 1842.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Jacques Monet, « LA FONTAINE (Ménard, dit La Fontaine), sir LOUIS-HIPPOLYTE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 5 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/la_fontaine_louis_hippolyte_9F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/la_fontaine_louis_hippolyte_9F.html |
| Auteur de l'article: | Jacques Monet |
| Titre de l'article: | LA FONTAINE (Ménard, dit La Fontaine), sir LOUIS-HIPPOLYTE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1977 |
| Année de la révision: | 2023 |
| Date de consultation: | 5 avr. 2025 |