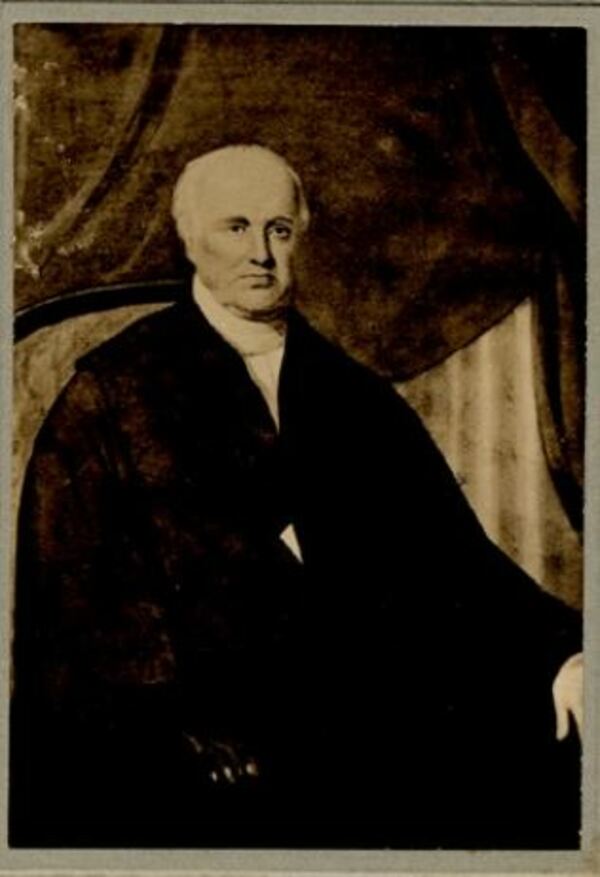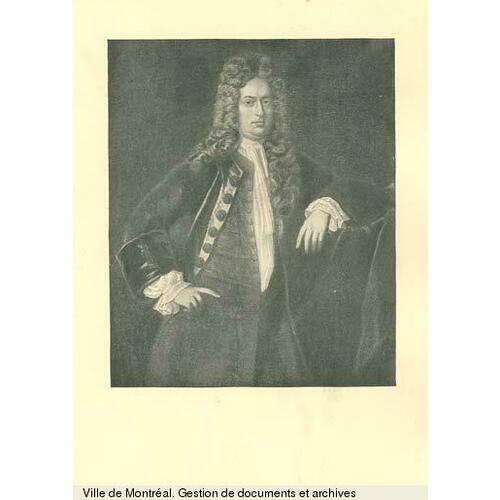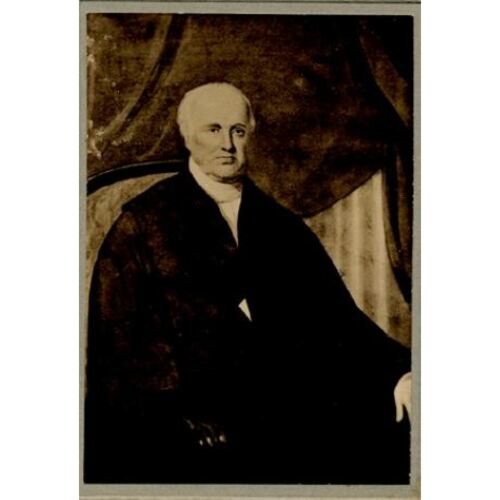POWELL, WILLIAM DUMMER, avocat, juge, fonctionnaire. homme politique et auteur, né le 5 novembre 1755 à Boston, fils aîné de John Powell et de Janet Grant ; le 3 octobre 1775, il épousa Anne Murray*, et ils eurent neuf enfants ; décédé le 6 septembre 1834 à Toronto.
William Dummer Powell était issu, tant du côté paternel que du côté maternel, d’immigrants anglais installés au Massachusetts au xviie siècle. Son grand-père maternel, William Dummer, avait été lieutenant-gouverneur de la colonie, et son grand-père paternel, John Powell, l’avait suivi en qualité de secrétaire. Marchand prospère à Boston, son père, nommé aussi John Powell, fut l’un des fournisseurs de la marine durant les trois décennies qui précédèrent la Révolution américaine. Par tradition, les Powell étaient anglicans et royalistes, les Dummer, presbytériens et partisans du parlementarisme. En vertu d’une convention entre ses parents, John Powell fils reçut sa formation religieuse dans l’Église d’Angleterre, tandis que ses deux jeunes frères furent élevés dans le congrégationalisme. Même à la veille de la Déclaration d’indépendance, il subsistait au sein de la famille une opposition politique, John Powell étant un loyaliste avoué et ses deux frères, des rebelles.
À cette époque, William Dummer Powell avait terminé ses études et s’interrogeait sur la voie qu’il allait emprunter. Après avoir passé trois ans à la Boston Free Grammar School, il avait été envoyé pendant quatre ans dans une école anglicane de Tunbridge (Royal Tunbridge Wells, Angleterre), puis à Rotterdam (Hollande) où il avait étudié le français et le néerlandais pendant deux ans. Alors âgé de 16 ans, il était retourné passer un an en Angleterre, où il avait « cultivé plus que tout les bonnes grâces des dames » ; en 1772, il était rentré à Boston parce que l’état de santé de son père suscitait de l’inquiétude. Comme il l’admit plus tard, il était loin d’être un élève assidu : au terme de ses études, il parlait couramment le français, adorait le cricket et avait pour les classiques latins un goût qu’il devait conserver mais, apparemment, c’était à peu près tout. On ne badinait guère chez les Powell, et si les lettres de William à ses parents ne révèlent pas un jeune homme particulièrement studieux, il s’y montre sérieux et plutôt collet monté. Déjà, en réagissant avec véhémence à une fausse rumeur qui circulait à l’école de Tunbridge selon laquelle son père était insolvable, il manifestait le souci du rang social qui allait le caractériser toute sa vie.
De retour à Boston et une fois passé l’accès de fièvre rhumatismale de son père, Powell se mit à lorgner du côté du commerce. Son père se montra peu disposé à lui céder une partie du contrat d’approvisionnements qu’il avait passé avec la marine, et un projet qui aurait consisté à se lancer en affaires avec des parents de sa mère à Londres échoua. Il visita Montréal au cours de l’été de 1773, puis la Pennsylvanie et New York l’année suivante. Il passa ses hivers à étudier le droit auprès du procureur général du Massachusetts, Jonathan Sewell (Sewall), mais son but était de se préparer à la vie publique, non à une carrière d’avocat. En 1774, il caressa l’espoir de se lancer dans les affaires à New York, où le sentiment anti-impérial était moins répandu qu’à Boston, mais il dut interrompre son voyage lorsque sa mère, à laquelle il était très attaché, mourut de la petite vérole. Une fois revenu à Boston, il s’engagea dans l’action politique en organisant avec d’autres la publication d’une déclaration de citoyens loyaux contre le parti révolutionnaire, qui parut le 19 avril 1775. Il s’engagea comme volontaire dans la garnison britannique, mais il ne participa apparemment à aucun engagement. Comme la rébellion ouverte approchait et qu’il était trop reconnu comme antirévolutionnaire pour pouvoir composer avec les rebelles, il décida de quitter l’Amérique du Nord. Il avait fait la connaissance de la fille d’un médecin écossais, Anne Murray, qui était venue vivre chez des parents à Boston. Ils se marièrent en octobre 1775 et partirent aussitôt pour l’Angleterre où ils s’installèrent près de la famille Murray, à Norwich.
John Powell les rejoignit moins d’un an plus tard et élut résidence à Ludlow, dans le comté de ses ancêtres, le Shropshire. Il subvenait toujours aux besoins de son fils, mais avec plus de difficulté qu’auparavant, surtout à cause de la faillite d’une plantation dans laquelle il avait beaucoup investi, aux Antilles. Une partie des propriétés qu’il possédait à Boston fut confisquée le 30 avril 1779 en vertu d’une loi adoptée cette année-là, qui le classait comme absentéiste plutôt que comme traître. Évaluée à £902 1s 2d, la partie confisquée alla à son frère William, qui s’était rangé du côté des rebelles et qui avait avancé £1 000 à John quand celui-ci avait quitté Boston. Une autre loi, adoptée dans le Massachusetts en 1784, allait autoriser les absentéistes à réclamer leurs biens. William Dummer Powell l’invoquerait à plusieurs reprises, sans jamais parvenir à récupérer la totalité de la succession paternelle, et s’en plaindrait toute sa vie ; néanmoins, il semble que la famille Powell put garder la plus grande partie des propriétés immobilières détenues par Powell père aux États-Unis, en dépit du fait qu’il était loyaliste. Il était clair cependant que William Dummer Powell devait embrasser une carrière pour assurer lui-même la subsistance de sa famille de plus en plus nombreuse.
Powell qui se trouvait en concurrence avec d’autres loyalistes ne réussit pas à obtenir un poste dans la fonction publique, et un deuxième projet d’entreprise avec un des parents de sa mère (cette fois en Jamaïque) échoua. Il opta donc pour le droit. Dès mai 1779, il avait fait, au Middle Temple, les études exigées pour devenir avocat mais, incapable de payer les frais, il retarda jusqu’au 2 février 1784 son admission officielle au barreau d’Angleterre. Un autre parent de sa mère, William Grant, ancien procureur général de la province de Québec, lui ayant recommandé cette colonie, il débarqua à Québec en août 1779.
Powell obtint l’autorisation de pratiquer le droit, mais il ne reçut pas du gouverneur Frederick Haldimand* la protection qu’il avait espérée. Sur l’avis du procureur général, James Monk, et du sous-commissaire général, Isaac Winslow Clarke (un autre loyaliste de Boston, qui épousa par la suite sa sœur Anne), il ouvrit un cabinet à Montréal. Cette décision se révéla judicieuse. Centre commercial en pleine expansion, Montréal comptait quelque 15 000 habitants mais à peine une demi-douzaine d’avocats. Powell réussit assez bien pour faire venir sa famille, pour acheter une maison sur le mont Royal, pour exiger les plus hauts honoraires du barreau montréalais et peut-être même pour se passer de l’assistance de son père.
Pourtant, l’insatisfaction ne tarda pas à gagner Powell et ce, paradoxalement, en partie à cause de son succès même. Son premier client fut Pierre Du Calvet*, accusé de diffamation à l’endroit des juges de la Cour des plaids communs de Montréal. Du Calvet, mécontent d’un jugement de ce tribunal, avait publié une lettre dans laquelle il critiquait les juges, et il avait frappé l’un d’eux, John Fraser, qui l’avait attaqué. En dépit des conseils de Monk, qui l’avait prévenu qu’en s’occupant de cette poursuite en diffamation n’importe quel avocat se mettrait à dos tout le pouvoir judiciaire aussi bien que le gouverneur, Powell défendit Du Calvet et persuada le jury de l’acquitter. En janvier 1780, il remporta une autre victoire, cette fois devant un tribunal des sessions trimestrielles sans jury. Il fut en mesure de montrer que la vieille loi anglaise invoquée par Haldimand contre les marchands de grains, qui avaient fixé leurs prix, avait été révoquée. Powell était prêt à braver aussi bien la désapprobation de la population que celle des autorités – il intenta des poursuites, en vertu de la loi sur la corvée, pour refus de transporter des ravitaillements militaires – mais ses succès lui valurent l’étiquette d’adversaire du gouvernement. Ni celui-ci ni les commerçants ne cessèrent de faire appel à ses services, mais c’était là un rôle qui convenait mal à un tory comme lui.
Powell était tout de même convaincu que l’Acte de Québec, promulgué en 1774, avait livré le gouvernement et l’administration de la justice à l’arbitraire, et en particulier qu’il fallait suivre l’exemple de l’Angleterre en matière de jurys et d’habeas corpus. Il allégua plus tard n’en avoir rien dit et avoir « incité les autres au silence et à la subordination », mais ses opinions étaient assez bien connues pour qu’il se trouve au nombre des délégués qui partirent de Québec le 25 octobre 1783 pour aller déposer en Angleterre une pétition contre l’Acte de Québec. La pétition ne donna aucun résultat immédiat mais, à son retour, Powell passa près d’un an à Boston. Il tenta de recouvrer la part confisquée des biens paternels. Il accepta de gérer pendant un temps les domaines de son oncle, le rebelle Jeremiah Powell, et espéra même, la paix étant revenue aux État-Unis, pouvoir se réinstaller à Boston sans renoncer à son allégeance à la couronne britannique. L’échec de ses démarches, ses espoirs déçus et la mort de son oncle le ramenèrent à Montréal au début de 1785.
Powell retrouva sa position au barreau et put constater que la plupart des motifs de son mécontentement avaient disparu. Une ordonnance du 29 avril 1784 avait introduit l’habeas corpus ; une autre datée du 21 avril 1785 autorisa les jugements par jury au civil, ainsi que le reconnaissait la common law. Mais surtout, peut-être, Haldimand était parti. Sir Guy Carleton*, devenu lord Dorchester, arriva en octobre 1786 pour entreprendre son deuxième mandat de gouverneur de la province de Québec. Sous son règne, Powell trouva enfin la faveur des autorités, non sans l’avoir méritée d’ailleurs. En 1787, on l’envoya avec un autre commissaire auprès des colons loyalistes du Haut-Saint-Laurent, afin de faire rapport sur le mécontentement de ces gens qui s’inquiétaient à propos de leurs titres de propriété ; il ne reçut aucune rémunération pour ce travail. Les deux commissaires recommandèrent de donner aux colons qui avaient mis leur terre en valeur la prime de 200 acres qui fut surnommée le « cadeau de lord Dorchester ». Powell rédigea le rapport de la commission qui fit une enquête semblable dans la seigneurie de Sorel. Il fit partie d’une commission qui devait fixer les frais de transport à réclamer aux commerçants de la partie ouest de la province qui avaient utilisé des navires du gouvernement pendant la guerre. Enfin, il dirigea une commission chargée d’enquêter sur les plaintes formulées contre le marchand québécois John Cochrane, qui avait fourni du numéraire à l’armée durant la guerre et était accusé de réaliser des bénéfices excessifs sur les lettres de change. La commission recommanda de rejeter les réclamations contre Cochrane et établit que les poursuites judiciaires intentées contre lui étaient irrégulières. Tout cela réveilla l’hostilité des juges en cause, Adam Mabane* et John Fraser, contre Powell. Mabane l’accusa d’avoir juré fidélité au gouvernement américain, mais on ne le crut pas. Powell reçut en concession les « quelques acres de terre » (en fait, 3 000 acres) que Mabane tentait de l’empêcher d’obtenir. Malgré les succès remportés depuis son retour à Montréal, il ne pouvait guère espérer obtenir un poste dans la magistrature.
Toute la portion de la province qui allait devenir le Haut-Canada en 1791 faisait encore partie du district de Montréal. À l’exception des juges de paix, qui étaient autorisés par groupe de deux à instruire des affaires de dettes lorsque la somme était de £5 ou moins, elle comptait une seule juridiction civile, la Cour des plaids communs de Montréal. Les colons loyalistes du Haut-Saint-Laurent avaient réclamé en 1785 la création d’une province distincte ; l’année suivante, les marchands de Montréal s’allièrent pour se plaindre de l’absence de tribunaux dans l’arrière-pays. Dorchester s’opposa à la création d’une autre province mais, le 24 juillet 1788, il délimita quatre nouveaux districts, tous dotés d’un tribunal des plaids communs. Le plus à l’ouest était celui de Hesse (rebaptisé district de Western le 15 octobre 1792). Trois juges, tous résidents de Detroit, y furent nommés : Jacques Baby*, dit Dupéront, et William Robertson* étaient marchands, tandis qu’Alexander McKee* occupait un poste de fonctionnaire au département des Affaires indiennes. Tous trois joignirent leur voix à celle des habitants du district pour réclamer un juriste de profession qui n’exercerait pas d’autre activité et n’aurait pas d’attaches commerciales. Powell, qui s’était occupé à Montréal de plusieurs causes touchant la partie ouest de la province, était le candidat tout désigné. Le 2 février 1789, il devint le premier juge (en fait, il resta le seul) du tribunal des plaids communs à Detroit. Le salaire de £500 (cours d’Angleterre) qui correspondait à ce poste dépassait probablement les honoraires qu’il touchait à Montréal. Par la suite, il affirma avoir accepté ces fonctions « dans le secret mais ferme espoir » d’être placé à la tête de l’appareil judiciaire au moment où une nouvelle province serait créée. Mais, à l’époque, le fait que le tribunal du district de Hesse avait, en raison de la traite des fourrures, le pouvoir de juger des actes commis hors de son territoire (en vertu de l’ordonnance du 30 avril 1789) suffisait peut-être à en faire, aux yeux d’un avocat, le plus important des nouveaux tribunaux.
Detroit était une ville fruste d’environ 4 000 habitants. Jamais encore Powell n’avait vécu dans un endroit aussi petit et aussi isolé, mais il allait passer presque tout le reste de sa vie dans des villes de dimensions encore plus modestes : ainsi York (Toronto) ne comptait pas encore 2 000 habitants lorsqu’il s’y retira en 1825. Detroit était pittoresque et, au début, la compagnie des officiers de la garnison réussit à distraire Mme Powell et sa belle-sœur Anne. Mais, tout comme elles, Powell n’y fut pas heureux bien longtemps. Son travail de juge ne lui attira aucune inimitié particulière. La cour siégeait à L’Assomption (Sandwich), car Detroit se trouvait en territoire américain. La procédure que Powell institua était simple, et il rendait la justice avec célérité, peut-être en partie parce qu’il ne convoquait jamais de jury. Cependant, du 7 août 1789 au mois d’octobre 1792, il siégea aussi au comité des terres où, par son refus de reconnaître les achats irréguliers faits auprès des Indiens et par son assiduité (il ne manqua que 5 des 53 réunions), il devint une menace pour les officiers de l’armée et les fonctionnaires des Affaires indienne, qui n’avaient pas l’habitude d’une telle ingérence, surtout de la part d’un nouveau venu. Powell reçut des menaces de mort, et sa loyauté fut mise en doute. On organisa des parodies d’embuscades indiennes qui effrayèrent sa femme et ses enfants, si bien qu’en octobre 1791 celle-ci s’embarqua pour l’Angleterre afin de les mettre à l’abri et de placer les deux aînés à l’école. Enfin, deux officiers, inspirés peut-être par un humour cruel, forgèrent une lettre dans laquelle Powell, s’adressant à Henry Knox, secrétaire américain à la Guerre, apparaissait comme un traître.
Déjà, au moment de ces incidents, Powell avait d’autres raisons de s’inquiéter. La province du Haut-Canada avait été constituée, mais ses hauts fonctionnaires avaient été choisis sans égard aux avis de Dorchester. Son candidat au poste de lieutenant-gouverneur, le loyaliste sir John Johnson, avait été écarté. En dépit de l’appui de ces deux hommes, Powell ne décrocha pas le poste qu’il convoitait, celui de juge en chef, et n’entra ni au Conseil législatif ni au Conseil exécutif. À titre de juge du tribunal des plaids communs, il eut juridiction non plus seulement sur le district de Hesse mais sur toute la province à compter du 31 décembre 1791. Cependant, il avait pour nouveaux maîtres des étrangers sur lesquels il n’exerçait aucune influence. En février, il se rendit à Québec – pour rencontrer le nouveau lieutenant-gouverneur, John Graves Simcoe*, et pour désavouer le faux qui avait été fait en son nom. Les deux hommes furent rassérénés par leur premier entretien, et Powell retourna vaquer à ses occupations à Detroit. Au cours de l’automne, il partit en congé pour l’Angleterre, emportant avec lui cette prudente approbation de Simcoe : « en autant que je sache, M. Powell a agi en tous points d’une manière qui convient à la position qu’il détient ». Il obtint une assurance semblable du secrétaire d’État à l’Intérieur, Henry Dundas.
Powell demeura à l’écart sous le nouveau gouvernement. Le juge en chef, William Osgoode, qui n’avait nullement son expérience d’avocat et de juge, ni sa connaissance de la province, ne le consulta pas lorsqu’il réorganisa les tribunaux. Les cours de district furent remplacées par un tribunal central, la Cour du banc du roi, qui avait juridiction en matière criminelle aussi bien que civile. Auparavant, les juges comme Powell n’avaient en matière criminelle qu’une compétence limitée, qu’on leur conférait par des commissions d’audition et de jugement des causes criminelles et d’audition générale des délits commis par les personnes emprisonnées. Powell fut nommé juge puîné de la Cour du banc du roi le 9 juillet 1794. Il présida le tribunal pour la première fois le 6 octobre suivant à Newark (Niagara-on-the-Lake), son point d’attache n’étant plus Detroit depuis que sa juridiction avait été élargie. Comme le seul autre juge régulier du tribunal était le juge en chef et que celui-ci s’absentait souvent, Powell assuma dès le début la plus grande partie du travail, comme il le ferait d’ailleurs durant le reste de sa carrière.
Powell ne s’opposa pas aux mesures prises par le gouvernement Simcoe, si ce n’est le choix d’York comme capitale. Il avait déjà formulé sur les comités des terres de district des critiques préfigurant les motifs pour lesquels Simcoe les abolirait, et il appuya avec enthousiasme le projet visant à doter l’Église d’Angleterre en louant à bail les réserves du clergé. Néanmoins, il en voulait aux jeunes Anglais qui avaient été placés au-dessus de lui. Il ne manquait pas de faire voir la patience avec laquelle il supportait que ses ambitions aient été déçues et évoquait un peu trop souvent « les longues années [où il avait rempli] de manière irréprochable [ses] fonctions de premier magistrat de la nouvelle colonie avant qu’elle ne soit séparée du Bas-Canada ». Il avait raison de mettre en doute la légalité des concessions foncières octroyées avant 1791, mais il le fit de concert avec Robert Hamilton*, magnat de Niagara qui était lui aussi mécontent, et ce n’est qu’après que les légistes de Westminster eurent donné leur avis qu’il laissa le procureur général de la province, John White*, découvrir son opinion sur le sujet. Sans être vraiment dans l’opposition, Powell s’arrangeait pour avoir l’air d’y être : connaissant l’antipathie de Simcoe à l’endroit du gouverneur de Québec, il baptisa sa maison de Newark Mount Dorchester. Quand Osgoode quitta la province, il vit encore le poste de juge en chef lui passer sous le nez, car Simcoe exigeait « un homme de loi anglais ». Powell avait aussi des raisons personnelles d’être amer : la vente de sa maison de Montréal à Monk donna lieu à une longue dispute et Mme Powell, en tentant de recueillir un héritage à Boston, ne réussit guère qu’à se quereller avec son frère, George Murray.
La patience de Powell allait encore être mise à l’épreuve. Son ami Peter Russell*, qui administra la province après le départ de Simcoe, n’avait pas assez d’influence pour le protéger : après avoir été juge en chef à titre intérimaire, pendant plus de deux ans, Powell vit le poste aller à John Elmsley*. Ses réclamations ne furent pas tout à fait vaines : grâce à un autre séjour en Angleterre, qu’on l’autorisa à faire après qu’il eut menacé de démissionner, il réussit à exercer assez de pression sur le gouvernement britannique pour obtenir qu’on lui verse la moitié des émoluments du juge en chef lorsque le poste était vacant, plus une augmentation de son propre salaire. Quand il siégeait seul au tribunal, cette augmentation lui assurait un traitement de £1 300 (cours d’Angleterre), ce qui représentait plus de deux fois son revenu antérieur. Cependant, les dépenses que lui imposait la tournée annuelle des six districts engloutissaient près de la moitié de cette somme. Powell avait énormément de sens politique, comme il le montra en essayant de régler les disputes de William Jarvis*, secrétaire de la province, avec ses collègues. Il avisa David William Smith*, élu député de la circonscription de Suffolk and Essex, qu’il ne devait pas s’attendre à ce que les Canadiens votent pour lui, mais qu’il pouvait gagner sans eux. Ce fut pour des considérations d’ordre politique qu’il s’opposa, le 3 janvier 1797, à ce qu’on poursuive le fils de Joseph Brant [Thayendanegea*] pour meurtre, même s’il pensait alors que, dans leurs villages, les Indiens échappaient à la juridiction des tribunaux. À titre de membre de la première Commission des héritiers et légataires à compter de 1797, il manifesta l’assiduité, le sens du détail et le souci d’équité qui faisaient de lui un administrateur compétent, quoique sans imagination.
Powell se voyait comme un homme de principes, prêt à encourir le mécontentement des autorités pour défendre ses convictions, mais ses principes avaient tendance à ressurgir surtout lorsque ses propres intérêts ou ses sentiments partisans étaient en cause. Ainsi lorsqu’il fit valoir que les loyalistes réclamaient à juste titre de jouer un rôle particulièrement important dans le Haut-Canada, il ne manqua pas de rappeler que lui-même avait droit à de l’avancement. Lors de la longue dispute que les honoraires des agents des terres suscitèrent dans les milieux officiels, il signala que la part de Jarvis ne couvrait pas ses dépenses ; mais Jarvis était un ami dont le fils aîné, Samuel Peters*, allait devenir son représentant commercial et le mari de sa fille cadette, Mary Boyles. Durant ses fréquentes absences, le lieutenant-gouverneur Peter Hunter* confiait l’exercice du pouvoir à un comité du Conseil exécutif, ce qui, soulignait Powell, était peut-être illégal ; mais il venait encore de se voir refuser un siège au conseil et était offensé que Hunter ait évincé Russell. Comme il l’écrivait à Dorchester, il se voyait « sans protecteurs en Europe [et] dans une espèce de disgrâce [dans le Haut-Canada], où le nouveau gouvernement prenait [sa] connaissance de la situation et [son] zèle pour un affront impardonnable ».
Powell continua à présenter des requêtes au gouvernement impérial, ne lui laissant ainsi guère l’occasion d’oublier ses mérites, ni les améliorations à la législation provinciale qu’il aurait pu suggérer si on l’avait consulté. Mais avant que son ambition ne puisse être satisfaite, il dut encore survivre à deux autres juges en chef venus de Grande-Bretagne : Henry Allcock* et Thomas Scott. Il était en assez bons termes avec le second pour lui emprunter 400 $ en juillet 1806, lors de l’épisode le plus mélodramatique de sa vie personnelle. S’étant joint à un groupe de don Quichottes qui voulaient aider les rebelles de la colonie espagnole du Venezuela, son quatrième fils, Jeremiah, avait récolté une peine de dix ans de travaux forcés et gisait dans la prison d’Omoa, près de Cartagena (Colombie), qui était renommée comme un foyer de fièvres. Powell prit un congé de six mois et alla faire pression à Boston, New York, Philadelphie, Londres et Madrid pour que son fils soit libéré. Celui-ci put sortir de prison en 1807, mais il mourut en mer l’année suivante. Le succès de Powell révèle que ses relations à l’extérieur du Haut-Canada étaient plus étendues et plus puissantes qu’il ne l’admettait (elles allaient du duc de Kent [Edward* Augustus] à la marraine du fils du ministre d’Espagne aux États-Unis) et, en dépit de son chagrin, il ne manqua pas de faire valoir sa propre cause pendant son séjour à Londres. Powell avait connu aussi d’autres drames : sa sœur préférée, Anne, était morte en couches à Montréal en 1792, et trois de ses enfants étaient décédés avant Jeremiah, sa fille Anne, encore bébé, en 1783, son deuxième fils, William Dummer, en 1803, et son benjamin, Thomas William, en 1804, dans une école de Kingston. Tous ces événements avaient été plus tragiques, mais ils n’avaient pas épuisé ses énergies et ses finances comme l’escapade de Jeremiah. Powell rentra à York en octobre 1807, à bout de force. Sa femme et lui étaient devenus plus ombrageux, plus soucieux que jamais de leur rang, jaloux de la préséance à laquelle ils estimaient avoir droit dans la société yorkaise et facilement blessés par l’attitude solennelle du nouveau lieutenant-gouverneur Francis Gore*. Mme Powell fut insultée, en septembre 1807, à la perspective d’avoir pour gendre un riche marchand d’York, Laurent Quetton St George. Elle fit la sourde oreille aux demandes de son mari et encourut le déplaisir de Gore en refusant d’apporter son concours pour que Mme John Small soit admise de nouveau dans les cercles mondains de la capitale.
En fait, l’arrivée de Gore marqua un tournant dans la carrière de Powell. La première fois que le lieutenant-gouverneur lui proposa un siège au Conseil exécutif, il refusa parce qu’il n’aurait pas été rétribué. Dès qu’un poste régulier et rémunéré devint vacant, il accepta l’offre et fut assermenté le 8 mars 1808. Toujours d’une indépendance farouche, il offensa Gore le 15 juillet 1809 en décidant, ce que les légistes impériaux confirmeraient en appel, que David McGregor Rogers ne pouvait être destitué de son poste de registrateur parce qu’il était du côté de l’opposition à l’Assemblée. Gore n’en revint pas moins à l’opinion qu’il avait exprimée en mars précédent, à savoir que Powell était « un gentleman qui s’acquittait depuis plus de vingt ans de ses importantes fonctions avec probité et honneur et qui, à cause de sa connaissance [de la province, était] particulièrement apte » à siéger au sein du Conseil exécutif. Grâce à Powell et à John McGill, qui étaient deux conseillers compétents et assidus, le conseil rattrapa ses retards, et Powell entreprit de simplifier le processus confus par lequel les lettres patentes sur les terres étaient délivrées. Sa crédibilité augmentait constamment, et il eut bientôt la satisfaction de voir des magnats comme Richard Cartwright* et des immigrants éminents comme John Strachan* lui demander d’user de son influence auprès du lieutenant-gouverneur.
L’opinion publique de l’époque surestimait cette influence, comme allaient le faire plus tard les critiques réformistes Robert Gourlay*, Francis Collins et William Lyon Mackenzie*. En outre, rétrospectivement, elle paraît plus grande et plus personnelle qu’elle ne l’était en réalité. En effet, la correspondance que Gore et Powell s’échangèrent dans les années qui suivirent atteignit un niveau exceptionnel de cordialité dans la vie de Powell. Les deux convenaient que les simples fonctionnaires du gouvernement devaient avoir une connaissance pratique de la province mais, tandis que c’était une question de bon sens pour Gore, Powell, lui, était animé du désir de « réserver [aux Haut-Canadiens] les honneurs de la profession [de juriste] ». Powell put obtenir que son fils aîné, John, succède à James Clark* le 19 février 1807 à titre de greffier du Conseil législatif, mais il ne réussit pas à faire nommer son protégé John Macdonell* (Greenfield) procureur général. Ce fut Isaac Brock*, administrateur de la province en l’absence de Gore, qui accepta la nomination de Macdonell et recommanda celle du troisième fils de Powell, Grant*, au siège de président de la Cour d’enregistrement et d’examen des testaments, qu’il occupa à compter d’avril 1813. Powell rédigea le célèbre discours que Brock prononça le 22 juillet 1812 en réponse à la proclamation publiée à Detroit par le général de brigade William Hull. À l’époque, selon Powell, Brock et plus tard sir George Murray*, qui fut administrateur du 25 avril au 30 juin 1815, lui prêtaient une oreille aussi attentive que Gore l’avait fait.
Les années 1808 à 1818 furent la période la plus faste de la carrière de Powell. Lui qui avait juré en 1797 de ne jamais installer sa famille à York y possédait une impressionnante maison, Caer Howell, en plus de 100 acres dans le canton d’York et de 5 000 acres réparties dans toutes les régions de la province. Il assumait les obligations inhérentes au rang social dont lui-même, et plus encore sa femme, étaient si fiers. Tout en ne manquant jamais de se plaindre des dépenses que cela représentait, il souscrivit consciencieusement en vue de la construction d’une caserne de pompiers en 1802 et de l’église St James en 1803. Il siégea également au conseil d’administration de la bibliothèque d’abonnement en 1814, de la Loyal and Patriotic Society of Upper Canada en 1812 et de la Society for the Relief of Strangers in Distress en 1817. Comme Mme Powell l’écrirait en 1819 : « dans un régime aristocratique, chacun doit supporter des frais correspondant à son rang ». York n’était plus pour Powell, comme il l’avait dit en 1797, le siège de « la petite politique d’une colonie lointaine » ; c’était sa ville. Les attaches familiales qui le liaient à Boston avaient été rompues bien avant la guerre de 1812, et York était devenu l’endroit où il avait connu ses plus grandes réussites et où s’ouvraient pour lui toutes les perspectives d’avenir.
Pendant la guerre, Powell décida de ne pas quitter York même si les troupes américaines occupaient la ville. Il n’eut à craindre aucunes représailles des militaires : « Le pire pour nous, écrivit-il en 1815, était la vie incroyablement chère, ce que les exigences de l’armée aggravaient. » Cependant, il ne manquait pas d’informer les commandants britanniques des mouvements ennemis et renseignait régulièrement le commandant en chef, sir George Prévost*, sur ce qui se passait dans la capitale occupée. Sur un ton moins flamboyant mais tout aussi ferme que Strachan, il insistait pour que le commandant américain maintienne l’ordre et protège la propriété contre les pillards, que ceux-ci soient des soldats de l’armée d’occupation ou encore des civils comme il croyait que c’était le cas la plupart du temps. On ne pouvait absolument plus, ainsi qu’on l’avait fait autrefois et refait en 1807, l’accuser de sympathie envers les Américains. À la fin de la guerre, comme le juge en chef Scott était gravement malade et Gore était revenu de son congé en Angleterre, la suprématie de Powell sur la magistrature et son influence au conseil furent établies hors de tout doute. Le 11 avril 1814, il fut nommé à la commission chargée d’entendre les accusations de trahison et, le 21 décembre 1815, à la commission chargée d’examiner les réclamations en dommages de guerre. L’Assemblée lui accorda £1 000 pour ses années de service à la Commission des héritiers et légataires. Quand Scott se trouva dans l’impossibilité de présider le Conseil législatif, Powell se sentit assez puissant pour conclure un marché mesquin. Il accepta un siège de conseiller et celui de président du conseil à la condition que Scott quitte immédiatement ces deux postes et renonce à son salaire. Nommé le 21 mars 1816, Powell ne toucha d’abord aucune rémunération, mais il récupéra les arrérages deux ans plus tard. Finalement, le 1er octobre 1816, il obtint le poste auquel il estimait déjà avoir droit 25 ans auparavant et qu’il avait si souvent occupé à titre intérimaire, celui de juge en chef du Haut-Canada.
Les années de guerre et son propre succès firent de Powell un tory moins tourmenté. Il n’avait plus de raisons de jalouser les fonctionnaires venus d’Angleterre et, s’il n’oubliait pas qu’il était un loyaliste américain, il n’éprouvait plus le besoin de se tenir sur la défensive. Le complexe d’infériorité du colonial et le ressentiment qu’il avait éprouvés jadis ne persistaient que sous la forme de vieilles animosités personnelles : le souvenir des Haldimand, Simcoe, Osgoode, Elmsley, Hunter et Allcock le hanta jusqu’à la fin de ses jours. Il était incurablement, et peut-être délibérément, provincial dans sa tenue, ses manières et son langage : il achetait ses vêtements à Boston, engouffrait la nourriture avec ses doigts quand il était chez lui et continuait à nasiller comme un Yankee, mais tout cela lui servait désormais à affirmer l’indépendance de sa personnalité et ne faisait plus obstacle à son succès. Il demeurait convaincu que le Haut-Canada était destiné, à juste titre, à être la province par excellence des loyalistes et que la plupart des réfugiés qui avaient quitté New York en 1784 y seraient venus si le gouvernement impérial n’avait pas tardé à leur ménager un accueil au point que leur installation au Nouveau-Brunswick était « trop avancée pour songer à les déplacer ».
Le Haut-Canada était devenu la terre d’adoption de Powell et ne pouvait subsister, selon lui, hors de l’Empire. À ses yeux, ce n’étaient ni la négligence du gouvernement impérial ni l’agression américaine qui menaçaient le Haut-Canada, mais l’opposition d’inspiration démocrate et les prétentions de l’Assemblée législative. En 1807, il avait fortement désapprouvé que Robert Thorpe* passe dans l’opposition tout en étant juge ; de même, les premières critiques lancées contre Gore lui avaient semblé dangereuses en raison surtout de la popularité du journal de Joseph Willcocks*, l’Upper Canada Guardian ; or, Freeman’s Journal. Le radicalisme de l’ouvrage de John Mills Jackson*, A view of the political situation of the province of Upper Canada [...], publié à Londres en 1809, l’avait suffisamment inquiété pour qu’il annote son exemplaire en vue d’y répondre. Cependant, la réplique qui parut à Halifax en 1810, Letters, from an American loyalist, n’était pas de lui, comme le supposait Robert Thorpe, mais bien de Richard Cartwright. Que l’Assemblée prétende être la seule à pouvoir présenter des projets de loi de finances lui avait paru menaçant pour le Conseil législatif longtemps avant qu’il n’y siège, et il avait nié à la Chambre basse un droit de regard sur les dépenses administratives, même lorsqu’elle l’avait affirmé devant le lieutenant-gouverneur qu’il détestait le plus, Hunter. L’affrontement final de l’Assemblée avec Gore en avril 1817, même s’il était mené par Robert Nichol, spéculateur foncier dont les intérêts coïncidaient avec les siens, prouvait selon lui que la province était menacée du type même de subversion démocrate qui l’avait chassé de Boston.
Powell avait peut-être, tout simplement, trop pris l’habitude d’être mécontent pour se passer d’un objet de désapprobation. Quoi qu’il en soit, dès le début de 1817, ce fut sur un ton de plus en plus sombre qu’il parla, dans ses lettres, de la société du Haut-Canada. Ayant entrepris d’élever sa petite-fille Anne Murray Powell à York, il s’inquiétait comme sa femme de ce qu’« il ne [pouvait] y avoir de distinction de classes en ce lieu », et donc de ce que la jeune demoiselle pourrait acquérir des manières plébéiennes. Les Powell furent probablement aussi réconfortés que préoccupés d’apprendre, après les élections de 1828, que « la majorité à la Chambre basse [venait de classe] inférieure », ce qui ne pourrait « rendre l’association agréable », mais le juge en chef sentait de plus en plus que la province s’éloignait de sa vocation originale, celle d’une société loyaliste. En 1822, en évoquant avec passion les origines « authentiquement britanniques et loyales » de la province, il réussit à faire rejeter une motion de l’Assemblée visant à redonner à York son nom d’origine, Toronto. Finalement, quand la ville fut érigée en municipalité sous ce nom en 1834, il nota sa désapprobation en ces termes : « par ce mot à la sonorité barbare et terrifiante, Toronto, les misérables citoyens seront appelés chaque année à des élections populaires, abomination qui réveille toutes les passions tordues de la nature humaine ». Peut-être aurait-il jugé moins sévèrement les élections populaires s’il avait su que son petit-fils John serait échevin de Toronto en 1837, puis maire de 1838 à 1840.
Powell avait beau être devenu juge en chef et être reconnu comme le membre le plus chevronné du gouvernement provincial, il n’avait pas perdu le tour de se faire des ennemis. Son voisin à York, John Strachan, admit en 1816 que Powell connaissait « la province (et peut-être le Bas-Canada) mieux que tous ses contemporains », mais le « manque de délicatesse » avec lequel il avait délogé Scott l’avait choqué. Bientôt, les deux hommes divergèrent d’opinion sur les moyens de doter l’Église d’Angleterre dans la province. Powell fut d’abord d’avis que l’Acte constitutionnel de 1791, où l’on employait l’expression « clergé protestant », ne faisait pas de l’Église d’Angleterre la seule bénéficiaire des réserves du clergé. Puis il révisa sa position car, en février 1828, il envoya au secrétaire d’État, William Huskisson, un texte intitulé On clergy reserves, qui s’opposait aux prétentions de l’Église presbytérienne à une part du revenu de ces réserves. Il maintenait que les réserves avaient été créées pour remplacer la dîme que Strachan espérait imposer. Abstraction faite de la légalité ou de l’illégalité de la dîme, Powell estimait qu’il serait difficile de tenter de la percevoir. Trouver des tenanciers pour les réserves du clergé était déjà un problème assez aigu : le territoire ouvert aux colons était en effet si vaste qu’il fallait des « appâts bien tentants pour qu’ils acceptent de travailler sur la terre de quelqu’un d’autre ». En mai 1817, Strachan ne voyait plus en Powell que quelqu’un qui adhérait « peut-être » à l’Église d’Angleterre, même si les deux filles de celui-ci enseignaient dans son école du dimanche. Il déplorait aussi qu’il soit « un peu indifférent » à ses projets sur les réserves du clergé, « ou plutôt contre, et [qu’il] craigne de se prononcer franchement » à ce sujet au Conseil législatif.
Au delà de leurs désaccords, les deux hommes se ressemblaient en ceci qu’ils étaient dévorés par l’ambition. Strachan jalousait l’influence de Powell, qui était plus grande que la sienne, et Powell détestait les prétentions de Strachan. Ils se disputaient également le titre de protecteur de John Beverley Robinson*. Ce dernier avait été l’élève de Strachan, mais il devait à l’appui de Powell d’avoir occupé la charge de procureur général intérimaire de 1812 à 1814, puis d’avoir été nommé solliciteur général le 13 février 1815. Powell aida Robinson à obtenir un congé de deux ans et demi pour aller étudier le droit en Angleterre, mais celui-ci se fit à Londres des relations qui lui assurèrent le poste de procureur général, le 11 février 1818, et qui lui permirent de se passer à peu près complètement de la bienveillance de Strachan et de Powell. Il revint également dans la colonie avec une Anglaise qui était devenue sa femme, mettant ainsi fin aux espoirs d’Anne, la fille de Powell. À titre de procureur général, il ne tarda pas à s’apercevoir que Powell n’était pas un juge avec qui il était facile de s’entendre. Le nouveau lieutenant-gouverneur, sir Peregrine Maitland*, le constata aussi. Les deux hommes s’opposèrent à propos d’un plan d’imposition des terres en friche. Maitland voulait une loi qui rendrait efficace un impôt déjà existant. Powell était d’avis de ne pas soumettre à l’Assemblée une question qui relevait des tribunaux et du gouvernement. Maitland le trouvait pédant, obstiné, trop soucieux de ses propres intérêts ; Powell jugeait que le lieutenant-gouverneur négligeait les prérogatives royales et ne faisait aucun cas de l’expérience des coloniaux. En 1821, le Conseil législatif humilia Powell en lui retirant, pour le confier à Robinson, le poste de commissaire chargé de rechercher l’aide du gouvernement impérial afin de régler la répartition des droits de douane avec le Bas-Canada. Insulté qu’on lui ait préféré son propre protégé, il crut que Robinson et Strachan avaient conspiré contre lui. Cependant, il est plus probable que son irascibilité avait offensé trop de personnes et qu’elle aurait fait de lui un mauvais commissaire. Mais tout cela était mineur par rapport à ce qui allait survenir : sa fille Anne, toujours éprise de Robinson, défia ses parents en le suivant en Angleterre, où il allait remplir sa mission de commissaire, et se noya le 22 avril 1822 lors du naufrage de l’Albion.
Powell plaça toujours les principes de la common law anglaise au-dessus du gouvernement haut-canadien. Aussi mesquin, calculateur et rancunier qu’il ait été dans sa course aux fonctions, il se montrait, au tribunal, jovial et soucieux du sort des accusés. Son humour à la cour était conventionnel : lors d’un procès pour meurtre, il expliqua aux jurés, dont le verdict était partagé, qu’il ne pouvait ni pendre l’accusé à moitié ni pendre la moitié de l’accusé, si bien que leur verdict équivalait à un acquittement. Il croyait aux jugements par jury, mais il n’était pas convaincu pour autant que les jurés étaient très aptes à comprendre le droit ou même à distinguer les faits pertinents d’une affaire. Les instructions qu’il leur donnait ne laissaient guère de doute sur les témoins que lui-même trouvait crédibles ou sur le verdict qu’il attendait. Quand l’esclave Jack York* comparut devant lui pour vol qualifié en septembre 1800, il ne manqua pas de souligner au jury que le propriétaire d’York, James Girty, n’était pas un témoin objectif de la défense. York fut reconnu coupable, et Powell le condamna à mort. Un mois auparavant, il avait prononcé la même sentence dans le cas de William Newberry, fils d’un loyaliste, après qu’il eut été trouvé coupable du même crime. Sur le plan du droit, il s’agissait de deux affaires semblables mais, aux yeux de Powell, les résultats concrets ne devaient pas nécessairement être les mêmes. Il s’attendait à ce que la lettre de la loi soit tempérée par la clémence, mais la clémence dépendait exclusivement de celui qui avait le droit de l’accorder et ne pouvait venir d’un jury compatissant. Jack York, dont le propriétaire était lié aux fonctionnaires du département des Affaires indiennes avec lesquels Powell avait eu maille à partir à Detroit, aurait été pendu s’il n’avait pas réussi à s’évader de prison ; quant à Newberry, Powell recommanda une commutation de peine au lieutenant-gouverneur. Dans une affaire moins dramatique, en août 1810, il demanda la clémence après avoir invité le jury à condamner un ministre méthodiste parce qu’il avait célébré illégalement des mariages.
Powell s’opposa à la suspension de l’habeas corpus et à la promulgation de la loi martiale pendant la guerre de 1812 et désapprouva le recours à des commissions spéciales pour instruire les affaires de trahison parce que, selon lui, le gouvernement ne devait pas interrompre le cours de la common law pour se simplifier la tâche. En juin 1814, il présida en alternance avec le juge en chef Scott et le juge William Campbell les procès pour trahison qui se tenaient aux assises d’Ancaster. Il recommanda au jury de rendre un verdict de culpabilité contre seulement 7 des 50 accusés non comparants dont il eut à juger le cas, en dépit du fait que lui-même était convaincu que tous méritaient un châtiment. Il présida 6 des 18 procès auxquels les accusés comparurent et où ils plaidèrent non coupables. Sa conception rigide de l’acte de trahison, exposée sans compromis au jury, déboucha sur la condamnation du malheureux Jacob Overholser*. Trois autres accusés contre lesquels les preuves étaient abondantes furent aussi condamnés. Par ailleurs, sur les quatre prisonniers acquittés à Ancaster, deux, Robert Troup et Jesse Holly, comparurent pendant que Powell présidait le tribunal, et ses résumés de la preuve laissaient clairement prévoir l’acquittement. Il n’était cependant pas disposé à dépasser, pour les traîtres, les bornes de la stricte justice ; contrairement aux deux autres juges, il ne fit aucune, recommandation de clémence.
Dans les années qui suivirent l’accession de Powell au siège de juge en chef, son humeur difficile commença à transparaître en cour. Il trouvait depuis longtemps que la loi restreignait de façon inopportune les règlements de son tribunal. La procédure qu’il avait établie au départ fut d’abord modifiée par Elmsley pour la rendre conforme au modèle anglais, plus complexe, puis partiellement restaurée en 1797 par l’Assemblée au moyen d’une loi « mal comprise par les législateurs [...], qui oblige[ait] presque la cour à la contourner par des faux-fuyants, des anomalies et des contradictions qui étaient inconciliables ». Il réagit en manifestant une tendance de plus en plus forte, et selon bien des gens de plus en plus partisane, à invoquer des subtilités juridiques dont certaines étaient d’application douteuse. Dans le procès en dommages-intérêts qui opposa Robert Randal à Elijah Phelps en août 1819, le plaignant rapporta que Powell, dans son allocution aux jurés, les avait menacés de mort civile – ce qui ne s’était pas fait depuis plus d’un siècle – s’ils ne penchaient pas, comme lui, en faveur du défendeur. À Sandwich (Windsor), en 1821, il déclara au jury d’accusation que les Indiens, bien que soumis à la juridiction des tribunaux réguliers par la common law, pouvaient y échapper par traité. L’année suivante, cette remarque servit de fondement à la défense de Shawanakiskie, accusé de meurtre, de sorte que sa condamnation ne fut confirmée que quatre ans plus tard, après que son cas eut été soumis aux légistes de la couronne. En octobre 1823, lors du procès de la domestique Mary Thompson pour infanticide, on put voir à quel point Powell en était venu à se retrancher derrière les subtilités de la loi. Le jury la déclara coupable mais demanda la clémence ; Powell, bien que touché par sa situation pathétique, estima qu’il ne pouvait recommander la grâce. Il ne changea d’avis qu’après avoir découvert que certaines des preuves qu’il avait retenues contre elle n’auraient pas été admissibles devant les tribunaux anglais de l’époque. Pourtant, aussi vétilleux qu’il soit devenu en matière de droit, il se montrait, vers la fin de sa carrière, un peu vague quant aux limites de son autorité. En 1823, il refusa d’appuyer la nomination d’Alexander Wood*, dont il réprouvait la moralité, au poste de commissaire chargé des réclamations de guerre. Puis Wood ayant été nommé quand même sur la recommandation de Strachan, il refusa, à titre de juge en chef, de l’assermenter. Wood lui intenta alors une poursuite de £120 en dommages-intérêts, et il gagna son procès. Powell répliqua en réclamant une fin de non-recevoir, moyen particulièrement obscur d’écarter un jugement qui aurait obligé Maitland à exercer sa juridiction de juge d’equity. Même après que ce stratagème eut échoué, Powell refusa de payer ; sa dette devait être effacée après sa mort.
Il n’était pas surprenant que Powell, qui avait toujours tant posé au champion de l’indépendance du pouvoir judiciaire, soit devenu un vieillard difficile et pédant. Peut-être que son unique concession à la règle administrative, en qualité de juge, fut de s’abstenir, pendant l’hiver de 1791–1792, de demander si le mandat qu’il tenait de la province de Québec était encore légal même si le Haut-Canada était devenu une province distincte. En 1818, il embarrassa le gouvernement de la province par la série de décisions qu’il rendit à la suite des démêlés du comte de Selkirk [Douglas*] à la colonie de la Rivière-Rouge, dont certains avaient engendré des poursuites devant les tribunaux haut-canadiens. Il rejeta les accusations de conspiration déposées contre Selkirk, ce que déplora Robinson, ainsi que la plupart des accusations portées par Selkirk contre ses adversaires, ce qui irrita grandement Strachan. Toutefois, lors du plus spectaculaire de ses procès, il fut pris au piège par la loi et forcé de collaborer à une solution qu’il trouvait, au mieux, inutile. Il désapprouvait entièrement Robert Gourlay et recommandait qu’on n’accorde pas d’autres concessions foncières aux personnes qui avaient assisté à la convention que celui-ci avait organisée à York en juillet 1818, mais il déclara à maintes reprises que, en droit, il n’y avait aucun motif de poursuivre Gourlay pour ses attaques contre le gouvernement de la province. Lorsque ces motifs furent découverts dans le Sedition Act de 1804 et que Robinson persista à les invoquer même si, de toute évidence, Gourlay était trop malade pour pouvoir se défendre, Powell dut se résoudre à prononcer une sentence de bannissement.
Cependant, la plupart des causes que Powell instruisit étaient banales. Il était non seulement convaincu que les débiteurs condamnés devaient être incarcérés, mais aussi que ceux qui étaient accusés de dettes devaient être détenus en attendant leur procès. Selon un relevé fait en 1827, les 11 prisons de district de la province comptaient en tout 298 cellules dont 264 étaient occupées. Parmi les prisonniers, 159 étaient détenus pour dettes et seulement 29 pour des actes délictueux graves. Au cours de ses dernières années dans la magistrature, il défia l’Assemblée et les deux conseils en insistant sur le fait que même les législateurs n’étaient pas à l’abri de l’arrestation pour dettes. En 1824, il en était à trouver ses fonctions judiciaires aussi lourdes que son travail administratif, et il songeait à les quitter quand il atteindrait l’âge de 70 ans, en novembre 1825.
Powell s’était fait trop d’ennemis pour qu’on le laisse prendre tranquillement sa retraite. Le 24 octobre 1824, William Lyon Mackenzie publia dans le Colonial Advocate une lettre signée du pseudonyme de A Spanish Freeholder, dans laquelle on attaquait l’élite yorkaise et brocardait Powell en le mettant en scène sous le nom de « cardinal Alberoni, juge en chef de Sa Majesté l’empereur d’Espagne ». Le signataire rappelait que Powell avait été accusé de sympathie envers les Américains lorsqu’il vivait à Detroit. Il alléguait en outre qu’il avait obtenu le siège de juge en chef en récompense de la sévérité des sentences qu’il avait rendues aux assises d’Ancaster et condamnait sa conduite lors d’un procès qui n’était pas identifié mais qui était certainement celui de Singleton Gardiner, en 1822–1823. Gardiner, fermier du comté de Middlesex qui se trouvait politiquement en désaccord avec deux magistrats tories de sa région, Mahlon Burwell* et Leslie Patterson, avait intenté des poursuites contre eux. Powell estimait que, du point de vue juridique, l’accusation n’était pas bien solide ; en soumettant le cas à un jury, il ébruita toutefois l’abus d’autorité que les magistrats avaient commis. Il avait agi dans les règles, mais probablement avec une intention malveillante : à l’Assemblée, en 1821, Burwell avait fait pression en faveur de la nomination de Robinson à titre de commissaire, et il était le lieutenant de Thomas Talbot*, envers qui Powell éprouvait de l’inimitié depuis l’époque de Gore. C’était probablement le jeune frère de Burwell, Adam Hood Burwell*, qui se cachait sous le pseudonyme de A Spanish Freeholder. Avant de paraître dans le journal de Mackenzie, sa lettre avait reçu dans le Weekly Register de Charles Fothergill* un commentaire favorable qui indiquait largement qu’elle faisait allusion à Powell. La lettre fut bientôt suivie d’une réplique tout aussi excessive, soit un pamphlet intitulé The answer to the awful libel of the Spanish freeholder, against the Cardinal Alberoni et publié sous le pseudonyme de Diego à York en 1824.
Bien que ce pamphlet ait été attribué à Powell et à son gendre Samuel Peters Jarvis, il est beaucoup plus probable qu’il soit de la plume de John Rolph*, avocat qui était associé à Jarvis et qui peu de temps auparavant, aux élections de 1824, avait défait Mahlon Burwell. Cependant, même avant la parution du pamphlet, Powell s’était laissé emporter au point de commettre des indiscrétions que ni Maitland ni les conseillers exécutifs et législatifs n’étaient le moins du monde disposés à pardonner. Refusant de se satisfaire des excuses que Maitland avait arrachées à Fothergill, le vieux juge, furieux, rédigea deux pamphlets : Correspondence and remarks, elicited by a malignant libel, signed « a Spanish freeholder » [...] et Spanish freeholder, app. A. Ils avaient peu à voir avec le récent écrit diffamatoire : le premier rappelait les griefs de l’auteur à l’endroit de Maitland et de son secrétaire, George Hillier* ; le second parlait de sa querelle avec Robinson en 1821 ; enfin, les deux reproduisaient de la correspondance qui n’était pas destinée à la publication. Après avoir été la victime de l’affaire, Powell devenait, aux yeux des autorités yorkaises, le principal offenseur. Le 28 janvier 1825, le Conseil exécutif déclara qu’il s’était mis en position de se faire poursuivre en justice pour avoir réitéré une diffamation, qu’il avait abusé de la confiance du lieutenant-gouverneur et qu’il avait exposé « des mesures du gouvernement à la vindicte publique ». Cette rebuffade était d’autant plus amère que John Strachan en était l’auteur, les deux autres conseillers présents étant le tranquille James Baby et le vieux Samuel Smith. Et même si, à l’époque, Strachan était davantage devenu l’instrument du lieutenant-gouverneur qu’il n’exerçait d’influence sur lui, il se sentit dans une position assez solide pour ajouter que le juge en chef n’avait pas cessé de faire la tête depuis que Robinson était devenu procureur général. Maitland refusa d’adresser de nouveau la parole à Powell, sauf en présence d’un témoin.
Powell fut forcé de démissionner du Conseil exécutif en septembre 1825. Il demeura au Conseil législatif jusqu’à sa mort, mais il dut en céder la présidence à William Campbell, qui lui succéda également comme juge en chef le 17 octobre 1825. Le secrétaire d’État, lord Bathurst, lui alloua une pension annuelle de £1 000 (cours d’Angleterre), en dépit de l’avis du Conseil exécutif selon lequel il était « indigne d’une telle faveur ». En 1829, après avoir passé près de trois ans en Angleterre pour obtenir sa pension et justifier sa conduite, il se retira définitivement à York. Par la suite, son seul geste public consista à faire paraître sa correspondance avec Maitland sur l’affaire Wood.
Nul n’avait servi le gouvernement du Haut-Canada avec autant de persévérance et de perspicacité que William Dummer Powell. Dans l’histoire de la province, seuls Allcock durant le mandat de Hunter et Robinson durant celui de Maitland eurent plus d’influence que lui. Peut-être Strachan et Christopher Alexander Hagerman* en exercèrent-ils presque autant, mais seulement pendant une courte période. Powell avait atteint la prospérité et avait vu ses enfants acquérir une situation confortable. Mais l’état de la province le rendait pessimiste en raison de la montée des réformistes à la chambre d’Assemblée. Depuis le départ de Gore, il ne comptait aucun véritable ami au sein du gouvernement. C’était fort à propos que Gourlay l’avait surnommé Pawkie, car il demeura toujours gauche dans ses rapports personnels. À mesure que sa santé déclinait, son esprit perdit suffisamment d’acuité pour que ses alliés de jadis, Robinson et Strachan, trouvent un malin plaisir à le voir diminué. Il fit le bilan des querelles qui avaient marqué son existence, écrivit à leur sujet des notes dans lesquelles il se donnait le beau rôle et publia des mémoires plutôt larmoyants, Story of a refugee, qui parurent à York en 1833. Au bout du compte, malgré ses nombreuses réussites officielles, il ne trouva guère matière à se réjouir et eut peu de foi en l’avenir de sa province d’adoption.
Les écrits autobiographiques de William Dummer Powell deviennent de plus en plus sujets à caution à mesure qu’il vieillit ; heureusement il a conservé une grande partie de sa correspondance. La principale collection de ses papiers conservée à la MTL, de même qu’une autre collection plus petite (APC, MG 23, HI, 4), fournissent une riche documentation sur sa vie. Powell se montre sous son plus mauvais jour dans les pamphlets : Correspondence and remarks, elicited by a malignant libel, signed « a Spanish freeholder », in Upper Canada, 14th October, 1824 ([York (Toronto), 1824] ; Spanish freeholder, app. A ([York, 1824]) ; (A letter from W. D. Powell, chief justice, to Sir Peregrine Maitland, Lieutenant-Governor of Upper Canada, regarding the appointment of Alexander Wood as a commissioner for the investigation of claims [...] ([York, 1831]) ; et Story of a refugee (York, 1833). Powell a été l’objet de plusieurs commentaires de ses concitoyens ; on en trouve quelques-uns particulièrement dans les papiers John Strachan (AO, ms 35, et MTL), John Beverley Robinson (AO, ms 4) et Samuel Peters Jarvis (AO, ms 787, et MTL). Les collections de documents imprimés les plus riches sont : Strachan, Letterbook (Spragge) ; Town of York, 1793–1815 (Firth) et 1815–34 (Firth) ; et Corr. of Lieut. Governor Simcoe (Cruikshank). Les registres du tribunal où siégeait Powell ont été publiés dans AO Report, 1917 : 23–190, sous le titre de « Upper Canada, District of Hesse ; record of the Court of Common Pleas, L’Assomption, 1789 ». On trouve dans les rapports de 1910 et 1915 « The journals of the Legislative Council of Upper Canada » [...].
La biographie écrite par William Renwick Riddell*, The life of William Dummer Powell, first judge at Detroit and fifth chief justice of Upper Canada (Lansing, Mich., 1924), même s’il ne s’agit pas du meilleur ouvrage de l’auteur, demeure la seule biographie utile de Powell. Riddell a aussi décrit le travail de tribunaux dans « Practice of Court of Common Pleas of the District of Hesse », SRC Mémoires, 3e sér., 7 (1913), sect. ii : 43–56, et « The early courts of the province », Canadian Law Times (Toronto), 35 (1915) : 879–890. La révision que fit Riddell des décisions prises par Powell au sujet du statut juridique des Indiens se trouve dans Sero v. Gault (1921), 50 O.L.R. 27. Voir aussi : Riddell, « The Ancaster « Bloody Assize » of 1814 », OH, 20 (1923) : 107–125 ; Alison Ewart et Julia Jarvis, « The personnel of the family compact, 1791–1841 », CHR, 7 (1926) : 209–221 ; R. E. Saunders, « What was the family compact ? », OH, 49 (1957) : 165–178 ; G. M. Gressley, « Lord Selkirk and the Canadian courts », N.Dak. Hist. (Bismarck), 24 (1957) : 89–105 ; S. F. Wise, « Upper Canada and the conservative tradition », Profiles of a province : studies in the history of Ontario [...] (Toronto, 1967), 20–33, et « Conservatism and political development : the Canadian case », South Atlantic Quarterly (Durham, N.C.), 69 (1970) : 226–243 ; Terry Cook, « John Beverley Robinson and the conservative blueprint for the Upper Canadian community », OH, 64 (1972) : 79–94 ; R. J. Burns, « God’s chosen people : the origins of Toronto society, 1791–1818 », SHC Communications hist., 1973 : 213–228 ; K. M. J. McKenna, « Anne Powell and the early York elite », « None was ever better ... » : the loyalist settlement of Ontario ; proceedings of the annual meeting of the Ontario Historical Society, Cornwall, June 1984, S. F. Wise et al., édit. (Cornwall, Ontario, 1984), 31–43 ; et Paul Romney, « The Spanish freeholder imbroglio of 1824 : inter-elite and intra-elite rivalry in Upper Canada », OH, 76 (1984) : 32–47. [s. r. m.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
S. R. Mealing, « POWELL, WILLIAM DUMMER », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 27 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/powell_william_dummer_6F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/powell_william_dummer_6F.html |
| Auteur de l'article: | S. R. Mealing |
| Titre de l'article: | POWELL, WILLIAM DUMMER |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la révision: | 1987 |
| Date de consultation: | 27 avr. 2025 |