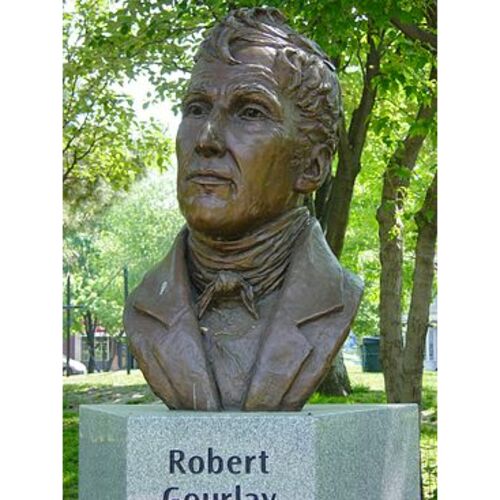Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
GOURLAY, ROBERT FLEMMING, agronome, réformiste et écrivain, né le 24 mars 1778 à Craigrothie, Fifeshire, Écosse, troisième des quatre enfants d’un gros propriétaire foncier, Oliver Gourlay, et de Janet Fleming ; il épousa en premières noces en 1807 Jean Henderson qui donna naissance à quatre enfants et, en secondes noces, en 1858, Mary Reenan ; décédé le 1er août 1863 à Édimbourg, Écosse. En mémoire de sa mère qui mourut en 1827, il ajouta à son nom celui de Fleming.
Les débuts de la carrière de Robert Fleming Gourlay laissaient prévoir le rôle important et mouvementé qu’il allait jouer au Haut-Canada. Après avoir reçu une éducation de gentleman, il obtint une maîtrise ès arts à St Andrews en 1797 et étudia l’agriculture pendant deux autres années à l’University of Edinburgh. En 1799, il écrivit pour le secrétaire du Board of Agriculture Arthur Young un ouvrage sur la condition des agriculteurs dans deux comtés anglais, qui fut publié et cité plus tard par Thomas Malthus. De 1800 à 1809, il administra une des fermes de son père et, de 1809 à 1817, il fut locataire du duc de Somerset à Deptford Farm, Wiltshire. Il fut apprécié aux deux endroits pour son esprit ouvert au progrès en tant que fermier et pour sa bonté en tant que propriétaire.
Gourlay était un agrarien radical qui ressemblait sur bien des points à William Cobbett ; ils détestaient tous deux les Ibis sur l’assistance publique, sympathisaient à la cause des paysans pauvres et souhaitaient leur restituer le monde que les propriétaires leur avaient volé en érigeant des enclos. Ils avaient aussi en commun leur goût pour l’invective personnelle. À la différence de Cobbett, Gourlay était un rêveur et un visionnaire ; héritier de deux générations de polémistes radicaux, il élabora lentement « les nouvelles structures politiques » qui transformeraient un monde corrompu. Il tenait de son père, qui avait fait bon accueil à la Révolution française, une partie de son radicalisme et se rapprochait du démocrate ; mais ses idées politiques étaient profondément contradictoires. Convaincu de la perfectibilité du genre humain mais persuadé en même temps que les vices inhérents à la race humaine rendaient tout gouvernement malsain, Gourlay proposa des systèmes de réformes détaillés, que ce soit pour la redistribution des terres ou l’éducation universelle, nécessitant manifestement une bureaucratie complexe. Il espérait arriver à ces réformes en faisant des pétitions non violentes, forme d’action politique qui supposait que les gouverneurs corrompus se réforment eux-mêmes ou bien se retirent devant la volonté unanime du peuple.
Une de ses brochures au texte touffu intitulée : A specific plan for organising the people, and for obtaining reform independent of parliament [...] to the people of Fife [...] of Britain ! qui fut publiée à Londres en 1809 est très représentative du genre de ses premiers écrits. Dans ce texte, Gourlay voyait les gouvernements comme des coalitions d’hommes puissants conspirant pour enchaîner l’espèce humaine par des « cérémonies mystérieuses » et une « machination subtile », et comme de grosses machines soutenues par les procédés et les arguties des avocats, et par ces « apologistes de l’iniquité » qu’était le clergé entretenu. Les gouvernements encourageaient la guerre, que Gourlay détestait comme toute autre forme de violence, dans l’unique but de favoriser les classes privilégiées. La révolution balayerait les structures pourries de la société, et, bien menée, elle n’aurait pas besoin de recourir à la violence et de faire couler du sang ; « tout dépend de son organisation », disait Gourlay. Les changements ne viendraient pas de la « mare croupissante » de l’aristocratie mais sortiraient de « la demeure des pauvres » ; le suffrage universel établirait un gouvernement simplement structuré et la pratique de « la vraie vertu libérée de ses chaînes ».
D’après le plan spécifique de Gourlay (qu’il appelait son « système favori »), la Grande-Bretagne serait divisée en sections de 300 électeurs sachant lire et écrire. À chaque premier mai, à six heures du matin, les électeurs s’achemineraient dans le plus complet silence jusqu’à leur lieu de vote où ils affronteraient une machine pour voter « élaborée de façon singulière ». Chaque électeur choisirait à tour de rôle 30 candidats sur les 300 personnes présentes, au moyen de boules de scrutin. À midi, les 30 hommes ainsi élus se rassembleraient avec leurs compagnons des paroisses avoisinantes dans un centre du district, pour y répéter le même procédé. À sept heures du soir, l’élection des représentants de chaque comté à l’Assemblée nationale serait terminée ; ils auraient pour première tâche de préparer une pétition au roi ; et ils ne « ressembleraient en rien au parlement actuel ». Dans un passage très révélateur, Gourlay imaginait l’homme régénéré par son système et se voyait lui-même comme l’artisan d’un nouveau monde où régnerait la vertu : « Seigneur, toi qui es l’auteur de la vérité et de la nature à l’état pur, si, dans une période de renouveau, tu me confies une tâche, qu’elle consiste à brûler les anciennes structures ! [...] Et toi, homme libéré de tes liens, noble sauvage une fois redevenu toi-même, je te rencontrerai sur la douce pelouse verte, et j’établirai les plans de notre futur jardin. »
« Toute ma vie », affirmait Gourlay d’une façon désarmante, « j’ai poursuivi ma tâche avec enthousiasme. » A Deptford Farm, c’est à la fois son enthousiasme et son manque de jugement qui le firent entrer en conflit avec ses voisins et avec le duc de Somerset. À cause des efforts qu’il déployait pour créer une organisation nationale des locataires à bail capable de lutter contre les gros propriétaires fonciers, « dernière cohorte du pouvoir féodal », il fut expulsé des sociétés d’agriculture de Bath et de Wiltshire. Il s’engagea contre le duc dans un procès long et coûteux au sujet de ses conditions de bail ; le prix de sa victoire fut de perdre son bail et de s’appauvrir.
Durant ces années, où il exerça sa philanthropie et écrivit sans cesse des pamphlets, Gourlay fit de la condition des pauvres paysans sa préoccupation majeure. Pourquoi, demandait-il dans son pamphlet intitulé To the labouring poor of Wily parish (1816), des millions seraient-ils dépensés pour des guerres sanglantes quand « pas un sur dix des vôtres n’a pu apprendre à lire ou à écrire » ? Il tira d’une lecture de Malthus une réponse pleine d’optimisme : ce n’était pas l’homme, « cet animal docile et bon lorsqu’il n’était pas contrecarré par un régime tyrannique », mais le système qui était coupable. Des institutions malfaisantes comme les lois sur l’assistance publique avaient appauvri et abruti les paysans, leur ôtant toute raison et toute possibilité d’améliorer leur condition. Il demanda au parlement d’abolir ces lois et d’offrir une éducation aux pauvres dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement à l’échelle de la nation. Dans une autre pétition à la chambre des Communes en 1817, il préconisa une vaste redistribution des terres aux pauvres qui, une fois propriétaires d’une terre, seraient complètement transformés. Son plan, très simple (mais qui faisait le cauchemar de la bureaucratie), proposait que le gouvernement fasse l’acquisition de 100 acres dans chaque paroisse d’Angleterre et les répartisse en lots d’une demi-acre destinés aux pauvres. En s’acquittant rapidement de son loyer et en pratiquant une culture appropriée, le pauvre pourrait devenir « propriétaire paroissial ». La somme de £100 placée dans une banque d’épargne du gouvernement leur permettrait d’acquérir une chaumière de cette valeur, construite par le gouvernement, et le titre de « propriétaire d’une chaumière ». Une somme supplémentaire de £60 leur donnerait le titre « d’homme libre » et la possibilité d’être élu par la paroisse. Les pauvres parviendraient ainsi à la respectabilité et à l’indépendance.
« Je suis un vrai radical, mais à ma façon », disait Gourlay avec à-propos. « On me connaît aussi bien en Angleterre qu’en Écosse à cause de mes idées spéciales, mais celles-ci restent incomprises par plusieurs. » C’est avec cette réputation qu’il partit en 1817 pour le Haut-Canada, dans l’espoir de rétablir sa fortune. Sa femme, nièce de Robert Hamilton*, avait hérité de 866 acres dans le canton de Dereham, et les cousins de celle-ci, Thomas Clark* et William Dickson*, avaient tous deux visité Deptford Farm et leur avaient suggéré d’émigrer. Gourlay débarqua à Québec le 31 mai, avec l’idée de retourner en Angleterre à l’automne.
On allait lui accorder au Haut-Canada une importance qu’il n’avait jamais acquise en Grande-Bretagne. Le mécontentement fermentait dans la province. La prospérité qui régnait pendant la guerre avec les États-Unis prit fin en même temps que cette dernière. L’immigration avait été considérablement réduite à la suite notamment d’une décision impériale vigoureusement appuyée par le gouvernement local, interdisant la concession de terrains aux Américains. Ceux qui avaient subi des pertes à cause des Américains pendant la guerre n’avaient pas été indemnisés ; les miliciens qui avaient servi activement n’avaient pas reçu en récompense les terres qu’on leur avait promises. Le mécontentement se faisait particulièrement sentir dans le district de Niagara, non seulement parce que ce dernier avait été la principale arène de combats pendant la guerre, mais aussi en raison de son oligarchie locale, menée par Dickson et Clark et dont faisaient partie Samuel Street*, Robert Nichol*, et les héritiers de Robert Hamilton. Cette oligarchie possédait d’immenses territoires indéfrichés que seule l’immigration permettrait d’exploiter. En avril 1817, Nichol s’était présenté devant l’Assemblée à York (Toronto) et avait ouvertement demandé de lever l’interdit sur l’immigration des Américains et d’autoriser la vente des terres de la couronne. Seule la prorogation hâtive de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur Francis Gore* empêcha l’adoption de toutes les résolutions de Nichol. Gore fut également obligé de renvoyer de la commission de la paix le conseiller législatif Dickson qui ne voulait pas refuser le serment d’allégeance aux Américains désireux de venir s’installer au Canada. Là, au milieu de la classe dirigeante de la province, Gourlay avait à sa portée des collaborateurs prêts à l’aider et toute une collection de griefs prêts à être exploités ; il n’avait qu’à tendre la main.
Gourlay resta avec Thomas Clark pendant six semaines où il soigna ses piqûres de moustiques et assimila les vues du district de Niagara sur les affaires provinciales. Il fut très abattu lorsqu’il apprit que Clark ne pouvait pas lui prêter d’argent, du fait que son capital était immobilisé dans des terres, et qu’il lui était impossible de vendre les terrains de sa femme « à cause d’un ordre illégal et arbitraire du lieutenant-gouverneur », c’est-à-dire l’interdit posé sur l’immigration américaine. Après une randonnée à pied dans la région de Genesee (New York), il décida cependant de prolonger son séjour. Il avait résolu de devenir agent des terres, disait-il à sa femme, « pour traverser l’Atlantique chaque année et en même temps [se] faire une fortune, établir un vaste système d’immigration, et rendre le Haut-Canada prospère et heureux ». Mettant aussi à profit la longue tradition des sciences de l’agriculture et des statistiques en Écosse, il se proposa de rédiger un compte rendu statistique sur la province.
C’est dans cette optique à facettes multiples qu’il prépara un exposé à l’intention des propriétaires résidants du Haut-Canada, auquel il ajouta une série de 31 questions s’inspirant de celles posées par sir John Sinclair dans son Statistical account of Scotland. C’est bien à partir de cet ouvrage, et non dans un dessein secret, qu’il souleva la fameuse 31e question : « Qu’est-ce qui, à votre avis, retarde les progrès de votre canton en particulier, ou de la province en général ; et que pourrait-on faire pour y remédier ? » Grâce à ses amis de Niagara, Gourlay fut présenté à la plupart des hommes influents d’York (à l’exception notable de John Strachan) ; il se fit accorder par l’administrateur de la province Samuel Smith* la permission d’insérer son exposé dans l’Upper Canada Gazette et en envoya 700 copies supplémentaires aux fonctionnaires des cantons. Pendant qu’il séjournait à York il posa sa candidature pour une concession de terrain. Apparemment, il demanda qu’on lui accordât une attention toute spéciale, du fait probablement qu’il avait besoin d’une grande superficie pour lancer son programme d’immigration.
Son exposé était habile et produisit de l’effet, même si certains le trouvèrent condescendant. Désavouant tout intérêt pour les questions politiques, Gourlay comparait l’état actuel de la province à l’avenir brillant qui s’ouvrait devant elle. Le Haut-Canada ayant toujours été peuplé en majorité par les pauvres, il était inévitable qu’on y retrouvât une société « rustre, faible et sans ambition ». Ce qu’il lui fallait, ce n’était pas la reprise de l’immigration américaine, mais un plan qui amènerait les capitalistes britanniques à investir dans la province et à encourager l’immigration. Si cela se réalisait, une société supérieure « dotée de toute la force, et l’ordre et le raffinement » de la Grande-Bretagne, verrait le jour. Gourlay proposa que son compte rendu statistique serve de première étape pour éveiller l’intérêt des Britanniques, et il invita les habitants du Haut-Canada à tenir des assemblées de canton pour répondre à son questionnaire.
En février 1818, alors que des réunions se tenaient encore dans des cantons des quatre coins de la province, Gourlay changea brusquement de ton et de tactiques. Dans un second exposé, il annonça qu’il avait changé d’opinion au sujet de l’immigration des Américains ; d’après lui, on aurait dû mettre en accusation le gouverneur Gore pour l’avoir interdite. Si le Haut-Canada faisait partie des États-Unis, la valeur de ses terres doublerait. Gourlay ne préconisait pas l’annexion comme bien des gens se l’imaginèrent. Il jetait cependant le gant au gouvernement provincial, l’accusant de maintenir « un système de favoritisme mesquin et ruineux » et exigeait que l’Assemblée fasse une enquête sur l’état de la province, dont les résultats seraient communiqués à l’Angleterre par une commission.
Gourlay prit une décision, qui lui fut fatale, en jetant un défi au gouvernement de la colonie sur un des points majeurs de sa politique et en se présentant non pas comme un chercheur scientifique mais plutôt sous les apparences, qui lui étaient plus familières, d’un adversaire de l’autorité. Il donna toutes sortes de raisons pour expliquer cette décision. Au cours d’une randonnée à pied à travers l’Ouest du Haut-Canada, qui était peuplé en majorité d’Américains, il avait trouvé ces derniers « actifs, intelligents, amicaux et versés dans l’art de la colonisation ». D’autre part, il « ne pouvait s’empêcher de compatir » à la situation dans laquelle l’interdit sur l’immigration des Américains avait mis ses amis Dickson et Clark. Il fallait ajouter à cela le rejet de sa demande pour une concession de terrain « à cause des sales manigances du Petit York » et « des procédés dégoûtants du Land Granting Department » – en fait, le refus de cet organisme était justifié, parce que Gourlay ne se proposait pas de devenir un véritable colon. Il reconnut là l’œuvre de ce « monstrueux petit imbécile de pasteur » Strachan. Même si cette supposition était inexacte, sans doute eut-il raison de reprocher à Strachan le fait que pas un seul canton du populeux district de Home ne lui avait fait parvenir de rapport et qu’il n’en avait reçu qu’un petit nombre des districts à l’est d’York. Strachan avait essayé de convaincre le juge en chef William Dummer Powell* et Samuel Smith que Gourlay était « un brandon de discorde dangereux » lorsqu’il avait vu son premier exposé chez l’imprimeur du gouvernement, et il continua de travailler contre lui dans la coulisse.
Toutes ces déconvenues, auxquelles vint s’ajouter une série de lettres déprimantes de sa femme sur Deptford Farm, le jetèrent dans « une perplexité et une humeur absolument fébriles ». Il déversa dans les colonnes du Niagara Spectator un torrent d’injures contre « la vermine infâme, répugnante et fainéante du Petit York » et contre plusieurs autres de ses ennemis. Pendant ses randonnées à travers la province, il avait recueilli des faits scandaleux aussi bien que des statistiques, et la facilité et la véhémence avec lesquelles il les exposait maintenant ébranlèrent les milieux politiques soi-disant bien du Haut-Canada jusque dans leurs fondements. Lorsque Thomas Clark s’avisa de le mettre en garde, Gourlay passa outre et expédia sa réponse chez l’imprimeur. Pourquoi, répliquait-il à Clark, quelqu’un qui « avait lutté contre le deuxième pair d’Angleterre » devrait-il modérer son langage envers un petit minable « qui n’est qu’un parvenu » ? Strachan devrait cesser de se mêler de politique et se rendre dans un pénitencier, comme devrait le faire son homme de paille, le révérend John Béthune*, fils, « cette espèce de mouche du coche imbécile et médisant ».
Le troisième exposé de Gourlay, publié le 2 avril 1818, polarisa encore davantage l’opinion publique. Il l’avait écrit « d’un trait » en apprenant que Smith avait prorogé la législature à cause d’un conflit entre les deux chambres sur des projets de loi de finance, éliminant ainsi la motion proposée par l’Assemblée pour entreprendre une enquête gouvernementale sur l’état de la province. « La constitution de la province est en danger », annonça-t-il ; « tous les bienfaits du contrat social courent à leur perte. » Dans un langage impétueux, donnant prise aux interprétations les plus préjudiciables, il déclara que « [c’était] le système qui anéanti[ssait] tout espoir de jouir des vraies valeurs ; et tant que le système ne [serait] pas aboli, il [était] vain d’espérer quoi que ce soit d’un changement des représentants à la chambre ou des gouverneurs ». La constitution de la province n’étant d’aucun remède, il préconisa d’en appeler directement au prince régent ; on tiendrait une série de réunions aux niveaux des cantons et des districts, qui aboutirait à une convention provinciale à York où une pétition serait alors rédigée. Il fallait éviter toute discussion ; « la seule chose indispensable » que ses partisans devaient garder à l’esprit, était « un changement radical du système gouvernemental au Haut-Canada ».
Bien que Gourlay perdît à cette époque la plupart de ses puissants alliés – Clark mit en garde les gens de Niagara contre « les passions des visionnaires » et l’illégalité possible des assemblées – dès le début de mai le district de Niagara avait tenu une réunion et adopté un texte de pétition. Mille copies de la pétition et du procès-verbal de la réunion furent imprimées et, en mai et juin, Gourlay entreprit de distribuer la brochure à travers l’Est du Haut-Canada, ce qui souleva beaucoup de controverses. Dans le compte rendu qu’il écrivit dans le Spectator sur sa tournée dans l’Est, il fit observer à ses lecteurs que « les vils scélérats » qu’il avait rencontrés dans l’Est « ne s’étaient jamais élevés dans les domaines de la bonté parce que leur propre iniquité les aveugl[ait] ». À Kingston, il entra en conflit avec Daniel Hagerman et John Macaulay*, et à Prescott avec Jonas Jones*. Philip VanKoughnet* arracha ses affiches au fur et à mesure qu’il les posait. À Cornwall il fut attaqué par le magistrat Richard Duncan Fraser* ; à Kingston il se fit cravacher par Christopher Hagerman* pour avoir refusé de retirer de la presse une histoire comme quoi le frère de Hagerman « avait été en prison pendant plusieurs années aux États-Unis pour crime de faux et qu’il aurait été pendu depuis ».
À Kingston et à Cornwall, Gourlay fut accusé d’avoir écrit un article diffamatoire et séditieux. En avril, sur les instances de Strachan, l’administrateur avait donné pour directive au procureur général John Beverley Robinson de saisir la première occasion de poursuivre Gourlay, afin d’arrêter net la « carrière extrêmement menaçante [qu’il avait] entreprise ». Selon Robinson, le troisième exposé de Gourlay ainsi que la brochure de Niagara contenaient des passages grossièrement diffamatoires et subversifs. Bien qu’il craignît qu’un acquittement éventuel « élevât immédiatement Gourlay au titre de champion de la liberté contre une oppression imaginaire », à Kingston on porta accusation contre lui sur ses instances ; à Cornwall, c’est Fraser qui prit l’initiative de porter plainte contre Gourlay.
Les membres du gouvernement appréhendaient surtout la convention à venir. Robinson, par exemple, trouvait les conventions extrêmement dangereuses « puisqu’elles dénotaient la façon dont les mouvements populaires, sous des prétextes moins spécieux que celui-ci, [pouvaient] s’effectuer ». Le 4 juillet, il compara « les mesures sauvages de M. Gourlay » avec les réunions « qui, à une autre époque et dans d’autres colonies de l’empire britannique, avaient abouti à la rébellion ». Mais ni les juges ni lui-même ne parvinrent à trouver des raisons constitutionnelles valables d’annuler la convention et de punir ses membres les plus actifs.
La convention se tint à York du 6 au 10 juillet 1818. Elle fut décevante. Seulement 14 représentants de district sur les 25 élus étaient présents ; Gourlay en espérait 25 pour rivaliser avec le nombre de représentants à l’Assemblée. Bien que Strachan prétendit que Gourlay « les menait comme des enfants », les membres de la convention se montrèrent inquiets devant l’agitation qu’ils avaient provoquée. Ils décidèrent de s’appeler l’« Upper Canadian Convention of Friends to Enquiry » afin de distinguer leur réunion des « conventions formées dans le but de surveiller et de diriger les affaires publiques ». Au lieu d’adresser une pétition au prince régent, ils votèrent pour en présenter une au nouveau lieutenant-gouverneur, sir Peregrine Maitland*, et pour lui demander de procéder à de nouvelles élections provinciales. Gourlay lui-même semble avoir été déconcerté par la maigre assistance et par les critiques que lui adressèrent deux délégués. Son propre discours fut d’une platitude singulière ; n’aurait-ce été pour se défendre contre les accusations portées contre lui, déclara-t-il plus tard, il aurait laissé la convention « s’extirper de la boue du Petit York par ses propres moyens » dès la seconde journée.
Gourlay passa en jugement à Kingston le 15 août, et à Brockville le 31 août. Il prit sa propre défense dans les deux causes, et aux deux procès le jury l’innocenta. Immédiatement après son deuxième acquittement, il se rendit à New York dans l’espoir d’y trouver des lettres récentes de sa femme. Pendant qu’il séjournait au Haut-Canada elle avait dû affronter ses créanciers, réunir péniblement le montant pour payer le loyer de la ferme et tenir à l’écart les agents du duc de Somerset. « Tout le monde ici a les yeux braqués sur moi », lui avait écrit son mari, et « mes préoccupations actuelles m’empêchent absolument de penser à nos affaires » ; « reviens chez nous, cher Gourlay », le suppliait sa femme dans la lettre qui l’attendait à New York ; il lui envoya en retour une procuration l’autorisant à faire ce qu’elle pouvait, car « la seule pensée » de Deptford Farm lui était « douloureuse ». « Je suis ballotté par les flots capricieux », lui écrivit-il, « et je ne suis pas maître de ma destinée. » En octobre, il était de retour à Kingston où il organisa des réunions de canton pour demander des élections provinciales. À peu près à la même époque, sa femme abandonna la ferme et amena ses enfants à Édimbourg. L’influence qu’exerçait Gourlay sur les événements du Haut-Canada s’évanouit encore plus vite que ses projets familiaux. Maitland, convaincu que Gourlay était « moitié Cobbett et moitié Hunt », obtint de la législature une loi proscrivant toute réunion séditieuse, qui fut votée à l’unanimité moins une voix par l’Assemblée. Il refusa alors de considérer la pétition des Friends to Enquiry, qui leur avait demandé tant d’efforts, parce que leur convention représentait « un acte anticonstitutionnel ». Gourlay riposta par une lettre intitulée « Gagged, gagged, by Jingo ! » (Muselé, muselé, nom de nom !), qui entraîna l’arrestation du rédacteur en chef du Spectator, Bartimus Ferguson*, pour écrit diffamatoire et séditieux. Le mandat d’arrêt fut émis par William Dickson et William Claus*, à la suite d’une dénonciation d’Isaac Swayze*, un des députés de Niagara et confident de Dickson. Swayze informa le secrétaire de Maitland que Gourlay lui-même serait sous peu « sous bonne garde » ou « envoyé de l’autre côté de la rivière ».
Le 18 décembre 1818, Swayze fit serment devant les deux mêmes conseillers législatifs que Gourlay n’avait « pas de lieu de résidence particulier ou défini », que c’était « un homme mal intentionné et séditieux », qu’il n’avait pas habité la province pendant les six derniers mois (il s’était absenté du pays), et qu’il n’avait pas prêté le serment d’allégeance (c’est-à-dire, au Haut-Canada). Ces allégations étaient soigneusement modelées sur les clauses de la loi de sédition de 1804, qui avait été adoptée à l’origine pour faire face au danger possible des révolutionnaires français et des radicaux irlandais, mais n’avait jamais servi contre un sujet britannique. Gourlay devait prétendre tout le reste de sa vie qu’en tant que sujet britannique cette loi ne pouvait s’appliquer à lui ; pourtant, si l’on s’en tient aux intentions spécifiques de ses auteurs, aux termes extrêmement généraux de la loi elle-même, et à l’interprétation qu’en donnèrent les juges le 10 novembre 1818, il est clair qu’il tombait sous le coup de cette loi.
Un article particulièrement pernicieux de cette loi spécifiait qu’il incombait à l’accusé de prouver son innocence. Gourlay, qui comparut devant Dickson et Claus, « ne donna pas complète et entière satisfaction », et il fut condamné à quitter la province ainsi que le stipulait la loi. Comme il refusait d’exécuter cet ordre, il fut mis en prison à Niagara le 4 janvier 1819 en attente de son procès. À part sa comparution devant le tribunal d’York le 8 février pour demander une mise en liberté sous caution, que lui refusa d’ailleurs le juge en chef sous prétexte que la loi l’interdisait expressément, il resta en prison jusqu’au 20 août.
Ce n’était pas le gouvernement qui avait pris l’initiative d’appliquer cette loi « inconstitutionnelle, inique, frauduleuse et antichrétienne, exécrable ». Maitland et ses conseillers croyaient, non sans raison, que Gourlay perdait de son influence. Strachan pensait que cette arrestation était inopportune, que tôt ou tard Gourlay serait tombé sous le coup des lois ordinaires ayant trait à la diffamation, et que d’ailleurs ce dernier était « un objet de pitié » qui « depuis sa jeunesse a[vait] été agité et insubordonné ». Maitland avisa le ministère des Colonies que cette arrestation le laissait perplexe, mais qu’il avait décidé de laisser la loi suivre son cours. Ce n’était pas le gouvernement mais la renaissance inopportune de la loyauté « longtemps assoupie » de Niagara, comme le disait Strachan, qui avait pris Gourlay dans son piège. Pour Dickson et quelques-uns de ses amis, Gourlay était devenu un personnage qui avait perdu sa raison d’être, et, avec la venue d’un nouveau lieutenant-gouverneur tenace, il était devenu pour eux un véritable danger. Cherchant à redonner une assise à leur position à York, ils jetèrent Gourlay aux loups. Gourlay lui-même blâma Dickson ; « votre cousin ne s’est révélé guère meilleur qu’un fou », écrivit-il à sa femme.
De sa prison, Gourlay continua d’écrire des articles vigoureux pour le Niagara Spectator, notamment un quatrième exposé aux propriétaires terriens résidants le 20 mai. Des publications ultérieures, en juin, furent déclarées diffamatoires par l’Assemblée, et Gourlay fut encore plus étroitement gardé. L’impossibilité de laisser courir sa plume et la chaleur excessive qui régnait dans sa cellule minèrent sa santé physique et morale. D’après Gourlay et John Charles Dent*, dont le compte rendu dans The story of the Upper Canadian rebellion semble basé en partie sur des témoignages oculaires, il fut dans l’incapacité mentale de se défendre à son procès qui eut lieu le 20 août 1819. Son poursuivant, Robinson, qualifia la description que fit Gourlay du procès de « tissu de mensonges », mais il y a peu de raisons de douter de son exactitude fondamentale. Quoi qu’il en soit, le verdict du jury était décidé d’avance puisque le procès consistait à déterminer si oui ou non l’accusé avait désobéi à une ordonnance d’expulsion de la province. Le 21 août, Gourlay était sur la rive américaine du Niagara, comme un homme libre mais un Britannique banni.
Le principal document que laissa Gourlay de son séjour au Haut-Canada fut son Statistical account (1822), qu’il fit publier à Londres en deux volumes ; il y eut le projet d’un troisième volume qui finalement ne fut pas publié. Le ton persifleur de cet ouvrage, ses idées désordonnées et hors de propos, reflètent son sens aigu de l’injustice et la dépression dans laquelle l’avait jeté la mort de sa femme en 1820. Malgré tous ses défauts, cet ouvrage reste le meilleur recueil d’informations sur le Haut-Canada d’alors. Même si Gourlay ne tenta pas de les analyser, les 57 rapports de cantons qu’il fit imprimer offrent une description exceptionnelle de la vie économique et sociale de la province.
Il n’est pas aussi facile de discerner le rôle qu’a joué Gourlay dans le mouvement de réforme de la province, bien que des efforts aient été tentés dans ce sens. En plus d’avoir entretenu le mythe bien utile de son martyre entre les mains d’une oligarchie réactionnaire et offert peut-être quelques techniques d’organisation utiles, il semble avoir momentanément court-circuité la réforme. Son égotisme obscurcit les desseins de celle-ci, son style la discrédita et sa technique de recourir à des pétitions aboutit à un cul-de-sac. En réalité, Gourlay n’était pas un Canadien du Haut-Canada mais un réformiste britannique et impérial. « Je ne me soucie guère du Canada », affirma-t-il plus tard, « je me suis surtout efforcé [d’améliorer la condition] des pauvres en Angleterre. » Il ne proposa aucun programme efficace jusqu’à la publication de sa lettre « Aux représentants à l’Assemblée du peuple du Haut-Canada » (autrement dit « mes très augustes députés, frères culs-terreux »), qu’il écrivit de sa prison de Niagara le 7 juin 1819. Il y démontra, et les rapports de canton le confirmèrent, que si le Haut-Canada ne se développait pas c’était parce que d’immenses terrains non exploités restaient entre les mains des spéculateurs et du gouvernement. Plus vite ces terres seraient converties à la production, mieux ce serait, et il proposa subséquemment un contrôle direct du gouvernement impérial sur les concessions de terrains, la taxation des terres cultivées et inexploitées, qu’elles soient publiques ou privées, et le financement de l’émigration britannique et des projets de développement à grande échelle par les revenus et les crédits de la province ainsi établis. En préconisant la taxe sur les terres non exploitées et la vente des terres de la couronne, il était seulement en avance de quelques années sur son temps, et en suggérant de soulager ainsi la pauvreté des Anglais en finançant l’émigration, il influença directement Edward Gibbon Wakefield. Cependant, quand bien même il aurait exposé ces idées plus tôt dans sa carrière au Haut-Canada, il est très douteux qu’il ait pu trouver des partisans.
Les longues années que vécut encore Gourlay furent ternies par son expérience au Haut-Canada et son éternelle recherche de justification. Son don de se mettre en avant et de jouer au martyr ne le quitta jamais. En 1822, il acquit de la notoriété à travers la presse, qui l’appela le « pauvre amateur », en cassant des cailloux sur les routes de la paroisse de Wily. En 1824, il fut enfermé à la prison de Cold Bath Fields comme un personnage dangereux et privé de sa raison, pour avoir frappé Henry Brougham avec une cravache dans les couloirs de la chambre des Communes, sous prétexte qu’il ne défendait pas suffisamment sa cause. Il préféra rester incarcéré plutôt que de donner du poids à l’accusation d’aliénation mentale portée contre lui, en demandant une mise en liberté sous caution. Dans sa chronique de l’événement, An appeal to the common sense, mind and manhood of the British nation (1826), il déclara : « le monde entier est encore contre moi, le même monde qui empoisonna Socrate, crucifia le Christ et emprisonna Galilée ». Relâché en 1828, il essaya sans succès d’obtenir la chaire d’agriculture à Édimbourg en 1831 et d’entrer au parlement en 1832. En 1833, il alla s’installer avec des amis en Ohio, mais il ne parvint pas à intéresser la population à un compte rendu statistique de leur état, ni au projet de creuser des puits au niveau de la mer pour fournir des données sur la croûte terrestre. Le même sort fut réservé aux projets de développement qu’il soumit à plusieurs villes. Les Bostoniens, par exemple, restèrent froids devant son idée d’allonger Faneuil Hall de 40 pieds parce qu’il n’était pas « suffisamment long par rapport à la largeur ». De 1846 à 1856, Gourlay vécut en Écosse et tenta de se faire élire au parlement avec un programme proposant « un lit, un parapluie et du pain ». En 1856, il retourna au Haut-Canada pour s’installer sur sa terre de Dereham. À 80 ans, il se présenta dans la circonscription électorale d’Oxford et épousa sa femme de ménage, Mary Reenan, qui était âgée de 28 ans ; ces deux initiatives s’avérèrent malheureuses, et il quitta le Haut-Canada pour Édimbourg où il vécut le restant de ses jours.
Pendant toutes ces années, Gourlay demanda justice aux autorités britanniques et coloniales. Ses démarches sont racontées en partie dans son journal personnel The banished Briton and Neptunian, relié en 39 numéros et publié à Boston en 1843. En dépit de tout, il demeurait « un Britannique avec une âme de véritable patriote ». Ainsi, à l’époque de la rébellion au Haut-Canada, il condamna publiquement William Lyon Mackenzie qui, d’après lui, manquait de stabilité, pour sa conduite déloyale, et il fournit à sir Francis Bond Head* des renseignements sur les activités des Patriotes aux États-Unis. De temps à autre, certains hommes politiques compatissants prirent sa cause en considération au Canada, mais il les contrecarra tous en refusant les pensions et les pardons qu’il trouvait insultants. Il ne souhaitait rien de moins que l’histoire change de cours. Jusqu’à la fin de sa vie, il resta convaincu de la justesse de sa cause et de l’iniquité de ceux qui l’avaient écrasé. John Neilson* essaya de l’aider en 1841 : « vous n’allez sûrement pas imaginer que vous étiez exempt de tout tort dans les difficultés que vous avez rencontrées au Canada », lui écrivit-il dans une lettre pleine de sympathie. Mais Gourlay lui répondit que c’était précisément la question : « J’étais absolument exempt de tout tort et je vous prie instamment de relire tous mes écrits au Canada, et d’y trouver mes torts si vous le pouvez. »
Les ouvrages suivants de Robert Fleming Gourlay, notamment The banished Briton and Neptunian : being a record of the life, writings, principles and projects of Robert Gourlay [...] (Boston, 1843) et Chronicles of Canada : being a record, of Robert Gourlay [...] (St Catharines, Ont., 1842), contiennent une documentation de première main qui n’existe plus ailleurs ; par exemple, une partie de la documentation gardée autrefois dans les archives du Niagara Spectator (Niagara, Ont.) est aujourd’hui disparue. Les autres ouvrages publiés de Gourlay comprennent : A specific plan for organising the people, and for obtaining reform independent of parliament [...] to the people of Fife [...] of Britain ! (Londres, 1809) ; [...] To the labouring poor of Wily parish ([Bath, Angl., 1816]) ; General introduction to statistical account of Upper Canada, compiled with a view to a grand system of emigration, in connexion with a reform of the Poor Laws (Londres, 1822 ; réimpr., [East Ardsley, Angl.], 1966 ; Londres, 1966) ; Statistical account of Upper Canada, compiled with a view to a grand system of emigration (2 vol., Londres, 1822 ; réimpr., [East Ardsley], 1966 ; [New York, 1974]) ; et An appeal to the common sense, mind and manhood of the British nation (Londres, 1826).
La seule biographie qui couvre toute la vie de Gourlay, Lois Darroch Milani, Robert Gourlay, gadfly : the biography of Robert (Fleming) Gourlay, 1778–1863, forerunner of the rebellion in Upper Canada, 1837 ([Thornhill, Ont., 1971]), contient de nombreux documents provenant surtout d’Écosse, introuvables ailleurs. L’avant-propos du livre de Gourlay, Statistical account of Upper Canada, S. R. Mealing, édit. (Toronto, 1974), constitue un compte rendu perspicace et équilibré ; il nous renseigne tout particulièrement sur les antécédents écossais des travaux statistiques de Gourlay. [s. f. w.]
APC, MG 24, B33 ; RG 5, A1.— PAO, Gourlay family papers ; Macaulay (John) papers ; Robinson (John Beverley) papers ; Strachan (John) papers.— PRO, CO 42/359–362.— Sir John Sinclair, The statistical account of Scotland ; drawn up from the communications of the ministers of the different parishes (21 vol., Édimbourg, 1791–1799).— [John Strachan], The John Strachan letter book, 1812–1834, G. W. Spragge, édit. (Toronto, 1946).— S. D. Clark, Movements of political protest in Canada, 1640–1840 (Toronto, 1959).— Craig, Upper Canada.— Dent, Upper Canadian rebellion.— E. A. Cruikshank, Post-war discontent at Niagara in 1818, OH, XXIX (1933) : 14–46.— W. R. Riddell, Robert (Fleming) Gourlay, OH, XIV (1916) : 5–133.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
S. F. Wise, « GOURLAY, ROBERT FLEMMING », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 30 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/gourlay_robert_flemming_9F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/gourlay_robert_flemming_9F.html |
| Auteur de l'article: | S. F. Wise |
| Titre de l'article: | GOURLAY, ROBERT FLEMMING |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1977 |
| Année de la révision: | 1977 |
| Date de consultation: | 30 déc. 2025 |