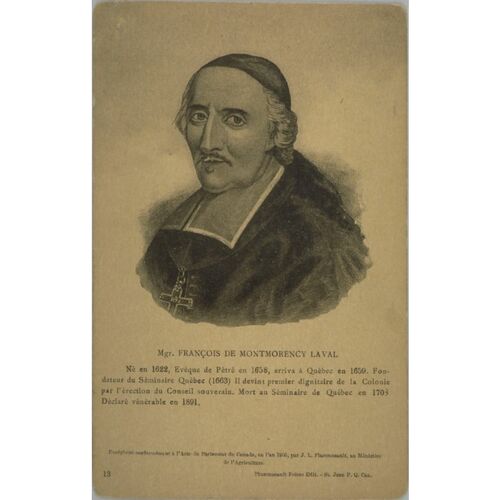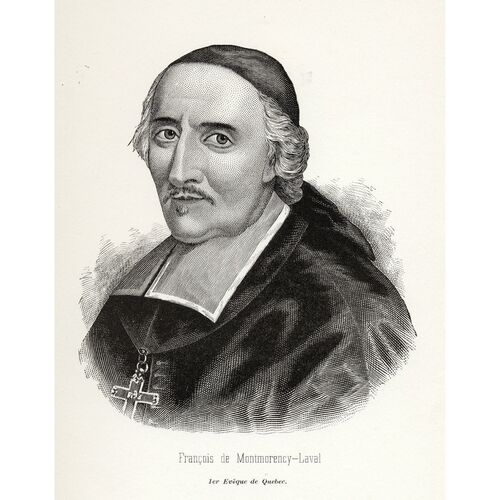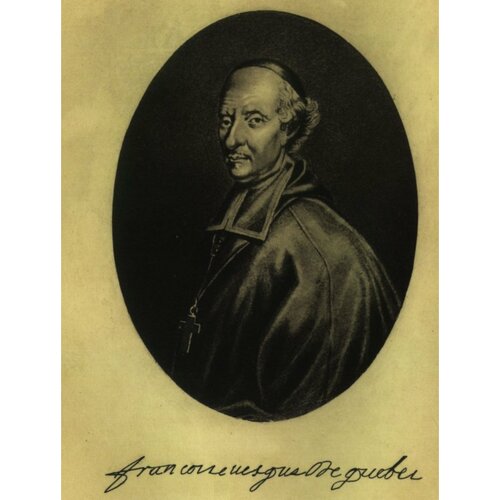Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
LAVAL, FRANÇOIS DE, évêque in partibus de Pétrée, vicaire apostolique en Nouvelle-France (1658–1674), premier évêque de Québec (1674–1688), né à Montigny-sur-Avre (Eure-et-Loir), dans le diocèse de Chartres (France), le 30 avril 1623, baptisé sous les prénoms de François-Xavier, fils de Hugues de Laval, seigneur de Montigny, Montbaudry, Alaincourt et Revercourt, et de Michelle de Péricard, décédé à Québec le 6 mai 1708, inhumé le 9 dans la cathédrale de cette ville.
François de Laval était issu de la branche cadette d’une des plus nobles familles de France, les Montmorency, dont l’origine remonterait à la Gaule païenne. Un Montmorency aurait été, en effet, le premier des grands du royaume de France à recevoir, avec Clovis, le baptême des mains de saint Remi, à Reims, en 496. Le cri de guerre Dieu ayde au premier baron chrestien, qui fut aussi la devise de cette lignée et que l’on retrouve dans les armoiries de Mgr de Laval, perpétuait le souvenir de ce glorieux événement. Le titre de Premiers barons de France, également porté par les Montmorency, n’était pas moins mérité : à l’Église et au Royaume, cette famille donna plusieurs cardinaux, six connétables, douze maréchaux, quatre amiraux, un grand nombre de généraux et d’officiers civils et militaires. Au xiiie siècle, Mathieu de Montmorency, dit le Grand, connétable de France, épousa en secondes noces Emme de Laval, elle-même de haute noblesse. Guy, né de cette union, prit le nom de sa mère ; c’est de lui que descendait François de Laval.
Par sa mère, Michelle de Péricard, fille du seigneur de Saint-Étienne, en Normandie, François de Laval appartenait à une famille de robe, qui avait fourni plusieurs officiers royaux au parlement de Rouen et de nombreux prélats à l’Église. Le siège épiscopal d’Évreux, justement, était occupé vers cette époque par un frère de Mme de Laval, François de Péricard, qui allait jouer un rôle important dans la vie du jeune François.
Le seigneur de Montigny et son épouse, tous deux d’une piété et d’une vertu éprouvées, ne possédaient point, malgré leur noblesse, de grandes richesses : le fief de Montigny, le plus important des quatre qu’ils détenaient, n’était à vrai dire qu’un gros bourg. La situation financière de la famille allait bientôt devenir assez précaire, et François allait devoir se consacrer un jour à son rétablissement.
Hugues de Laval et sa femme eurent six fils et deux filles, dont une, Isabelle (fille posthume), mourut à l’âge de sept mois. Henri, cinquième fils, entra chez les Bénédictins et devint prieur de La Croix-Saint-Lauffroy ; Anne-Charlotte prit le voile chez les Filles du Saint-Sacrement, dont elle fut la supérieure. Destiné par sa famille à l’état ecclésiastique, auquel lui-même aspirait, François fut tonsuré et prit la soutane à l’âge de huit ans et demi, selon les usages de l’époque, peu après son entrée au collège des Jésuites de La Flèche, que fréquentaient les fils des meilleures familles de France. François allait passer dix ans (1631–1641) dans cette célèbre institution, y poursuivant avec grand succès ses études littéraires et philosophiques. En 1637, son oncle, François de Péricard, évêque d’Évreux, le nomma chanoine de la cathédrale de son diocèse. Ce bénéfice, bien que peu considérable – il fut augmenté en 1639 –, arrivait à point. Ajouté aux maigres ressources familiales, il permit à François de continuer ses études, menacées un moment par la mort de son père survenue le 11 septembre 1636.
Pour François de Laval, les années vécues à La Flèche furent en quelque sorte décisives. Sous la direction éclairée des Jésuites, il progressa rapidement dans la voie de la piété et de la vertu, méritant bientôt d’être admis dans la Congrégation de la sainte Vierge, alors dirigée par le père Jean Bagot. De cette époque date sa détermination de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, de même que son intérêt pour les missions du Canada, fort à l’honneur en ce collège où résidèrent quelques-uns des plus grands apôtres de l’Amérique française. En contact constant avec les fils de saint Ignace, François apprit à les connaître, s’imprégna de leur spiritualité et s’attacha très sincèrement à eux : « Dieu seul, écrivait-il en 1659, sait combien j’ai d’obligation à votre Compagnie [la Compagnie de Jésus], qui m’a réchauffé dans son sein lorsque j’étais enfant, qui m’a nourri de sa doctrine salutaire dans ma jeunesse, et qui depuis lors n’a cessé de m’encourager et de me diriger [...]. [Les Jésuites] m’ont appris à aimer Dieu et ont été mes guides dans la voie du salut et des vertus chrétiennes... »
En 1641, François s’installa à Paris, au collège de Clermont, également dirigé par les Jésuites, pour y faire sa théologie. Il marchait allégrement vers le sacerdoce quand, coup sur coup, deux événements tragiques le frappèrent cruellement : à Fribourg en 1644 et à Nordlingen en 1645, tombèrent ses deux frères aînés, François et Gabriel, engagés l’un dans l’armée de Condé, l’autre dans celle de Turenne. Héritier du patrimoine et des obligations familiales, François prit le nom d’abbé de Montigny. Sa mère, puissamment secondée par l’évêque d’Évreux, le supplia de quitter l’état ecclésiastique, de se marier et de soutenir l’honneur de sa maison. Inébranlable, François décida toutefois de suspendre momentanément ses études. Il retourna à Montigny, mit bon ordre aux affaires de la famille, et, avec l’encouragement cette fois de l’évêque d’Évreux, rentra bientôt au collège de Clermont. Sous-diacre en 1646, diacre l’année suivante, il fut ordonné le 1er mai 1647.
Prêtre à 24 ans, François était bien préparé pour un ministère qui, des témoignages les plus autorisés, se révéla très fructueux. À Paris, il avait retrouvé le père Bagot et plusieurs de ses compagnons de la Congrégation de La Flèche. Regroupés dans la société des Bons Amis, ils poursuivirent ensemble l’œuvre de leur perfectionnement spirituel. François s’y distingua par sa piété, son zèle et sa vertu. Dans l’année qui suivit son ordination, il se consacra au soin des malades, à l’instruction des enfants délaissés et à l’administration de son patrimoine. En 1648, il se démit de son canonicat – tout honorifique – d’Evreux. Peu après, en décembre, il était nommé archidiacre du même diocèse, qui comptait alors 155 paroisses et 4 dessertes. La tâche était lourde. Mais « l’exactitude de ses visites, écrivait M. de La Colombière, la ferveur avec laquelle il s’y comporta, la réforme et le bon ordre qu’il établit dans les paroisses, le soulagement des pauvres, son application à toutes sortes de biens, tout cela fit bien voir que, sans être évêque, il en avait l’esprit et le mérite et qu’il n’y avait pas de services que l’Église ne dût attendre d’un si grand sujet. » En 1649, il avait obtenu une licence en droit canon de l’université de Paris, requise pour l’exercice de ses fonctions d’archidiacre.
Depuis 1642 au moins, François de Laval rêvait en secret d’être missionnaire. Les Bons Amis, avec lesquels il resta en contact étroit pendant les années de son archidiaconat, partageaient ses aspirations. (Cette société, du reste, fut le berceau du séminaire des Missions étrangères de Paris.) Or, en 1652, le jésuite Alexandre de Rhodes cherchait, avec l’autorisation du pape, des candidats qui accepteraient d’être nommés vicaires apostoliques au Tonkin et en Cochinchine. Après consultation avec le père Bagot et les Bons Amis, il choisit MM. François Pallu, Bernard Picques et François de Laval, que Rome et la cour agréèrent. François de Laval était destiné au Tonkin. Mais l’affaire traîna bientôt en longueur : la Propagande, qui désapprouvait la trop grande indépendance des Jésuites dans les pays de mission, craignait que les candidats proposés ne leur fussent trop attachés, d’autant qu’ils s’étaient déclarés prêts à entrer dans la Compagnie de Jésus, et le Portugal s’opposait fermement à l’envoi d’évêques français en Extrême-Orient. Le projet fut abandonné en 1654. Quelle que dût être son activité future, François de Laval décida de s’y préparer désormais dans la prière et la retraite. En 1654, sans même en retenir la pension à laquelle il avait droit, il se démit en faveur de son ami Henri-Marie Boudon de l’archidiaconat d’Évreux – qui eût pu le mener à l’épiscopat – et céda à son frère puîné, Jean-Louis, son patrimoine et ses droits d’aînesse. (Hugues, le plus jeune de ses frères, était décédé en 1642, âgé d’une douzaine d’années.) Rompus ces derniers liens avec le monde, il prit la route de Caen.
François alla frapper à la porte de l’Ermitage, dirigé par M. Jean de Bernières de Louvigny. Un des grands mystiques de son temps, M. de Bernières, quoique laïc, avait été choisi pour maître et directeur spirituel par quelques-uns des plus pieux et des plus vertueux personnages de France. L’Ermitage abritait depuis 1649 une petite communauté de prêtres et de laïcs, adonnés à l’oraison et aux exercices de charité, et menant une vie fort réglée et austère. « Intime ami » de M. de Bernières, François de Laval mit en pratique ses admirables maximes ; joignant à la prière et à l’oraison les œuvres de charité, il s’occupa, comme il l’avait fait à Paris, des pauvres et des malades, dans la grande tradition de Vincent de Paul. Dans le même temps, il réforma un monastère tombé dans le relâchement et fit éclater jusqu’à la cour le bon droit d’une communauté d’hospitalières menacée de spoliation. Administrateur et confesseur, au surplus, de deux communautés de femmes, il mérita de Mgr Servien, en 1657, un éloge sans équivoque (fait sous la foi du serment) : prêtre « d’une très grande piété », « très prudent et supérieur en affaires », qui a donné, dans le diocèse de Bayeux, de « grands exemples » de vertu.
Mais voici que, de nouveau, on s’employait à doter la Nouvelle-France d’un évêché. Le mouvement avait pris naissance parmi les Associés de Montréal, en 1645, mais avait rencontré par la suite beaucoup d’obstacles. En janvier 1657, les Associés proposaient un candidat, le sulpicien Gabriel de Thubières* de Levy de Queylus. Agréé par l’Assemblée du clergé de France, l’abbé de Queylus ne le fut pas par les Jésuites. Ces derniers, ayant décliné l’invitation de la reine mère Anne d’Autriche de faire nommer un des leurs au siège épiscopal de Québec, soumirent le nom de leur ancien élève, François de Laval. La reine mère et la cour, désireuses que le nouvel évêque vécût en bons termes avec les Jésuites canadiens, approuvèrent ce choix. François de Laval fut prévenu, à l’Ermitage, des projets qu’on avait formés pour lui. Il ne pouvait, toutefois, prévoir les difficultés dont sa route allait être jalonnée désormais.
Le choix de François de Laval et les circonstances de sa nomination au siège épiscopal de la Nouvelle-France allaient en effet réveiller et faire éclater au grand jour le conflit latent qui se développait dans cette colonie, dont Rome et l’archevêque de Rouen se disputaient discrètement, mais avec beaucoup de détermination et de ténacité, la juridiction ecclésiastique.
Depuis le xvie siècle, le pape avait perdu toute autorité directe sur les missions : il lui fallait passer par les rois, qui avaient le droit de patronage, par les évêques, qui poussaient leur influence en dehors des limites de leurs diocèses, et par les supérieurs généraux des grands ordres missionnaires, qui avaient acquis une large autonomie. Le général des Jésuites, par exemple, et ses provinciaux de France pouvaient fonder des missions sans même consulter le Saint-Siège. Ainsi, à leur arrivée au Canada en 1625, et à leur retour en 1632, les Jésuites détenaient leurs pouvoirs de Rome, mais par l’intermédiaire de leur général. Pourtant, dans le but de centraliser l’administration de toutes les missions et de les placer sous l’autorité immédiate du Saint-Siège, le pape avait créé en 1622 la Sacrée Congrégation de la Propagande. Celle-ci. avait dès lors entrepris, avec beaucoup de prudence et de diplomatie, mais avec assez peu de succès, de réduire l’indépendance quasi totale des Jésuites en pays de mission.
Au Canada, cependant, les missionnaires de la Compagnie de Jésus allaient perdre peu à peu leur tranquille assurance des débuts. L’arrivée des Ursulines et des Hospitalières en 1639 – de ces dernières en particulier à qui l’archevêque de Rouen avait fait promettre de reconnaître sa juridiction sur leur communauté –, contribua singulièrement à inquiéter les Jésuites sur la validité des professions religieuses auxquelles ils pourraient être appelés à présider et des mariages entre colons qu’ils bénissaient en se fondant exclusivement sur leurs facultés missionnaires. Leur juridiction s’étendait-elle au-delà du ministère proprement missionnaire auprès des Indiens ? Ils en étaient de moins en moins certains. Demander à la Propagande des pouvoirs plus étendus, c’était se mettre dans sa complète dépendance et déroger, au surplus, à la politique traditionnelle de la compagnie que défendait farouchement leur général, à Rome. Par ailleurs, l’archevêque de Rouen, qui ne doutait pas du bien-fondé de sa juridiction sur la Nouvelle-France, imposait graduellement, mais d’une façon irréversible, son autorité épiscopale à la jeune colonie.
Deux événements allaient faire pencher les Jésuites canadiens du côté de Rouen. En 1645 et 1646, d’une part, les Associés de Montréal travaillaient à l’érection d’un évêché au Canada, et proposaient un candidat de leur choix, l’abbé Thomas Le Gauffre ; s’ils réussissaient, c’en était fait de l’autonomie des Jésuites en Nouvelle-France. Le nouveau général des Jésuites, d’autre part, s’était rendu aux pressions de la Propagande, en 1646, et lui avait rétrocédé, en fait, la plupart de ses pouvoirs en matière de missions. Dans cette conjoncture, les Jésuites canadiens hésitèrent, consultèrent discrètement et, finalement, en 1648, acceptèrent la juridiction de la Propagande en lui demandant de nouveaux pouvoirs, mais sollicitèrent en même temps, et acceptèrent en 1649, des lettres de grand vicaire de l’archevêque de Rouen pour leur supérieur de Québec. Cette dernière démarche – sur laquelle leur général lui-même ne fut pas consulté – fut tenue secrète jusqu’en 1653, au point que Marie de l’Incarnation [Guyart*], si proche des Jésuites pourtant, n’en soupçonnait rien. Les pouvoirs de grand vicaire étaient plus étendus que ceux conférés par la Propagande, et rassuraient davantage les Jésuites sur la validité des professions religieuses et des mariages. Aussi, en 1653, rendirent-ils publique leur dépendance de Rouen, et cessèrent-ils de correspondre avec la Propagande après cette date. Des deux options qui s’offraient à eux, ils avaient choisi la moins restrictive : la formule rouennaise leur laissait plus d’autorité et d’autonomie que ne l’eût fait la romaine.
En refusant le candidat de l’Assemblée du clergé de France, en janvier 1657, ce n’est pas la personne même de l’abbé de Queylus que repoussaient les Jésuites, mais la menace qu’il représentait pour l’indépendance de l’Église canadienne, qu’ils entendaient restaurer et assurer définitivement. En secret, ils proposèrent à la cour un candidat de leur choix, François de Laval. Ils voulaient faire de lui l’évêque en titre de Québec. Pendant 18 mois, ils poussèrent cette affaire à Paris et à Rome, sans que l’archevêque de Rouen, François de Harlay de Champvallon, en eût rien soupçonné, semble-t-il. C’est qu’ils se promettaient, une fois leur candidat nommé et sacré, de détacher entièrement l’Église canadienne de l’archevêché de Rouen. Dans leur esprit, l’évêque de Québec devait dépendre directement du pape. Bien sûr, Harlay n’eût pas été de cet avis...
En janvier 1657, Louis XIV écrivit donc au pape, lui présentant son candidat à l’évêché de Québec, le père François de Laval. Rome voulut d’abord savoir à quelle communauté appartenait ce père. Première cause de retard ; puis on oublia de transmettre les informations canoniques. Le temps passait. Les Jésuites faisaient pression surpression, appuyés par la cour de France. Des mois s’écoulèrent. Tout le monde s’impatientait ; on multipliait les mémoires, on sollicitait le concours des cardinaux romains, mais en vain. Seul François de Laval restait muet et comme indifférent, à la surprise de ceux qui supportaient le plus sa candidature. Cette nomination, il ne l’avait point recherchée ; se rappelant peut-être l’affaire du Tonkin, il attendait, à l’Ermitage, et sans rien faire pour l’influencer, la décision de Rome, qui serait l’expression de la volonté de Dieu sur lui.
Le retard de Rome à prendre une décision venait à vrai dire de la Propagande. On y craignait encore une fois que, par le moyen de François de Laval, qui leur était très lié depuis son enfance, les Jésuites ne perpétuent leur indépendance de cette congrégation romaine au Canada. Il ne pouvait être question d’y nommer un évêque en titre. Aussi souleva-t-on de multiples difficultés, pour enfin proposer à la cour de France la création d’un vicariat apostolique en Nouvelle-France plutôt que d’un évêché. La cour obtint sur cette question l’assentiment des Jésuites et de M. de Laval lui-même. (On a prétendu, à tort, que les Jésuites avaient eux-mêmes suggéré cet expédient.) La nomination d’un simple vicaire apostolique mettrait l’Église et la mission du Canada – Jésuites inclus – dans la dépendance directe de la Propagande et partant du Saint-Siège ; pour Mgr de Laval et les Jésuites, elle aurait l’avantage de les soustraire, en théorie tout au moins, à la juridiction de l’archevêque de Rouen qui le céderait à celle, plus universelle, du pape.
Les bulles de vicaire apostolique en faveur de François de Laval furent signées à Rome le 3 juin 1658. Pour sa consécration, Mgr de Laval choisit le 4 octobre, fête de saint François d’Assise.
L’archevêque de Rouen, qui se considérait l’évêque légitime du Canada, où il avait depuis dix ans un grand vicaire, ignorait tout, semble-t-il, des démarches entreprises pour doter cette partie de son diocèse d’un siège épiscopal. Ardent gallican au surplus, il reçut fort mal la nouvelle de l’expédition de ses bulles à François de Laval. D’autant que la dignité – nouvelle dans l’Église – de vicaire apostolique, le plus souvent obtenue par surprise et sous de fausses représentations, avait fait l’objet de sérieuses délibérations à l’assemblée du clergé de France, qui recommanda finalement aux évêques de refuser la consécration à ces prélats s’ils se présentaient à eux. Le 25 septembre 1658, à Paris, devant une assemblée particulière du clergé, Harlay souleva la question des bulles expédiées à François de Laval, et obtint qu’une circulaire fût adressée aux évêques, les incitant à lui refuser la consécration, conformément aux recommandations de l’assemblée plénière et à cause du préjudice que cette intervention romaine causait à l’Église gallicane. Les trois évêques qui avaient déjà promis leur concours à François de Laval se désistèrent aussitôt.
Outre l’appui de l’Église de France, Harlay chercha celui des parlements, défenseurs jaloux et pointilleux des « libertez », droits, privilèges et immunités de l’Église gallicane. Lui-même siégeait au parlement de Rouen. Il en obtint, le 3 octobre 1658, veille du jour fixé pour la consécration de Mgr de Laval, un arrêt interdisant à ce dernier de « s’ingérer dans les fonctions de vicaire apostolique au Canada » et déclarant qu’en cette affaire la bonne foi du pape avait manifestement été surprise.
Silencieux jusque-là, François de Laval le resta cette fois encore ; ses alliés, les Jésuites et le nonce du pape à Paris, Mgr Piccolomini, tournèrent cependant la difficulté. Rome avait le droit de nommer des vicaires apostoliques dans les pays de mission ; les prétentions de l’archevêque de Rouen n’étaient pas fondées en droit ni reconnues par Rome ; la reine mère, enfin, et le jeune roi étaient favorables à leur candidat ; ils décidèrent donc de procéder en secret à la consécration de Mgr de Laval, dans une église exempte de la juridiction ecclésiastique du royaume. Le 8 décembre 1658, dans la chapelle de la Vierge (aujourd’hui disparue) de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le nonce imposa les mains à François de Laval, alors âgé de 35 ans.
La réaction gallicane ne se fit pas attendre, dès la nouvelle de la consécration. L’archevêque de Paris, froissé qu’on eût consacré François de Laval dans son diocèse sans sa permission, et l’archevêque de Rouen, à qui Mazarin refusa, pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec cette affaire, de convoquer l’assemblée du clergé de France, se rabattirent sur le parlement de Paris. Entrant dans leurs vues et jugeant qu’il y avait atteinte aux droits de l’épiscopat et aux libertés de l’Église gallicane, le parlement rendit, le 16 décembre, un arrêt obligeant François de Laval a communiquer ses bulles à la cour et lui interdisant de s’en autoriser avant d’avoir reçu les lettres patentes nécessaires en pareille occurrence. Cet arrêt fut signifié à Mgr de Laval le 19. Le 23, le parlement de Rouen, à son tour, renouvelait son arrêt du 3 octobre, défendait à tout sujet du roi de reconnaître M. de Laval comme vicaire apostolique, et enjoignait à tous les officiers du royaume de s’opposer à son entreprise et d’empêcher qu’il n’exerçât aucune fonction. Mgr de Laval, cette fois encore, resta silencieux : il voyait bien que, dans toute cette affaire, il n’était que le prétexte ou l’occasion d’une bataille depuis longtemps prévue, et que d’autres livraient sur son dos.
Après avoir en vain menacé de sanctions l’archevêque de Rouen, Rome conseilla à Mgr Piccolomini, en décembre 1658 et en janvier 1659, de s’appuyer désormais sur « Leurs Majestés », Anne d’Autriche et le jeune Louis XIV. C’était la seule issue, la reine mère ayant dès le début favorisé le plan des Jésuites. Mgr de Harlay, cette fois, se sentit menacé. Le 3 mars 1659, il suggéra à Mazarin un compromis, dont il fut tenu compte dans les lettres patentes du 27 mars, demandées par Anne d’Autriche pour casser l’arrêt du parlement. Ces lettres ordonnaient que Mgr de Laval fût reconnu « pour faire les fonctions épiscopales, sans préjudice des droits de la jurisdiction ordinaire, et cela, en attendant l’érection d’un évêché dont le titulaire sera suffragant de l’archevêque de Rouen ». C’était aller entièrement à l’encontre du plan des Jésuites et de la Propagande. La reine mère, présente au Conseil du roi, pouvait-elle l’ignorer ? Elle se reprit le 30 mars, peut-être à la suggestion du nonce. Elle écrivit une lettre à M. d’Argenson [Voyer], gouverneur de la Nouvelle-France, lui enjoignant de faire reconnaître Mgr de Laval en qualité de vicaire apostolique et de « tenir la main à ce qu’il soit obéi dans toutes les fonctions épiscopales », et même d’ « empêcher qu’aucun ecclésiastique ou autre n’en puisse exercer ni avoir aucune jurisdiction ecclésiastique que par les ordres ou consentement » de Mgr de Laval. Ainsi se trouvait éliminée du Canada, en théorie tout au moins, l’autorité de l’archevêque de Rouen.
Mgr de Laval prêta le serment de fidélité au roi, et s’embarqua à La Rochelle le 13 avril 1659. Il n’avait ni recherché ni repoussé la dignité épiscopale ; les pires tempêtes avaient soufflé autour de lui sans qu’il intervînt en quoi que ce fût pour les apaiser, abandonnant entièrement à Dieu le soin d’orienter sa vie. Une chose était certaine, désormais : Dieu le voulait en Nouvelle-France. Il y voguait, avec pour seul revenu une rente de 1 000# dont l’avait avantagé la régente.
Dans le détachement et la pauvreté, commençait une grande et pénible aventure : l’édification d’une Église canadienne.
Le Canada de 1659 était, à vrai dire, bien peu de chose. La population française n’y atteignait pas 2 000 âmes, partagées entre trois centres de peuplement, sur une distance de plus de 60 lieues. La région de Québec, formée de la ville proprement dite et des seigneuries de Beauport, Beaupré, Notre-Dame-des-Anges et Lauson, présentait la plus forte concentration de population, avec près de 1 200 habitants ; quelques centaines de colons étaient établis à Trois-Rivières ou dans les seigneuries voisines du Cap-de-la-Madeleine, de Sainte-Anne et de Champlain, qui commençaient à peine à se développer ; aux avant-postes, l’île de Montréal était le dernier centre habité.
La faiblesse numérique de sa population manifeste le peu de progrès de la colonie depuis sa fondation par Champlain* en 1608. Les compagnies à monopole, sur lesquelles l’État se déchargea entièrement des destinées de la Nouvelle-France, négligèrent tout à fait de satisfaire à leurs obligations, à l’exception de la Compagnie des Cent Associés (1627), qui connut cependant un début désastreux dont elle ne se releva jamais. À partir de 1645, la Communauté des Habitants assuma les charges du pays, mais ne fit guère mieux, par suite de la guerre iroquoise qui paralysait presque complètement la traite des fourrures. Une population insuffisante, des institutions administratives demeurées embryonnaires, les attaques répétées des Iroquois, une crise économique sans issue, autant de facteurs qui, même aux plus optimistes, faisaient craindre pour l’avenir de la colonie.
Colonie française, la Nouvelle-France était en même temps pays de mission. Les Récollets, les premiers, y étaient débarqués en 1615 ; les Jésuites les avaient rejoints dix ans plus tard. Après le traité de Saint-Germain-en-Laye (1632), les Jésuites revinrent seuls en Nouvelle-France. Ils y représentaient désormais l’Église, leur supérieur y étant la plus haute autorité ecclésiastique. Les missions progressèrent d’une façon remarquable : en quelques années, elles s’étendirent à l’Acadie, au lac Saint-Jean, aux Grands Lacs, à l’Iroquoisie. Parallèlement, les Jésuites assuraient le ministère aux Français. La mission allait beaucoup mieux que la colonie.
Les Jésuites tentèrent en outre de suppléer aux faiblesses des Cent Associés et des Habitants. Dans leurs Relations annuelles, ils se firent les propagandistes de la mission, mais aussi de la colonie, empêchant que le Canada ne tombât dans l’oubli. Ils attirèrent des colons, les établirent dans leurs seigneuries. Ils intéressèrent des personnes riches et puissantes à la Nouvelle-France, et la dotèrent ainsi d’un collège (1635), d’un séminaire pour jeunes filles (1639) et d’un hôpital (1639). Missionnaires, curés, professeurs, propagandistes, colonisateurs, explorateurs, interprètes, ambassadeurs à l’occasion, les Jésuites – dont le supérieur était au surplus membre d’office du conseil – étaient partout, engagés dans les affaires civiles tout autant que dans les matières proprement religieuses. La mission soutenait la colonie ; l’inverse eût été plus normal.
Le vicaire apostolique, arrivé à Québec le 16 juin 1659, débarqué le lendemain, se mit à l’œuvre sans tarder. Il pouvait compter sur un effectif ecclésiastique fort réduit : 17 jésuites, 4 sulpiciens et 6 séculiers, dont un n’était que tonsuré. Aux Jésuites, il laissa les missions indiennes ; aux Sulpiciens, le soin de la paroisse de Montréal où ils étaient installés depuis 1657, les séculiers, pour leur part, se chargeraient du ministère paroissial dans la région de Québec, Trois-Rivières demeurant provisoirement sous la conduite spirituelle des Jésuites. Le siège épiscopal serait à Québec.
La première préoccupation de Mgr de Laval fut de faire reconnaître son autorité. Il était hanté par l’idée qu’il pût rencontrer dans la colonie l’opposition qu’il avait connue en France ; bien au courant des agissements de l’abbé de Queylus, qui fut un temps grand vicaire de l’archevêque de Rouen au Canada, il craignait en particulier quelque entreprise des Sulpiciens de Montréal sur son autorité. En quoi il ne se trompait point. Nous avons raconté, dans la biographie de l’abbé de Queylus, les péripéties de ce long conflit de juridiction dont le vicaire apostolique sortit vainqueur, avec l’appui de la Propagande. Or l’arrivée d’une lettre de Louis XIV à M. d’Argenson, du 14 mai 1659, lui fournit une occasion inespérée. Le roi y enjoignait au gouverneur de faire reconnaître partout l’autorité du vicaire apostolique, et de ne permettre à aucun grand vicaire de l’archevêque de Rouen de « s’ingérer à faire aucune fonction de juridiction ». Mgr de Laval la fit publier et afficher d’un bout à l’autre du pays.
Vers le même temps, le prélat établit une officialité, tribunal ecclésiastique qui connaîtrait de tout conflit mettant en cause un membre du clergé séculier ou régulier, et jugerait de toute matière tombant sous la juridiction épiscopale. La hâte mise par le vicaire apostolique à créer ce tribunal – trois mois après son arrivée – paraît assez surprenante, quand on pense, par exemple, que pas une seule paroisse n’était érigée canoniquement. Mgr de Laval s’armait contre les opposants éventuels. Dans le contexte gallican, cependant, cette mesure prenait l’allure d’une provocation à l’endroit du pouvoir civil.
De « grandes brouilleries entre les puissances » survinrent bientôt, dues à la présence de l’officialité, mais aussi à des querelles nombreuses de préséance. Ces disputes peuvent, aujourd’hui, paraître futiles. Mais la société française du xviie siècle avait une conception jalouse de l’honneur. Elle était imbue de respect pour tout ce qui, de près ou de loin, appartenait ou touchait au monarque. En cette société au surplus très hiérarchisée, tous les représentants du roi, du gouverneur jusqu’au plus humble officier de justice, avaient à jouer un rôle précis, auquel était attachée une certaine somme d’honneurs, minutieusement évaluée et fixée définitivement. Des honneurs supplémentaires, qu’ils fussent conférés par l’État ou par l’Église, étaient une récompense enviable, et parfois tenaient lieu de salaire. Se défendait donc âprement qui se croyait lésé en ce domaine.
Or, depuis 25 ans, bien des façons de faire avaient été adoptées, en Nouvelle-France, qui n’étaient pas toujours conformes aux coutumes observées dans le royaume, ou qui s’expliquaient par l’absence d’un évêque. C’est ainsi que le gouverneur avait son prie-Dieu à l’endroit le plus honorable dans le chœur de l’église, qu’il assistait régulièrement aux délibérations de la fabrique de Québec, à titre de marguillier honoraire. Mgr de Laval, soucieux de réprimer les abus et de préserver sa jeune Église contre les interventions inopportunes de l’État, décida de remettre les choses à leur place avant qu’il ne fût trop tard. L’intention était louable. Mais peut-être, dans l’ardeur de ses 36 ans et de son zèle un peu fougueux, n’usa-t-il pas suffisamment de tact et de diplomatie, brusquant inutilement un gouverneur jaloux de ses privilèges et mal disposé, au surplus, envers ce jeune prélat dont le premier geste avait été de créer, en face de la justice civile, un tribunal ecclésiastique. Le gouverneur s’entêta, ne voulut rien céder, non plus que l’évêque. De mois en mois le conflit s’aggrava, sans cesse alimenté de nouveaux incidents, le plus souvent provoqués par Mgr de Laval. « On pensa en venir aux extrémités », note le supérieur des Jésuites, qui blâme discrètement l’évêque.
À l’origine de ces querelles, il y avait sans doute, chez Mgr de Laval, le désir ardent de voir son autorité reconnue et son Eglise hors d’atteinte des entreprises de l’État, pour qui – Louis XIV l’écrira en 1665 – il était absolument nécessaire de « tenir dans une juste balance l’autorité temporelle qui réside dans la personne du Roi et de ceux qui le représentent, et la spirituelle qui réside en la personne du Sieur Évêque et des Jésuites, de manière toutefois que celle-ci soit inférieure à l’autre. » Mais il y avait aussi, chez le gouverneur et chez plusieurs colons, le refus de reconnaître au vicaire apostolique la même autorité qu’à un évêque siégeant à la tête de son diocèse. Pour eux, l’évêque de Pétrée ne pouvait être l’évêque de Québec. Au début, les communautés religieuses elles-mêmes avaient hésité : fallait-il obéir à ce « commissaire apostolique » venu au pays « sous le titre étranger d’évêque de Pétrée », ou au grand vicaire de l’archevêque de Rouen ? Quand elles passèrent enfin sous la houlette de Mgr de Laval, les religieuses n’entraînèrent pas toute la population, loin de là. Montréal, en particulier, restait plus ou moins hostile au vicaire apostolique.
Tous s’accordaient, cependant, sur les vertus personnelles de Mgr de Laval. On louait sa piété profonde, sa charité, son humilité. « Il vit saintement et en apôtre », écrit Marie de l’Incarnation. Comme autrefois à Paris et à Caen, en dépit de ses origines illustres et de sa dignité nouvelle, il exerçait les plus humbles ministères, soignant les malades, faisant leurs lits, donnant l’extrême-onction aux Indiens. À l’automne de 1659, par exemple, une épidémie survint, apportée par un navire : il fut constamment à l’hôpital, malgré les tentatives faites pour l’en dissuader et les dangers évidents d’être lui-même atteint. Ne ménageant point sa personne, il était prodigue de ses biens quand il s’agissait d’aider les pauvres. Lui qui n’avait que 1 000# de revenu assuré distribua en secret des sommes énormes (10 000 écus en trois ans, au témoignage de Bertrand de Latour*). Il vivait pauvrement, du reste, retiré d’abord chez les Hospitalières, puis chez les Ursulines, et enfin chez les Jésuites, avant d’acquérir en 1662 une vieille maison où il réunit son petit clergé.
En dépit de ses nombreuses difficultés, Mgr de Laval déploya une grande activité. En 1660, il avait complété sa première visite pastorale, commencée à Gaspé, où il s’était arrêté lors de sa traversée au Canada. Il avait conféré le sacrement de confirmation à des centaines de Blancs et d’Indiens. Il s’était en outre attaqué, dès les débuts, à la traite de l’eau-de-vie : ennemi des demi-mesures et fort de l’appui de son clergé, consulté à trois reprises sur cette question, il avait fulminé une excommunication contre les trafiquants rebelles. Cette intervention énergique lui valut l’opposition déclarée des commerçants et plus ou moins avouée du gouverneur. De quoi alimenter les « brouilleries » déjà en cours. Voyant qu’il ne viendrait point à bout de ce trafic sans l’aide puissante du roi, Mgr de Laval résolut, en 1662, d’aller exposer à Louis XIV son point de vue sur le commerce des boissons, de même que les besoins les plus urgents de son Église.
Il reçut à la cour un accueil fort sympathique. Louis XIV combla tous ses désirs : il promit d’interdire formellement la traite de l’eau-de-vie, et de rappeler M. Davaugour [Dubois*], qui l’avait favorisée ; il invita même le prélat à désigner le nouveau gouverneur, enfin, il nomma dès lors Mgr de Laval à l’évêché de Québec (1662).
Il est raisonnable de croire que Louis XIV et Mgr de Laval discutèrent longuement de la réorganisation de la Nouvelle-France, qu’on placerait sous l’autorité directe du roi. Sans doute, le prélat fut-il également consulté sur le projet de création d’un Conseil souverain (1663) dont il allait être le second personnage, immédiatement après le gouverneur. L’abbé Bertrand de Latour, le plus ancien biographe de Mgr de Laval, va même jusqu’à affirmer que « le Conseil souverain du Canada fut l’ouvrage de son premier évêque ». Quoi qu’il en fût, Mgr de Laval reçut du roi des pouvoirs politiques qui le plaçaient, à certains égards, sur un pied d’égalité avec le gouverneur : « conjointement et de concert » avec ce dernier, il était chargé de nommer les conseillers et de concéder les seigneuries. Bien plus, quand il revint en Nouvelle-France, en 1663, en compagnie du nouveau gouverneur, M. de Mézy [Saffray*], et d’un commissaire royal, M. Gaudais-Dupont*, c’est à lui que le roi avait confié le soin d’apporter au Canada l’édit de création du Conseil souverain.
Ce Louis XIV qui, en 1662 et 1663, s’emploie à édifier la puissance politique de l’Église canadienne, est-il bien le même qui, à partir de 1665, prendra ombrage de toute intervention réelle ou supposée de l’Église coloniale dans les affaires civiles, et qui se préoccupera si fort de maintenir le clergé dans la dépendance de l’État, de peur que l’évêque et les Jésuites n’ « establissent trop fortement leur authorité par la crainte des excommunications et par une trop grande sévérité de vie qu’ils veulent maintenir » ? Louis XIV n’alla-t-il pas jusqu’à porter de graves accusations, comme s’il eût perdu le souvenir d’événements pourtant récents : « Pour s’y maintenir [dans la colonie] ils [les Jésuites] ont esté bien aises de nommer le Sieur Évesque de Petrée pour y faire les fonctions episcopales comme estant dans leur entiere dépendance et mesme jusques icy où ils ont nommé les Gouverneurs pour le Roy en ce pays là, où ils se sont servis de tous les moyens possibles pour faire revoquer ceux qui avoient esté choisis pour cet employ sans leur participation... » ? L’attitude du roi en 1662 et 1663 s’explique-t-elle par son ignorance de la situation politico-religieuse anormale qui prévalait encore à ce moment au Canada ? Ou bien faut-il attribuer ce changement radical à Colbert, ministre de la Marine depuis peu et gallican convaincu ? Il reste que Louis XIV a contribué fortement à dresser l’une contre l’autre, dans la colonie, l’Église et l’État. Les querelles et les violences qui marquèrent le gouvernement de M. de Mézy, relativement à la composition du conseil, furent préparées par le roi lui-même. Louis XIV regretta un jour l’extrême libéralité des débuts de son règne à l’endroit de l’Église canadienne. En 1677, Colbert faisait écho à ce sentiment en écrivant : « Je vois que l’évêque de Québec affecte une autorité un peu trop indépendante de l’autorité royale, et que par cette raison il serait peut-être bon qu’il n’eût pas de séance dans le Conseil [...] ».
Fort de sa nomination au futur évêché de Québec et des connaissances qu’il avait acquises sur la situation religieuse de la Nouvelle-France, Mgr de Laval n’avait pas voulu quitter Paris sans jeter les fondements de son Église. Pour assurer à la colonie les prêtres dont elle avait besoin, il conçut l’idée d’un séminaire, qui devait être pendant des années le centre et l’âme de la vie religieuse canadienne. Ce fut par une ordonnance émise à Paris le 26 mars 1663, confirmée par le roi le mois suivant, que le vicaire apostolique établit le séminaire de Québec.
Dans la pensée de Mgr de Laval, le séminaire de Québec était, certes, un grand séminaire, « dans lequel on élèvera et formera les jeunes clercs qui paraîtront propres au service de Dieu et auxquels, à cette fin, l’on enseignera la manière de bien administrer les sacrements, la méthode de catéchiser et de prêcher apostoliquement, la théologie morale, les cérémonies, le plain-chant grégorien, et autres choses appartenant aux devoirs d’un bon ecclésiastique. » Mais le séminaire de Mgr de Laval était beaucoup plus que cela : « nous érigeons [...], déclarait le prélat, un séminaire pour servir de clergé à cette nouvelle Église, [...] un lieu de réserve d’où nous puissions tirer des sujets pieux et capables pour les envoyer à toutes rencontres et au besoin dans les paroisses et autres lieux du dit pays, afin d’y faire les fonctions curiales et autres auxquelles ils auront été destinés, et les retirer des mêmes paroisses et fonctions quand on jugera à propos [...] ». Mgr de Laval conçut donc son séminaire comme une véritable communauté de prêtres séculiers « qui sera conduit[e] et gouverné[e] par les supérieurs que nous ou les successeurs évêques de la Nouvelle-France y établirons, et suivant les règlements que nous donnerons à cet effet. » Clergé et séminaire, c’était tout un, dans l’esprit de Mgr de Laval : le séminaire de Québec serait le clergé de la Nouvelle-France.
Le prélat précisait que le futur chapitre de l’évêché de Québec serait formé « dans le dit Séminaire et clergé » ; que toutes les cures seraient unies au séminaire, auquel les dîmes seraient versées ; que le séminaire pourvoirait aux besoins des curés et s’engagerait à les entretenir « tant en santé qu’en maladie, soit dans leurs fonctions, soit dans la communauté quand ils y seront rappelés ». En retour de cet engagement, le séminaire exigerait la désappropriation, c’est-à-dire la mise en commun des biens et des revenus de tous ses membres. Les prêtres séculiers, néanmoins, étaient libres d’adhérer au séminaire ; les abbés Le Sueur* et Le Bey, déjà dans la colonie en 1659, n’en firent point partie. Mais, dans la pratique, il était difficile, à qui rêvait d’obtenir une cure, de ne pas d’abord se joindre au séminaire. À la requête de Mgr de Laval, le séminaire de Québec fut affilié, le 29 janvier 1665, au séminaire des Missions étrangères de Paris, avec lequel il allait entretenir des liens très étroits d’amicale collaboration.
Le séminaire de Mgr de Laval répondait parfaitement aux besoins de l’Église canadienne de 1663, et lui assurait en outre une admirable unité. Il rendit de très grands services tant que Mgr de Laval en eut lui-même la direction ; mais il avait nécessairement, à certains égards, un caractère provisoire. Avec le développement de la colonie, et une fois les paroisses capables d’entretenir les curés, cette communauté diocésaine du clergé n’aurait plus sa raison d’être. Sous Mgr de Laval, dont le prestige était grand, et à cause des liens très forts d’amitié qui l’unissaient à ses prêtres, le prélat et le séminaire collaborèrent étroitement, dans l’harmonie la plus entière. Mais, sous un nouvel évêque, tout ne marcherait peut-être pas aussi bien ; il faudrait d’abord que cet évêque consentît à n’exercer son autorité sur le clergé et les paroisses que par l’intermédiaire des directeurs du séminaire. Successeur de Mgr de Laval, Mgr de Saint-Vallier [La Croix], pour sa part, s’y refusa catégoriquement.
Le mandement qui créait le séminaire de Québec, enregistré à Québec le 10 octobre 1663, établissait en même temps la dîme au Canada. Mgr de Laval la fixa au treizième, mesure que le roi approuva. Malheureusement, le prélat crut bon, un mois plus tard, d’y faire exception pour les paroissiens de Québec, qu’il dispensait de payer la dîme pour l’année 1663, tout en la portant, pour eux seuls, au vingtième pendant les six années suivantes. Aussitôt, dans toutes les parties de la colonie, l’on se mit à espérer pareil allégement ; en attendant, on refusa de subvenir aux besoins du clergé. Ce fut l’occasion de grandes difficultés et d’importantes contestations. M. de Mézy appuyait les colons. Mgr de Laval étendit d’abord à tout le pays le privilège accordé à la paroisse de Québec, puis fixa la dîme au vingtième pour la durée de sa vie, et enfin retarda jusqu’en 1665 le paiement obligatoire de la dîme. Celle-ci, néanmoins, resta impayée jusqu’en 1667, alors que, le 23 août, M. de Tracy [Prouville*] la fixa au vingt-sixième pour 20 ans, et au vingtième par la suite. Bon gré mal gré, les colons se conformèrent à ces dispositions, plutôt que d’être traînés en justice. En 1707, après bien des avatars [V. Louis-Gaspard Dufournel*], la dîme fut fixée définitivement au vingt-sixième. En toute cette affaire, Mgr de Laval, si ferme et si intraitable quand les grands principes ou la morale étaient menacés, se montra accommodant et compréhensif, voire un peu faible devant la résistance des colons. Cela seul suffirait à reviser certains jugements sur son caractère.
Quand M. de Mézy mourut, réconcilié avec l’évêque et le clergé, commença pour Mgr de Laval une courte période de paix, sinon de parfaite union, avec les représentants de l’État. La présence de M. de Tracy y contribua beaucoup. Le prélat, qui avait érigé canoniquement la paroisse de Québec en 1664, en consacra l’église en 1666. Pendant ces quelques années, il s’appliqua à implanter au Canada un certain nombre de dévotions, comme celle de la sainte Famille, à laquelle il tenait particulièrement, et celle de sainte Anne. En 1668, le 9 octobre, il fondait à Québec son petit séminaire, dit de l’Enfant-Jésus : huit jeunes Canadiens, que l’on destinait à l’état ecclésiastique, et six Hurons, que l’on se proposait de franciser, en furent les premiers élèves. Logés et formés au petit séminaire, ils suivaient leurs cours au collège des Jésuites. Vers la même époque, Mgr de Laval mit sur pied, à Saint-Joachim, une école de métiers, de même qu’une petite école où les enfants apprendraient à lire et à compter.
Soudain, le 10 octobre 1668, s’amorçait une nouvelle crise. Mais il convient ici de prendre les choses d’un peu plus loin.
Dès 1657, par un arrêt de son conseil, le roi avait confirmé l’interdiction de la traite de l’eau-de-vie, en vigueur dans la colonie depuis l’époque de Champlain. À son tour, le 5 mai 1660, Mgr de Laval avait défendu, sous peine d’excommunication ipso facto, de donner des boissons enivrantes aux Indiens ; quelque temps après, il avait excommunié nommément le trafiquant Pierre Aigron*, dit Lamothe. La traite ayant cessé sous la double menace des sanctions civiles et ecclésiastiques, Mgr de Laval leva son excommunication générale en octobre 1661, pour la renouveler le 24 février 1662, peu après que, sur un coup de tête, le gouverneur général Davaugour se fut déclaré favorable à ce commerce. Or, la veille, à Paris, les théologiens de la Sorbonne, saisis de la question par le vicaire apostolique, avaient exprimé l’avis que, « vu les désordres qui arrivent de la vente de telles boissons, faite aux Américains [i.e. aux Indiens], l’Ordinaire ou Prélat peut défendre sous peine d’excommunication ipso facto aux Européens la vente de telles boissons, et traiter ceux qui seront désobéissants et réfractaires comme des excommuniés. » Par suite de l’attitude conciliante de Davaugour, cependant, la traite avait pris une telle ampleur et les désordres s’étaient à ce point aggravés que Mgr de Laval avait décidé de passer en France pour solliciter l’appui de Louis XIV.
Lorsqu’il revint à Québec, en 1663, le vicaire apostolique constata avec satisfaction que les trafiquants s’étaient rendus, sous l’effet de la terreur provoquée par le grand tremblement de terre de 1663. M. de Mézy, le nouveau gouverneur, et Mgr de Laval s’entendaient pour interdire conjoitement la traite des boissons.
L’union, à ce sujet, de l’Église et de l’Etat se maintint jusqu’au 10 octobre 1668. Ce jour-là, à l’instigation de l’intendant Talon*, le Conseil souverain permit la traite de l’eau-de-vie, tout en interdisant aux Indiens de s’enivrer, ce qui était un non-sens. En réponse, le 21 avril 1669, Mgr de Laval fit un cas réservé du péché qui consistait à enivrer les Indiens et à leur donner des boissons à transporter dans leurs villages.
C’est alors qu’éclata la grande querelle de la traite de l’eau-de-vie. Jusque-là, en effet, et à l’exception de l’incident provoqué par Davaugour, l’Église et l’État avaient eu, officiellement tout au moins, une politique commune. Mais, dès lors, Mgr de Laval, les missionnaires et le clergé furent constamment attaqués par tous ceux – et ils étaient fort nombreux – qui favorisaient la traite ; on les accusait de s’ingérer dans une matière de politique commerciale qui relevait exclusivement de la police civile. On reprochait en particulier à l’évêque son cas réservé. En 1674, Mgr de Laval soumit de nouveau la question aux théologiens de la Sorbonne. La réponse, datée du 8 mars 1675, lui donnait raison sur les deux points proposés : la traite de l’eau-de-vie constituait un péché mortel, et l’Ordinaire avait le droit de prendre les mesures appropriées pour réduire ce commerce, comme d’en faire un cas réservé.
Dans ses combats contre la puissance civile, dans ceux en particulier qu’il mena contre la traite de l’eau-de-vie, Mgr de Laval voyait son autorité épiscopale partout mise en doute, du fait qu’il n’était que vicaire apostolique. Lui-même, jusqu’en 1664, ne douta pas qu’il eût tous les pouvoirs d’un ordinaire ; aussi érigea-t-il en toute bonne foi une officialité, un séminaire et la paroisse de Québec. Quand il découvrit enfin les limitations de sa fonction, il implora de Rome l’érection d’un évêché à Québec, de manière à pouvoir organiser son Église et faire face avec plus d’autorité aux « émules perpétuels et contempteurs de la puissance ecclésiastique » au Canada.
Cette requête ne parut point, tout d’abord, devoir soulever d’objections. En 1662, Louis XIV avait assuré Mgr de Laval de sa nomination au futur siège de Québec, dont il avait peu après demandé l’érection au pape. Le vicaire apostolique s’était empressé d’appuyer sa démarche. Sur quoi la Propagande avait exprimé l’avis que le temps était venu, en effet, de doter la Nouvelle-France d’un diocèse. Mais Louis XIV avait fini par donner de telles proportions à l’incident de la garde corse (20 août 1662) que les relations Rome-Paris s’étaient tout à fait détériorées ; la Propagande, dès lors, s’était montrée plus réticente sur le projet d’un évêché, ne promettant plus que de l’examiner attentivement.
Le roi exigea bientôt que le futur évêché de Québec dépendît de celui de Rouen. Ne voulant rien céder sur ce point, Rome se désintéressa de l’affaire pendant deux ans (1664–1666). Or, de Québec, Mgr de Laval expédiait des lettres fort pressantes au Saint-Siège, expliquant les menées de la Compagnie des Indes occidentales qui, sous prétexte qu’il n’y avait point d’ordinaire au Canada, s’apprêtait à y envoyer des prêtres, à créer des paroisses et à nommer aux cures. Les colons, par ailleurs, contestaient au vicaire apostolique le droit d’établir et de percevoir la dîme. En 1666, Rome reprit son étude, qu’une nouvelle exigence de Louis XIV vint encore ralentir : le roi voulait cette fois que l’érection de l’évêché de Québec se fît dans le respect des privilèges de l’Église gallicane. Pendant que Mgr de Laval s’impatientait en vain à Québec, Rome adressait enfin à Paris, le 18 juin 1668, un modèle de bulle « pour recevoir sur cela les ordres du Roy ». Le document fut examiné, puis retourné au Saint-Siège. L’obstacle majeur restait la dépendance de l’archevêché de Rouen.
En 1669, lassé d’attendre et voyant son Église menacer ruine, Mgr de Laval fit la concession suprême : écrivant à Rome, il accepta que le futur évêché dépendît de Rouen, si les cardinaux jugeaient qu’il en devait être ainsi. Or, la même année, Louis XIV et Colbert, comprenant que les discussions avec le Saint-Siège n’aboutiraient jamais, abandonnaient la condition qu’ils avaient mise jusque-là à l’érection de l’évêché de Québec, c’est-à-dire la dépendance de Rouen !
L’affaire prit une tournure excellente en 1670, mais Mgr de Laval se trouva dans l’impossibilité de payer les frais élevés de l’érection de son diocèse. Sans fortune personnelle, il rédigea plaidoyer sur plaidoyer, demandant qu’on lui expédiât gratuitement ses bulles. En 1671, alarmé, il passa en France, déterminé à ne jamais revenir au Canada à moins que le diocèse ne fût érigé. Rome accepta finalement de réduire les frais. Les bulles ne furent expédiées que le 4 octobre 1674. Mgr de Laval prêta le serment de fidélité au roi, et s’embarqua pour le Canada à la fin de mai 1675.
Dès lors, le diocèse de Québec échappait entièrement aux prétentions de l’archevêque de Rouen, mais non point encore à celles de l’archevêque de Paris, ce même Harlay de Champvallon qui, de Rouen, avait été promu à Paris. Harlay tenta, cette fois, de mettre Québec dans la dépendance du « principal » diocèse de France ; mais il dut, en 1679, abandonner ce projet que Rome n’eût jamais approuvé.
Mgr de Laval débarqua à Québec au début de septembre 1675, après une absence de quatre ans. Évêque en titre, il prit possession de sa cathédrale, renouvela plusieurs de ses ordonnances, confirma l’érection de l’officialité et de la paroisse de Québec, et forma un chapitre provisoire, faute de pouvoir l’ériger canoniquement. Il tira ses chanoines du séminaire, dont il avait, peu avant son départ de Paris, renouvelé l’acte d’union à celui des Missions étrangères. Puis, au printemps de 1676, il entreprit la visite de son diocèse.
Au moment où Mgr de Laval assurait une plus grande stabilité à son Église, Louis XIV réorganisait le Conseil souverain de Québec. Le 5 juin 1675, il portait à sept le nombre des conseillers – outre le gouverneur, l’évêque et l’intendant –, qui seraient dès lors nommés à vie, par le roi. Mgr de Laval reprenait au conseil la seconde place, qui avait été la sienne avant la venue de Jean Talon. L’État conservait donc à l’Église canadienne un rôle important dans les affaires civiles.
Mgr de Laval n’ignorait rien des querelles nombreuses qui, en son absence, de 1672 à 1675, avaient mis à dure épreuve l’union de l’Église et de l’État, et qui furent une des causes de la réorganisation du conseil. Or, en 1676, deux grandes questions opposaient encore les « puissances » : la traite de l’eau-de-vie et l’établissement des cures. L’évêque jugea nécessaire de déléguer à Paris un représentant sûr et dévoué qui défendît la position de l’Église canadienne et répondît aux attaques de Frontenac [Buade*] et de ses alliés. Il arrêta son choix sur l’abbé Jean Dudouyt*.
La mission confiée à M. Dudouyt était d’autant plus nécessaire que le clergé de la Nouvelle-France n’avait plus son ancienne unité. En 1670, en effet, à l’instigation de Jean Talon, les Récollets étaient revenus au Canada, chargés par l’État de faire contrepoids à l’autorité et à la sévérité des Jésuites et des séculiers canadiens, qu’on accusait de « gehenner les consciences ». Ces bons religieux, protégés par Frontenac à partir de 1672, prirent leur rôle fort au sérieux et devinrent les instruments dociles du gouverneur. Sur la traite de l’eau-de-vie, sur l’établissement des cures, sur la dîme, ils adoptèrent et prêchèrent les opinions de Frontenac, étant du reste entièrement à ses ordres plutôt qu’à ceux de l’évêque. Mgr de Laval, qui savait les raisons de leur venue, les avait pourtant accueillis avec beaucoup de charité, leur avait assigné des terrains d’apostolat, et continua de leur prodiguer des marques d’estime. Ce fut en vain. Les Récollets enchérissaient sur les calomnies lancées à la cour par le clan de Frontenac contre l’évêque et les Jésuites – qui n’auraient interdit la traite de l’eau-de-vie que pour la mieux faire eux-mêmes, et auraient été plus intéressés à la conversion des castors qu’à celle des âmes.
Mgr de Laval avait profité de son séjour à Paris pour consulter de nouveau les théologiens de la Sorbonne sur la question de l’eau-de-vie. Il reçut d’eux un jugement favorable en tout point à sa thèse. Dans l’espoir d’obtenir un avis contraire, ses adversaires s’adressèrent aux théologiens de l’université de Toulouse. La réponse fut toute différente de celle de la Sorbonne : « M. l’Évêque de Québec ne peut point licitement faire un péché mortel et moins un cas réservé de la vente des eaux-de-vie ». Cela était de nature à nuire à la cause de Mgr de Laval. Aussi M. Dudouyt, dès son arrivée à Paris, sollicita-t-il une entrevue avec Colbert. Il lui exposa, le 27 avril 1677, les raisons de l’attitude de Mgr de Laval, mais ne le convainquit pas. Une seconde audience, le 11 mai, lui laissa quelque espoir, le ministre l’ayant écouté avec plus de patience. Il recommanda donc à l’évêque de rédiger un mémoire complet sur la question ; la cour avait adressé la même demande à l’intendant Duchesneau*.
Manifestement, Louis XIV était décidé à trancher le débat. Il ordonna à Frontenac de convoquer 20 des principaux habitants du pays, et de recueillir leurs avis sur la traite de l’eau-de-vie. Le Conseil souverain désigna ces représentants, qui se réunirent le 28 octobre 1678. Presque tous engagés dans le commerce, ils se prononcèrent en majorité pour la liberté absolue de la traite de l’eau-de-vie. Le conseil chargea MM. Nicolas Dupont de Neuville et Jean-Baptiste de Peiras de porter à la cour le résultat de la consultation. La situation était critique pour l’Église canadienne. Malgré des infirmités de plus en plus accablantes, Mgr de Laval se rembarqua immédiatement pour la France, dans un suprême effort pour convaincre le roi de la justesse de sa cause.
Louis XIV confia à son confesseur, le père de La Chaise [Aix], et à l’archevêque de Paris le soin d’étudier les mémoires sur le trafic des boissons reçus du Canada ; puis, le 24 mai 1679, il rendit une ordonnance interdisant la traite de l’eau-de-vie en dehors des habitations françaises. Mgr de Laval s’engagea à ramener son cas réservé aux dispositions de l’ordonnance. Cet aboutissement d’une lutte de 20 années avait de quoi décevoir profondément le vieil évêque ; il pouvait, néanmoins, tirer quelque consolation du fait que les trafiquants d’alcool n’iraient plus, légalement, poursuivre les Indiens jusque dans leurs villages les plus reculés.
La question de l’érection des cures fut également débattue en France, pendant l’hiver de 1678–1679, en présence de Mgr de Laval. En confirmant l’établissement du séminaire de Québec en 1663, Louis XIV avait approuvé le double principe de l’amovibilité des cures et du paiement des dîmes au séminaire, lequel se chargeait de les redistribuer équitablement aux desservants des diverses paroisses. Or, avec le temps et sous l’influence, semble-t-il, de Jean Talon, ce système – le seul qui fût applicable à la Nouvelle-France d’alors – fut critiqué, puis vivement combattu. On accusa Mgr de Laval de ne point vouloir établir de cures. À cela, il y avait deux réponses : d’une part, tant qu’il fut vicaire apostolique, Mgr de Laval n’eut pas les pouvoirs nécessaires à l’érection des paroisses – ce qu’il ne découvrit qu’après avoir « érigé » celle de Québec en 1664 ; d’autre part, il ne pouvait établir de paroisses que si la subsistance des curés était assurée. Or, vers 1675–1680, aucune « paroisse » n’était encore en mesure de faire vivre un curé, encore moins de construire une église et un presbytère. Pour assurer les revenus nécessaires, il eût fallu augmenter considérablement le nombre des paroissiens, en reculant indéfiniment les frontières des paroisses, qui, dès lors, seraient redevenues territoires de mission.
Sur la question des cures tout autant que sur celle de l’eau-de-vie, Mgr de Laval dut céder devant la volonté du roi. En mai 1679, Louis XIV signa un édit sur les « dîmes et cures fixes » : les dîmes appartiendraient à l’avenir au curé de la paroisse, « où il serait établi perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant ». Mgr de Laval ne mit aucune mauvaise grâce à l’exécution de cet édit. Déjà, en 1678, il avait conféré avec Frontenac et Duchesneau sur la façon d’assurer la subsistance des curés. Il avait, peu après, érigé sept paroisses. « Dans la plupart de ces paroisses, écrivait-il, les habitants n’ont pas voulu se conformer à la décision de la conférence pour la nourriture et l’entretien de leurs pasteurs. N’importe ; j’ai envoyé mes missionnaires hiverner chez eux, m’obligeant à leur fournir ce qui leur serait nécessaire. » Travaillant de concert avec l’intendant, Mgr de Laval érigea six nouvelles cures en 1684 ; de nouveau, aucune d’entre elles ne pouvait subvenir à l’entretien de son curé. Il fallut l’aide du séminaire et de l’État. Cela prouvait hautement la sagesse de Mgr de Laval lorsqu’il conçut son séminaire, en 1663 ; malgré le régime nouveau, instauré en principe par l’édit de 1679, le séminaire n’en continuait pas moins de soutenir les paroisses.
Mgr de Laval rentra au pays à l’automne de 1680, après s’être occupé pendant plus d’un an d’autres questions relatives à son Église, en particulier de l’union canonique – que toutefois il ne put réaliser – des abbayes de Maubec et de Lestrées à son évêché. En 1681, il fit la visite de son diocèse.
Cette année 1681 vit le début de nouvelles difficultés entre l’évêque et les Récollets. Ces derniers venaient d’obtenir du roi l’emplacement de l’ancienne sénéchaussée, dans le but d’y bâtir un hospice qui leur servît de retraite lors de leurs séjours à Québec. Mgr de Laval accueillit favorablement ce projet, mais précisa, conformément au document royal, que ce lieu de retraite ne devait pas être transformé en couvent ni utilisé pour des cérémonies publiques du culte. Les religieux n’en firent pas moins un couvent, le surmontèrent d’un clocher [V. Henri Leroy], célébrèrent des offices publics et se moquèrent ouvertement des directives de l’évêque. Ce dernier révoqua la permission qu’il leur avait donnée de construire un hospice ; les Récollets, par représailles, abandonnèrent leurs missions ; Mgr de Laval fut finalement contraint de leur interdire toute fonction ecclésiastique. Le roi, une fois encore, dut trancher le débat : il ordonna d’abattre le clocher, mais le couvent subsista. Conciliant à son ordinaire, Mgr de Laval avait invité, au début de cette querelle, un récollet, le père Adrien Ladan, à prêcher l’avent à la cathédrale. Le religieux en profita pour fustiger à plusieurs reprises l’intendant et les adversaires de Frontenac ; les avertissements de Mgr de Laval n’eurent point d’effet sur lui. Les Récollets jouaient consciencieusement le rôle que leur avait confié l’État...
Les relations de Mgr de Laval avec les diverses communautés religieuses de son diocèse, si l’on excepte les Récollets et, pour un temps, les Sulpiciens, furent toujours excellentes, empreintes d’estime et de respect mutuels. Le prélat ne fut pas toujours d’accord, il est vrai, avec les supérieurs des diverses communautés, mais leur union n’en fut jamais altérée. Mgr de Laval, par exemple, se montra peu favorable à la multiplication des ordres religieux dans son diocèse : il eût voulu fondre les deux communautés d’hospitalières, de même qu’il désira unir les sœurs de la congrégation de Notre-Dame aux Ursulines. En attendant, il aida chaque groupe de son mieux, et finit par reconnaître à chacun son existence propre. À partir de 1668, il fut en bons termes avec les Sulpiciens, faisant même de M. de Queylus, qu’il avait autorisé à revenir à Montréal, son grand vicaire. La charité et l’humilité ne laissaient point de place chez Mgr de Laval à la rancune et aux mesquineries.
Au retour de sa visite pastorale de 1681, le prélat, épuisé, tomba gravement malade ; « dans l’espace de quinze jours, on n’espérait que la mort ». Il aurait bientôt 60 ans, et sa santé déclinait. Il se persuada qu’un évêque plus jeune et plus solide ferait dès lors plus de bien que lui, et qu’il lui fallait porter sa démission au roi. Auparavant, il voulut parfaire quelque peu son œuvre. Il travailla à l’établissement de six nouvelles cures, érigea canoniquement son chapitre en 1684, et confia au séminaire la réalisation de quelques projets, laissant 8 000# pour la construction de la chapelle du séminaire, prévue dans les plans de l’édifice commencé en 1678, 4 000# pour la construction d’une église à Saint-Joachim et 8 000# pour la subsistance du curé qui desservirait cette paroisse et dirigerait l’école des arts et métiers qu’il y avait créée. À l’automne, il s’embarqua pour la France.
Sa démission acceptée, Mgr de Laval convint de demeurer évêque de Québec jusqu’à la consécration de son successeur, l’abbé de Saint-Vallier, qu’il avait choisi avec le plus grand soin. Cependant, les relations tendues qui existaient pour lors entre Paris et Rome ne permettant pas l’expédition immédiate de ses bulles, l’abbé de Saint-Vallier passa au Canada, en 1685, avec le titre de grand vicaire. À son retour à Paris, en janvier 1687, il eut quelques démêlés avec Mgr de Laval au sujet du séminaire de Québec. C’est alors que le vieil évêque comprit le dessein de son successeur de modifier profondément l’organisation de l’Église canadienne, dont son cher séminaire était la clef de voûte. Une seule solution s’offrait à lui, pour sauver son œuvre : obtenir de l’abbé de Saint-Vallier, qui n’avait pas encore reçu ses bulles, qu’il renonçât à cet évêché. En vain Mgr de Laval fit-il intervenir les personnages les plus influents ; l’abbé de Saint-Vallier ne voulut point céder, se contentant d’expliquer son attitude et promettant beaucoup de modération.
Au printemps de 1687, Mgr de Laval s’apprêtait à partir pour le Canada, où il désirait finir ses jours. Le marquis de Seignelay l’en empêcha, de crainte que sa présence n’y fût une cause de troubles et de division. Mgr de Laval écrivit au père de La Chaise, à Seignelay lui-même, mais ne les fléchit point. Il s’abandonna dès lors à la volonté de Dieu, et rédigea, à l’adresse de ses prêtres, une lettre admirable, pleine de résignation devant, l’immense épreuve, qu’il acceptait « avec un cœur rempli de joie et de consolation au fond de l’âme ».
L’abbé de Saint-Vallier fut consacré le 25 janvier 1688. Mgr de Laval devenait Mgr l’Ancien. Avec l’appui du nouvel évêque, et sur la promesse de ne lui causer aucun embarras, Mgr de Laval obtint l’autorisation de retourner à Québec. Il y arriva le 3 juin, et Mgr de Saint-Vallier, le 31 juillet.
Le retour de Mgr l’Ancien dans la colonie réjouit non seulement ses prêtres, mais toute la population, sur laquelle, au dire du gouverneur général Brisay de Denonville, il avait « un grand ascendant par son génie et par sa réputation de sainteté ». Si certains représentants du pouvoir civil et la plupart des commerçants intéressés à la traite de l’eau-de-vie s’étaient opposés à lui, les colons, malgré les difficultés de l’établissement des dîmes, aimaient sincèrement et vénéraient cet évêque courageux, tout dévoué à son Église, et dont ils connaissaient bien la piété, l’humilité, et surtout l’immense charité. On était partout conscient des progrès réalisés sous Mgr de Laval : de cinq en 1659, le nombre des paroisses était passé à 35 en 1688 ; les prêtres, de 24 à 102 (36 jésuites, 19 sulpiciens, 14 récollets et 33 séculiers) ; et les religieuses, de 32 à 97 environ. On n’était pas non plus insensible au fait que 13 prêtres canadiens œuvraient déjà au pays, et que 50 Canadiennes avaient prononcé leurs vœux perpétuels dans les différentes communautés de Québec et de Montréal. En plus de jeter les bases d’une Église nationale, Mgr de Laval en avait fort heureusement commencé l’édification.
Il retourna vivre au séminaire. On affecta à son service un donné, le frère Hubert Houssart. Le prélat ne pensait plus qu’à la prière et à la mortification, limitant ses interventions extérieures aux seuls actes d’une charité fort discrète du reste. Il distribua tout ce qu’il possédait, ne réclamant rien qui ne fût pour ses pauvres, auxquels il réservait même la meilleure part de ses repas. Quand il n’eut plus rien, il sut que sa mort était proche. Il assistait à tous les offices de la paroisse, étant le premier à l’église tous les matins, bien avant le lever du soleil et par les froids les plus rigoureux. Complètement retiré des affaires, il n’avait plus d’intérêt que pour son cher séminaire, auquel il continuait de prodiguer ses conseils, et pour les séminaristes, dont il surveillait de très près les progrès, aimant converser avec eux pendant leurs récréations. En une courte phrase M. Bochart de Champigny, intendant, décrit bien la nouvelle existence du vieil évêque : « Il vit saintement dans la retraite, ne se mêlant que de la conduite de son séminaire. »
Son séminaire ! Que de douleurs n’allait-il pas lui occasionner en ses dernières années ! Mgr de Saint-Vallier, tout d’abord, s’opposa violemment à ce que les cures lui fussent unies, et en obtint finalement du roi, en 1692, la séparation complète, le séminaire étant réduit à n’être plus qu’une maison de formation pour les futurs prêtres. C’était détruire du coup la grande œuvre de Mgr de Laval. Cela devait se faire, à vrai dire, tôt ou tard ; mais qui songerait à reprocher au vieil évêque son attachement à l’œuvre de sa vie – ce séminaire auquel il avait cédé tous ses biens fonciers –, surtout après la rigidité de Mgr de Saint-Vallier à son égard et envers ses collaborateurs ? Au plus fort de la querelle de l’évêque avec le séminaire, Mgr de Laval s’était prudemment retiré à Saint-Joachim, pour éviter d’avoir à intervenir et à s’opposer ouvertement à son successeur. Dans l’attitude de Mgr de Saint-Vallier, dont il reconnaissait la sincérité personnelle, il voyait presque l’action de quelque puissance maléfique acharnée à détruire cette nouvelle Église. Cette perspective lui arrachait des cris de douleur. Mais en apprenant la nouvelle de la réforme de son séminaire, il se plia comme d’habitude aux voies de la Providence, s’oubliant lui-même pour consoler ses prêtres et les inviter à la soumission. Blessé au plus profond de l’âme, il prêchait la réconciliation et la paix : jamais sa vertu n’avait été plus héroïque.
Les plaies causées par la réforme du séminaire n’étaient pas encore fermées qu’un nouveau malheur s’abattait sur cette institution. Le 15 novembre 1701, un incendie consuma en quelques heures le séminaire, la chapelle et le presbytère. Ce fut pour Mgr de Laval une épreuve très pénible. Fort âgé, reverrait-il son séminaire debout ? On reconstruisit avec ardeur ; tout fut bientôt rétabli, sauf la chapelle. Or, à peine voyait-on la fin des travaux que, de nouveau, le 1er octobre 1705, la presque totalité du séminaire était détruite par le feu. Sa Grandeur, dit le frère Houssart, « n’en perdit pas pour un seul instant sa paix, sa joie, ni sa tranquillité, parce que ces accidents n’étaient pas des sujets capables d’attaquer sa patience et sa vertu qui étaient bien au-dessus de tout cela. » Et l’humble frère d’ajouter, ce qu’illustre parfaitement toute la vie de cet évêque, que « les seuls intérêts de Dieu, de la vertu et de la religion étaient capables de l’émouvoir ».
Au milieu de ces dures épreuves, Mgr de Laval avait dû sortir quelque peu de sa retraite, pour remplir à l’occasion les fonctions épiscopales de Mgr de Saint-Vallier, parti en 1700 et qui ne devait rentrer dans la colonie qu’en 1713. Mgr l’Ancien avait, du reste, toujours secondé son évêque, sans jamais manifester publiquement ses sentiments sur les questions qui pouvaient l’opposer à lui. Il tenait, en particulier, en l’absence de son successeur, à toujours assister aux offices de la cathédrale, pour les rehausser de la présence épiscopale. C’est ainsi que, dans la semaine sainte de 1708, il contracta une engelure au talon, qui s’aggrava et le mit bientôt à l’extrémité. Il mourut le 6 mai, à sept heures et demie du matin. On exposa son corps dans la cathédrale.
« Aussitôt après son décès les peuples l’ont pour ainsi dire canonisé, écrit l’intendant Jacques Raudot, ayant eu la même vénération pour son corps qu’on a pour ceux des saints, étant venus en foule de tous côtés pendant qu’il a été exposé sur son lit de parade et dans l’église, lui faire toucher leurs chapelets et leurs heures. Ils ont même coupé des morceaux de sa robe, que plusieurs ont fait mettre dans de l’argent, et ils les regardent comme des reliques. »
Les funérailles eurent lieu le 9 mai. M. de Glandelet prononça l’oraison funèbre. Puis le premier évêque de Québec fut enseveli dans la cathédrale.
Il est impossible de citer ici, dans le détail, les milliers de documents relatifs à la longue carrière de Mgr de Laval, ce qui nécessiterait un inventaire presque complet des archives du
De même, les études sur Mgr de Laval sont nombreuses. Toutes les histoires générales lui font une large place ; nous ne les énumérerons pas ici, nous contentant de citer les études suivantes : Émile Bégin, François de Laval (Québec, 1959).— [Étienne-Michel Faillon], Histoire de la colonie française en Canada (3 vol., Villemarie [Montréal], 1865–1866).— Auguste Gosselin, Vie de Mgr de Laval (2 vol., Québec, 1890) ; L’Église du Canada, I ; Henri de Bernières premier curé de Québec (« Les Normands au Canada », Québec, 1902).— Rochemonteix, Les Jésuites et la N.–F. au XVIIe siècle, I, II, III.— H. H. Walsh, The Church in the French Era (Toronto, 1966).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
André Vachon, « LAVAL, FRANÇOIS DE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/laval_francois_de_2F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/laval_francois_de_2F.html |
| Auteur de l'article: | André Vachon |
| Titre de l'article: | LAVAL, FRANÇOIS DE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1969 |
| Année de la révision: | 1991 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |