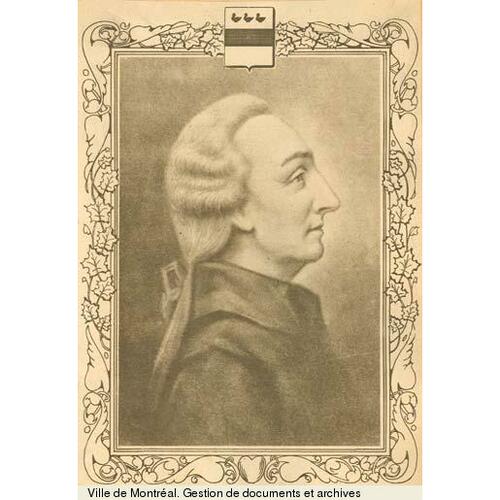Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2895071
BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, CHARLES DE, marquis de BEAUHARNOIS, seigneur de Villechauve, officier de marine, gouverneur général de la Nouvelle-France, lieutenant général des armées navales, né au château familial de La Chaussaye, près d’Orléans, France, et baptisé le 12 octobre 1671, fils de François de Beauharnois de La Boische, et de Marguerite-Françoise Pyvart (Pinard) de Chastullé, inhumé le 12 juillet 1749 dans la paroisse de Saint-Sauveur à Paris.
Les Beauharnois appartenaient à une ancienne et éminente famille d’Orléans. D’abord négociants à l’aise, les Beauharnois avaient, durant des générations successives, occupé des fonctions dans l’administration royale, ducale ou municipale. Sous Henri IV, en qualité de magistrats dans les tribunaux inférieurs à Orléans, ils accédèrent à la noblesse de robe. Le père de Charles, avocat au parlement et directeur général des finances et gabelles du roi à Orléans, représentait la branche cadette de la famille. Il était propriétaire de modestes terres seigneuriales. Sa mère était la fille d’un maître ordinaire à la Chambre des Comptes de Blois.
Au nombre des mariages notables contractés dans la famille Beauharnois, les alliances avec les Phélypeaux ont été d’une grande portée. Louis Phélypeaux de Pontchartrain, petit-fils d’un Beauharnois et beau-frère d’un autre, fut nommé secrétaire d’État de la Marine en 1690. Les deux aînés des six frères de Charles s’étaient engagés dans l’armée avant cette date, mais à partir de 1691, les autres frères Beauharnois s’engagèrent dans la marine où ils pouvaient compter sur la protection de Pontchartrain, leur cousin.
Charles de Beauharnois passa 20 ans en mer durant les deux plus longues guerres du règne de Louis XIV, la guerre de la Ligue d’Augsbourg et la guerre de la Succession d’Espagne. À huit différentes occasions, il prit part à des combats violents, dont le premier fut la bataille navale de la Hougue au large de la pointe de Barfleur (dép. de la Manche, France), en 1692, qui amena la marine française à abandonner la guerre d’escadre pour la guerre de course. En 1698, il s’embarqua avec d’Iberville [Le Moyne*] pour découvrir l’embouchure du Mississipi, et, l’année suivante, il commanda une compagnie d’infanterie navale dans la lutte contre les pirates de Salé (Maroc). En 1703, Beauharnois reçut le commandement de son premier vaisseau, la Seine, à destination de Québec où son frère aîné, François, avait été nommé intendant par Pontchartrain. En 1707, il commanda l’Achille, vaisseau corsaire armé par René Duguay-Trouin, qui prit feu en se lançant à l’attaque d’un convoi anglais au large du cap Lizard. Bien qu’il ne réussît pas à capturer de vaisseau, Duguay-Trouin et le comte de Forbin louèrent la vigueur avec laquelle il avait mené l’attaque.
En 1710, Beauharnois fut muté de Brest à Rochefort, vraisemblablement dans l’espoir de profiter de la nomination récente de son frère François au poste d’intendant de ce port. Le ministère de la Marine ayant été forcé de comprimer ses dépenses à la suite des coûteuses guerres de Louis XIV, Beauharnois poursuivit son service dans les ports de mer durant les 16 années suivantes.
En août 1716, à l’âge de 46 ans, il épousa Renée Pays, riche veuve de Pierre Hardouineau de Landianière, conseiller du roi et receveur général des domaines et bois à La Rochelle. Grâce à ce mariage, il devenait maître d’une fortune qui atteignait peut-être 600 000#. Une plantation de canne à sucre à Saint-Domingue (île d’Haïti) en constituait la partie la plus importante. De son côté, il apportait 66 000# de biens meubles. Trois ans auparavant, son frère cadet, Claude*, avait épousé une des filles de Renée Pays. Beauharnois devenait de par son mariage le tuteur des trois autres enfants mineurs de sa femme.
Aucun enfant ne naquit de ce mariage, qui ne fut d’ailleurs pas une union heureuse. En septembre 1719, Renée Pays intenta une action en justice pour obtenir la séparation de la communauté de biens, et les enfants nés de son premier mariage engagèrent des poursuites judiciaires contre elle et Beauharnois, afin de pouvoir administrer eux-mêmes leur héritage. Beauharnois réussit à résister jusqu’à ce que le tribunal ordonne, en 1725, que la moitié des biens de la communauté soit divisée parmi les enfants. Après une courte trêve en 1721, sa femme avait refusé la réconciliation et réouvert le procès pour séparation. La mauvaise administration du patrimoine de l’épouse était le seul motif justifiant la dissolution de la communauté de biens, et Renée Pays, comme on pouvait s’en douter, accusa Beauharnois de dilapider sa fortune au jeu, de tenter, en complicité avec son frère, de s’approprier l’héritage de ses enfants, de laisser la fortune décroître au point où elle ne représentait plus qu’une fraction de son ancienne valeur. Pour améliorer sa cause, elle accusa aussi son mari de s’être rendu coupable à son égard d’injures et de voies de fait. Les documents qui sont parvenus jusqu’à nous ne permettent pas d’établir de façon certaine que la fortune de Hardouineau avait diminué, par suite des prétendues extravagances de Beauharnois. Des témoignages ont permis de prouver qu’il s’adonnait au jeu, mais non qu’il jouait de façon anormale pour un homme de son rang, ni qu’il perdait au jeu. Une déposition sur la foi d’autrui fut faite selon laquelle les plantations de Saint-Domingue étaient mal administrées. Une métairie en France avait grand besoin de réparations. Beauharnois, tenace, ne voulait pas céder son droit de maître de la communauté. Ni l’une ni l’autre des deux parties ne firent preuve de charité. Les procès, les appels, les irrégularités de procédure se succédèrent devant les tribunaux de La Rochelle et de Niort, en France, de Léogane, à Saint-Domingue, et même devant le parlement de Paris, pratiquement jusqu’à la mort de Renée Pays en 1744. Elle n’obtint jamais la séparation. Beauharnois continua de jouir de certains revenus de la communauté, en particulier de ceux de Saint-Domingue, mais sa femme parvint à se faire accorder une rente confortable, de même que la plupart des revenus provenant de France. Seuls les avocats sortirent gagnants de l’affaire.
Au plus fort de ces querelles, Beauharnois sollicita le poste de gouverneur de la Nouvelle-France, que la mort de Philippe de Rigaud* de Vaudreuil, en octobre 1725, avait laissé vacant. Le roi ayant décidé après la mort de Vaudreuil que les gouverneurs ne devraient plus avoir de liens étroits avec des familles canadiennes, rejeta la demande de Charles Le Moyne* de Longueuil, gouverneur de Montréal, et choisit Beauharnois en février 1726. Celui-ci arriva à Québec en août. Capitaine de vaisseau depuis 1708 et chevalier de l’ordre de Saint-Louis depuis 1718, il était le premier officier de marine à accéder au poste. Son expérience convenait assez bien à la situation militaire en Nouvelle-France. Au Canada comme sur les mers, la stratégie française était essentiellement défensive. En outre, la guerre en forêt au Canada ressemblait à la guerre de course en mer, les deux étant menées par des petites bandes de maraudeurs qui attaquaient brusquement lorsque l’ennemi se trouvait désavantagé. Le fait que Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas et cousin de Beauharnois, était ministre de la Marine depuis 1723 explique vraisemblablement la nomination de ce dernier. En plus de l’habituel titre de marquis, Beauharnois obtint des lettres d’État, qui furent renouvelées par la suite, suspendant toutes les causes civiles dans lesquelles il était impliqué.
La plus grande source d’inquiétude en Nouvelle-France durant l’administration de Beauharnois fut l’expansion coloniale de l’Angleterre. La France avait été forcée à Utrecht (1713) de céder la baie d’Hudson, l’Acadie et Terre-Neuve aux Anglais, ainsi que le droit de faire le commerce directement avec les tribus de l’Ouest. Disposant de marchandises de traite moins chères, les négociants d’Albany, de la Pennsylvanie et de la baie d’Hudson étaient bien placés pour accaparer le commerce avec les Indiens de l’Ouest et les alliances qui s’y rattachaient. Par ailleurs, les accords conclus entre la France et l’Angleterre à Utrecht interdisaient au gouverneur du Canada d’utiliser la force armée. Beauharnois se voyait donc forcé d’entretenir à l’égard des Anglais l’hostilité des alliés indiens, desquels dépendait la sécurité de l’empire français en Amérique du Nord, pendant que Paris imposait la paix.
En Acadie, les Abénaquis, déçus par le refus des Français de les aider ouvertement à résister à l’établissement des Anglais dans le nord-ouest au-delà de la baie de Casco, faisaient bon accueil aux intéressantes propositions de paix de ces derniers. Si bien qu’avant l’arrivée de Beauharnois, les Abénaquis de Penobscot avaient déjà signé un accord avec le gouverneur du Massachusetts, William Dummer [V. Sauguaaram]. Beauharnois craignait le pire, à savoir que les Anglais ne réussissent à gagner les Abénaquis à leur cause, ce qui eût constitué une sérieuse menace à l’est dans l’éventualité d’une guerre. Grâce à certaines précautions, cependant, un dénouement aussi désastreux fut évité. Beauharnois persuada le ministre de maintenir la subvention de 6 000# accordée aux Abénaquis à titre d’aide militaire pour appuyer le travail de diplomatie effectué par les missionnaires jésuites et les frères Saint-Castin [V. Joseph d’Abbadie] étis de sang français et indien. Il exhorta les Abénaquis à participer aux attaques contre les Renards, dans l’Ouest, gardant ainsi bien vivante leur alliance avec les Français. Il encouragea la migration des missions et leur établissement à Saint-François et à Bécancour, près de Trois-Rivières, et dissuada les Indiens de rebâtir leurs villages près des établissements anglais. Mais au cours des 15 années suivantes, les Anglais, grâce au commerce et à leurs sollicitations auprès des Indiens, affaiblirent les alliances françaises et, dès 1732, ils avaient construit un fort et un établissement à Pemaquid, non loin de villages abénaquis.
La menace anglaise était spécialement inquiétante au lac Ontario. Le gouverneur de la colonie de New York, William Burnet, bien décidé à anéantir le commerce français dans l’Ouest, entreprit la construction du fort Oswego en 1725, en partie pour riposter contre la récente fondation de postes français à Niagara (près de Youngstown, N.Y.), Toronto et Kenté (Quinté). Les Six-Nations, en particulier un certain nombre de Tsonnontouans, étaient ouvertement hostiles à la fortification du fort Niagara par les Français, en contre-mesure, prétendant que Le Moyne de Longueuil et Louis-Thomas Chabert* de Joncaire avaient obtenu leur consentement de construire ce fort par des moyens détournés. Mais les Iroquois craignaient également la politique agressive de Burnet qui empiétait aussi sur leur territoire. En fait, dans la rivalité grandissante qui opposait les Français et les Anglais, les Iroquois étaient mal placés pour défendre leur position d’intermédiaires dans le commerce d’Albany et leurs prétentions territoriales. À la nouvelle, qui lui parvint au cours de l’été de 1727, que les Anglais envoyaient une garnison au fort Oswego, Beauharnois, inquiet, dépêcha Claude-Michel Bégon avec un ordre leur signifiant de se retirer dans les 15 jours. Il appela aussi la milice dans le but de mener une expédition militaire, mais après réflexion décida de consulter le roi avant de prendre des mesures aussi draconiennes. Les Iroquois avaient clairement déclaré qu’ils ne voulaient pas que le sang coule sur leur territoire. En insistant sur le rigoureux équilibre entre les forces françaises et anglaises, ils assuraient aux Français la possession du fort Niagara mais garantissaient également que les Anglais ne seraient pas délogés du fort Oswego. C’est sur cette interprétation des intentions des Iroquois que Beauharnois fonda sa politique concernant le lac Ontario. Dès lors, cette question, comme celle de la frontière acadienne, fut laissée à la diplomatie, et le nouveau statu quo, qui ne réglait rien, fut confirmé au congrès de Soissons en 1728.
Les Français s’adaptèrent tant bien que mal. Le commerce de l’eau-de-vie, quoique limité, avait déjà été rétabli pour contrebalancer la vente libre du rhum au fort Oswego. Beauharnois reçut l’ordre de rétablir la pratique de vendre les congés, c’est-à-dire les permis de faire la traite, dans les postes de l’Ouest, dans l’espoir de mieux concurrencer les Anglais. Il publia des ordonnances interdisant aux Français d’aller au fort Oswego, et recommanda que les forts Frontenac (Kingston, Ont.) et Niagara fussent largement approvisionnés en marchandises destinées à la traite et que la couronne subventionne leur commerce afin de les rendre aptes à faire concurrence aux marchandises offertes à plus bas prix par les Anglais sur l’autre rive du lac. Le ministre refusa de reconnaître qu’une subvention était nécessaire, et très vite le commerce des deux postes se solda par un déficit. Il était évident que la présence des Anglais au lac Ontario, en contact direct avec les tribus de l’Ouest, allait saper les alliances entre les Français et les Indiens.
Les guerres des Renards étaient jusqu’à un certain point un signe de l’influence anglaise dans l’Ouest. À cheval sur la rivière Wisconsin, à l’ouest de la baie des Puants (Green Bay, lac Michigan), les Renards contrôlaient la meilleure route du commerce avec les Sioux et les autres tribus de haut Mississipi. Ils défendaient jalousement leurs positions d’intermédiaires et exigeaient une contribution de la part de quiconque, Français ou Indien, passait sur leur territoire. Leurs rivaux étaient les Sauteux, qui faisaient le commerce avec les Canadiens sur le lac Supérieur, et les Illinois, qui traitaient avec les Français de la Louisiane sur les rives du Mississipi. Les autres tribus de l’Ouest, même celles avec lesquelles ils étaient apparentés, les considéraient comme des fomentateurs de troubles et ne leur faisaient pas confiance. Leurs interminables guerres tribales nuisaient au commerce français et compromettaient le fragile réseau d’alliances.
Après le traité d’Utrecht, le gouvernement français, devant la menace anglaise, avait adopté une politique d’exploration et d’expansion vers l’Ouest. En premier lieu, Beauharnois devait établir un poste et une mission chez les Sioux dans le haut Mississipi, au-delà du pays des Renards. Le ministre espérait ainsi renforcer la paix fragile conclue avec les Renards et en même temps les contourner pour traiter avec les Sioux. Beauharnois tenta de suivre cette politique incertaine en envoyant une expédition sous les ordres de René Boucher de La Perrière et du jésuite Michel Guignas, en 1727. La nouvelle alarmante arriva peu après que les Renards avaient repris leur guerre contre les Illinois et que plusieurs Français avaient été tués. On disait aussi, et c’était encore plus grave, qu’il y avait des traiteurs anglais sur la rivière Ouabache (Wabash), et que les Renards et d’autres tribus avaient été invités, par des intermédiaires indiens, à chasser les Français de l’Ouest. Sans attendre l’approbation du ministre, Beauharnois, qui avait abandonné son projet d’attaquer le fort Oswego, prépara en secret une campagne importante contre les Renards en 1728.
Une troupe, forte de 1500 hommes, Canadiens et Indiens, et commandée par Constant Le Marchand* de Lignery, échoua lamentablement dans sa mission de soumettre les Renards, et le prestige des Français en souffrit beaucoup chez les tribus de l’Ouest. Beauharnois, non sans raison, blâma Lignery qui avait transformé la campagne en expédition de traite à des fins personnelles. Le ministre exprima sa surprise devant la décision rapide qu’avait prise Beauharnois d’utiliser la force, mais l’approuva. Il subissait lui-même des pressions de la part du contrôleur général des Finances et de la Compagnie des Indes, lesquels voulaient qu’il presse Beauharnois de mettre un terme à la guerre que livraient les Renards aux Illinois. Les administrateurs de la Louisiane, en l’occurrence la Compagnie des Indes, soupçonnaient le nouveau gouverneur à Québec de perpétuer la politique de Vaudreuil en encourageant la guerre entre les Renards et les Illinois, dans le but d’empêcher les fourrures provenant des tribus du Nord-Ouest d’aboutir à La Nouvelle-Orléans. Mais même si cela était, les événements de 1727 avaient convaincu Beauharnois qu’on ne pouvait se fier aux Renards, et il s’efforça sérieusement de les anéantir.
Dans l’intervalle, les relations entre Beauharnois et l’intendant Dupuy* se détérioraient rapidement. Lors de leur première rencontre à Paris en 1726, tout semblait bien aller. Mais en dépit des instructions répétées du roi exhortant le gouverneur et l’intendant à assurer une entente parfaite entre eux, moins de deux mois après leur arrivée dans la colonie, ils avaient déjà commencé à se quereller. Les premières doléances de Beauharnois portaient sur le fait que Dupuy se faisait accompagner, contrairement à la règle, de deux archers en armes à toutes les cérémonies publiques, même dans son banc à l’église. Les querelles de préséance n’étaient pas chose nouvelle au Canada, mais celle-ci révélait que l’intendant aspirait à s’arroger les apparences autant que la substance de l’autorité royale et que le gouverneur était bien décidé à défendre ce qu’il considérait comme ses prérogatives.
Les événements qui se déroulèrent entre janvier et mars 1727 n’arrangèrent pas les choses. Pour des raisons assez spécieuses, Beauharnois refusa catégoriquement d’accéder à une requête formulée par Henry Hiché, procureur du roi à la Prévôté de Québec, d’autoriser la présence d’un tambour des troupes de la Marine lors de la publication d’un décret du tribunal. Dupuy mordit à l’appât, publia une ordonnance nommant un tambour civil et interdit la publication de toute ordonnance sans son autorisation expresse. Il s’ensuivit des scènes rappelant les démêlés qui marquèrent l’administration de Frontenac [Buade*]. L’ordonnance fut déchirée et Dupuy en accusa le gouverneur. Beauharnois convoqua l’intendant au château pour « lui parler d’affaires de conséquence ». Dupuy refusa de s’y rendre. Même l’évêque, Mgr de Saint-Vallier [La Croix*], ne réussit pas à convaincre l’intendant de l’erreur qu’il faisait en défiant le gouverneur. Beauharnois fit alors preuve de sagesse et se retint d’utiliser la force, se contentant de rédiger un long rapport sur l’affaire à l’intention de Maurepas.
Des libelles diffamatoires, apparemment tous défavorables à Dupuy, circulèrent à Québec. Beauharnois fit remarquer que Dupuy s’était lui-même placé dans une situation ridicule en suivant les vains conseils des mauvaises langues, tels que ses subdélégués, Pierre André de Leigne et Pierre Raimbault*. Toute coopération devint impossible. Selon le gouverneur, que ce fût en réglant une querelle portant sur la propriété ou en affermant la traite des fourrures au poste de Toronto, Dupuy dépassait toujours ses prérogatives. De son côté, Dupuy accusait le gouverneur de faire abus de la vente des congés de traite, d’exiger des sommes d’argent de la part des commandants des postes de l’Ouest et de ne rien faire pour mettre fin au commerce illégal avec Albany. Quand Dupuy se déclara convaincu qu’il y avait conspiration contre l’autorité du roi, il devint évident qu’il n’avait jamais cessé d’entretenir, sur la constitution, une opinion courante dans les tribunaux souverains en France, selon laquelle la magistrature et non la vieille noblesse de sang, était la légitime dépositaire de l’autorité royale. L’incompatibilité qui régnait entre les deux administrateurs sur le plan social ne pouvait qu’aggraver leurs querelles au sujet de leurs prérogatives. Dupuy était un parvenu dans les services du roi ; Beauharnois y était né. « Il me paroist, écrit le gouverneur à plus d’une occasion, qu’il a fait le general, l’Evesque et l’Intendant. C’est un homme absoluement hors de sa sphere. »
L’affrontement ultime eut lieu au cours de l’hiver de 1728. Une querelle s’était élevée à savoir qui exercerait l’autorité ecclésiastique dans la colonie à la suite de la mort de l’évêque, Mgr de Saint-Vallier, à la fin de décembre 1727. Sans se demander si lui-même et le Conseil supérieur avaient la compétence pour régler le litige, Dupuy prit le parti d’Eustache Chartier de Lotbinière, archidiacre nommé par l’évêque décédé, contre les pétulants chanoines du chapitre de la cathédrale et leur vicaire capitulaire, Étienne Boullard*. Pendant deux mois, Beauharnois ne se mêla pas officiellement à ces bizarres événements qui constituèrent pour les Québécois la principale source de distractions cet hiver-là : l’intendant fit inhumer l’évêque, en secret, à l’Hôpital Général, puis se lança dans des diatribes enflammées contre Boullard et les membres du chapitre impénitent, pendant que les chanoines défiaient les ordonnances de Dupuy contre eux. À titre privé, le gouverneur appuya Boullard et facilita l’expédition des doléances du chapitre à la cour, via la Nouvelle-Angleterre, à la fin de janvier. Ces doléances valurent à Dupuy d’être rappelé en France. Dans l’intervalle, celui-ci, se montrant toujours aussi vindicatif en dépit du scandale public, Beauharnois se rendit en personne au Conseil supérieur, le 8 mars, pour ordonner la suspension de toutes les délibérations concernant « les délicates et dangereuses » querelles ecclésiastiques de l’hiver. C’était au roi à décider. Par la suite, il partit pour Montréal. Dupuy refusa d’admettre que le gouverneur avait une certaine autorité en matière de justice et pressa le conseil de poursuivre comme auparavant. Cependant, les conseillers les plus lucides refusèrent de suivre le provocant exemple de Dupuy et seul un conseil « croupion » l’appuya. En mai, Beauharnois relégua deux conseillers appartenant à ce groupe, Guillaume Gaillard* et Louis Rouer d’Artigny, à deux seigneuries des environs de Québec, mais ceux-ci allèrent tout simplement se réfugier au palais de l’intendant.
Quand parvint la nouvelle de la disgrâce de Dupuy, Beauharnois ne cacha pas son triomphe. Confidentiellement, le ministre lui reprocha d’avoir fait preuve de mesquinerie, ce qui avait contribué à envenimer la situation. Beauharnois s’était arrogé beaucoup de prérogatives qui ne lui revenaient pas, en particulier celle de bannir les conseillers. Pourtant, il ne s’était pas montré plus susceptible au sujet de ses prérogatives que ne l’aurait été toute personne de son rang et de sa classe sociale. Sur le point essentiel, c’est-à-dire le comportement du gouverneur advenant un désaccord avec l’intendant, sa conduite avait été parfaitement correcte. C’est seulement après que la situation était devenue intenable qu’il avait fait intervenir son ultime « autorité ». Et sur ce point-là, le ministre était d’accord. En dépit de ses connaissances en matière de droit, Dupuy se montra totalement incapable de comprendre les relations d’ordre constitutionnel qui s’étaient établies peu à peu au cours d’un demi-siècle entre les principales autorités canadiennes, soit le gouverneur, l’intendant, le Conseil supérieur et l’Église. Beauharnois, qui n’était qu’un amateur en droit constitutionnel, avait le sens de la politique et comprenait qu’il lui fallait exercer son autorité avec retenue.
Il se réjouit de sa victoire sur Dupuy et se montra fort peu charitable à cette occasion. Il ne fit rien pour épargner à Dupuy l’humiliation de la saisie de ses biens pour la sûreté des créances, ses dettes étant assez considérables. Il donna pour excuse que cela relevait de la justice. Pour beaucoup de gens sans doute, sa victoire évidente était la preuve qu’il jouissait d’influence auprès de Maurepas.
L’agitation populaire et la petite guerre aux frontières qui avaient marqué les deux premières années de son administration s’apaisèrent, mais Beauharnois se trouva encore aux prises avec des problèmes chroniques. La fragilité des défenses du Canada l’inquiétait. La paix et les restrictions financières plaçaient la défense des colonies au bas de l’échelle des priorités. La plupart des recommandations de Beauharnois furent jugées trop coûteuses et superflues. Il fit valoir qu’il était essentiel de fortifier Québec et de renforcer les garnisons par un apport de 1 500 hommes de troupes. Il déclara sans ménagement que la forteresse de Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), n’était d’aucune utilité pour la défense du Canada : « Je ne sais pas, Monseigneur, écrit-il au ministre en 1727, qui peut avoir fait entendre a la cour que l’Isle Royale estoit le rempart de ce pays cy toute l’armée d’Angleterre pouroit venir à Quebec qu’on n’en scauroit rien a l’isle Royale et quand mesme on le scauroit en cy pays la que pouroient ils faire. » Le mur de pierre autour de Montréal, commencé en 1716, fut finalement terminé en 1741, mais on ne tint pas compte des deux autres recommandations.
Il réussit à convaincre le ministre de construire le fort Saint-Frédéric (Crown Point, N.Y.) aux sources du lac Champlain, après avoir appris que les Anglais projetaient de s’y établir, cet endroit étant situé sur la principale voie qui menait de New York au cœur de la colonie. S’assurant d’abord de la neutralité des Iroquois, il construisit le fort, et les Anglais ne purent que formuler une protestation diplomatique. Par une action rapide, Beauharnois avait assuré la défense d’un point stratégique des plus importants à la frontière.
Beauharnois fut amené à s’occuper de plus en plus de l’Ohio, par suite de l’influence grandissante des Anglais dans ce territoire, et, dans les années 30, il lui fallut surveiller de près plusieurs tribus, comme les Miamis, les Ouiatanons, les Peanquishas [V. Jean-Charles d’Arnaud], et les Chaouanons nomades sur la Ouabache, ainsi que les Iroquois et les autres tribus de l’est qui étaient allées s’établir à la rivière Blanche.
À Détroit, poste d’une importance vitale où de nombreuses tribus traditionnellement hostiles étaient rassemblées dans une alliance précaire, la possibilité de conspirations tribales constituait une menace constante. Quand, en 1727, les Hurons se plaignirent amèrement des prix élevés exigés par les agents d’Alphonse Tonty*, commandant du poste et détenteur du monopole de la traite, Beauharnois le rappela et accorda plusieurs congés à différents traiteurs, dans le but de stimuler la concurrence. Mais les Hurons, cédant à l’influence des Anglais et des Tsonnontouans, firent la paix avec les Têtes-Plates au sud. Une guerre générale faillit éclater parmi les tribus des Grands Lacs, en 1738, quand les Outaouais accusèrent, avec raison, les Hurons de les avoir trahis dans une embuscade outaouaise au cours d’un raid contre les Têtes-Plates. Sur les ordres de Nicolas-Joseph de Noyelles de Fleurimont, le commandant à Détroit, les Français se barricadèrent dans le fort. Beauharnois et Noyelles négocièrent une trêve avec grande difficulté. Ils ne purent empêcher un groupe de Hurons, commandé par Orontony, d’aller s’installer à Sandoské (Sandusky) sur la rive sud-ouest du lac Érié où ils entretenaient un commerce régulier avec les négociants de la Pennsylvanie.
Plus au nord, les Renards réfractaires nuisaient toujours au commerce français. Beauharnois travailla sans relâche à les isoler sur le plan diplomatique. En 1730, la tribu avait cherché refuge chez les Tsonnontouans. Ils furent interceptés en route et attaqués par un détachement de Louisianais, de Canadiens et d’Indiens alliés totalisant 1400 hommes [V. Robert Groston* de Saint-Ange ; Nicolas-Antoine Coulon* de Villiers ; Nicolas-Joseph de Noyelles ; François-Marie Bissot* de Vinsenne]. Plusieurs centaines de Renards furent tués en tentant de fuir et d’autres furent distribués comme esclaves parmi les tribus victorieuses. Ravi, Beauharnois rétablit, en 1731, les postes qui avaient été abandonnés à Baie-des-Puants (Green Bay, Wisc.) et chez les Sioux. Cependant, en traitant le reste des Renards comme il le fit, Beauharnois n’avait pas prévu la réaction des tribus de l’Ouest aux récents événements. Apparemment, il n’avait pas l’intention de négocier de bonne foi avec une tribu qui s’était déjà moquée de ses efforts pour instaurer la paix. Au contraire, il encouragea les commandants des postes, les alliés de l’Ouest et les Indiens des missions à harceler le reste de la tribu des Renards à chaque occasion qui se présentait jusqu’à ce que « cette maudite nation [soit] tout a fait Eteinte ». En 1733, Kiala*, le principal chef des Renards, demanda grâce. Beauharnois l’envoya à la Martinique comme esclave. Si le reste des Renards refusaient d’être dispersés dans les missions de la colonie, ils seraient tués.
Beaucoup d’alliés désapprouvèrent un traitement aussi impitoyable et commencèrent à témoigner ouvertement leur sympathie à la malheureuse tribu, allant même jusqu’à libérer leurs esclaves. Quand, en septembre 1733, Nicolas-Antoine Coulon de Villiers exigea imprudemment qu’on lui remette quelques Renards qui avaient trouvé refuge chez les Sauks à la baie des Puants, il fut tué ainsi qu’un de ses fils et plusieurs autres Français. Beauharnois tenta en 1735 de relever le prestige des Français en mettant sur pied une autre expédition militaire, commandée par Noyelles de Fleurimont. Ce fut un désastre attribuable au mauvais temps, au manque de planification, à une préparation inadéquate et au manque d’enthousiasme chez les Indiens alliés. Les Renards trouvèrent refuge chez les Sioux.
L’expansion du commerce des fourrures vers le Nord-Ouest, grâce à Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye, dont Beauharnois appuyait énergiquement les expéditions, compliquait les efforts du gouverneur pour stabiliser les relations avec les Indiens dans l’Ouest. Pour La Vérendrye, il était indispensable d’entretenir des relations amicales avec les Sauteux, les Cris et les Assiniboines, mais ces tribus étaient toutes des ennemis traditionnels des Sioux. La Vérendrye ne voulait ou ne pouvait pas empêcher les Cris de mener des incursions contre cette nombreuse tribu. En 1736, un groupe de guerriers sioux tua Jean-Baptiste Gaultier* de La Vérendrye, le jésuite Jean-Pierre Aulneau* et 19 Canadiens au lac La Pluie (Rainy Lake, Ont.). La position de Jacques Legardeur de Saint-Pierre au poste sioux étant devenue intenable, il se retira en 1737. Le problème des Renards avait cédé la place au problème des Sioux, plus à l’ouest, et compromettait la moitié des sources d’approvisionnement en peaux de castor destinées à l’exportation. La tentative de Beauharnois d’exterminer les Renards avait échoué. Il était désormais convaincu qu’il ne pouvait faire grand-chose pour « imposer une loy » aux Indiens. La conciliation s’imposait, même « s’il n’était pas possible de faire un fond certain sur l’inconstance des Sauvages ». Ne pouvant obtenir des renforts pour les garnisons de l’Ouest, il comptait sur les cadeaux et les médailles qu’il distribuait avec prodigalité pour cimenter les alliances avec les Indiens. Les dépenses en cadeaux, qui avaient été fixées à 22 000# par an, atteignirent 65 000# en 1741 et 76 600# en 1742, au grand désespoir du ministre. Si cette politique réussit, ce fut en grande partie grâce à l’habile diplomatie de Paul Marin de La Malgue, que Beauharnois avait nommé commandant au poste de Baie-des-Puants en 1738. En 1743, une paix précaire était rétablie dans l’Ouest. Si Beauharnois avait employé la conciliation en 1730 alors que les Français et leurs alliés de l’Ouest étaient unis et victorieux, il aurait peut-être été mieux en mesure plus tard de résister aux tensions que subissait le réseau d’alliances des Français.
Comparativement aux querelles qu’il avait eues avec Dupuy, Beauharnois entretint des relations paisibles avec les gens. Pourtant le favoritisme dont il fit preuve à l’égard des Ramezay, anciens rivaux des Vaudreuil, aurait pu susciter des tensions. Avec les Vaudreuil, il se montra correct sinon généreux. Les privilèges de patronage reliés au poste de gouverneur étaient considérables. La plupart des gouverneurs participèrent au commerce des pelleteries et Beauharnois ne fit sans doute pas exception. Dupuy l’en accusa. La détermination avec laquelle il avait fondé un poste chez les Sioux et la protection qu’il n’avait jamais cessé d’accorder à La Vérendrye concernant son monopole de la Mer de l’Ouest, signifient peut-être qu’il avait des intérêts personnels dans l’entreprise. Avec la décision royale d’étendre le commerce des fourrures vers l’Ouest, les avantages attachés au poste grandirent encore. Beauharnois bénéficia aussi de la décision prise en 1726 de réintroduire la vente des congés dans la plupart des postes des Grands Lacs. Vingt-cinq de ces permis devaient être accordés, moyennant une somme de 250#, à des familles pauvres mais de bonne réputation dans la colonie. Nonobstant, Beauharnois les vendit au plus offrant, en général pour 500#, et certaines années en délivra jusqu’à 50. Il déposa 6 250# au compte de la Marine et distribua 10 000# en pensions aux veuves des notables de la colonie. Le ministre approuva prudemment cette innovation qui élargissait le patronage du gouverneur. Quand, en 1742, le roi réduisit de façon draconienne, en grande partie pour des motifs budgétaires, le nombre des congés et entreprit d’affermer la plupart des postes de l’Ouest au plus offrant, Beauharnois et les commandants des postes, qui perdaient ainsi leurs privilèges commerciaux, protestèrent naturellement. Beauharnois allégua qu’un négociant détenteur d’un permis allait demander des prix exorbitants pour les articles de traite, ce qui pousserait les Indiens à faire le commerce avec les Anglais.
Dans l’ensemble, Beauharnois semble avoir distribué ses faveurs équitablement. Il avait ses favoris, Gaultier de Varennes et de La Vérendrye, Noyelles de Fleurimont, Jean-Charles d’Arnaud, Louis Denys de La Ronde, Jacques de Lafontaine de Belcour, Marin de La Malgue, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, Claude-Charles de Beauharnois, son neveu, et il y eut quelques plaintes, mais c’était normal. Il réussit à abaisser l’âge de l’engagement des jeunes recrues dans les troupes de la Marine et à en augmenter le nombre et défendit avec vigueur les intérêts de l’ensemble des officiers.
Engagé dans l’organisation commerciale du Canada, Beauharnois fit ce qu’il put pour empêcher que le commerce ne se fasse par l’intermédiaire de la colonie rivale, la Louisiane. Les Chicachas, alliés des Anglais de la Caroline dans le bas Mississipi, réussissaient assez bien, à l’instar des Renards, à désorganiser le commerce de la Louisiane. Beauharnois pressa les Indiens du Canada d’envoyer des bandes les attaquer. La capture, en 1736, de quelques Français de la Louisiane ayant à leur tête Pierre d’Artaguiette d’Itouralde, eut pour effet d’intensifier la guerre, mais une campagne concertée, menée en 1739, et dont le contingent canadien était commandé par Charles Le Moyne de Longueuil, ne donna pas beaucoup de résultats [V. Le Moyne de Bienville]. Les Chicachas ne tinrent pas leur promesse de garder la paix. De fait, les continuelles incursions que les Indiens du Canada, aiguillonnés par Beauharnois, menaient contre les Chicachas ne servirent qu’à entretenir l’hostilité de cette tribu à l’égard des Français de la Louisiane. Beauharnois refusa de faire la paix avec eux ou les Cherokees en 1746. Lorsque la Compagnie des Indes céda le gouvernement de la Louisiane à l’autorité royale en 1732, il joignit sa voix à celle des nombreux Canadiens qui soutenaient que le pays des Illinois devrait de nouveau relever de l’administration de Québec. N’ayant pas réussi à faire valoir son point de vue, il continua de délivrer des congés pour le pays des Illinois aux traiteurs canadiens, en donnant comme motif que les traiteurs de la Louisiane n’étaient pas en mesure de satisfaire les besoins des Indiens. En 1743, il protesta avec énergie contre la prétention de Pierre de Rigaud* de Vaudreuil, récemment nommé gouverneur de la Louisiane, de soumettre la traite des fourrures sur le Missouri à des règlements.
Sauf dans un ou deux cas, Beauharnois s’entendait bien avec le clergé. Même quand le coadjuteur, Mgr Dosquet*, publia un mandement en 1731, remettant en vigueur certaines des anciennes restrictions de Mgr de Laval* contre le commerce de l’eau de-vie, Beauharnois reconnut qu’il n’outrepassait pas sa compétence. Il se contenta de prier les missionnaires de Montréal et des postes de l’Ouest de ne pas se montrer trop sévères dans l’interprétation du mandement. Il croyait fermement que sans l’extension du commerce de l’eau-de-vie, les Indiens iraient traiter avec les Anglais. « Etant toujours en commerce, écrivait-il, peut estre en cas de guerre aurions nous bien dela peine a les faire revenir. » Ce vieil argument était devenu plus convaincant depuis la fondation du fort Oswego sur le lac Ontario.
Beauharnois préférait nettement les sulpiciens aux jésuites. Il fit l’éloge de la fidélité des Indiens de la mission du Lac-des-Deux-Montagnes dirigée par le père François Picquet*, et leur obtint bien des faveurs. D’un autre côté, en 1741, il se lança dans une critique acerbe des Indiens de la mission de Sault-Saint-Louis (Caughnawaga), et, implicitement, de leurs missionnaires jésuites, en particulier du père Pierre de Lauzon, qui ne s’étaient pas servis de leur influence pour régler une querelle tribale. Il accusait les jésuites d’être de connivence avec Marie-Anne Desauniers et ses sœurs, Marguerite et Marie-Madeleine, dans le commerce illégal qu’elles pratiquaient, au su de tous, dans leur magasin à la mission du Sault. « Tout le monde de ce pais, écrivit-il au ministre, dit ouvertement que le college de Québec a été baty des fraudes qui ont été faites par le commerce Anglois. » Rendu furieux par la politique des jésuites qu’il considérait trop indépendante et contraire à la sienne, il se plaignit que « le Sault Saint-Louis était devenû une espèce de République ». Cet accès de colère coïncidait avec une sortie semblable contre le jésuite Armand de La Richardie, missionnaire chez les Hurons de Détroit, que Beauharnois accusait de faire preuve de trop d’indépendance relativement à l’établissement dans un nouveau lieu de cette tribu qu’il appelait « ses Sauvages a luy en propre comme maître absolû ». Les jésuites nièrent toutes ces accusations, protestant que les Indiens du Sault n’avaient pas « le cœur anglais » comme le gouverneur les en accusait injustement. En 1742, Beauharnois supprima le magasin des sœurs Desauniers ; néanmoins ses attaques contre les missionnaires et leurs ouailles perdirent quelque peu de leur violence. Il y avait menace de guerre avec l’Angleterre et la colonie aurait besoin de l’appui de tous ses alliés, même les moins sûrs. Il savait aussi qu’il fallait un certain commerce illégal pour procurer aux traiteurs français les articles de fabrication anglaise qu’exigeaient les tribus de l’Ouest.
Au cours de ces années angoissantes, Beauharnois se querella à plusieurs reprises avec l’intendant Hocquart*. Pendant un certain temps, les deux hommes s’étaient entendus à merveille. Après deux années difficiles avec Dupuy, Beauharnois fit part au ministre de son sentiment de soulagement : « l’Experience m’en fait gouter la douceur ». Jeune, compétent et ambitieux, Hocquart considérait sa nomination au poste de commissaire ordonnateur du Canada, en 1729, comme un échelon à gravir pour accéder éventuellement à une intendance en France. Mais il fut grandement déçu dans ses espoirs d’impressionner le ministre en réussissant avec éclat à rétablir l’ordre dans les finances de la colonie. Maurepas refusa d’admettre que le ministère de la Marine et les trésoriers généraux de la Marine devaient des sommes considérables à la colonie pour des dépenses antérieures. On s’attendait à ce que Hocquart fasse des économies en imposant des restrictions dans les budgets courants. Cela contrecarrait son désir de trouver des fonds pour réaliser ses nombreux et ambitieux projets, dont les forges du Saint-Maurice [V. François-Étienne Cugnet] et un chantier de construction navale à Québec. Hocquart décida qu’il faudrait également effectuer des économies dans les dépenses militaires et dans d’autres domaines où le gouverneur avait des intérêts. Avec persistance et circonspection, il réduisit les dépenses sur une large échelle : pensions pour les interprètes indiens, uniformes des officiers, commandes de poudre à canon, requêtes de cadeaux destinés aux Indiens alliés provenant des commandants des postes de l’Ouest. Il voulut réduire les coûteuses garnisons dans plusieurs forts, nommer un commandant permanent à Détroit, et affermer la traite au plus offrant dans chaque poste de l’Ouest. Il prétendit que Beauharnois engageait dans les fortifications des dépenses excessives et non nécessaires.
Naturellement, Beauharnois se plaignit. En 1740, il frappa un grand coup en révélant ce qu’il laissait supposer être une collusion entre l’intendant et Cugnet, fermier du poste de traite de Tadoussac et principal associé dans les forges du Saint-Maurice, pour fausser les rapports des revenus du poste de Tadoussac. Le protégé du gouverneur, Lafontaine de Belcour, offrit le double de la somme que payait Cugnet pour le bail. Cette querelle s’était élevée à la suite d’un désaccord sur la provenance de la gratification destinée à Nicolas Lanoullier de Boisclerc, ancien agent des trésoriers généraux de la Marine. La guerre du patronage s’amplifia jusqu’à comprendre une infinité de questions, les protégés de chacun des administrateurs prenant parti selon leur appartenance. Le gouverneur prétendit que l’intendant empiétait parfois sur ses prérogatives, ce qui n’était pas sans rappeler ses anciennes querelles avec Dupuy. Toutefois, il y avait une différence importante entre les deux situations : malgré les différends qui les opposèrent ouvertement après 1739, Beauharnois et Hocquart étaient encore capables de coopérer sur les questions qui nécessitaient leur collaboration.
Avec la nouvelle, en juin 1744, que la France et l’Angleterre étaient officiellement en guerre, une étroite collaboration s’imposait. La tâche du gouverneur était claire : assurer la défense de la colonie proprement dite, de même que les alliances avec les Indiens et la neutralité des Iroquois, et prendre des mesures offensives contre les possessions anglaises en Amérique du Nord. Dès les débuts de la guerre anglo-espagnole, en 1739, Beauharnois avait pris certaines mesures préventives. Il avait fait réparer les fortifications et augmenter la garnison aux forts Saint-Frédéric, Niagara et Frontenac et avait ordonné qu’on patrouille régulièrement le long de la frontière, au lac Champlain. L’installation de plates-formes et d’affûts aux batteries de Québec fut terminée en 1742. À la déclaration de la guerre, il fit faire des remblais de terre et une palissade le long de la rivière Saint-Charles, fit restaurer les forts en palissade dans les seigneuries, fit installer des postes de signaux dans le bas Saint-Laurent et des brûlots aux endroits stratégiques.
La preuve que Beauharnois avait réussi à rétablir le calme dans l’Ouest fut faite en 1744, quand lui-même et les commandants des postes n’eurent aucune difficulté à amener leurs alliés à se ranger du côté des Français. Sachant que les Indiens détestaient l’inactivité, il ordonna en 1744 une rapide incursion contre les traiteurs anglais de l’Ohio suivie de la petite guerre contre les frontières de la Nouvelle-Angleterre. Des détachements de miliciens et d’Indiens, sous la conduite d’officiers canadiens [V. Marin ; Francois-Pierre de Rigaud* de Vaudreuil ; Jean-Baptiste Boucher de Niverville ; Lue de La Corne*, dit La Corne Saint-Luc ; Jacques Legardeur de Saint-Pierre] attaquèrent des postes éloignés, tels que Saratoga (Schuylerville, N.Y.), le fort Massachusetts (Williamstown, Mass.) et Charlestown (N.H.) et en ravagèrent les environs.
Toutefois, il répugnait à Beauharnois de lancer une plus vaste offensive, peut-être en partie à cause de l’esprit de prudence qu’on lui avait inculqué dans la marine. Mais les circonstances justifiaient grandement cette stratégie. Les Iroquois l’avaient informé qu’ils resteraient neutres à la condition qu’Oswego ne soit pas attaqué et, même si Maurepas grommelait quelque peu, le gouverneur savait que tant que les Iroquois resteraient neutres, ils n’appuieraient pas une attaque contre le fort Niagara. C’est ainsi que la situation demeura inchangée au lac Ontario pendant toute la durée de la guerre.
Ce qui était plus gênant, c’était l’insuffisance de provisions, de munitions et d’articles de traite dans la colonie. Des années avant la déclaration de la guerre, Beauharnois, dans un long rapport, avait demandé instamment qu’on lui envoie des renforts pour les troupes de la Marine, dont les effectifs ne comptaient que 600 hommes dispersés dans plusieurs garnisons, et pour les 12 000 miliciens auxquels il ne faisait pas beaucoup confiance, « la paix qui dur[ait] depuis si longtemps ayant ralenti l’ardeur des Canadiens ». Le tiers d’entre eux n’avait pas d’armes. L’expérience de première main que Beauharnois avait acquise dans la marine lui ayant appris qu’en temps de guerre on ne pouvait pas escompter d’être ravitaillé par les navires français, il avait insisté pour qu’on lui envoie des réserves pour plus qu’une année. Mais le ministre, influencé par l’intendant qui se souciait d’abord du budget, refusa de reconnaître ces besoins. Il rejeta la requête de Beauharnois de faire construire un mur à Québec du côté exposé à une attaque par terre. Le ministre était d’avis qu’à cause des échecs subis dans le passé, les Anglais n’attaqueraient pas la ville. Beauharnois n’entretenait pas de telles illusions et il remarqua : « Ils pouront toujours avoir en vue Quebec qui est la pièce importante et qui décide du sort des autres. » Trois années de mauvaises récoltes aggravèrent encore la situation, et la colonie risquait de connaître une pénurie de vivres.
Dans ces circonstances, il n’était pas question d’entreprendre une campagne importante et prolongée. Au printemps de 1745, il contremanda une attaque contre les postes anglais de la baie d’Hudson et réduisit la petite guerre au minimum requis pour maintenir les alliances avec les Indiens. De mauvaise grâce, il avait envoyé un détachement de miliciens et d’Indiens commandé par Marin, pour appuyer une attaque contre Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse, mais il ne voulait pas affaiblir davantage ses défenses pour une campagne qu’il aurait été plus logique de conduire à partir de l’île Royale ou de France. La campagne se termina brusquement avec la prise de Louisbourg, le 28 juin, par William Pepperrell et le commodore Peter Warren.
La rumeur grandissait d’une invasion par mer et par terre. À Québec, les habitants réclamaient à grands cris la fortification de la ville. Beauharnois sauta sur l’occasion pour commencer les travaux, même sans l’autorisation officielle, car c’était là un projet qu’il nourrissait de longue date. L’année suivante, en 1746, Maurepas ordonna la cessation des travaux, à moins que les habitants ne fussent prêts à en assumer les frais. L’opinion était divisée et la décision fut remise à plus tard, mais la construction était bien amorcée.
Beaucoup plus grave était la pénurie de munitions et d’articles de traite. Le scepticisme de Beauharnois concernant l’efficacité de Louisbourg parut justifié quand des corsaires anglais qui croisaient dans le golfe Saint-Laurent empêchèrent plusieurs vaisseaux d’atteindre la colonie en 1744. Le printemps suivant, Beauharnois sonna l’alarme dans cette phrase prophétique : « la rareté, ainsi que le haut prix des marchandises donne lieu a cette diminution de commerce que l’on pouroit même regarder totalement perdû l’année prochaine, si nos vaisseaux n’arrivent pas a bon port, il y a lieu de craindre que dés cette année le peu de marchandises qui est monté tante a Niagara que dans les autres Postes, ne dégoute les sauvages et ne les engage à se ranger du côté des Anglois pour y trouver leurs besoins ». Mais il ne reçut qu’une petite quantité de marchandises en 1745. Il écrivit alors non sans pessimisme « je chercheray le possible dans l’impossible [...] il ne me sera peut estre pas possible de garantir la colonie ». Il recommanda d’organiser une campagne pour reprendre Louisbourg et l’Acadie et assurer la sécurité de la navigation française dans le nord de l’Atlantique. Le ministère de la Marine préparait déjà les plans d’une telle expédition, mais la flotte qui, sous le commandement du duc d’Anville [La Rochefoucauld] it le cap sur la baie de Chibouctou en juin 1746 ne connut que des échecs. Le seul aspect positif de cette tentative fut la victoire remportée contre un détachement de la Nouvelle-Angleterre, à Grande-Pré, par Nicolas-Antoine Coulon de Villiers, commandant en second de Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de Ramezay*, que Beauharnois avait dépêché avec 1800 Canadiens et Indiens à la rencontre du duc d’Anville. Pour la troisième année consécutive, Québec ne reçut pas suffisamment de munitions et d’articles de traite.
Il en résulta ce qu’avait prévu Beauharnois : le réseau d’alliances dans l’Ouest faillit être démembré. Au printemps de 1747, il ne restait plus d’articles de traite dans les postes français. Pour les Indiens, cela rendait plausibles les dires des Anglais selon lesquels la défaite française était totale. George Croghan, agent et traiteur de la Pennsylvanie, profita du mécontentement des Hurons de Sandoské, au sud-ouest du lac Érié, pour les inciter à tuer cinq traiteurs français et à cerner le poste de Détroit [V. Orontony]. Les Outaouais, les Potéouatamis et les Sauteux se joignirent à eux. Les établissements furent incendiés et Paul-Joseph Le Moyne* de Longueuil, commandant du poste, se trouva réduit à l’impuissance. Les troubles se propagèrent vers le nord jusqu’à Michillimakinac et vers l’ouest, dans le pays des Illinois. Ce n’est que lorsque Beauharnois fut en mesure d’envoyer des troupes de Montréal avec des articles de traite que le soulèvement fut freiné. Mais il n’était plus possible de faire confiance aux tribus de l’Ouest.
De plus, et cela aggravait encore la situation, George Clinton, le gouverneur de New York et son brillant agent auprès des Indiens, William Johnson*, avaient réussi, au cours de l’été de 1746, à persuader des Iroquois de déclarer la guerre aux Français. Les cantons de l’Ouest, à l’exception de quelques Tsonnontouans, restèrent neutres en général, mais les Agniers, pour la première fois depuis 45 ans, firent des incursions dans les environs de Montréal [V. Theyanoguin]. Beauharnois leur déclara la guerre en mars 1747, pour maintenir le prestige français dans l’opinion de ses alliés. Désormais, il n’était même plus possible de compter sur l’importation illégale d’articles de traite en provenance d’Albany. On réussit à prendre une bande d’Agniers dans une embuscade près de Châteauguay en juin 1747, ce qui dissuada les Indiens de poursuivre leurs incursions [V. Karaghtadie] ; toutefois, l’impression que les Français étaient faibles et isolés se répandit dans tout l’Ouest. En quittant la colonie en octobre 1747, Beauharnois laissait à son successeur, La Galissonière [Barrin], la tâche de reconstruire l’empire français en Amérique du Nord.
Le rappel de Beauharnois, décidé en 1746, avait été retardé par suite de l’échec du duc d’Anville. Il avait maintenant 76 ans, et le ministre, comme d’ailleurs Hocquart, considérait qu’un général plus jeune répondrait mieux aux exigences de la guerre. On ne mettait pas sa conduite sérieusement en doute. Des rumeurs couraient sur l’affaiblissement de ses facultés mentales, mais le ton alerte des dépêches qu’il expédia à ses officiers durant la guerre contredit ces rumeurs. « M. le Marquis de Beauharnais est arrivé à Paris en bonne santé », écrivit Pierre Hazeur* de L’Orme en février 1748. « Ceux qui ont fait courir le bruit qu’il etoit en enfance en ont bien imposé. »
En reconnaissance de ses longs états de service, il fut nommé lieutenant-général des armées navales en janvier 1748. Il avait déjà été fait commandeur et grand croix de l’ordre de Saint-Louis en 1732 et 1738, et avait été promu chef d’escadre le fer mai 1741. Il survécut à tous ses frères et consacra les deux dernières années de sa vie à mettre de l’ordre dans leurs successions. Quant à sa fortune et à celle de sa défunte femme, elles furent en grande partie réunies en 1751 par le mariage de François de Beauharnois de La Boische et de La Chaussée, son neveu, à Marie-Anne Pyvart de Chastullé, sa cousine et sa rivale comme prétendante à la fortune des Hardouineau. Toutefois, le mariage eut lieu après la mort de Charles de Beauharnois survenue le 12 juillet 1749, à Paris. Il fut inhumé dans la paroisse de Saint-Sauveur.
À son arrivée au Canada en 1726, la colonie était aux prises avec de graves problèmes de frontière en Acadie, au lac Ontario et au-delà des Grands Lacs. À son départ en 1747, le réseau d’alliances avec les Indiens avait été sur le point de se démembrer. Il serait injuste de prétendre que Beauharnois était responsable de l’état des choses au moment de son départ ; on peut même dire que sans lui la situation aurait été pire. Sa prudente stratégie défensive était entièrement valable dans les circonstances. Si sa politique à l’égard des Renards compromit les alliances de l’Ouest il réussit du moins à rétablir la stabilité avant la déclaration de la guerre. Dans l’ensemble, sa politique perpétua celle de Vaudreuil, reflétant les mêmes problèmes auxquels la colonie devait faire face. Le fait que les recommandations de Beauharnois furent approuvées après son départ en prouve le bien fondé : la fortification de Québec, l’augmentation des troupes coloniales et le renforcement de la puissance française dans l’Ouest.
Les renseignements que nous avons sur son tempérament sont rares et difficiles à interpréter. Ses démêlés juridiques avec sa femme et les enfants de sa femme soulèvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. La mesquinerie dont il fit preuve dans ses querelles avec Dupuy fut contrebalancée par le sérieux et la prudence avec lesquels il prit presque toutes ses décisions. Mgr de Pontbriand [Dubreil] loua sa prudente conduite durant le violent débat relatif à la continuation de l’enceinte de Québec, en 1746. Son raffinement et sa sensibilité impressionnaient les gens. Sa bibliothèque contenait 38 titres représentant un large éventail de sujets à la mode du jour : l’histoire, la géographie, l’architecture, la littérature, les classiques, et aussi des ouvrages sur la guerre, le commerce, la police et la généalogie. Parmi quelques ouvrages pieux se trouvait un exemplaire du Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle. Hocquart, malgré les différends qui s’élevèrent entre lui et Beauharnois, n’a pas été le seul à le décrire comme un être « bon, affable et généreux ». Les Indiens le connaissaient sous le nom de « Paix ». Beaucoup exprimèrent leurs regrets à son départ.
D’un autre côté, plusieurs années plus tard, le comte de Raymond*, à Louisbourg, avait l’impression que Beauharnois jouissait de peu de respect à la fin de son mandat. Ce n’était peut-être qu’une rumeur. Mais s’il avait été très populaire, comme l’avait été Vaudreuil, son prédécesseur, on pourrait s’attendre à en trouver plus de preuves. L’absence d’opinions hostiles à son égard est compréhensible, étant donné l’influence dont il jouissait auprès du ministre. À part la seigneurie de Villechauve, qui lui avait été concédée conjointement avec son frère Claude, en 1729, mais n’avait jamais été mise en valeur, il n’établit aucune racine dans la colonie, ce qui, avec la crainte qu’inspirait son influence, explique peut-être pourquoi il est resté jusqu’à un certain point un étranger dans une collectivité qui devenait de plus en plus provinciale.
La documentation concernant les débuts de la carrière et la vie de Beauharnois est dispersée et d’inégale valeur. Quoique plusieurs registres civils et de propriété aient été détruits pendant la seconde guerre mondiale, les archives départementales du Loiret (Orléans) et les archives communales contiennent encore de nombreux documents concernant les Beauharnois et les biens de cette famille. De plus, on trouve d’intéressants documents aux AN, 251 AP et dans le Minutier central ainsi qu’à la BN, mss, Fr., 26 726 (Pièces originales, 242). Hozier, Armorial général de France est un ouvrage généalogique indispensable. Les détails au sujet de la carrière navale de Beauharnois se retrouvent éparpillés aux AN, dans les séries suivantes : Col., D2c ; Col., E ; Marine, B2, B4, C1, C2, C7, et à la BN, mss, Fr., 27 770, 22 771. Les sources concernant ses démêlés judiciaires avec sa femme et ses beaux-fils se retrouvent en grande partie aux AD, Charente-Maritime (La Rochelle), séries B et E, à la Bibliothèque municipale de La Rochelle et aux AN, dans le Minutier central, dans la série X1b et dans la section Marine C7.
Le gros de la documentation au sujet de sa vie publique au Canada se trouve aux AN dans les séries bien connues contenant la correspondance officielle : Col., B, C11A, C11E, C13A, D2C, E, F3 ; Marine, B2, B3. Les APC possèdent des copies ou des microfilms de la plupart de ces séries. On trouve aussi aux ASQ des documents intéressants, bien que dispersés. L’ensemble de la correspondance de Beauharnois n’a jamais été publiée quoique les NYCD (O’Callaghan et Fernow) contiennent plusieurs dépêches traduites en anglais, concernant les problèmes de frontière entre la Nouvelle-France et la colonie de New York.
La première biographie de Beauharnois reste encore à paraître bien que certains historiens aient traité d’un aspect ou l’autre de sa vie publique. Parmi ces historiens, Frégault, dans La civilisation de la Nouvelle-France, donne une vue d’ensemble sur cette période de paix. Au sujet de l’attitude de Beauharnois concernant les guerres des Renards, Kellogg, dans son étude intitulée French régime, a tenté, de façon prématurée sinon limitée, d’en faire l’analyse. La ligne de conduite de Beauharnois envers La Vérendrye et au sujet du Nord-Ouest est exposée en détail par Champagne, dans Les La Vérendrye. Au sujet de ses démêlés avec Dupuy, on consultera l’ouvrage de Dubé, Claude-Thomas Dupuy, qui constitue l’étude la plus récente et la plus complète. [s. d. s.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
S. Dale Standen, « BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, CHARLES DE, marquis de BEAUHARNOIS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/beauharnois_de_la_boische_charles_de_3F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/beauharnois_de_la_boische_charles_de_3F.html |
| Auteur de l'article: | S. Dale Standen |
| Titre de l'article: | BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, CHARLES DE, marquis de BEAUHARNOIS |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1974 |
| Année de la révision: | 1974 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |