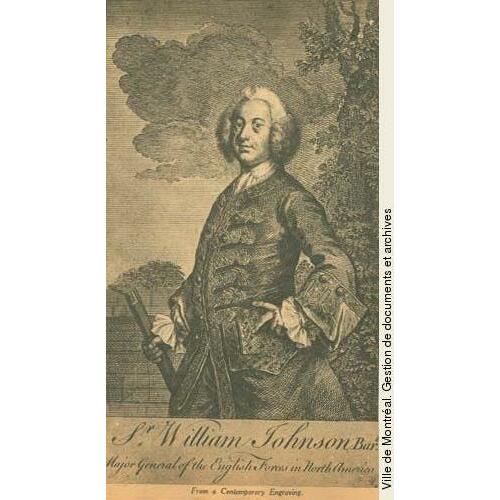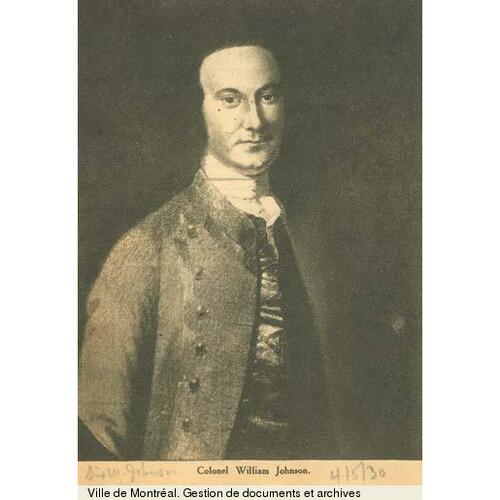Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2837207
JOHNSON, sir WILLIAM, surintendant du département des Affaires des Indiens du Nord, né vers 1715, fils aîné de Christopher Johnson, de Smithstown (près de Dunshaughlin, République d’Irlande), et d’Anne Warren, sœur du vice-amiral sir Warren*, décédé le 11 juillet 1774 à Johnson Hall (Johnstown, New York).
En 1736, William Johnson commença à remplir les fonctions d’agent de Peter Warren, encaissant le loyer des locataires irlandais de Warren. Au début de 1738, Johnson vint en Amérique pour surveiller une propriété que Warren avait acquise près de Fort Hunter, dans la vallée de la Mohawk, dans la colonie de New York. Il arrivait à un moment propice, car la lutte que la France et la Grande-Bretagne se livraient pour l’hégémonie de l’est de l’Amérique du Nord allait atteindre sa phase critique de son vivant. C’est à ce conflit et à ses suites que Johnson voua le reste de sa vie, conflit qui lui permit de bâtir sa fortune, une des plus vastes de l’Amérique coloniale.
Grâce à un gros capital que son oncle avait mis à sa disposition, Johnson devint, moins d’une décennie après son arrivée, l’homme d’affaires le plus important sur la rivière Mohawk. Employant de la main-d’œuvre blanche engagée à long terme et des esclaves noirs, il mit sur pied une ferme de 200 acres sur la rive sud de la rivière ; en 1739, il acheta une terre de 815 acres sur la rive nord, avec accès au King’s Road, qui allait vers l’ouest jusqu’à l’Oneida Carrying Place (près du lac Oneida). Par l’intermédiaire d’un représentant, il se mit à faire le commerce de marchandises anglaises importées avec le village indien d’Oquaga (près de Binghamton). Il passa également des contrats avec des fermiers pour leurs surplus de blé et de pois. Avant 1743, il avait commencé à faire du commerce avec Oswego (ou Chouaguen ; aujourd’hui Oswego, New York), le poste principal de la traite des fourrures de l’Amérique britannique. Son magasin, situé sur le King’s Road, servait de centre d’approvisionnement pour toutes ses transactions, concurrençant ainsi le monopole depuis longtemps établi des maisons hollandaises d’Albany. Il expédiait également ses propres marchandises dans la ville de New York où elles étaient vendues ou expédiées soit aux Antilles, soit à Londres.
Cette habileté et ce succès dans le commerce l’entraînèrent inévitablement dans les affaires publiques. En avril 1745, il était nommé juge de paix du comté d’Albany. Entre 1745 et 1751, il fut colonel des Indiens des Six-Nations, fonction détenue auparavant par un groupe de marchands de fourrures d’Albany. Son influence auprès des Six-Nations, en particulier ses voisins, les Agniers, prit de l’ampleur car il avait facilement accès aux fonds de la province pour payer régulièrement les services que rendaient les Indiens. Pendant la guerre de la Succession d’Autriche, il tenta d’organiser chez les Indiens des patrouilles de reconnaissance et des coups de main sur la frontière pour appuyer un plan d’attaque sur le fort Saint-Frédéric (près de Crown Point, New York) mais il ne réussit pas vraiment car les Six-Nations continuaient, d’une façon générale, à rester neutres. En février 1748, il fut nommé colonel des 14 compagnies de milice sur la frontière de New York et, en mai, colonel du régiment de milice de la ville et du comté d’Albany, postes qu’il occupa jusqu’à la fin de sa vie et qui offraient maintes occasions de favoritisme. Il fut nommé au Conseil de la colonie de New York en avril 1750 mais il assista rarement aux séances.
Pendant un intervalle de paix relative, de 1748 à 1754, il chercha surtout à améliorer sa situation financière. En avril 1746, il avait réussi à obtenir le contrat d’approvisionnement de la garnison d’Oswego et, en 1751, il avait fourni des biens et des services totalisant £7 773, cours de New York. Il prétendit avoir perdu environ 5 p. cent sur le contrat mais il est évident qu’il en tira profit en percevant des droits à Oswego et en gonflant ses comptes. À l’approche de la guerre de Sept Ans, il se trouva de nouveau très engagé dans les affaires provinciales. Membre de la délégation de la colonie de New York au congrès d’Albany en juin et juillet 1754, il préconisa l’augmentation des dépenses pour entretenir des garnisons chez les Indiens en des points stratégiques et exigea une véritable politique de paiement pour les services que rendaient les Indiens. Il réclamait que l’on envoyât de jeunes hommes chez les indigènes comme interprètes, maîtres d’école et catéchistes. Le congrès n’aboutit à aucun accord mais, un mois plus tard, le Board of Trade décida, de sa propre initiative, d’établir un organisme administratif permanent au service des Indiens, financé par le parlement. En avril 1755, Edward Braddock, commandant en chef de l’Amérique du Nord, désigna Johnson pour diriger les relations avec les Six-Nations et les tribus qui relevaient d’elles. Comme il l’expliquait au duc de Newcastle, Johnson était « une personne particulièrement qualifiée pour cela, vu sa grande influence sur ces Indiens ». En février 1756, Johnson reçut une commission royale le nommant « Colonel des [...] Six Nations unies d’Indiens, et de leurs confédérés, dans les parties septentrionales de l’Amérique du Nord », et « unique agent et surintendant desdits Indiens ».
En avril 1755, Braddock avait aussi nommé Johnson commandant d’une expédition, avec la commission provinciale de major général, pour prendre le fort Saint-Frédéric. Le plan projeté exigeait de plus une armée sous la conduite de Braddock pour s’emparer du fort Duquesne (Pittsburgh, Pennsylvanie) et une autre sous celle de William Shirley pour prendre le fort Niagara (près de Youngstown, New York). Cette campagne fut un échec lamentable, à l’exception d’un engagement auquel fut mêlé Johnson au début de septembre. Au lac George (lac Saint-Sacrement), Johnson, avec une partie de ses troupes de quelque 300 Indiens, ayant à leur tête Theyanoguin*, et 3 000 Américains, apprit qu’une forte colonne française commandée par Dieskau* se dirigeait sur le fort Edward (aussi appelé fort Lydius ; aujourd’hui Fort Edward, New York), où campaient le reste de ses hommes. Le détachement de secours de Johnson fut pris dans une embuscade et les survivants furent talonnés par quelques réguliers français qui essayèrent témérairement de prendre d’assaut la position du lac George fortifiée à la hâte. Les Américains les taillèrent en pièces ; Dieskau fut blessé et fait prisonnier. Johnson, lui-même blessé au début de l’offensive, joua un faible rôle dans la bataille mais se vit accorder le mérite du résultat. En visite à New York à la fin de l’année, il fut accueilli en héros et reçut du roi le titre de baronnet. En 1757, le parlement lui fit un don de £5 000. Un combat aussi insignifiant ne reçut jamais une si généreuse récompense.
Johnson s’était démis de sa commission militaire vers la fin de 1755 ; par la suite, ses fonctions touchèrent surtout aux affaires indiennes. Comme les raids indiens semaient le trouble à la frontière de la Pennsylvanie, il obtint l’autorisation d’y nommer un adjoint, George Croghan. Ils essayèrent sans grand succès d’amener les Indiens à servir la cause britannique pendant les premières années de la guerre, qui furent marquées par de singuliers échecs britanniques. Le fort Bull (à l’est du lac Oneida) fut envahi par les troupes de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry en mars 1756. Oswego tomba aux mains de Montcalm* en août de cette année-là et fut détruit. Le fort William Henry (appelé aussi fort George ; aujourd’hui Lake George, New York) se rendit en août 1757, et German Flats (près de l’embouchure du ruisseau West Canada) fut attaqué en novembre. En 1758, une forte troupe commandée par Abercromby ne réussit pas à s’emparer du fort Carillon (Ticonderoga). Les Indiens, pour une bonne part, restèrent neutres, malgré les nombreux entretiens qu’il eut avec eux et le prestige de Johnson déclina.
Or, cette situation changea grâce à une succession de victoires, à commencer par la prise de Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), par Amherst en 1758, et qui culmina avec la chute du fort Niagara et celle de Québec. L’attaque réussie du fort Niagara fut un engagement militaire d’importance pour Johnson. En effet, sous la conduite de John Prideaux, les Britanniques, ayant échappé à la vigilance de la garnison de Pierre Pouchot*, concentrèrent au fort Niagara, au début de juillet 1759, une force armée composée d’environ 3 300 réguliers et provinciaux. Johnson, commandant en second, était responsable d’un contingent de quelque 940 Indiens. Après moins de deux semaines de siège, Prideaux fut tué et Johnson assuma le commandement. Cinq jours plus tard, des forces françaises commandées par François-Marie Le Marchand* de Lignery, arrivant de la vallée de l’Ohio, s’approchèrent pour secourir la garnison. Johnson réussit tellement bien son guet-apens que l’ennemi, pris de panique, s’enfuit laissant derrière lui les morts et les prisonniers. Le jour suivant, le 25 juillet, le fort se rendait. Avec cette capture disparaissait le contrôle de ce portage, important du point de vue stratégique ; la route principale de la traite française des fourrures venait d’être coupée.
Lors de la dernière campagne de la guerre, Johnson accompagna Amherst à Montréal en 1760. Parti avec près de 700 Indiens, il ne lui en restait que 185 pour faire son entrée dans la ville ; le reste l’avait quitté après la reddition du fort Lévis (à l’est de Prescott, Ontario). Au bout de quelques jours passés à Montréal, il y nomma Christian Daniel Claus son adjoint résidant et retourna dans la vallée de la Mohawk.
La chute du Canada donna aux affaires indiennes une importance et des dimensions nouvelles. Des problèmes qu’il avait fallu traiter un à un au cours de la guerre exigeaient maintenant qu’on les envisage dans leur ensemble. Or, la politique de Johnson, qu’il n’avait jamais exposée dans tous ses détails malgré plusieurs invitations de Londres, contenait quatre points principaux : les achats des terres appartenant aux Indiens devaient être réglementés suivant le rythme auquel les tribus étaient prêtes à vendre ; le commerce devait être limité à des postes indiqués où les trafiquants, après avoir déposé une caution et reçu un permis, renouvelable chaque année, exerceraient ce commerce à des prix fixes ; pour surveiller l’administration, le surintendant aurait besoin non seulement d’adjoints mais aussi de commissaires-inspecteurs, d’interprètes et d’armuriers ; enfin, pour financer l’entreprise, il suggérait un droit de douane sur le rhum.
La réalité fut assez différente. Une grande partie de la structure administrative fut mise en place mais elle fut financée par le parlement. Les prix ne furent jamais fixés et les trafiquants ne se virent jamais limités complètement par les cautions et permis, ou aux postes de commerce indiqués. En outre, comme le gros du commerce des fourrures passait par le Canada, les gouverneurs émirent leurs propres permis et prirent des mesures pour réglementer le commerce sans se référer à Johnson ou à son adjoint à Montréal. Ce qui fut pire encore pour Johnson, étant donné que ses règlements n’eurent jamais force de loi, c’est qu’il se retrouva impuissant à punir ceux qui ne tenaient pas compte de ses sanctions. À partir de 1768, alors que Londres abandonna la centralisation de la surveillance des affaires indiennes, il ne resta à chaque colonie qu’à développer au mieux ses rapports avec les Indiens sur ses frontières. Cette décision coïncida avec une autre mesure d’économie que prit Londres, soit de retirer les garnisons des postes de l’Ouest. Il s’ensuivait que Johnson aurait dû avoir d’étroits rapports avec le gouvernement de New York et, pourtant, il ne fut pas consulté sur les affaires indiennes. Il ne prit pas non plus la peine de créer un groupe pour le soutenir au sein du conseil ou de l’Assemblée.
À titre de surintendant, Johnson était sous les ordres du commandant en chef de l’Amérique du Nord qui, jusqu’en 1763, était Amherst et avec lequel Johnson différait grandement d’opinion. Puisque l’instrument véritable de la puissance britannique en Amérique était l’armée, les opinions d’Amherst l’emportaient. Alors que Johnson voulait stimuler la fourniture d’armes et de munitions aux Indiens, Amherst, qui attachait peu de prix à leurs services, tenait à la restreindre. Tandis que Johnson usait toujours de diplomatie pour se concilier les Indiens, Amherst tenait à traiter énergiquement toute tribu opposée aux armées britanniques. Le soulèvement indien de 1763–1764 aurait sans nul doute abouti à un grave conflit entre Johnson et le commandant en chef, si Amherst, au plus fort de la crise, n’avait reçu autorisation de retourner chez lui, en Angleterre. Son successeur, Gage, revint à la politique qu’avaient suivie lord Loudoun et Abercromby ; il ne donnait aucun ordre direct et laissait au surintendant le loisir de mettre au point les détails. De cette façon, la paix fut faite avec Pondiac* et ses alliés, et l’on infligea de légères sanctions pour la mort de près de 400 soldats et de peut-être 2 000 colons.
Après 1760, Johnson eut de fréquentes réunions avec les Indiens pendant lesquelles il réglait les doléances et renouvelait avec eux les pactes d’amitié au nom de la couronne. En 1766, il rencontra Pondiac à Oswego et, en 1768, au fort Stanwix (Rome, New York), il établit les nouvelles lignes de démarcation des terres indiennes avec Kaieñˀãkwaahtoñ et d’autres chefs. Par la suite, il se contenta pour une bonne part de réunir les Six-Nations chez lui. Ce fut au cours d’une de ces conférences, en juillet 1774, qu’il tomba malade « avec un évanouissement et une suffocation qui [...] l’emportèrent en deux heures ». Gage constata : « Le roi a perdu un serviteur fidèle et intelligent, parfaitement versé dans les affaires indiennes, dont on pouvait très difficilement se passer dans ces moments critiques ; ses amis [ont perdu] un homme intègre, digne et respectable qui méritait leur estime. » Historiens et biographes, dans l’ensemble, souscrivent à ce jugement.
En fait, Johnson se servit au moins aussi bien qu’il servit le roi. À partir d’avril 1755 jusqu’à sa mort, il reçut £146 546 en tant que surintendant, soit une moyenne annuelle de £7 700. Ce montant incluait son traitement ainsi que ceux de son fils John* et de ses gendres Guy Johnson et Christian Daniel Claus. Il prit des dispositions pour que la couronne louât son magasin et payât le salaire du garde-magasin ; de plus, il prélevait à la couronne une commission de 2 et demi p. cent sur toutes les marchandises qu’il fournissait aux Indiens en sa qualité de surintendant. Toujours par l’entremise de la couronne, il fit construire une école destinée aux Indiens et verser le salaire d’un maître d’école, tout en s’attribuant le mérite de l’une et l’autre de ces initiatives. D’autre part, le produit fourni aux Indiens qui avait peut-être le plus de valeur était le rhum ; les mêmes comptes débitaient à la couronne le coût de l’enterrement des Indiens tués en état d’ivresse. Johnson ne présentait jamais de pièces justificatives mais seulement des notes sèches qui, quoique non vérifiées, étaient toujours réglées.
Il y eut aussi un sérieux conflit d’intérêts dans ses transactions foncières avec les Indiens. Publiquement, il défendait une politique destinée à empêcher la spoliation de ces terres ; en privé, toutefois, il en arrangeait l’achat pour lui-même et pour d’autres. Ces étendues de terrain étaient sans valeur pour les Blancs à moins qu’ils ne s’y établissent et qu’ils les cultivent ; ce faisant, le genre de vie des Indiens, où la chasse jouait un grand rôle, était détruit. En tant que surintendant, Johnson négociait l’opération foncière entre l’acheteur éventuel et les Indiens ; à partir de 1771 du moins, il reçut la permission des Six-Nations de fixer le prix de leurs terres.
Le territoire dont il se rendit lui-même acquéreur n’était pas négligeable. Il accepta une concession de 130 000 acres des Agniers de Canajoharie (près de Little Falls, New York). Pour £300, cours de New York, il acheta environ 100 000 acres sur le ruisseau Charlotte, affluent de la rivière Susquehanna ; néanmoins, à la suite du traité de 1768 conclu au fort Stanwix, qui fixait les lignes frontalières, il se vit obligé d’abandonner son acquisition. En 1765, moins de trois mois après qu’on eut conclu avec Pondiac un traité dont l’un des buts était de dissiper les craintes des Indiens pour leurs terres, Johnson acheta quelque 40 000 acres aux Onneiouts. Dans tout ceci, il n’agissait pas autrement que des douzaines d’autres qui spéculaient sur les terres des Indiens. Il ne s’en distinguait que par les grands avantages qu’il tirait de sa fonction et de sa longue fréquentation des Indiens. Il fut à vrai dire l’un de leurs principaux exploiteurs ; mieux que tout ce qu’il a pu dire, ses actes parlent d’eux-mêmes. C’était le type même du fonctionnaire impérial, dans un domaine où il n’avait que peu de concurrents capables d’égaler son intelligence et son intérêt, combinaison qui était presque invincible au xviiie siècle.
Johnson avait une certaine curiosité intellectuelle : il amassa une collection considérable de livres et de revues et, à l’occasion, il acheta des instruments scientifiques. En janvier 1769, il fut élu membre de l’American Philosophical Society mais ne se rendit jamais aux réunions. Il appartenait aussi à la Society for the Promotion of Arts and Agriculture et au conseil d’administration de Queen’s College (Rutgers University, New Brunswick, New Jersey) quoiqu’il n’assistât jamais aux séances.
Rien n’indique que Johnson se soit jamais marié. Dans son testament, il reconnaissait pour son épouse Catherine Weissenberg (Wisenberg), travailleuse au pair qui s’était enfuie de chez son employeur de New York. Il vécut avec elle à partir de 1739, et, lorsqu’elle mourut, en avril 1759, ils avaient trois enfants. On pense qu’il cohabita avec un bon nombre d’Indiennes mais la liaison qui compta le plus pour lui, pour des raisons personnelles et politiques, fut celle qu’il eut avec Mary Brant [Koñwatsiˀtsiaiéñni]. Huit de leurs enfants lui survécurent.
Le plus ancien portrait de Johnson, achevé vers 1751 et attribué à John Wollaston, se trouve à l’Albany Institute of History and Art (Albany, N.Y.). Pour leur part, les APC conservent une miniature. La N.Y. Hist. Soc. possède une copie, faite en 1837 par Edward L. Mooney, d’un portrait exécuté en 1763 par Thomas McIlworth. Un quatrième portrait, peint en 1772 ou 1773 par Matthew Pratt, est exposé au Johnson Hall, où l’on peut également voir une statue de bronze commémorative.
Johnson apparaît dans plusieurs ouvrages de fiction et, de l’avis du spécialiste de Johnson, Milton W. Hamilton, ce sont les romans de Robert William Chambers qui « ont donné aux Américains leur seule conception de sir William ». Johnson a fait l’objet de plusieurs biographies, dont aucune ne lui rend justice. Les erreurs de la première. W. L. [et W. L.] Stone, The life and times of Sir William Johnson, bart. (2 vol., Albany. N. Y., 1865), ont été souvent répétées. La plus récente, M. W. Hamilton, Sir William Johnson, colonial American, 1715–1763 (Port Washington, N.Y., et Londres, 1976), apporte une information intéressante, mais comprend mal le trait dominant de la carrière de Johnson, ses relations avec les Indiens.
Le rôle de Johnson comme agent des Affaires indiennes ressort dans plusieurs monographies, dont les meilleures n’ont pas été publiées. Parmi les thèses, on peut noter, D. A. Armour, « The merchants of Albany, New York, 1686–1760 » (thèse de ph.d., Northwestern University, Evanston, Ill., 1965), en particulier le chap. IX ; C. R. Canedy, « An entrepreneurial history of the New York frontier, 1739–1776 » (thèse de ph.d., Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 1967), en particulier les chap. II et III ; E. P. Dugan, « Sir William Johnson’s land policy (1739–1770) » (thèse de m.a., Colgate University, Hamilton, N.Y., 1953) ; W. S. Dunn, « Western commerce, 1760–1774 » (thèse de ph.d., University of Wisconsin, Madison, 1971), en particulier le chap. V ; E. R. Fingerhut, « Assimilation of immigrants on the frontier of New York, 1764–1776 » (thèse de ph.d., Columbia University, New York, 1962) ; E. M. Fox, « William Johnson’s early career as a frontier landlord and trader » (thèse de m.a., Cornell University, Ithaca, N.Y., 1945) ; F. T. Inouye, « Sir William Johnson and the administration of the Northern Indian Department » (thèse de ph.d., University of Southern California, Los Angeles, 1951) ; D. S. McKeith, « The inadequacy of men and measures in English imperial history : Sir William Johnson and the New York politicians ; a case study » (thèse de ph.d., Syracuse University, Syracuse, N.Y., 1971) ; Peter Marshall, « Imperial régulation of American Indian affairs, 1763–1774 » (thèse de ph.d., Yale University, New Haven, Conn., 1959).
La plupart des manuscrits de Johnson ont été publiés dans Johnson papers (Sullivan et al.), publication dont le dernier éditeur, M. W. Hamilton, a également écrit un grand nombre de courts articles sur certains aspects de la vie de Johnson et sur diverses questions le concernant. D’autres collections de documents comportent un grand nombre de lettres de Johnson : The documentary, history of the state of New-York [...], E. B. O’Callaghan, édit. (4 vol., Albany, N.Y., 1849–1851) et NYCD (O’Callaghan et Fernow), en particulier les vol. VI–VIII. Un bon nombre de ses livres de comptes conservés à la Clements Library, Thomas Gage papers, et au PRO, AO 1 et T 64, sont encore inédits.
Deux autres études traitent de certains aspects de la vie de Johnson : F. J. Klingberg, « Sir William Johnson and the Society for the Propagation of the Gospel (1749–1774) », dans Anglican humanitarianism in colonial New York (Philadelphie, [1940]), 87–120 ; et Julian Gwyn, The enterprising admiral : the personal fortune of Admiral Sir Peter Warren (Montréal, 1974), qui traite des relations de Johnson avec son oncle. [j. g.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Julian Gwyn, « JOHNSON, sir WILLIAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/johnson_william_4F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/johnson_william_4F.html |
| Auteur de l'article: | Julian Gwyn |
| Titre de l'article: | JOHNSON, sir WILLIAM |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1980 |
| Année de la révision: | 1980 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |