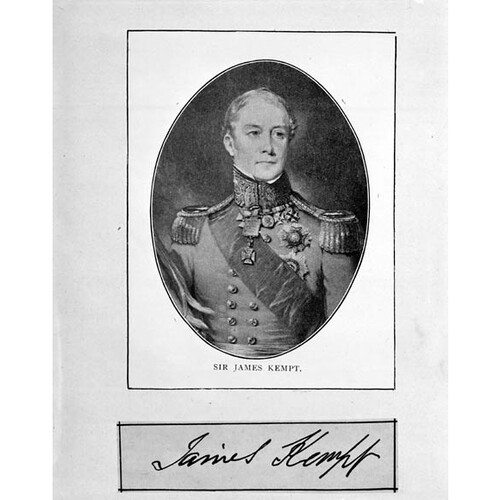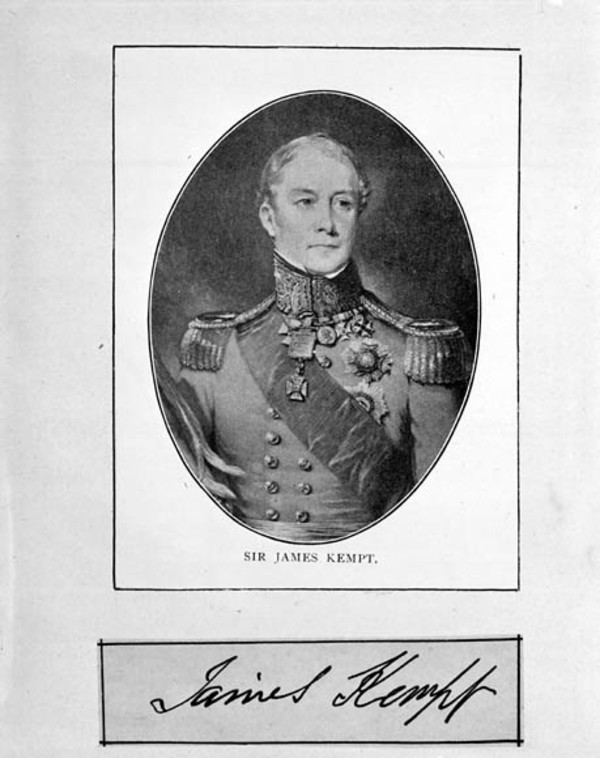
Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2935395
KEMPT, sir JAMES, officier et administrateur colonial, né vers 1765 à Édimbourg, fils de Gavin Kempt et d’une fille d’Alexander Walker, d’Édimbourg ; décédé célibataire le 20 décembre 1854 à Londres.
On ne sait rien des premières années de James Kempt. En mars 1783, il reçut une commission d’enseigne dans le Iole d’infanterie et devint lieutenant en août 1784. Lorsque son régiment fut licencié, l’année suivante, il fut mis à la demi-solde et le demeura jusqu’en 1794, au moment où furent publiées ses nominations aux grades de capitaine, puis de major du 113e d’infanterie, qui venait d’être levé. Après le licenciement de ce régiment, il servit pendant quelque temps à Glasgow comme officier supérieur de visite du recrutement, mais fut remis à la demi-solde en 1796. Trois ans plus tard, à titre de lieutenant-colonel sans affectation, il fut nommé aide de camp de sir Ralph Abercromby, commandant des troupes de la Grande-Bretagne du Nord (Écosse), qu’il accompagna avec des corps expéditionnaires en Hollande, puis en Méditerranée. À la mort d’Abercromby, survenue à Alexandrie en 1801, Kempt fut affecté à l’état-major de lord Hutchinson et participa à toute la campagne d’Égypte. En 1803, il devint aide de camp du général David Dundas, commandant en chef du district de Southern, en Angleterre, dont le quartier général se trouvait à Chatham ; plus tard dans l’année, il fut nommé lieutenant-colonel du 81e d’infanterie, avec lequel il suivit sir James Henry Craig* en Méditerranée en 1805. De 1807 à 1811, Kempt fut quartier-maître général en Amérique du Nord britannique et, en 1809, il fut promu colonel. En 1811, il fut muté au sein de l’état-major du duc de Wellington, dans la péninsule Ibérique, avec le grade de major général. Grièvement blessé à la bataille de Badajoz, il se distingua par sa bravoure pendant les campagnes de 1813 et de 1814 en Espagne et en France. À l’été de 1814, il commandait l’une des quatre brigades qui furent envoyées de Bordeaux pour renforcer l’armée britannique dans le Haut et le Bas-Canada ; ses hommes servirent dans le district de Montréal, sur la frontière du Niagara et à Kingston. Rappelé en Europe parce que Napoléon s’était enfui de l’île d’Elbe, il commanda la 8e brigade à la bataille de Waterloo.
En reconnaissance de ses éminents services durant les guerres napoléoniennes, Kempt reçut une série de distinctions : la croix de chevalier commandeur de l’ordre du Bain et la grand-croix de l’ordre du Bain en 1815, la grand-croix de l’ordre des Guelfes en 1816 et de nombreuses décorations étrangères. Depuis 1813, il était lieutenant-gouverneur de la garnison de Fort William, en Écosse, et, en 1819, il fut nommé lieutenant-gouverneur de Portsmouth, en Angleterre. Il fut successivement colonel du 60e d’infanterie (1813), du 3rd West India Regiment (1818), du 81e d’infanterie (1819) et du 40e d’infanterie (1829). Il fut promu lieutenant général en 1825 et général en 1841.
Comme tant d’autres officiers de Wellington, Kempt allait, après les guerres napoléoniennes, poursuivre sa carrière dans les colonies. En février 1819, il demanda une affectation militaire à Halifax, mais, à l’automne, lord Dalhousie [Ramsay*] ayant été élevé au rang de gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, on lui offrit le poste de lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Ne connaissant ni la province, ni ses habitants, ni son gouvernement, Kempt profita de son amitié avec Dalhousie – ils avaient servi ensemble en Espagne – pour lui écrire sans délai afin de se renseigner et de demander conseil. En juin 1820, dans une esquisse de la politique néo-écossaise, qui allait être suivie de dix ans de correspondance entre les deux hommes, Dalhousie prévint Kempt de l’imminence de désaccords politiques. Le mandat de Dalhousie s’était en général déroulé dans le calme, mais, pendant sa dernière session, l’Assemblée avait revendiqué des droits supplémentaires, surtout sur l’affectation des revenus de la couronne, au détriment des prérogatives royales et des pouvoirs du Conseil de la Nouvelle-Écosse. Dans ce contexte, les relations de Dalhousie et du président de la chambre, Simon Bradstreet Robie, s’étaient détériorées au point que le lieutenant-gouverneur avait résolu de ne plus accepter désormais à la présidence « un crabe imbu de principes yankees ». Dans son journal, Dalhousie prédisait un pénible affrontement « à moins que sir James Kempt ne prenne avec fermeté les mesures que [lui-même] aurai[t] prises s’ [il] étai[t] demeuré là ». Kempt, quelque peu écrasé par l’ampleur de la tâche qu’il avait acceptée, entama son mandat avec l’intention avouée de suivre les traces de Dalhousie et de s’inspirer de ses idées et de ses politiques. Mais, heureusement pour le climat qui prévalut durant son mandat en Nouvelle-Écosse, et plus tard dans le Bas-Canada, tout comme pour sa propre tranquillité d’esprit, il se montra plus conciliant que ne l’était instinctivement son mentor, presbytérien susceptible, lorsque des hommes politiques rusés et ambitieux des colonies le défiaient. Même si Kempt et Dalhousie avaient une conception de l’administration coloniale qui se ressemblait, leur tempérament opposé allait, en pratique, faire toute la différence.
Peu après son arrivée en Nouvelle-Écosse, le 1er juin 1820, Kempt se rendit au Cap-Breton afin de proclamer la réunion de cette colonie à la partie continentale de la province. Le gouvernement britannique avait opté pour une nouvelle annexion, y voyant le meilleur moyen de mettre un terme au chaos administratif des dernières décennies et de donner au gouvernement de l’île des fondements plus solides et tout à fait légaux [V. George Robert Ainslie*]. Cette réunification entraîna aussi une modification des modalités de location des mines de charbon du Cap-Breton et, en 1826, tous les droits miniers de la Nouvelle-Écosse furent pris en charge par la General Mining Association de Londres, ce qui allait se révéler bénéfique pour l’économie de la province, sinon pour les revenus de la couronne [V. Richard Smith*]. Les questions financières étaient de nature à susciter des controverses mais, au grand soulagement et à la grande satisfaction de Kempt, les sessions de la chambre d’Assemblée, au début des années 1820, se déroulèrent dans un climat plus tempéré et plus harmonieux qu’il ne l’aurait cru. D’abord, il attribua cette détente à la semonce que Dalhousie avait faite à l’Assemblée avant de partir, mais, en entretenant des relations cordiales avec le président Robie, Kempt lui-même contribua encore davantage à faciliter la conduite des affaires publiques. Pendant plusieurs années, l’Assemblée vota les subsides sans se plaindre et sans défier le pouvoir de l’exécutif sur les revenus de la couronne. Kempt ne s’attendait pourtant pas à ce que cela dure. Ainsi, en janvier 1821, dans une lettre à Dalhousie, il reconnaissait que « l’humeur de tels organismes [était] très changeante, et [que] leur but constant [était] de saisir le pouvoir et d’empiéter sur les droits et privilèges des autres branches du corps législatif ».
Pour l’instant du moins, l’énergie des habitants semblait passer tout entière dans les controverses religieuses. Cela était particulièrement évident dans le domaine de l’éducation supérieure, qui mettait en cause tant des questions confessionnelles que des questions financières. Non seulement le King’s College, établissement anglican de Windsor, était-il déchiré par une vieille et inconvenante querelle personnelle entre le directeur, Charles Porter*, et son adjoint, William Cochran*, mais l’édifice même se trouvait dans un état de délabrement avancé en raison d’un manque de fonds. Comme il fallait réunir £30 000 pour construire un nouvel édifice et engager d’autres professeurs, le révérend John Inglis*, vicaire général, lança avec optimisme ce que Kempt qualifia en décembre 1821 de vaste « campagne de mendicité » pour recueillir cette forte somme en Angleterre. Afin de briser le monopole anglican sur l’instruction supérieure, Dalhousie avait fortement contribué à établir à Halifax un collège non confessionnel qui portait son nom, mais les ressources financières manquaient pour en achever la construction et même pour obtenir une charte royale. En 1823, les dettes du collège s’élevaient à £5 000. Une troisième maison d’enseignement, la Pictou Academy, fondée par le révérend Thomas McCulloch* et les presbytériens, tentait aussi d’obtenir quelque partie des fonds qui pourraient provenir des revenus de la couronne ou des crédits votés par l’Assemblée. En 1821, celle-ci avait voté £1 000 pour la construction du Dalhousie College, et Kempt pressait régulièrement le secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst, d’autoriser le versement d’une autre somme de £1 000, prélevée sur les revenus de location des mines de charbon de la province. Mais Bathurst, anglican dévoué, refusait avec entêtement de sanctionner quelque versement que ce soit au Dalhousie College. « Attristé et mortifié » par cette décision, Kempt blâma les intrigues de l’évêque de la Nouvelle-Écosse, Robert Stanser*, « qui [était] encore dans la métropole, profitant de son salaire mais demeurant dans l’oisiveté lorsqu’il s’agi[ssait] des devoirs rattachés à ses fonctions sacrées », et de John Inglis, « un des plus sournois et des plus obstinés des hommes ».
Kempt en arriva bientôt à la conclusion que, dans les circonstances, la solution la plus efficace et la plus économique consistait à réunir le Dalhousie College et le King’s College, mais il ne voyait pas encore comment cela pourrait se réaliser. Il n’y avait pas assez de fonds pour deux établissements distincts et, selon Kempt, un seul collège, à Halifax, suffirait à tous les besoins de la Nouvelle-Écosse pendant les années à venir. Même si quelques partisans du King’s College s’opposaient à son transfert dans une ville populeuse, source d’influences supposément maléfiques, Inglis et la majorité des membres du conseil d’administration du collège convenaient dès 1823 que la fusion était le meilleur moyen de sortir de leur situation précaire. Des représentants des deux maisons d’enseignement mirent en 1824 la dernière main à un plan d’unification qui devait sauvegarder leurs intérêts respectifs. L’administration et l’enseignement relèveraient des anglicans, mais seuls les étudiants de théologie seraient appelés à témoigner de leur appartenance à l’Église d’Angleterre.
Pour Kempt, il ne faisait pas de doute qu’un arrangement aussi raisonnable et aussi acceptable pour toutes les parties serait approuvé par le secrétaire d’État aux Colonies et par l’archevêque de Cantorbéry, Charles Manners-Sutton. Mais c’était oublier l’assurance avec laquelle ce représentant de la high church exerçait son autorité au sein de l’Église d’Angleterre. Son veto fut sans appel. Kempt ne put rien faire, même en se rendant à Londres, pour tempérer « l’abominable obstination ou plutôt la bigoterie de l’archevêque de Cantorbéry » ni pour amener Bathurst à adoucir sa position. L’échec de la fusion, signalait Kempt à Dalhousie en juillet 1825, allait être « un grand triomphe pour MacCulloch et sa bande », et il devait perpétuer la rivalité entre les collèges confessionnels de la Nouvelle-Écosse, au détriment de l’instruction publique.
De mai 1824 à août 1825, Kempt prit un congé en Angleterre, où il s’occupa de ses affaires personnelles. Quand il rentra en Nouvelle-Écosse, le gouvernement britannique avait décidé, en dépit de ses avertissements, de demander aux assemblées des colonies de l’Amérique du Nord de voter une liste civile couvrant les salaires des principaux fonctionnaires pour plusieurs années. Tout comme ses conseillers et les partisans de l’autorité de l’exécutif, Kempt doutait qu’il soit sage de soulever la question hautement litigieuse de l’affectation des fonds. Si les pouvoirs de l’Assemblée étaient accrus de cette façon et si le contrôle des revenus de la couronne était cédé en échange d’une liste civile, l’établissement des salaires du lieutenant-gouverneur et des fonctionnaires civils dépendrait en fait du bon vouloir de l’Assemblée. Le ministère des Colonies, prédisait Kempt, aurait alors dix fois plus de difficultés à faire voter chaque année les subsides et susciterait en Nouvelle-Écosse des querelles semblables à celles qui agitaient alors les Canadas, gouvernés par Dalhousie. En même temps, maintenait-il, si la proposition devait absolument être faite, elle devait l’être seulement dans des circonstances qui lui garantiraient un accueil favorable. Or, pendant la session de 1826, les députés de la Nouvelle-Écosse se préoccupaient des prochaines élections générales, de sorte qu’ils n’étaient pas prêts à étudier objectivement une question aussi controversée. C’est pourquoi Kempt se contenta d’y faire brièvement allusion dans son discours d’ouverture de la session, en février 1826 : « J’en ai glissé un mot, aussi discrètement que possible », annonça-t-il à Dalhousie. Ses successeurs hériteraient de cette épineuse question.
Pour justifier encore davantage la prudence avec laquelle il abordait les questions financières, Kempt invoquait les modifications apportées depuis peu aux lois impériales sur le commerce et dont il fallait attendre qu’elles aient produit en Nouvelle-Écosse les effets bénéfiques escomptés. En 1825, on avait réduit les restrictions imposées au commerce des colonies britanniques avec les États-Unis, l’Europe et les Antilles, ce qui allait probablement stimuler l’économie de la province, qui se relevait à peine de la longue dépression d’après-guerre. Au moment de cette reprise, l’Assemblée serait peut-être mieux disposée à voter une liste civile. Il est certain que, pendant le mandat de Kempt, des indices non équivoques d’une reprise des activités commerciales se manifestaient. Ainsi, la Halifax Banking Company fut créée en 1825 par Henry Hezekiah Cogswell et d’autres, tandis que les travaux d’un projet ambitieux et coûteux, le canal, Shubenacadie, commencèrent l’année suivante. Autant valait pour Kempt se satisfaire de cet optimisme croissant. Le climat était bon ; on n’en était pas encore aux années 1830, qui verraient Joseph Howe* soulever de l’agitation en faveur de réformes politiques. Kempt lui-même était aimé et respecté de tous ; comme le notait Howe sur un ton approbateur, c’était un homme qui « a[vait] une passion pour la construction des routes et pour les jolies femmes ». Quant à l’un de ses aides de camp, il rappela plus tard que « la vie mondaine, par la force de son exemple, était la plus agréable des choses que l’on ait pu imaginer », tout en signalant qu’il était « parfaitement estomaqué » par les talents d’administrateur de Kempt.
Au printemps de 1828, Kempt fut temporairement affecté à une mission militaire spéciale, la présidence d’une commission d’enquête sur la construction du canal Rideau, dans le Haut-Canada. À juste titre, les autorités londoniennes s’inquiétaient fortement des coûts croissants de l’entreprise, des contrats illimités passés par l’ingénieur en chef, le lieutenant-colonel John By*, et de ce qu’il en coûterait à la fin pour terminer ce que les militaires considéraient encore comme un atout important pour la défense de l’Amérique du Nord britannique. S’appuyant sur ce que Dalhousie lui avait appris en confidence à ce sujet, Kempt estimait que le gouvernement britannique avait sanctionné les travaux trop précipitamment, avant d’avoir reçu des estimations fiables de leur coût total. Si c’était le cas, on ne serait nullement justifié de blâmer By parce que ses dépenses excédaient de loin les piètres calculs préliminaires. Kempt ne voyait pas non plus pourquoi on réunissait une commission d’enquête alors que By pouvait fort bien envoyer dans la métropole toutes les explications demandées. Mais il espérait aussi éviter un long et épuisant voyage. Sa santé n’avait pas été bonne et, comme un accès de claudication, hérité d’une vieille blessure, l’avait confiné dans sa résidence officielle pendant presque tout l’hiver précédent, il se plaignit en juin de ce que ses « jambes n’[aient] absolument pas [été] en état de partir en campagne ». Néanmoins, la commission était obligée de faire ce mois-là une inspection rapide de l’emplacement du canal. Passant jusqu’à 17 heures par jour sur les terrains accidentés qui séparaient Bytown (Ottawa) de Kingston, et ce par une chaleur accablante, Kempt connut des souffrances et un épuisement plus grands que jamais auparavant dans sa vie de soldat. « Merci mon Dieu, s’exclama-t-il en arrivant à Kingston, me voilà enfin de nouveau en terre chrétienne, hors du pays des marécages et des moustiques. » Dans son rapport, la commission fit plusieurs recommandations qui échouèrent de façon notoire à freiner l’escalade des coûts et la prodigalité avec laquelle By continuait de dépenser l’argent des contribuables britanniques.
Une fois sa tâche terminée, Kempt s’attendait à rentrer en Nouvelle-Écosse pour y terminer tranquillement son mandat de lieutenant-gouverneur. Mais les événements de Québec et de Londres allaient bientôt entraîner sa mutation dans le Bas-Canada. Depuis 1825, prévoyant qu’il pourrait fort bien être désigné à la succession de Dalhousie comme gouverneur en chef, il répétait à ses supérieurs qu’il se trouvait très bien à Halifax et n’avait nul désir d’être affecté dans les Canadas. « Je suis attristé, signala-t-il de manière caractéristique à Dalhousie en mars 1827, profondément attristé de vous entendre évoquer la possibilité que je prenne bientôt votre place au Canada [...] Je vous assure le plus solennellement du monde qu’un transfert au Canada est le dernier de mes vœux. » Néanmoins, à l’automne de 1827, il écrivit au secrétaire d’État aux Colonies, William Huskisson, pour lui demander s’il pourrait obtenir le haut commandement des troupes de l’Amérique du Nord dans l’éventualité où, comme le voulait la rumeur, Dalhousie serait muté en Inde. Kempt pensait occuper cet important poste militaire tout en demeurant lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse et ce, en transférant de Québec à Halifax le quartier général de l’armée. L’opposition des autorités militaires de Londres entraîna le rejet de cette proposition, mais, en mai 1828, constatant la rapide détérioration des relations entre Dalhousie et l’Assemblée du Bas-Canada, Huskisson se mit à envisager la nomination de Kempt au poste de gouverneur en chef. Ce printemps-là, parvinrent en Grande-Bretagne d’importantes pétitions exposant les griefs de l’Assemblée et contenant de sérieuses accusations contre le gouvernement de Dalhousie. Lorsque ces documents, en même temps qu’une série de protestations des réformistes du Haut-Canada, retinrent l’attention des critiques du cabinet du duc de Wellington à la chambre des Communes, Huskisson jugea sage de concéder la création d’un comité spécial qui se pencherait sur le gouvernement civil des Canadas. Au début de 1828, Dalhousie fut nommé pour commander les troupes britanniques en Inde et Kempt fut invité à restaurer le calme et l’harmonie dans la colonie bouleversée, tâche à laquelle il s’attellerait à la fin de l’été.
Sir James n’accueillit pas avec enthousiasme la nouvelle de sa nomination. Pourtant, en juillet 1828, Dalhousie notait dans son journal : « Je sais bien qu’il se serait senti blessé s’il avait été évincé par quelqu’un d’autre. » Néanmoins, l’offre ne représentait pas pour Kempt une promotion convoitée. En dépit de son titre plus prestigieux, avançait-il, le gouverneur en chef n’avait pas, en pratique, plus d’importance qu’un lieutenant-gouverneur et ne gagnait pas davantage. En outre, la rigueur du climat nord-américain avait nui à sa santé et il en avait assez d’être administrateur colonial. Il était alors « impatient d’avoir deux ou trois années [...] pour se promener sur le continent » et satisfaire un vieux désir de visiter la Suisse et l’Italie. Il accepta le poste de mauvais gré, uniquement par sens du devoir, et en soulignant que rien ne le convaincrait de demeurer plus de deux ans à Québec.
La crise politique avait en effet atteint des proportions considérables dans le Bas-Canada et le prédécesseur de Kempt lui avait laissé entrevoir une lutte interminable contre une chambre d’Assemblée excitable et réfractaire. Depuis des années, la Chambre basse tentait d’étendre ses pouvoirs politiques au détriment de l’exécutif en cherchant à obtenir un droit de regard sur tous les revenus prélevés dans la colonie [V. Denis-Benjamin Viger*]. Comme l’Assemblée refusait de voter une liste civile permanente, les gouverneurs qui s’étaient succédé avaient essayé de préserver l’intégrité des revenus de la couronne et de rédiger les projets de loi annuels de finances pour qu’ils ne contiennent aucune reconnaissance tacite des prétentions que l’Assemblée avait sur ces revenus. Toutefois, pendant que Dalhousie s’était absenté pour se rendre en Grande-Bretagne, en 1824–1825, son remplaçant, sir Francis Nathaniel Burton*, se rendant à une demande rejetée jusqu’alors, avait accepté de l’Assemblée un projet de loi de finances qui rassemblait en un seul fonds public les revenus de la couronne et d’autres revenus et qui prévoyait l’affectation d’une somme globale au paiement des dépenses du gouvernement pendant un an. Le projet de loi avait été endossé par le Conseil législatif et accepté, après quelques protestations, par les autorités londoniennes. À son retour, en 1826, Dalhousie s’était vu présenter une mesure semblable. Il l’avait rejetée en alléguant qu’elle empiétait sur les prérogatives de la couronne. Ayant placé la question des subsides dans une impasse, il avait illégalement puisé dans les fonds de la province pour combler le déficit budgétaire. Ses relations avec l’Assemblée s’étaient encore aigries lorsqu’en 1827 il était intervenu vigoureusement et de façon partisane dans les élections.
En dépit de l’impasse constitutionnelle créée par Dalhousie, Kempt aborda son rôle avec une certaine équanimité, sinon avec une confiance que son prédécesseur considéra comme des plus irréalistes. Tout en reconnaissant que l’« expérience [de Kempt] dans ces Parlements coloniaux lui permet[tait] de juger de l’état des querelles », Dalhousie précisait dans son journal en juillet 1828 : « il ne voit pas clairement la différence qui existe entre le régime bien adapté de la Nouvelle-Écosse, qui le met en présence d’hommes raisonnables, sensés et respectables, et l’état de ces questions dans le Canada, que je n’hésiterais pas à qualifier de tout à fait contraire ». Sir James espérait cependant que, grâce à de nouvelles instructions du ministère des Colonies, il traverserait ces difficultés immédiates et que le Parlement britannique fournirait bientôt une solution permanente aux points en litige.
Les attentes de Kempt seraient déçues et, durant son court mandat, il serait laissé à peu près exclusivement à lui-même. Les instructions qu’il recevait périodiquement de Londres étaient rédigées en termes vagues et contradictoires, signe du trouble et de l’indécision qui gagnaient les ministres britanniques lorsqu’ils étudiaient les affaires canadiennes. Au moins William Huskisson reconnaissait-il que les méthodes de Dalhousie avaient été peu avisées et dangereuses et qu’elles ne devaient pas être imitées. « Je suis certain, avait-il expliqué à Kempt en mai 1828, que vous connaissez trop bien l’humanité pour ne pas savoir que les gouvernements qui comprennent des représentants du peuple ne peuvent être manœuvrés comme un bataillon à la parade. » Il insistait aussi sur la nécessité absolue de traiter l’Assemblée du Bas-Canada avec mesure et tact. Mais Huskisson, puis son successeur au ministère des Colonies, sir George Murray*, refusaient d’envoyer des instructions plus explicites à Kempt avant que le comité spécial chargé d’enquêter sur le gouvernement civil des Canadas n’ait avisé leur ministère du meilleur parti à prendre pour régler les controverses. C’est aussi pour cette raison que, en juillet, Kempt reçut un mandat temporaire de gouverneur du Bas-Canada et qu’on lui promit un nouveau mandat de gouverneur en chef et de nouvelles instructions dès que le comité aurait remis son rapport – engagement qui, à sa grande déception, ne fut jamais tenu. Il quitta Halifax en août 1828 afin de pouvoir entrer en fonction après le départ de Dalhousie pour l’Angleterre, au début du mois suivant.
Même une fois que le comité eut terminé ses travaux, plus tard dans l’été, la politique impériale continua d’être paralysée par l’irrésolution. Le cabinet de Wellington n’était pas bien disposé envers un rapport qui, à son grand embarras, maintenait les plaintes des coloniaux sur presque tous les points et faisait des recommandations dont l’application diminuerait encore davantage l’indépendance de l’exécutif et transférerait le pouvoir effectif aux assemblées, c’est-à-dire, dans le Bas-Canada, au parti patriote [V. Louis-Joseph Papineau*]. En même temps, des considérations de politique intérieure empêchaient les ministres de répudier ouvertement les conclusions du comité, qui avaient été bien accueillies par les Communes. Préoccupés par l’émancipation des catholiques et par d’autres problèmes affligeant la Grande-Bretagne, ils tergiversaient, laissant Kempt se débattre avec les instructions les plus déconcertantes et les plus obscures qu’un gouverneur ait jamais reçues.
Dès le début, Kempt considéra que sa tâche première était de maintenir la paix en agissant avec prudence et patience. Ayant compris les erreurs de Dalhousie, il s’abstint d’exprimer des opinions personnelles et écouta attentivement toutes les parties, Papineau compris. Finalement, Kempt se fia au meilleur de son jugement parce qu’il estimait ne pouvoir compter sur aucun fonctionnaire dans cette colonie déchirée par les disputes politiques et les animosités personnelles. « Je découvre avec surprise et regret, faisait-il remarquer à Dalhousie en mai 1829, qu’il ne se trouve à peu près pas deux hommes publics qui aient les mêmes opinions et les mêmes sentiments à propos de quelque question politique et même à propos de quelque question d’intérêt général ! » Dans ce contexte, expliqua-t-il à Murray, sa position était la suivante : « j’essaie de gouverner sans me lier à aucun parti et de les concilier tous [...] mais aucune réforme réelle d’aucune sorte, je le crains, ne pourra avoir lieu avant que les querelles financières n’aient été définitivement réglées ». Ce règlement, il l’attendait avec impatience des ministres britanniques.
D’ici là, Kempt devait se rabattre sur des expédients temporaires et des concessions politiques afin de tenter de maintenir à flot le gouvernement de la colonie et de préserver des relations tolérables entre les conseils et l’Assemblée. C’était une « tâche très pénible et laborieuse », concédait Kempt à Dalhousie en février 1849, mais il avait « fermement résolu de ne pas [s’]engager dans une querelle personnelle avec aucune des branches du pouvoir législatif ». En cela, il fut aidé par l’atmosphère des deux chambres. Nombre de députés du parti des bureaucrates, comme le juge en chef Jonathan Sewell* et Herman Witsius Ryland*, concluaient du rapport du comité spécial que le conservatisme rigide traditionnellement pratiqué par le Conseil législatif était tombé en défaveur en Angleterre et que, pour conserver leur influence, ils devaient maintenant coopérer prudemment avec l’Assemblée. Quant à celle-ci, elle se trouvait temporairement dans un état d’esprit plus accommodant en raison du contenu imprévisiblement favorable du rapport et était disposée à collaborer avec un gouverneur dont l’équité évidente commandait le respect.
Quand, en novembre 1828, Kempt rencontra l’Assemblée, prorogée 18 mois plus tôt par Dalhousie « dans des circonstances très particulières », il conçut une formule acceptable par toutes les parties pour confirmer sans réélection Louis-Joseph Papineau comme président, même si celui-ci avait auparavant été rejeté par Dalhousie. Lorsque, par la suite, sir George Murray souligna que cette façon de procéder n’était pas conforme à ses instructions, Kempt signa la première d’une série de lettres dans lesquelles il déplorait le peu de considération que ses supérieurs accordaient aux efforts qu’il tentait dans des circonstances difficiles. Mais bientôt, en acceptant le projet de loi de finances de 1829, le gouverneur déclencha une plus grande controverse. Selon les instructions données par Murray en septembre précédent, on autoriserait l’Assemblée, pour une année au moins, à rédiger un projet de loi de finances permettant de couvrir la forte proportion des dépenses du gouvernement civil qui ne pouvaient pas être épongées au moyen des revenus de la couronne. De plus, ces instructions reconnaissaient explicitement la faiblesse de la position du gouverneur en matière financière. « Aussi longtemps que l’Assemblée aura à assurer ou à réglementer quelque partie des dépenses publiques, concédait Murray, elle en viendra virtuellement à gagner une autorité sur l’ensemble. » Étant donné l’insuffisance des revenus de la couronne, l’exécutif « ne [pouvait] pas être libéré par quelque moyen constitutionnel d’un état de dépendance pécuniaire virtuelle envers l’Assemblée ».
Fort de cet aveu franc, que Kempt citerait plus tard lorsqu’il serait accusé d’avoir désobéi aux instructions, le gouverneur parvint à obtenir de l’Assemblée un projet de loi de finances qui fut accepté par le Conseil législatif grâce à un expédient extraordinaire – le juge en chef, en tant que président du conseil, exerçant son double droit de vote. Comme le projet était d’une forme semblable à celui de 1825, que le ministère des Colonies avait désapprouvé, l’initiative de Kempt sema la consternation à Londres. Les ministres tories échangèrent des messages inquiets, on parla de refuser de sanctionner la mesure, mais, au bout du compte, des opinions plus modérées prévalurent et, avec des expressions consolantes de regret qui n’équivalaient pas à une véritable censure, Kempt fut autorisé à accepter un projet semblable en 1830. À court terme, les travaux de 1829 et de 1830 permirent à Kempt d’établir des relations harmonieuses avec l’Assemblée en matière de finances. Mais le fait de voir que sa conception de la forme des projets de loi de finances était acceptée encouragea simplement l’Assemblée à se montrer plus audacieuse et à réclamer, ce qui était encore plus controversé, la responsabilité de l’affectation de tous les revenus de la couronne.
Cet arrangement financier ne fut pas la seule mauvaise surprise que Kempt fit à ses supérieurs. En 1829, l’Assemblée décida sans prévenir de corriger les inégalités du système de représentation du Bas-Canada en redistribuant en fonction de la population les sièges d’une chambre élargie. On ne tint pas compte des protestations des députés anglophones, mais le Conseil législatif amenda le projet de loi en s’appuyant sur un double critère – l’étendue du territoire et la population – et la Chambre basse accepta cet amendement. De l’avis de Kempt, cette mesure était la meilleure qui ait jamais pu être obtenue de l’Assemblée, mais cette initiative coloniale dans un domaine controversé sema de nouveau la consternation à Londres. Quelques ministres insistèrent pour que la loi soit révoquée, car les habitants anglophones des Cantons-de-l’Est, même s’ils avaient des sièges pour la première fois, seraient fortement sous-représentés dans une Assemblée dont les membres, passant de 50 à 84, comprendraient sûrement une plus forte proportion de Canadiens français. Toutefois, lors d’une réunion extraordinaire, le cabinet britannique approuva la loi, quoique de mauvais gré, et, en août 1829, Murray informa Kempt de cette décision.
À ce moment, sinon auparavant, Kempt avait compris qu’il obtiendrait peu d’indications utiles de la Grande-Bretagne sur la manière de traiter avec l’Assemblée du Bas-Canada. De nombreuses dépêches publiques demeuraient sans réponse et, tentant d’établir personnellement avec Murray des communications confidentielles, Kempt, comme il le confiait à Dalhousie en août 1830, n’avait reçu que « quelques lignes écrites en toute hâte par le sous-secrétaire qui, de toute évidence, n’a[vait] pas la moindre connaissance du sujet qu’il abordait ! ! ! » Entre-temps, la Grande-Bretagne avait connu deux sessions parlementaires qui n’avaient rien donné. En 1829, puis de nouveau en 1830, un projet de loi avait bien été présenté aux Communes pour régler le différend financier dans le Haut et le Bas-Canada ; il proposait de céder aux deux Assemblées le contrôle des revenus prélevés en vertu de la loi de Québec sur le revenu, votée en 1774, en échange de listes civiles, mais Kempt n’en connaissait absolument pas le contenu. Sans aide ni avis du gouvernement impérial, il se consacra tout entier à calmer les passions politiques lorsqu’en 1830 l’Assemblée tenta de nouveau, avec violence, d’obtenir une réforme judiciaire et des conseils électifs [V. Denis-Benjamin Viger]. « Mes corps législatifs sont composés de matériaux si inflammables, déclara en mars le gouverneur harassé, que j’ai l’impression d’être assis sur un baril de poudre et que je ne sais jamais à quel moment une explosion surviendra. » Il tenta d’agir en médiateur, conservant son indépendance et son sang-froid. « Mon grand objectif, dit-il à Dalhousie, a été de faire fonctionner le gouvernement, si possible sans réaction d’aucune sorte, et je l’ai atteint dans une certaine mesure. » Impatient de s’échapper de sa position inconfortable, il rappela en juillet au secrétaire d’État aux Colonies qu’il souhaitait rentrer en Angleterre au plus tard à l’automne. Murray tenta de le dissuader de démissionner en invoquant autant ses intérêts que ceux de la chose publique. Mais, après avoir été administrateur colonial pendant plus de dix ans et avoir passé presque toute sa vie professionnelle outre-mer, Kempt affirmait : « Je suis arrivé à un moment de la vie où je suis passablement en mesure de juger de ce qui convient le mieux à mes intérêts personnels. » Aucun homme, croyait-il, « n’a[vait] jamais abandonné un poste de £8 000 par an avec une plus grande satisfaction que [lui] ». Sa démission fut acceptée et, le 20 octobre 1830, il passa ses pouvoirs à lord Aylmer [Whitworth-Aylmer*].
Kempt pouvait être fier de son mandat. Pendant deux ans, il avait réussi une tâche presque impossible, préserver dans le Bas-Canada un certain degré d’harmonie et de bonne entente. Les ministres britanniques pouvaient maugréer contre les écarts regrettables qu’il avait commis à plusieurs reprises en ne suivant pas les instructions à la lettre, il était tout de même reconnu comme l’unique gouverneur en chef à avoir eu quelque succès dans l’administration des affaires canadiennes. Cette réussite singulière peut être attribuée en partie à des qualités de tempérament et de personnalité et en partie à une approche résolument non partisane de la politique provinciale. Bien qu’il ait été un Écossais austère à l’attitude parfois brusque et irritante, il déploya suffisamment de tact et de jugement pour gagner le respect des coloniaux de tendances et d’opinions diverses. En outre, l’absence d’instructions précises, loin d’être un handicap, lui donna une latitude qu’il employa à bon escient.
Kempt eut aussi une chance exceptionnelle. Il bénéficia des effets salutaires que le rapport du comité spécial chargé d’enquêter sur le gouvernement civil des Canadas eut dans le Bas-Canada, tout comme du contraste, inévitablement favorable, qui le distinguait de son infortuné prédécesseur. Ces circonstances fortuites déformèrent peut-être ses réalisations. Quand, en août 1837, on proposa de nouveau la candidature de Kempt au poste de gouverneur en chef des Canadas, lord Howick, alors secrétaire d’État à la Guerre dans le cabinet de lord Melbourne, déclara : « J’ai toujours pensé que sa réputation excédait ses mérites car, je crois, il l’a acquise dans une large mesure parce qu’il a eu la bonne fortune de quitter le Canada au bon moment et d’avoir, comme prédécesseur et comme successeur, des personnes à côté desquelles il brillait. » Ce jugement n’est pas dépourvu de vérité. Il est certain que l’« ère de bonne entente » que lui et les ministres tories – ceux-ci par leurs tergiversations – contribuèrent à créer dans le Bas-Canada entre 1828 et 1830 ne régla nullement le fond des querelles. Au contraire, cet intermède ne fit qu’accumuler des problèmes auxquels leurs successeurs respectifs auraient à faire face au début des années 1830.
À titre de gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, Kempt ne s’occupa guère du Haut-Canada, laissant avec plaisir les affaires de cette province au lieutenant-gouverneur, sir John Colborne*, avec qui il avait servi pendant les guerres napoléoniennes. Mais, comme il avait la responsabilité globale de la défense et des affaires indiennes dans les deux provinces, il put laisser libre cours à son enthousiasme constant pour les travaux de voirie en construisant une route militaire entre York (Toronto) et Penetanguishene. De plus, de concert avec Colborne, il réorganisa le département des Affaires indiennes et lui donna de nouvelles orientations, surtout en créant en 1830 un département distinct dans le Haut-Canada et en transférant la supervision des autorités militaires aux autorités civiles [V. James Givins*]. À un moment où il tardait au gouvernement britannique de réduire ses dépenses dans les Canadas, Kempt avança que la pratique coûteuse qui consistait à distribuer des présents et des marchandises aux tribus indiennes pour conserver leur amitié ne pouvait pas encore être abandonnée sans risque, mais qu’elle pourrait finir par devenir superflue si l’on encourageait les Indiens à s’établir dans des villages. Ainsi, leur situation matérielle s’améliorerait et, à long terme, ils formeraient des communautés agricoles autosuffisantes ; de plus, on les civiliserait en leur enseignant la religion et l’agriculture. Représenté par un surintendant dans chaque district du département des Affaires indiennes, pensait Kempt, le gouvernement rassemblerait les Indiens sur des terres défrichées et leur fournirait des maisons ainsi que les instruments aratoires et le bétail dont ils auraient besoin au début. Il espérait favoriser les activités des missionnaires anglicans et wesleyens britanniques, qui contreraient aussi l’influence néfaste des méthodistes américains parmi les Indiens [V. William Case]. Comme nombre de ses contemporains bien intentionnés, Kempt croyait que les Indiens deviendraient des êtres plus civilisés si on les initiait à la vie sédentaire et au travail assidu, politique assimilatrice plus facile à préconiser qu’à mettre en œuvre.
Au terme de son mandat en Amérique du Nord britannique, Kempt rentra en Angleterre et se mêla presque immédiatement de politique intérieure et d’administration militaire. Arrivés au pouvoir en novembre 1830, les whigs avaient beaucoup de mal à trouver un militaire d’expérience qui serait disposé à devenir maître général du Board of Ordnance, car la plupart des officiers supérieurs étaient des tories. Kempt accepta le poste, assorti d’un siège au Conseil privé, à condition de ne pas avoir à entrer à la chambre des Communes et de ne pas avoir à se mêler de politique partisane. Il devint ainsi responsable de la supervision des multiples activités du Board of Ordnance : approvisionner en armes et objets manufacturés les troupes de la métropole et d’outre-mer, construire et entretenir les ouvrages et bâtiments militaires et administrer les corps de l’artillerie et du génie. À titre de maître général, il siégea à la commission royale qui fut formée en 1834 pour étudier la question des sanctions militaires et qui, deux ans plus tard, prit avec modération la défense de la pratique de la flagellation dans l’armée, mais recommanda une large gamme de réformes salutaires des conditions du service militaire.
Kempt fut en outre membre d’une commission royale créée en 1833 pour examiner l’administration civile de l’armée, ce qui le plaça au cœur de plus grandes controverses. L’année suivante, le duc de Richmond, président de la commission, prépara un rapport recommandant de fusionner les divers départements civils qui s’occupaient d’affaires militaires en un bureau de l’armée dirigé par un ministre du cabinet et de faire entrer les corps de l’artillerie et du génie dans l’armée régulière. Comme on savait Kempt opposé à toute modification des pouvoirs ou du statut du Board of Ordnance, on ne le consulta pas sur ce rapport préliminaire, et il protesta fermement auprès du premier ministre, le comte Grey. Lorsqu’en 1835 lord John Russell critiqua les objections déterminantes soulevées par les militaires au sujet de la réforme administrative, il nota que Kempt avait « constitu[é] le grand obstacle », même si presque tous les officiers supérieurs s’opposaient sans compromis à pareille réorganisation.
Kempt démissionna de son poste de maître généra à la défaite des whigs, en décembre 1834, et commença enfin à se retirer de la vie publique. Lord Aberdeen, secrétaire d’État tory aux Colonies en 1835, proposa qu’il fasse partie d’une mission de commissaires qui iraient recueillir des faits dans le Haut et le Bas-Canada. Lorsque, à la veille de la rébellion de 1837–1838, les ministres whigs cherchèrent un candidat à la succession de lord Gosford [Acheson*], gouverneur en chef des Canadas, Kempt fut de nouveau mentionné, même s’il devait alors avoir plus de 70 ans. Ensuite, il disparut de la scène publique.
Pendant sa retraite, sir James Kempt fréquenta de vieux amis de l’armée, comme le duc de Wellington et lord Seaton [Colborne] et correspondit avec eux. Il vécut assez longtemps pour apprendre le déclenchement de la guerre de Crimée, en mars 1854, mais il ne sut jamais combien la légendaire armée du duc de Wellington y fut humiliée. Il mourut à Londres le 20 décembre ; il léguait des dons en argent totalisant £59 800 et £675 de rentes à divers parents, amis et collègues officiers, dont Charles Stephen Gore* et le fils de sir Archibald Campbell*. La mort de Kempt, suivie cet hiver-là par celle d’autres officiers des guerres napoléoniennes, causa une profonde tristesse à John Charles Beckwith*, lui-même ancien combattant, qui exprimait sans doute l’opinion de nombre de ses camarades en disant : « Tous ces hommes, je les considère comme les patriarches de tout ce que l’Angleterre a de solide. »
APC, MG 24, A52 (copies) ; B1, 6, 14–15 ; B16.— NLS, Dept. of mss, Adv. mss 46.8.8–15 ; mss 15029.— PANS, RG 1, 63–66 ; 113–113 1/2.— PRO, CO 42/217–230 ; 43/27–28 ; 217/138–148 ; 218/29–30 (mfm aux APC) ; PROB 11/2204 : 392–393.— SRO, GD45/3.— Univ. of Durham, Dept. of Palaeography and Diplomatic (Durham, Angl.), Earl Grey papers.— Christie, Hist. of L.C. (1848–1855), 3 ; 6.— Doc. hist. of campaign upon Niagara frontier (Cruikshank), 1 : 175.— G.-B., Parl., Command paper, 1836, 22, [no 59] : 1–556, Report from his majesty’s commissioners for inquiring into the system of military punishments in the army ; 1837, 34, part. i, [no 78] : 1–200, Report of the commissioners appointed to inquire into the practicability and expediency of consolidating the different departments connected with the civil administration of the army.— Gentleman’s Magazine, janv.–juin 1855 : 188–189.— H.-C., House of Assembly, Journals, 1828–1830.— N.-É., House of Assembly, Journal and proc., 1820–1828.— L.-J. Papineau, « Correspondance de Louis-Joseph Papineau (1820–1839) », Fernand Ouellet, édit., ANQ Rapport, 1953–1955.— Select British docs. of War of 1812 (Wood), 1 : 269 ; 3 : 229, 344, 346.— Times (Londres), 22 déc. 1854.— Boase, Modern English biog., 2 : 190–191.— DNB.— G.-B., WO, Army list, 1783–1854.— Morgan, Sketches of celebrated Canadians, 266–268.— Wallace, Macmillan dict.— Elizabeth Graham, Medicine man to missionary : missionaries as agents of change among the Indians of southern Ontario, 1784–1867 (Toronto, 1975), 23–24.— MacNutt, Atlantic prov.— George Raudzens, The British Ordnance Department and Canada’s canals, 1815–1855 (Waterloo, Ontario, 1979).— G. C. M. Smith, The life of John Colborne, Field-Marshall Lord Seaton [...] (Londres, 1903), 327.— H. [G. W.] Smith, The autobiography of Lieutenant-General Sir Harry Smith, baronet of Aliwal on the Sutlej, G. C. M. Smith, édit. (2 vol., Londres, 1901), 1 : 340–341 ; 2 : 303, 396.— Taft Manning, Revolt of French Canada.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Peter Burroughs, « KEMPT, sir JAMES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 8, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 20 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/kempt_james_8F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/kempt_james_8F.html |
| Auteur de l'article: | Peter Burroughs |
| Titre de l'article: | KEMPT, sir JAMES |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 8 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la révision: | 1985 |
| Date de consultation: | 20 avr. 2025 |