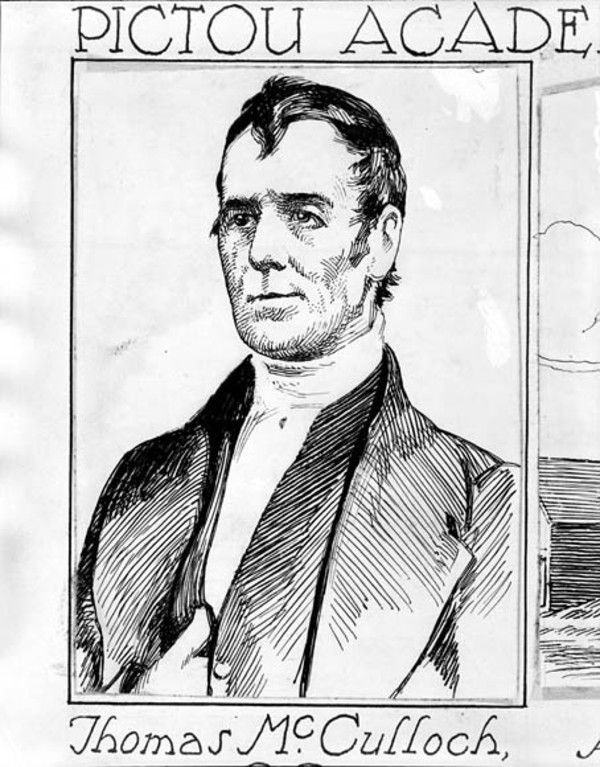
Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2834978
McCULLOCH,THOMAS, ministre presbytérien, éducateur, fonctionnaire, juge de paix, auteur et naturaliste, né en 1776 à Fereneze, près de Paisley, Écosse, fils de Michael McCulloch et d’Elizabeth Neilson, deuxième garçon d’une famille de six enfants ; le 27 juillet 1799, il épousa Isabella Walker, et ils eurent neuf enfants ; décédé le 9 septembre 1843 à Halifax.
Deux des phénomènes qui marquèrent l’Écosse au xviiie siècle contribuèrent à façonner la personnalité de Thomas McCulloch. D’abord, l’industrialisation : Paisley, centre textile florissant, faisait bien vivre la classe des artisans de la région, à laquelle appartenait son père, maître graveur qui confectionnait des planches servant à l’impression des étoffes. Ensuite, les Lumières, période faste de renouveau scientifique et philosophique. En 1792, Thomas obtint un diplôme de logique à l’University of Glasgow. Doué pour les langues anciennes, il enseigna l’hébreu pendant ses études et, une fois diplômé, continua de parfaire sa connaissance des langues, de l’histoire ecclésiastique et de la constitution britannique. Il commença son cours de médecine mais ne le termina pas, choisissant plutôt de fréquenter l’école de théologie du Général Associate Synod de Whitburn (Lothian). C’était le lieu de formation des ministres de l’Église scissionniste, née du schisme provoqué dans l’Église d’Écosse par le départ d’Ebenezer Erskine en 1733.
Autorisé à prêcher par le consistoire de Kilmarnock, McCulloch fut invité en 1799 à desservir Stewarton, au sud-ouest de Glasgow, où il reçut l’ordination. Six semaines plus tard, il épousa Isabella Walker, fille du révérend David Walker, ministre de la congrégation old light burgher d’une localité voisine, Pollokshaws (Glasgow). Quatre ans plus tard, il voulut démissionner de son poste de Stewarton parce que, affirma plus tard son fils, il n’y touchait pas un revenu suffisant. Peu après, il demanda au General Associate Synod de l’envoyer en Amérique du Nord et on l’affecta à l’Île-du-Prince-Édouard.
Les études de McCulloch et son milieu d’origine développèrent en lui un calvinisme fervent, une pensée libérale et une grande soif de savoir – traits qui allaient s’exprimer plus tard dans son enseignement, ses écrits et sa vision politique. S’il se tourna vers le missionnariat, c’est, semble-t-il, par égard pour ses parents, qui l’avaient élevé dans la piété. Lui-même admettait qu’il lui avait fallu plusieurs années pour se persuader que sa situation était préférable à celle de ses confrères restés au pays.
McCulloch arriva à Pictou, en Nouvelle-Écosse, au mois de novembre 1803, en compagnie de sa famille. Comme on lui déconseillait de franchir le détroit de Northumberland si tard dans la saison, il passa l’hiver à Pictou. La tradition raconte que deux citoyens de l’endroit, voyant les globes qu’il avait apportés (et qui représentaient le monde physique et le monde céleste), résolurent de le convaincre de rester. En juin 1804, on l’installa en l’église du « havre », plus tard appelée l’église Prince Street. Comme ses confrères James Drummond MacGregor* et Duncan Ross*, McCulloch visitait les agglomérations où il n’y avait pas de ministre presbytérien ; Halifax était du nombre. Populaire dans la capitale, il fut invité à s’y établir en 1807, mais l’Associate Presbytery de Pictou jugea qu’il serait plus utile à l’Église en demeurant à son poste. McCulloch fit cependant un bref séjour dans la congrégation de Halifax en 1817 pour arbitrer un conflit entre le ministre et les fidèles. Dans son sermon, publié sous le titre de Words of peace [...], il souligna que la discorde engendre de mauvais fruits et reprocha à la congrégation de négliger « ce progrès dans la piété » qui était le devoir des chrétiens et des presbytériens. En 1824, il quitta son ministère de Pictou pour se consacrer tout entier à l’éducation.
Moins de deux ans après son arrivée à Pictou, McCulloch s’était attaqué à ce qui allait être son grand œuvre, voire son obsession à certains moments. Depuis 1803, les non-conformistes, qui formaient pourtant 80 % de la population provinciale, n’avaient pas accès aux diplômes du King’s College de Windsor, unique établissement de haut savoir dans la province. Formé dans les universités écossaises, qui acceptaient des étudiants de toutes confessions, McCulloch ne pouvait souffrir pareil exclusivisme. De plus, soutenait-il, les prédicateurs avaient absolument besoin d’une formation libérale, que seules les universités dispensaient. Conscient de la grande pénurie de ministres presbytériens et reconnaissant que MacGregor faisait preuve de réalisme en soutenant que jamais la province ne serait desservie convenablement si elle ne pouvait compter que sur des ministres instruits en Écosse, McCulloch conçut un plan en vue de former un clergé néo-écossais. Sa première initiative fut d’ouvrir chez lui, en 1806, une école où les garçons recevaient un enseignement plus riche que celui des écoles ordinaires ; dès 1807, il pouvait compter sur une souscription de £1 150 en vue de la création d’un collège. Privé au début de toute aide gouvernementale, l’établissement de McCulloch survécut grâce à des fonds locaux jusqu’à ce que la loi provinciale de 1811 sur les grammar schools lui donne droit à une assistance. Quand brûla, en 1814, l’école en rondins qu’il avait construite sur sa propriété, il avait de 30 à 40 élèves ; après avoir fait appel au lieutenant-gouverneur, il reçut £100 de fonds publics pour la reconstruire.
En 1809, certains citoyens hostiles avaient profité de la visite du lieutenant-gouverneur sir George Prevost* à Pictou pour semer, dans l’esprit des autorités, des doutes sur la loyauté de McCulloch. Peu après, une lettre de menaces conseilla à McCulloch de quitter le pays. Toutefois, ses vigoureuses protestations de fidélité et les témoignages d’amis bien placés clouèrent le bec à ses accusateurs, si bien qu’il fut trésorier du district en 1810 et juge de paix au moins pendant cinq ans, jusqu’en 1815. L’un de ceux qu’il avait appelés à sa rescousse était l’évêque Charles Inglis*. En 1803, donc dans le climat de tension instauré par les guerres napoléoniennes, l’évêque anglican, dans une allocution à son clergé, avait lancé des propos malveillants sur la loyauté des catholiques néo-écossais. Le vicaire général catholique, Edmund Burke*, réagit vivement et déclencha une controverse politique et théologique. McCulloch, usant de son savoir, s’en mêla pour défendre les protestants. Dans Popery condemned [...] (1808), dédié à Inglis, puis dans Popery again condemned [...] (1810), il exposa la justification théologique du protestantisme et illustra les déviations de Rome à l’aide des Écritures et des enseignements du christianisme. Sa manière de poser les problèmes transforma en un débat surtout religieux ce qui avait été jusqu’alors une querelle largement politique. Les autorités anglicanes apprécièrent tant ses interventions qu’elles lui offrirent officieusement, par l’entremise de William Cochran*, directeur adjoint du King’s College, d’entrer dans leur Église et de faire partie du personnel du collège. Mais, comme leurs porte-parole l’apprirent avec un certain étonnement, le presbytérianisme de McCulloch l’empêchait de souscrire aux Trente-neuf Articles de foi de l’Église d’Angleterre, ainsi que l’exigeait pareille nomination. Cet incident persuada encore davantage McCulloch qu’il fallait créer un établissement d’enseignement supérieur pour les non-conformistes de la province.
En 1813–1814, la fondation d’une école interconfessionnelle où les élèves les plus avancés servaient de moniteurs aux plus jeunes poussa McCulloch à reprendre la plume. La Royal Acadian School de Walter Bromley était, à Halifax, la première depuis les années 1780 à accueillir des enfants de condition modeste. Sa fondation déclencha une controverse entre d’une part les tenants de l’Église établie, notamment Richard John Uniacke* et Alexander Croke, selon qui l’éducation devait préparer les enfants à entrer dans l’Église d’Angleterre, et d’autre part les non-conformistes, tel McCulloch, d’après qui les propositions anglicanes en faveur de l’orthodoxie niaient le droit à la dissidence. McCulloch soutenait que, dans les cas où les dénominations, prises individuellement, n’avaient ni l’argent ni l’influence nécessaires pour maintenir leur propre maison d’enseignement, elles pouvaient faire bénéficier leurs enfants d’une éducation chrétienne en se joignant à une association protestante interconfessionnelle qui soutiendrait un seul établissement. Dans un sermon de février 1814, The prosperity of the church in troublous times [...], il disait voir un signe de la Providence dans le fait que diverses dénominations commençaient à coopérer au sein de sociétés à buts religieux. Même si McCulloch ne fit jamais partie du conseil d’organismes comme la Royal Acadian Society et la British and Foreign Bible Society, il défendit vigoureusement leurs principes dans de nombreuses lettres aux journaux et, ce faisant, définit les paramètres de la tolérance religieuse qui s’instaura dans les faits en Nouvelle-Écosse.
En 1815, les presbytériens, guidés par McCulloch, amorcèrent le processus législatif qui devait mener à la création d’un établissement interconfessionnel de haut savoir à Pictou. Leur principal motif était d’assurer aux futurs ministres du culte la formation classique dont ils avaient besoin. Toutefois, dans leurs interventions publiques, ils mettaient l’accent sur le caractère non sectaire de l’établissement, car pour réussir ils avaient besoin de l’appui des méthodistes, des baptistes et des anglicans libéraux. Leur requête au Parlement se fit sur un ton discret : ils ne parlèrent ni de collation de grades, ni d’enseignement de la théologie, ni d’assistance financière, mais seulement de la fondation d’une académie. L’Assemblée, où siégeaient des députés de diverses confessions, adopta le projet de loi à l’unanimité. Au Conseil de la Nouvelle-Écosse, dominé par les anglicans, Brenton Halliburton* accepta de promouvoir une académie ouvertement presbytérienne. La loi de constitution, adoptée en 1816, ne contenait aucune restriction quant à l’appartenance religieuse des étudiants mais exigeait qu’administrateurs et professeurs prêtent un serment d’adhésion à l’une des Églises établies, celle d’Angleterre ou celle d’Écosse. Dans l’esprit des promoteurs, le conseil d’administration confessionnel n’était qu’une concession temporaire. Cette loi témoignait de l’astuce du député Edward Mortimer*, qui avait réussi à tempérer l’ardeur de McCulloch et à le convaincre des avantages de s’ajuster à la réalité politique.
La Pictou Academy commença à dispenser des cours en mai 1818, sous la direction de McCulloch. Plus tard dans l’année, en inaugurant l’édifice, il exposa ses convictions dans un discours qui fut publié sous le titre : The nature and uses of a liberal education illustrated [...]. L’éducation libérale, expliquait-il, englobait à la fois les traditionnelles humanités et les sciences (philosophie, mathématiques, sciences physiques), car l’homme devait pouvoir connaître et comprendre le monde dans lequel il vivait. Elle n’enseignait pas que des faits, mais aussi un ensemble de principes qui permettaient de les classer ; de plus, elle inculquait les aptitudes et l’inclination nécessaires pour continuer à s’instruire. « L’éducation libérale, soutenait McCulloch, tire sa valeur non pas tant de la matière qu’un jeune homme apprend au collège, mais plutôt des habitudes d’abstraction et de généralisation qu’il acquiert imperceptiblement au cours de ses études. » Au début de 1818, dans l’Acadian Recorder de Halifax, il réclama « un séminaire d’instruction supérieure, ouvert et général », et souligna les dangers d’un système qui, parce qu’il n’offrait qu’un enseignement supérieur confessionnel, forçait nombre de Néo-Écossais à faire leurs études à l’étranger, aux États-Unis surtout. De l’avis de McCulloch comme de tous les tenants de l’Église établie, l’éducation devait inculquer des principes chrétiens ; son objet était « le développement de l’intelligence et de la morale de l’homme, fondements de son bonheur futur ». Aussi fallait-il exposer de bons et utiles préceptes à la jeunesse. Toutefois, McCulloch affirmait que tous devaient avoir accès à l’instruction, peu importent leurs croyances religieuses.
Dans son rôle éducatif auprès des jeunes gens qui se préparaient aux professions libérales ou au ministère presbytérien, McCulloch était guidé par son exceptionnelle intelligence, à la fois étendue et pénétrante. En Écosse, à son époque, la philosophie sociale fusionnait éducation et religion, et lui-même était un exemple vivant de cette fusion. La technique scientifique était la servante de l’interrogation religieuse : « le professeur [qui œuvre] au sein de l’Église [...] doit être un homme qui possède des connaissances et de la facilité à les transmettre » ; cette condition était nécessaire au maintien de l’ordre de l’Église. McCulloch reconnaissait que, dans une contrée où il y avait très peu de maisons d’enseignement, on pouvait fort bien s’instruire soi-même mais, selon lui, son rôle était d’éviter cette nécessité aux ministres non conformistes. Dans sa correspondance avec le révérend Edward Manning*, il cherchait à déterminer les vues communes qu’avaient de l’éducation presbytériens et baptistes, dans l’espoir d’amener ces derniers à appuyer son séminaire.
La Pictou Academy ne se distinguait pas seulement par la conception de l’éducation et le dévouement personnel de McCulloch : les sciences figuraient à son programme. McCulloch éveillait chez ses élèves la curiosité scientifique et une appréciation de la valeur morale de la science. Dès 1820, il avait fait venir d’Écosse de l’équipement d’occasion pour un laboratoire de chimie et, à partir de 1827, il donna aussi des conférences publiques sur les principes de la chimie. Agrémentées d’expériences, ces conférences ajoutèrent beaucoup à sa popularité et à son prestige. Leur succès atteignit son apogée en 1830 ; cette année-là, dit McCulloch, les conférences de Halifax firent « plus grand bien à l’académie et à ses intérêts que tout ce qui était survenu auparavant ». Ses collections d’oiseaux et d’insectes de la région consolidèrent également la réputation scientifique de l’académie. En 1822, en partie pour le remercier de lui avoir fait parvenir une collection d’insectes de la Nouvelle-Écosse, l’University of Glasgow lui décerna un doctorat en théologie. En même temps, avec l’aide de son ami de toujours, le révérend James Mitchell de Glasgow, McCulloch négocia des doctorats en droit pour les deux plus fidèles amis politiques de la Pictou Academy, Samuel George William Archibald et Simon Bradstreet Robie* ; James MacGregor reçut un doctorat semblable en 1822. L’année suivante, en envoyant une autre collection d’insectes à l’University of Edinburgh, il demanda des diplômes pour Halliburton, le juge James Stewart et le juge en chef Sampson Salter Blowers. À cette occasion, il ne manqua pas de souligner que son établissement donnait des cours de mathématiques, de philosophie naturelle et de sciences physiques, contrairement au King’s College de Windsor, pourtant favorisé par le gouvernement.
Les premiers adversaires de la Pictou Academy furent des membres de l’establishment tory de Halifax, que dominait l’Église d’Angleterre. Leurs porte-parole au conseil, Uniacke et son gendre Thomas Nickleson Jeffery, se montrèrent intransigeants. Selon eux, pour que l’élite en devenir grandisse dans le respect des principes de l’ordre social et de la constitution britannique, il fallait que l’enseignement supérieur soit assuré par l’Église établie ; ils rejetaient donc l’idée de McCulloch, qui maintenait que l’éducation libérale non confessionnelle était le meilleur moyen de former de bons citoyens. Le champion du monopole anglican sur l’enseignement supérieur, le révérend John Inglis, fut aussi l’avocat le plus tenace des adversaires de la Pictou Academy qui, selon lui, était « susceptible de grandir ou de dépérir selon que le collège de Windsor [serait] languissant ou prospère ». Le trésorier de la province, Michael Wallace*, s’opposait également à l’académie ; son animosité envers le district de Pictou datait de la défaite politique qu’il y avait subie en 1799. En outre, certains conseillers avaient des raisons financières de souhaiter contenir les ambitions des commerçants de Pictou.
En 1818, une controverse sur le droit de célébrer des mariages avec dispense de bans donna l’occasion à McCulloch de mobiliser les non-conformistes. À titre de commissaire anglican, Inglis refusait de leur délivrer des dispenses. Voyant cela, McCulloch fit signer par divers ministres non conformistes une pétition demandant au Parlement de leur reconnaître le droit de célébrer des mariages avec dispense de bans. Il défendit aussi cette cause avec ardeur dans la presse locale. Dans une lettre mordante à l’Acadian Recorder, signée de son pseudonyme familier, Investigator, il jeta les bases de l’argumentation des non-conformistes. Pour lui toutefois, ce conflit n’était qu’« une épreuve de force » destinée à « attacher le clergé méthodiste et baptiste [au] séminaire » de Pictou et qu’une occasion d’embarrasser l’Église anglicane et de défier Inglis. En 1821, après que le ministère des Colonies eut désavoué un projet de loi autorisant les ministres non conformistes à célébrer des mariages avec dispense de bans, il se désintéressa de cette question, car il avait découvert que « la bonne volonté [des méthodistes et des baptistes] n’irait pas au delà des déclarations ». Il lui suffisait que la question « reste suspendue au-dessus de la tête de l’Église et puisse être ramenée sur le tapis n’importe quand ». Puis, en 1825, il prêta de nouveau attention à ce débat : ce fut l’un des quatre sujets autour desquels il amena l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse à tenter de former un conseil interconfessionnel qui coordonnerait l’action des non-conformistes. Il invoqua encore cette question à la fin des années 1820, en invitant les parlementaires à unir leurs efforts en faveur des non-conformistes, afin de gagner des appuis pour son académie.
Grâce à Mortimer, la Pictou Academy toucha en 1819 une subvention gouvernementale de £400, mais ses partisans ne parvinrent pas à obtenir un conseil d’administration non confessionnel. Néanmoins, McCulloch reçut cette année-là, de la part des méthodistes comme des baptistes néo-écossais, de chaleureuses lettres de recommandation en vue d’une tournée à Boston, à New York et au Canada. Toujours en 1819, Mortimer et Robie demandèrent pour lui un doctorat américain en théologie, en reconnaissance de ses écrits en la matière et de sa défense éloquente de la cause non conformiste. Leurs efforts furent infructueux mais, l’année suivante, McCulloch obtint un doctorat en théologie de l’Union College de Schenectady, dans l’état de New York. Le décès de Mortimer, à la fin de 1819, plaça en pratique la responsabilité de l’académie sur les épaules de McCulloch. Ainsi, dans les démarches auprès du conseil et du ministère des Colonies, c’est lui qui proposa en 1821 d’intégrer le projet de loi accordant une charte à l’académie au projet de loi touchant le Dalhousie College. Sur la scène politique, c’est l’habile Archibald qui prit la relève : aidé à l’Assemblée par George Smith de Pictou et Charles Rufus Fairbanks, et au conseil par Halliburton, il sut bien défendre chaque année au Parlement les intérêts de l’établissement. McCulloch leur apporta sa collaboration. Il témoigna devant l’Assemblée et le conseil, et diverses pétitions, présentées au moment opportun, vinrent appuyer sa volumineuse correspondance en faveur de l’éducation. En 1821, il déplorait d’être venu si souvent à Halifax pour défendre l’académie ; à tel point, disait-il, « que j’ai honte de [me] montrer le nez en ville quand la chambre siège ». De même, la popularité croissante de ses lettres anonymes à l’Acadian Recorder, où il satirisait les bêtises de la société néo-écossaise, lui fit peut-être redouter une trop grande publicité à Halifax. Ces lettres, d’une certaine manière, affermirent McCulloch dans sa vision socio-religieuse de l’académie. Les partisans de l’établissement ne parvinrent à obtenir ni un conseil d’administration non confessionnel, ni l’autorisation de conférer des grades, non plus qu’une subvention permanente, mais l’académie toucha une subvention presque chaque année pendant une décennie, ce qui prouvait son succès politique. Dès 1825, elle était très réputée pour la qualité de son enseignement, le dévouement de son directeur et le fait que les non-conformistes reconnaissaient qu’elle comblait leurs besoins éducationnels.
Les démarches que McCulloch et ses collègues faisaient pour que l’académie ait le droit de conférer des grades avaient rencontré un obstacle en 1817 : lord Dalhousie [Ramsay] allait fonder, à Halifax, un troisième établissement d’enseignement supérieur. Dalhousie n’avait rien contre la Pictou Academy, mais elle était à son avis l’équivalent d’un pensionnat écossais, et jamais il n’accepterait qu’elle aspire à un statut plus élevé, lequel devait revenir à son propre collège. McCulloch tenta bien de le convaincre de placer ce collège sous l’autorité de l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse plutôt que de rechercher une alliance avec le King’s College, mais Dalhousie était trop du côté de l’Église établie et tenait trop à gravir les échelons de l’administration impériale pour adopter pareille solution. De 1823 à 1825, son successeur, sir James Kempt*, essaya en vain de réunir le King’s College et le Dalhousie College en une université interconfessionnelle qui serait située à Halifax, et cet échec redonna un certain espoir à McCulloch d’acquérir, pour son propre établissement, le droit de conférer des grades. Toutefois, en 1825, comme il était incapable d’obtenir dans la province les attributions nécessaires, il envoya ses trois premiers finissants de théologie en Écosse, où ils passèrent avec distinction les examens de l’University of Glasgow.
L’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse avait été fondée en 1817 par les ministres presbytériens de l’extérieur de Halifax, qui étaient pour la plupart des scissionnistes. McCulloch contribua à définir les modalités de l’union et rédigea le premier rapport du synode. Il participa aux activités des comités du synode et servit de modérateur en 1821. Nommé professeur de théologie du synode cette année-là, il demanda, au nom de l’Église, une subvention gouvernementale pour la création d’une chaire de théologie à l’académie. Cette requête fut rejetée, mais jusqu’à la fin de sa vie, moyennant une minime rétribution annuelle du synode, il donna les cours qui menaient habituellement au diplôme de théologie en Écosse. Certes, il se plaignait de la tiédeur et des jalousies qui sévissaient au sein du synode, mais dès 1825 l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse considérait la province, surtout la partie est, comme son domaine, et McCulloch en était le chef incontesté.
Alors que McCulloch et d’autres prédicateurs de l’Église scissionniste se dépensèrent pendant plus de 20 ans pour faire progresser le presbytérianisme en Nouvelle-Écosse, l’Église d’Écosse resta désorganisée et ses ministres, isolés. L’est de la province ne compta pas de ministre de cette Église avant l’arrivée du révérend Donald Allan Fraser à Pictou en 1817. Le révérend Kenneth John MacKenzie, envoyé par la Glasgow Colonial Society, aile missionnaire de l’Église, avait rejoint Fraser à Pictou en 1824. Si McCulloch n’avait pas vu, dans les missionnaires que la société promettait d’envoyer, d’éventuels usurpateurs du territoire où il entendait affecter les finissants de la Pictou Academy, tous les ministres que les deux Églises pouvaient fournir auraient peut-être pu trouver à se placer, car il y avait probablement dans l’est de la province assez de colons écossais pour eux. De même, si les scissionnistes et les membres de l’Église d’Écosse n’avaient pas livré bataille pour la même région sous la gouverne de deux hommes aussi ambitieux, obstinés et vifs que MacKenzie et McCulloch, ils auraient pu se compléter au lieu de se heurter.
Au moment même où la Glasgow Colonial Society inaugurait ses activités en Nouvelle-Écosse, McCulloch réalisait un vieux projet, celui de faire une tournée écossaise pour consolider la position de son Église et faire valoir les intérêts de son académie. Nanti de témoignages des méthodistes, des baptistes, des barristers de la province et de députés importants de l’Assemblée, il s’embarqua en juillet 1825. Peu après son arrivée, il eut avec le révérend Robert Burns*, secrétaire de la Glasgow Colonial Society, un entretien orageux qui lui aliéna l’Église d’Écosse. Il fit en effet valoir avec véhémence que la société aurait plus de chances d’atteindre ses objectifs si, au lieu de financer l’installation de ministres écossais en Nouvelle-Écosse, elle aidait à leurs débuts des ministres qui avaient été formés dans la province et qui la connaissaient bien. Dans un écrit vigoureux, intitulé A memorial [...] et publié en juillet 1826, il accusa la société de vouloir neutraliser l’œuvre de l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse.
A memorial déclencha dans la presse écossaise une controverse hargneuse sur les objectifs et les activités de la société. Au fil de cette polémique, qui ne se termina qu’en 1828, Burns fit paraître Supplement to the first annual report of the Society [...], puis McCulloch publia A review of the Supplement, auquel Burns répliqua à son tour. Les amis que McCulloch comptait parmi les scissionnistes écossais, soucieux d’aider l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse et la Pictou Academy, fondèrent à la fin de 1826 la Glasgow Society for Promoting the Interests of Religion and Liberal Education among the Settlers of the North American Provinces, ce qui aggrava l’animosité entre les Églises d’Écosse. Quant à la campagne de sollicitation que McCulloch mena pour son établissement, elle donna des résultats extrêmement décevants. « J’ai tâté plus d’un métier, se plaignit-il à MacGregor, mais celui de mendiant est le pire. » En raison de ses relations hostiles avec la Glasgow Colonial Society et de la grave crise financière qui éprouvait l’Écosse, il n’eut pas le succès qu’Inglis avait remporté l’année précédente en Angleterre pour le King’s College.
La controverse sur la Glasgow Colonial Society déborda les frontières écossaises. Tant MacKenzie que le révérend John Martin, porte-parole de l’Église d’Écosse à Halifax, envoyèrent à Burns leurs commentaires sur A memorial de McCulloch. Dès septembre 1826, des lettres parues dans l’Acadian Recorder firent connaître la querelle dans la province et, à la fin de l’année, Pictou était devenu le foyer de la polémique journalistique. Même si McCulloch ne rentra en Nouvelle-Écosse qu’en décembre 1826, on les considéra, lui et MacKenzie, du début à la fin, comme les protagonistes de la controverse dans la province. Le débat commença le printemps suivant, lorsque McCulloch publia dans les journaux de Halifax une longue réponse au Supplement de Burns. Parce qu’ils maintenaient la séparation entre membres de l’Église d’Écosse et scissionnistes, séparation visible en Écosse mais beaucoup moins dans la colonie, les ministres de l’Église d’Écosse et leur société missionnaire naissante essuyèrent de virulentes attaques de la part de McCulloch. Si les aspirations de ce dernier se réalisaient, ils perdraient, remarquaient-ils, non seulement leur titre de représentants du presbytérianisme dans cette colonie britannique, mais aussi toute importance dans le territoire missionnaire de la Nouvelle-Écosse. Ils trouvèrent un sympathisant en la personne de Michael Wallace, qui exprima leur mécontentement au conseil en même temps que son opposition à l’académie.
Les porte-parole de l’Église d’Écosse, MacKenzie et Fraser, s’opposaient à la Pictou Academy pour trois raisons. Premièrement, même si l’académie était officiellement un établissement de type écossais qui desservait les presbytériens, elle était, dans les faits, un collège interconfessionnel. Elle ne dispensait pas l’instruction élémentaire dont l’est de la province avait besoin, et les ministres de l’Église d’Écosse s’en plaignaient en affirmant représenter la majorité des colons écossais de cette région, qui étaient affiliés à cette Église au moment d’émigrer. Deuxièmement, comme la Pictou Academy remplissait, en pratique, la principale mission pour laquelle avait été fondé le Dalhousie College, affilié à l’Église d’Écosse, elle conférait à l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse un statut dont l’Église d’Écosse ne jouissait pas, même si elle le considérait comme son dû. Troisièmement, les ministres de l’Église d’Écosse méprisaient la formation théologique donnée aux futurs ministres de l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse. Les administrateurs de la Pictou Academy firent toujours valoir que, si une dénomination souhaitait leur confier la formation de ses candidats au ministère, elle pouvait négocier des arrangements semblables à ceux de McCulloch ; toutefois, tant que l’Église d’Écosse niait la légitimité d’un clergé néo-écossais, une entente de ce genre était impossible. Comme ils refusaient de se soumettre à la dictature que McCulloch exerçait sur le conseil d’administration, MacKenzie et ses collègues ne pouvaient espérer modifier la gestion de l’académie qu’en suscitant un affrontement public.
William B. Hamilton, docteur en philosophie, a dit que de 1820 à 1825 les noms de McCulloch et de la Pictou Academy étaient sur le point de devenir « synonymes de la lutte pour la réforme politique et éducative » et qu’à la fin de cette période « l’étroite querelle confessionnelle s’était transformée en un vaste débat constitutionnel ». C’est un fait que pendant ces années la Pictou Academy devint un brandon de discorde entre l’Assemblée, où dominaient les non-conformistes et les députés ruraux, et le conseil de la province, qui défendait les tenants de l’Église établie et les Haligoniens. En 1825, malgré l’opposition tenace de Wallace, Uniacke et Jeffery, les subventions parlementaires à l’académie, versées en tranches quasi annuelles de £400, totalisaient £2 600. McCulloch escomptait que son établissement finirait par « se glisser dans la liste civile » et recevrait, comme le King’s College, une subvention annuelle permanente. Cependant, en dépit d’une offensive résolue, l’Assemblée ne parvint pas, en 1825, à faire accepter les trois requêtes que l’établissement avait présentées tant de fois : un statut de collège, un conseil d’administration non confessionnel et une subvention annuelle garantie. En outre, la même année, par suite d’un remaniement, le conseil devint plus réfractaire à l’académie. L’un des nouveaux conseillers était John Inglis, depuis peu évêque de la Nouvelle-Écosse. McCulloch lui imputa le revirement du conseil et le blâma pour ses « tactiques d’araignée qui tisse sa toile ». En fait, l’évêque n’avait pas tant d’influence au sein de l’organisme. Certes, il défendait constamment les intérêts de son Église, de sorte qu’il s’entendait fort bien avec les conseillers qui appuyaient les autorités anglicanes. Cependant, McCulloch n’arrivait pas à faire la distinction, fort importante, entre l’influence d’Inglis et celle de conseillers comme Enos Collins* et Charles Ramage Prescott*, qui en avaient plutôt contre Pictou et ses aspirations économiques. En conséquence, les promoteurs non conformistes de la Pictou Academy attribuaient souvent au vote d’Inglis le refus de ces conseillers, ce qui était simpliste.
De 1826 à 1831, les efforts pour en arriver à un compromis entre l’Église d’Écosse et l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse, de même qu’entre l’Assemblée et le conseil, continuèrent de marquer la question de la Pictou Academy. Quant à McCulloch, il acquit de plus en plus la conviction que transiger serait mortel pour son établissement. Dix ans passés à le promouvoir et à le défendre avaient instillé en lui un libéralisme social qui comportait des principes de liberté civile et religieuse incompatibles avec la rigide philosophie conservatrice qui dominait au conseil. La Pictou Academy n’était plus une maison d’enseignement au service de la province : elle était une mission d’œcuménisme chrétien confiée par Dieu à McCulloch. L’entier dévouement avec lequel il la défendait explique la dureté qui marqua la querelle à la fin des années 1820. Dans les derniers mois de 1826, McCulloch se voyait comme un martyr, un « bouc émissaire désigné pour porter les péchés du peuple ». Aigri par l’animosité de la Glasgow Colonial Society et désenchanté devant la tiédeur qu’il percevait chez ses frères d’Écosse, il attaqua le projet de loi qui aurait garanti une subvention annuelle à l’établissement parce que ce document affectait des fonctionnaires gouvernementaux au conseil d’administration de l’académie.
Les administrateurs réagirent au sentiment de crise de McCulloch par les « Résolutions du Nouvel An » de 1827, dans lesquelles ils vantaient l’académie et en réaffirmaient fermement les objectifs. Même si le directeur admettait que ces résolutions n’étaient « que du boniment », elles provoquèrent « beaucoup de rage parmi les ennemis » et « beaucoup trop de défections parmi les amis » (celle de Brenton Halliburton notamment), car elles invoquaient lourdement les droits naturels et le droit de l’académie à un traitement législatif égal à celui du King’s College. Il ne s’ensuivit d’ailleurs aucun résultat positif, puisqu’il n’y eut pas de projet de loi sur la Pictou Academy en 1827. Indifférents aux signes qui leur indiquaient le danger de leur stratégie, les administrateurs, guidés par McCulloch, n’en démordirent pas. Toujours en 1827, dans le Colonial Patriot de Pictou [V. Jotham Blanchard], les partisans de l’académie publièrent des articles radicaux qui témoignaient de leur connaissance des courants réformistes du Canada et de leur affinité avec eux. Même si McCulloch niait publiquement tout lien direct avec le journal, bien des gens tenaient pour acquis qu’il en était l’éminence grise, et en 1829 il y collaborait ouvertement. Défenseur de la liberté civile et religieuse en Nouvelle-Écosse, le Colonial Patriot reflétait et prônait énergiquement la position philosophique dont la Pictou Academy était de plus en plus le symbole.
En politisant de plus en plus ses revendications, à compter de 1827, le conseil d’administration exacerba les tensions religieuses qu’avaient suscitées la controverse de la Glasgow Colonial Society et les « Résolutions du Nouvel An ». Chaque année, de 1828 à 1832, l’Église d’Écosse exposa ses objections à l’académie dans des pétitions au Parlement. Ces pétitions, en raison de l’à-propos de leurs arguments, de leurs nombreuses signatures et de leur origine régionale, renforçaient la position des conseillers de la province qui s’élevaient contre l’académie. Au printemps de 1828, en abordant les questions constitutionnelles connexes, Halliburton nota avec raison que la controverse s’était « échauffée au point de devenir une lutte religieuse pour la domination politique ». Selon lui, l’enjeu était le suivant : « Est-ce que ce seront les non-conformistes ou [les membres de] l’Église d’Écosse qui auront l’ascendant religieux et politique sur toute la partie est de la Nouvelle-Écosse ? » Par ailleurs, le conflit était maintenant lié au débat majeur dans la province : eu égard à la constitution, le conseil avait-il le droit de rejeter des projets de loi de finance présentés, et maintes fois soutenus, par l’Assemblée ? De 1825 à 1830, en effet, le conseil rejeta pas moins de sept projets de loi d’aide financière à l’académie.
« L’académie, disait McCulloch, est la seule chose qui, dans les provinces britanniques, empêche l’[évêque] et la hiérarchie ecclésiastique d’avoir la haute main sur l’éducation, et, dans le secret comme au grand jour, ils recourent à tous les moyens, honnêtes ou fourbes, pour nous abattre. » Comme le Parlement coupa sa subvention après 1828, McCulloch dut redoubler d’efforts pour susciter la générosité des Écossais et amener ses partisans néo-écossais (qui formèrent des sociétés en 1829) à se dévouer encore davantage. En plus, pour contrebalancer les pressions de l’Église d’Écosse, il fallait veiller chaque année à ce que les diverses congrégations et dénominations envoient des pétitions. Au printemps de 1829, McCulloch, au bord du désespoir, concluait : « il faudra mettre le feu à la province pour assurer la sécurité de notre académie ». Pendant l’été, le Colonial Patriot flanqua « un savon » au conseil, ce qui l’amena à croire que le journal allait « soit obtenir directement une permanence pour [l’académie], soit, en révolutionnant le conseil, connaître la même fin ». Comme ces interventions pointaient le gouvernement, les adversaires de l’établissement y voyaient moins une stratégie de défense qu’un assaut délibéré contre l’ordre et l’harmonie qui régnaient dans la province.
Enhardi par l’opposition dont l’académie faisait l’objet au conseil, le clergé de l’Église d’Écosse continuait d’affirmer qu’il représentait l’ordre et la fidélité au gouvernement et que sa position sur l’académie tenait compte des besoins locaux. L’Église d’Écosse était beaucoup plus forte à la fin des années 1820 qu’elle ne l’avait été auparavant, et en 1831 la fondation de l’Observer and Eastern Advertiser, dirigé par MacKenzie, donna à ses membres le moyen de s’exprimer et d’affermir leur position. À l’occasion du scrutin de 1830, ils se lancèrent dans l’arène électorale. Les candidats qu’ils soutinrent furent défaits, mais leur succès relatif dans le district de Pictou atteste l’appui populaire qu’ils s’attribuaient. De plus, en adhérant en 1831 à la position selon laquelle le conflit était une querelle religieuse entre presbytériens, ils minèrent l’argument scissionniste qui voulait que défendre l’académie c’était défendre des sentiments réformistes légitimes et soutenir la liberté religieuse, comme d’autres le faisaient en Grande-Bretagne et dans le Haut-Canada.
En 1831, comme aucune des deux parties n’arrivait à prendre le dessus, chacune résolut de faire pression sur le ministère des Colonies. McCulloch rédigea la requête des administrateurs de l’académie, que Blanchard présenta. Étant donné les talents politiques d’Archibald, président du conseil d’administration, et de Halliburton, qui rédigea une longue critique de cette requête, le secrétaire d’État aux Colonies, lord Goderich, en vint à la conclusion que les griefs de la colonie avaient une cause politique, comme on le disait couramment et comme l’expliquaient d’ailleurs Blanchard et Halliburton. En juillet 1831, Goderich donna donc instructions au lieutenant-gouverneur sir Peregrine Maitland* de « faire adopter un projet de loi qui pourrait donner à l’établissement d’enseignement de Pictou [...] une aide pécuniaire permanente à même les fonds publics ». Dans sa réponse, Maitland lui fit remarquer qu’« en fait, la querelle oppos[ait...] les membres de l’Église d’Écosse et [...] les membres séparés de cette Église » plutôt que seulement « le conseil ou l’Église établie et les partisans » de l’académie. Goderich admit que, dans le cas d’un affrontement entre deux dénominations dont les effectifs étaient réputés à peu près égaux, verser une subvention à une seule ne réglerait rien. Il ordonna donc à Maitland de ne prendre aucune initiative, sinon celle de « tenter de concilier les parties en présence et d’encourager les chambres du Parlement [...] à régler la question au moyen de quelque compromis législatif ».
Incapable de régler à l’amiable la querelle de l’académie, le gouvernement la laissa pratiquement de côté. À la fin de 1831, Maitland tenta de réconcilier McCulloch et MacKenzie, mais il se buta à l’intransigeance du premier. Cependant, la crainte de déplaire aux autorités impériales et l’attitude plus modérée de ses nouveaux membres amenèrent le conseil à chercher une fois de plus un règlement à cette querelle dont toutes les parties étaient lasses. Il en résulta la loi de 1832, qui tentait de donner satisfaction à tous. L’académie dispenserait un enseignement élémentaire tout en continuant de donner un enseignement supérieur. Une subvention annuelle de £400, garantie pour dix ans, servirait d’abord à payer le salaire de McCulloch (£250) et du maître chargé de l’enseignement élémentaire (£100). Des 13 administrateurs, 7 resteraient en place ; Maitland, persuadé que les deux parties devaient trouver leur avantage dans le règlement, attribua à des représentants de l’Église d’Écosse quatre des six sièges à pourvoir. En introduisant ainsi le conflit au sein même du conseil d’administration, Maitland espérait sans aucun doute que les administrateurs seraient assez soucieux du bien de l’académie pour trouver un terrain d’entente. C’était compter sans l’antagonisme qui opposait McCulloch et MacKenzie.
La restructuration de la Pictou Academy par la loi de 1832 marqua le début d’une période critique dans l’existence de McCulloch. Jusque-là, il avait pu se considérer comme le véritable chef de l’établissement, mais la présence de quatre adversaires au conseil d’administration, il le constata, réduisait beaucoup son pouvoir. Dès 1833, les réunions du conseil furent l’occasion de tiraillements et d’insultes, et McCulloch n’y assista plus, même s’il en avait l’obligation. À cause d’une récession économique de plus en plus grave, l’académie voyait fondre ses appuis financiers et publics. McCulloch se plaignait constamment que les représentants de l’Église d’Écosse n’assuraient pas l’aide pécuniaire qu’ils avaient promise en entrant au conseil d’administration, et il était toujours exposé à leurs virulentes attaques personnelles. De plus, en 1831, dans l’Acadian Recorder, un correspondant qui signait A Presbyterian l’avait accusé d’avoir détourné au profit de l’académie des fonds amassés en Écosse pour venir en aide aux victimes de l’incendie qui avait ravagé la région de la Miramichi en 1825. Ces accusations avaient été réfutées, mais elles reparurent dans un pamphlet en 1833 ; elles furent niées dans des attestations signées par des Écossais, que l’Acadian Recorder publia en 1834, puis réitérées dans l’Observer de Pictou en 1835.
En janvier 1835, McCulloch informa le lieutenant-gouverneur sir Colin Campbell que la Pictou Academy n’était plus en mesure de remplir sa mission et lui demanda comment, de « quelque autre manière utile à la province », il pourrait « gagner [sa] vie en instruisant la jeunesse » ; un an plus tard, il présenta la même requête à l’Assemblée. Son découragement venait non seulement du climat d’affrontement qui régnait à l’académie, mais de la mort de deux de ses enfants, en 1834 et 1835. Entouré à l’occasion par les siens (sa mère, sa sœur, ses frères, son neveu, sa femme et ses neuf enfants), McCulloch avait toujours eu besoin de l’appui de sa famille, qui était très unie et partageait ses convictions.
En 1835–1836, on tenta par de nouvelles négociations de réunir le Dalhousie College et le King’s College, et les amis de McCulloch manifestèrent le désir de le voir nommé à Dalhousie. McCulloch accepta à contrecœur et, dans une lettre à Mitchell, ne parla que des aspects négatifs de Halifax : l’anglicanisme y dominait, et le milieu urbain était corrompu. En 1836, McCulloch démissionna du poste de professeur de théologie du synode. Par la suite, il affirma avoir fait ce geste parce qu’il sentait que sa présence suscitait du mécontentement et non parce que le synode n’avait pas doté ce poste comme il l’avait promis en 1832. L’année suivante cependant, on le persuada de réintégrer ses fonctions, qu’il exerça jusqu’à sa mort. À l’automne de 1837, après le rejet d’un projet de loi qui aurait redonné à la Pictou Academy sa mission originale, il était si peiné de la situation de son établissement qu’il songea sérieusement à se retirer en Grande-Bretagne.
Pendant la session législative de 1838, comme les négociations en vue de la création d’une université provinciale avaient échoué, Archibald et son fils Charles Dickson* coordonnèrent, avec succès, des démarches qui visaient à libérer McCulloch de Pictou et à lui ouvrir les portes du Dalhousie College. Axé à première vue sur la Pictou Academy, le projet de loi mutait McCulloch au collège de Halifax en même temps qu’il y transférait £200 de la subvention gouvernementale. La discussion de ce projet de loi ramena la querelle qui avait sévi dix ans plus tôt. L’opposition de l’Église d’Écosse se manifesta par le témoignage de Fraser en chambre et par des attaques contre la personne de McCulloch, en particulier la réédition du pamphlet signé A Presbyterian. D’autres vieux adversaires de l’académie, soit les marchands de Halifax et les anglicans, combattirent le projet qui, selon eux, leur enlevait l’emprise sur l’éducation supérieure. De leur côté, les catholiques et les non-conformistes de diverses dénominations l’appuyèrent, car il offrait des chances de mener à la création d’un établissement d’enseignement supérieur dépourvu de restrictions confessionnelles.
McCulloch devint le premier directeur du Dalhousie College le 6 août 1838, à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration. Nommé aussi professeur de logique, de rhétorique et de philosophie morale, il démissionna de la Pictou Academy en septembre pour s’installer dans la capitale. Outre ses cours réguliers, il donna le soir, à de « jeunes gentlemen », une série de leçons de logique et de composition. Reconnaissant combien il était ironique d’occuper pareil poste à Halifax après avoir combattu l’establishment de la capitale pendant 30 ans, il disait : « Dieu m’a confié la garde du domaine de mes ennemis. » Enfin, il se voyait comme le « chef de l’éducation de la province ».
Au cours de cette réunion, le conseil d’administration statua que Dalhousie, en fondant son collège, avait voulu en faire un centre affilié à l’Église d’Écosse ; tous les professeurs, à l’exception de McCulloch, devaient donc appartenir à cette Église. En conséquence, le révérend Alexander Romans, ministre de l’Église d’Écosse à Dartmouth, se vit confier la fonction de professeur d’humanités à la place d’Edmund Albert Crawley*, pasteur de l’église baptiste Granville Street et humaniste réputé à qui on avait promis officieusement ce poste en échange de l’appui des baptistes au projet de loi qui nommait McCulloch. En novembre, furieux d’être laissé pour compte, Crawley convainquit la Nova Scotia Baptist Education Society de fonder un collège en s’associant à la Horton Academy. Comme McCulloch ne semblait avoir eu aucune part dans la décision des administrateurs, ni l’approuver, ses relations avec le clergé baptiste souffrirent peu de l’incident. Lorsque, l’année suivante, Crawley abandonna la chaire de l’église Granville Street pour s’installer au nouveau collège de Wolfville, McCulloch prononça pendant l’intérim des sermons dont la congrégation tira « réconfort et satisfaction ».
Les années que McCulloch passa à Halifax ne furent pas heureuses. Son mandat prévoyait que, en dehors de ce qu’exigeraient ses fonctions, il ne se mêlerait ni de politique ni de questions connexes. Même si les membres de l’Église d’Écosse contestaient encore sa nomination après son entrée en fonction, il rapporta à Mitchell en mai 1839 : « Je ne me frotte à personne et personne, à présent, n’ose se frotter à moi. » On reconnaissait son intelligence, son savoir et ses talents de pédagogue, mais le conseil d’administration ne lui faisait pas confiance quand il s’agissait de la direction, de la gestion financière ou de l’avenir du collège. Saisi de deux propositions visant à rompre l’affiliation à l’Église d’Écosse, le conseil les rejeta. L’une, que McCulloch appuya, consistait à redonner au collège le caractère non confessionnel qu’avait souhaité son fondateur ; l’autre, à laquelle il s’opposa, à faire entrer un catholique à la faculté.
Par ailleurs, McCulloch s’employa à rétablir, à Halifax, une congrégation affiliée à l’Église presbytérienne de la Nouvelle-Écosse. Il s’indignait du rapprochement qui, tant en Écosse que dans la province, s’esquissait entre scissionnistes et membres de l’Église d’Écosse. Selon lui, les instigateurs de ce mouvement étaient des ministres de culture britannique qui ne comprenaient ni les besoins de la province, ni les profondes animosités qui y régnaient. Il voyait aussi, dans ces propositions d’alliance, de l’indifférence pour la « pureté des Écritures » et comptait sur ses anciens étudiants du synode pour l’aider à combattre inflexiblement les initiatives des ministres, tels les révérends John Sprott* et Thomas Trotter*, qui sondaient la possibilité de réunir les presbytériens de la province.
Durant les années de controverse religieuse et éducative qui avaient précédé son entrée au Dalhousie College, McCulloch avait gardé, sur ses adversaires, l’avantage d’être remarquablement doué pour la composition de sermons, d’argumentations théologiques, de réflexions politiques et de satires. À compter de son installation à Halifax, en 1838, il eut plus de temps pour écrire, mais l’aiguillon de la bataille devait lui manquer, car apparemment il le fit moins souvent que naguère. Malgré tout, la série de 16 lettres satiriques qu’il avait commencé à publier sous le couvert de l’anonymat dans l’Acadian Recorder le 22 décembre 1821 avait fermement ancré sa réputation dans l’esprit de la population. Ces lettres, qui soi-disant décrivaient un quelconque canton néo-écossais, ridiculisaient en fait l’indolence, l’agitation et l’appétit du gain rapide des campagnards et des villageois, mais elles révélaient aussi les limites du narrateur de McCulloch, Mephibosheth Stepsure, homme rusé et satisfait de lui-même. Alors qu’au début des lettres Stepsure le boiteux était, de toute évidence, celui qui servirait à mettre en relief le ridicule des autres personnages, il avait, à la fin de la première série (close le 11 mai 1822), une aussi grande soif de reconnaissance sociale que ses voisins. Sa signature, « Gent[leman] », à la fin de la dernière lettre, montrait sans équivoque que la satire avait été employée comme une arme à double tranchant ; de plus, elle levait le voile sur un personnage dont le caractère n’avait été révélé que progressivement, si bien que ces lettres, au lieu d’être de simples épisodes, comme la plupart des morceaux littéraires publiés dans les journaux, se rapprochaient d’un ouvrage d’imagination plus unifié. En ce sens, de par sa structure, la première série des lettres de Stepsure surpasse les premiers tableaux de Sam Slick, publiés par Thomas Chandler Haliburton* en 1835, et les Sunshine sketches of a little town (1912), de Stephen Butler Leacock*, même si ces trois œuvres utilisent fort bien à des fins comiques les conventions de l’esquisse journalistique.
Les lettres de Stepsure eurent d’emblée un énorme succès ; comme le disait un correspondant, elles faisaient tellement rire que « les combles de la maison tremblaient littéralement sous l’effet de la clameur et du tapage ». Dans les lettres indiscrètes que Stepsure écrivait à la « gentry de Halifax », McCulloch mettait en scène une galerie de vauriens qui troquaient les valeurs terriennes contre les richesses et la mobilité sociale attribuées au commerce, à la construction navale et à la coupe du bois. Ces personnages, dont les noms eux-mêmes étaient comiques (Monsieur Tipple, Jack Scorem, Shadrach Howl et Mademoiselle Sippit par exemple), McCulloch les faisait connaître en s’adonnant à des arlequinades enjouées ou en recourant à l’humour cinglant de Mephibosheth. Ainsi Monsieur Gypsum n’était « nullement un buveur avoué », l’étranger du village « mourut parce qu’il ne pouvait vivre plus longtemps » et les voisins de Stepsure n’étaient « jamais pressés, sauf au moment de travailler à la ferme, de quitter la maison ou de sortir de l’église ». Les passages consacrés à l’auberge des Whinge montrent particulièrement bien que les villageois ne savaient pas tirer parti de leur situation : non seulement les visiteurs trouvaient-ils des morceaux de souris ou de grenouille et des cheveux dans la soupe, mais ils constataient qu’« ils ne manquaient pas de compagnons de lit ». Northrop Frye a dit de ce type d’humour qu’il était « tranquille, observateur » et « profondément traditionnel au sens humain » ; qu’il se fondait non pas sur de « bons mots » mais sur « une vision de la société ». C’est pourquoi il voit en McCulloch « le créateur de l’humour authentiquement canadien », humour basé sur une compréhension du contexte social et sur la distinction entre le transitoire et le permanent. Stepsure s’inquiète de voir ses concitoyens courir de-ci de-là, s’adonner à des religions charismatiques qu’il trouve vides ou se noyer dans l’alcool, et son attitude illustre la sensibilité sociale et morale qui sous-tend la comédie : « Je n’étais ni grand homme ni fils de grand homme : j’étais Mephibosheth Stepsure, et ma plus haute ambition était d’être simplement un honnête fermier. »
Le message que livraient ces lettres ne pouvait arriver à un meilleur moment. Pendant son mandat de lieutenant-gouverneur, de 1816 à 1820, Dalhousie s’était inquiété du piètre état de l’agriculture provinciale et avait soutenu John Young, qui publiait dans l’Acadian Recorder des lettres fort soignées en faveur de l’amélioration des techniques agricoles. De 1828 à 1831, Joseph Howe* allait exploiter le même thème dans ses « Western rambles » et ses « Eastern rambles », qui parurent dans le Novascotian, or Colonial Herald. Mais ni lui ni les autres champions d’une économie fondée sur l’agriculture ne communiquaient leur message d’une façon aussi vigoureuse, aussi colorée que le Stepsure de McCulloch. Une houe dans une main et une bible dans l’autre, Stepsure prêchait les vertus de la frugalité, de la culture intellectuelle, du sens communautaire et du respect de la famille. En prônant le dur labeur et en se disant convaincu que « le temps, c’est de l’argent », il rappelait le Poor Richard de Benjamin Franklin, mais la moralité chrétienne qui sous-tendait sa vision sociale le faisait paraître plus altruiste que le narrateur de Franklin. McCulloch comme Franklin sont des maîtres de la litote mordante et savent à merveille discerner les idiosyncrasies des gens. Cependant, les lettres de Stepsure, écrites en un style posé et prosaïque que venaient ponctuer des facéties, des rudesses espiègles, des mots lancés en douce et des expressions moqueusement citées à la lettre, différaient passablement par leur ton des réflexions laconiques du personnage bien connu de Franklin. En outre, tout en sachant aussi bien que Franklin ou Haliburton ciseler un aphorisme (« Celui qui dépense ses gages avant de les gagner paie toujours en retard »), McCulloch allait plus loin qu’eux et explorait les dispositions psychologiques qui menaient ses voisins à leur perte. Alors que les tableaux de Sam Slick étourdissaient le lecteur par leur langage exubérant et la peinture hardie des caractères, les lettres de Stepsure attribuaient des motifs sérieux, quoique prévisibles, au déclin et à la chute des Néo-Écossais. Elles touchèrent certainement une corde sensible chez les lecteurs. À preuve, McCulloch ne trouva plus d’exemplaires présentables quand il voulut en envoyer à ses amis d’Écosse, et l’Acadian Recorder, le jour de la conclusion de la première série de lettres, publia le commentaire suivant : « Elles ont dépeint avec une si inimitable vérité les habitudes irréfléchies, luxurieuses et extravagantes de notre population, que nous nous voyions en elles comme dans un miroir [...] La correction de ces égarements doit être la première étape de l’augmentation du capital provincial ; et les satires sévères qui sont dirigées contre eux dans les lettres de notre correspondant ne peuvent manquer de produire un effet. » McCulloch expliqua à James Mitchell, de Glasgow, en novembre 1822 : « Aucun écrit [dans] ces provinces n’a jamais tant fait jaser. Presque tous les lecteurs ont été fâchés à leur tour et ont ri de temps à autre de leur voisin. Un des juges m’a dit qu’il croyait que notre gouverneur les savait par cœur. »
Même avant que ses lettres aient connu le succès. McCulloch projetait de se rendre « au moins jusqu’à la vingtième » pour « ensuite ajouter des notes et des illustrations et envoyer le tout [en Écosse] à titre d’exemple de la manière dont [on se] débrouill[ait] dans le monde occidental ». Une fois les 16 premières lettres achevées, en 1822, il les recopia et les polit, y ajouta une lettre comique, écrite en dialecte à l’intention des Écossais par l’ami covenantaire de Stepsure, Alexander Scantocreesh, et les intitula « The chronicles of our town, or, a peep at America ». En novembre 1822, il envoya les originaux de ces lettres anonymes à Mitchell en lui demandant de les porter à un libraire qui « pourrait un jour ou l’autre consentir à publier [ce] tableau des mœurs américaines ». Le 4 janvier 1823, il commença à publier dans l’Acadian Recorder une nouvelle série de lettres de Stepsure dans laquelle il développait un long conte moral autour d’un jeune immigrant écossais installé dans la province, William. Cette série différait de la première sous plusieurs aspects : elle mettait en scène un deuxième épistolier (Scantocreesh), élaborait une longue histoire au lieu de plusieurs petites et présentait un narrateur central connu (Stepsure). L’ensemble manquait d’intensité dramatique, même si la parution dans l’Acadian Recorder, du 21 décembre 1822 au 25 janvier 1823, de certaines lettres d’un correspondant portant le pseudonyme de Censor poussa McCulloch à poursuivre cette série. Ce mystérieux correspondant accusait Stepsure de « patauger constamment dans un trou de fumier, éclaboussé de saletés et de toutes les marques de la vulgarité ». La quatrième lettre, dans laquelle Stepsure feignait la douleur, et la sixième, qui était une parodie héroï-comique, montraient combien les ressources stylistiques de McCulloch étaient nombreuses. Puis apparemment, après la sixième lettre, publiée le 29 mars 1823, il comprit qu’il avait dévié de son plan original et avait en fait écrit un court roman. Il songea alors à envoyer « William » au rédacteur en chef de l’Edinburgh Christian Instructor and Colonial Religious Register. Cependant, le texte ne parut pas dans ce périodique ; McCulloch le souda à une deuxième histoire d’immigrant, « Melville », et apporta les deux manuscrits en Écosse quand il s’y rendit en 1825.
Absorbé par son infructueuse campagne de souscription et sa controverse avec la Glasgow Colonial Society, McCulloch n’eut guère de temps à consacrer à son œuvre littéraire pendant son séjour en Écosse. Il réussit pourtant à faire imprimer deux publications. En janvier 1826, la maison Oliphant publia « William » et « Melville » sous un seul titre, Colonial gleanings, et en juin McCulloch supervisa la publication de A memorial, réfutation de Robert Burns et de la Glasgow Colonial Society. Comme ils contenaient des observations sur la qualité de la vie pionnière et la souplesse des distinctions sociales en Nouvelle-Écosse, ces deux ouvrages rappelaient les lettres de Stepsure, mais « William » et « Melville », tout en abordant les mêmes thèmes que celles-ci, se situaient dans un registre beaucoup plus sombre. Ces deux contes reçurent une critique favorable dans l’Edinburgh Theological Magazine de février 1826, et le Novascotian reproduisit des extraits de « Melville » plus tard dans l’année. Par le thème et le style, « William » était désormais intégré à « Melville » : les deux jeunes gens grandissaient dans la même région, à l’extérieur de Glasgow, cherchaient fortune en Nouvelle-Écosse et perdaient tout ce qu’ils convoitaient en négligeant les préceptes chrétiens. À leur manière, « William » et « Melville » étaient aussi actuels que la série des lettres de Stepsure, car ils montraient de jeunes immigrants aux prises avec les tentations de Halifax et de la campagne, mais ces deux histoires révélaient une nouvelle facette de la sensibilité littéraire de McCulloch. Les allusions à l’histoire des covenantaires de l’ouest de l’Écosse et à la persécution de l’arrière-grand-père de William par celui de Melville faisaient un peu le pont entre les deux contes ; de plus, elles montraient que McCulloch commençait à explorer la veine historique dans ses ouvrages d’imagination. Issu d’une région d’Écosse où les covenantaires avaient été influents, McCulloch s’identifiait aussi à leur tradition par ses positions d’anti-burgher. Introduire ce thème dans « Melville » était donc naturel pour lui, étant donné ses antécédents personnels et théologiques, mais il lui donnait une dimension néo-écossaise en faisant du révérend James MacGregor l’un de ses personnages. MacGregor apparaît, dans « Melville », comme un remarquable exemple de la piété et du dévouement chrétiens qui animent aussi les covenantaires mis en scène par McCulloch. En outre, sa présence renforce le ton de plus en plus religieux de la fiction de McCulloch, car dans son long sermon à Melville il expose la vision calviniste qui sous-tendait la moralité de personnages antérieurs, tels Scantocreesh et ce narrateur au prénom biblique, Mephibosheth Stepsure.
Le 16 janvier 1828, un peu plus d’un an après son retour en Nouvelle-Écosse, McCulloch annonça à Mitchell qu’il était absorbé par la composition d’un autre roman. Cette œuvre compterait trois volumes, parlerait de la « papauté et du progrès des Lollards dans l’ouest de l’Écosse » et mettrait aussi en scène « une bonne quantité de sorcières, esprits des eaux et autres dieux auxquels [les anciens Écossais] rendaient un culte ». Les « Auld Eppie’s tales », qui se passaient sous le règne de Jacques III, dans les lieux où McCulloch avait vécu enfant, étaient présentés par un narrateur moderne qui, de retour au pays après des années d’errance, faisait cette découverte : « Là où plus d’une génération aux besoins modestes a coulé, dans un confort tout aussi modeste, une existence de tranquille indolence, il n’y a plus que moulins et prés où l’on fabrique, blanchit et imprime le coton ; et cette race ancienne et satisfaite, qui ne connaissait ni labeur ni travail en dehors des sacrements et des foires, a dépéri devant une horde d’intrus affairés au visage avide dont seule la pierre philosophale peut étancher la soif de richesse. » D’autres écrivains écossais, dont sir Walter Scott et John Galt, avaient déjà évoqué la rapidité du changement social. Comme eux, McCulloch tentait d’opposer à ces intrusions du modernisme toute la beauté de l’Écosse, ses légendes et ses traditions. Son roman n’était pas nostalgique pour autant car, en montrant combien l’Église d’avant la Réforme avait trompé le bas peuple, il rappelait les origines de la Réforme et, en un sens, de la montée des covenantaires en Écosse. Sans être au sens strict un roman sur les covenantaires, « Auld Eppie’s tales », en mettant au jour le caractère indomptable et l’humour persistant de personnages simples comme Jock of Killoch et Clunk, révélait l’âme du peuple écossais, qui s’exprimerait plus tard dans un mouvement comme celui des covenantaires. On y voyait d’ailleurs nombre de ces touches de couleur locale qui avaient fait la popularité de Scott et de Galt en Écosse : emploi de l’écossais pour le langage de tous les jours, thème de la sorcellerie du pays, présence d’une tour traditionnelle des Lowlands dans l’histoire, caractère populaire d’Auld Eppie et des contes de la vieille Écosse. Même si McCulloch espérait que son roman « amuse », il y voyait une contribution sérieuse à l’éveil de la sensibilité historique et religieuse de ses lecteurs écossais.
Du 29 juin au 29 décembre 1828, McCulloch envoya des tranches de « Auld Eppie’s tales » à Mitchell en insistant bien pour conserver l’anonymat. En expliquant qu’il avait écrit ce roman en partie pour réagir au portrait que Scott avait brossé des ancêtres écossais dans Tales of my landlord, il révélait en outre qu’il avait besoin d’argent pour ne pas avoir à « [se] mettre à planter des pommes de terre ou autre chose que [sa] famille pourrait se mettre sous la dent ». Le choix de l’éditeur l’inquiétait donc particulièrement. Il suggérait le nom de William Blackwood, qui avait donné des livres à la Pictou Academy en 1826 et avait été « aimable » avec lui durant son séjour en Écosse. Aussi fut-il doublement consterné que Blackwood refuse à la fois « Auld Eppie’s tales » et « The chronicles of our town », qui dormait en Écosse depuis 1822. Tout en louant « Chronicles » pour ses « descriptions pittoresques de la vie et des coutumes » et pour son « riche humour », Blackwood faisait valoir que la mode raffinée n’était plus aux écrits qui avaient « le mordant et l’originalité de Swift ». Certes, précisait-il, il n’était pas de « ces gens difficiles de la génération présente ». Il se sentait quand même tenu de rejeter les deux manuscrits en raison de la vulgarité de leurs traits d’esprit ; « un ouvrage de ce genre, qui exploite la même veine que Scott, doit porter la marque d’un talent subtil et présenter le moins possible d’éléments que les lecteurs ordinaires pourraient juger rudes ». En guise de compensation, il proposait à McCulloch, qu’il disait admirer beaucoup, de récrire certaines des lettres de Stepsure pour son périodique. Sa consigne était de les adresser explicitement à un auditoire écossais et de ne pas mentionner leur publication antérieure dans « l’un des journaux canadiens ». Blackwood invita aussi McCulloch à lui présenter d’autres textes pour le Blackwood’s Edinburgh Magazine ; il lui promettait de 8 à 10 guinées la page pour tout ce qu’il accepterait.
Piqué au vif par les commentaires de Blackwood, McCulloch ordonna à Mitchell de reprendre ses manuscrits et nota : « aussi malpropres que B1. juge mes romans, je trouve qu’ils sont la pureté même à côté de son magazine, et j’y penserais à deux fois avant d’écrire pour une publication dont la tendance est si irréligieuse ». Certes, dans « Chronicles », on pétait et on vidait des pots de chambre, mais cela donnait du piquant aux pitreries de l’auteur, qu’évoqua avec tant de nostalgie l’une des satires du « Club » de Howe, qui traitait des lettres de Stepsure et parut dans le Novascotian du 15 mai 1828 : « Avez-vous jamais lu son Mephiboschetch, qui a fait rire toute la contrée pendant des mois avec ses singulières histoires de pignons de maison et de choux ? » Il faut dire que McCulloch s’était adressé à Blackwood en une période où la presse britannique recherchait de plus en plus des choses raffinées. En 1826, Galt avait éprouvé des difficultés semblables pour publier « The last of the lairds » en feuilleton dans le Blackwood’s Magazine ; par la suite, l’éditeur avait même considérablement expurgé le roman de Galt pendant son séjour dans le Haut-Canada. McCulloch était bien résolu à ne jamais donner pareille occasion à Blackwood : de 1829 à 1833, il ne cessa de demander à Mitchell de reprendre ses manuscrits et de dire qu’il présenterait ailleurs tout nouveau roman.
Dans une lettre écrite en décembre 1833, McCulloch demanda à Mitchell de s’informer du prix que la maison Oliphant paierait pour un roman d’environ 400 pages, « Days of the Covenant ». Tout comme une histoire inédite sur James MacGregor, une bonne partie de ce manuscrit se trouve dans les papiers McCulloch aux Public Archives of Nova Scotia. Le roman se passe en 1669, dans la décennie qui précéda le meurtre de l’archevêque James Sharp, et confirme combien McCulloch voulait célébrer le courage religieux des covenantaires. On y retrouve maints éléments surnaturels, folkloriques et romantiques des « Auld Eppie’s tales » et, comme ce livre et comme les lettres de Stepsure, « Days of the Covenant » montre que McCulloch était beaucoup plus habile à créer des personnages du peuple que des lairds, des abbés et autres personnalités.
En juillet 1834, McCulloch informa Mitchell qu’il avait décidé, vu l’amélioration de sa situation financière et le piètre accueil qu’il avait reçu du public, de ne plus tenter de publier en Écosse. Il soumit cependant quelques articles légers à des journaux néo-écossais, et il y a lieu de croire qu’il était le Timothy Ticklemup qui écrivit sur le révérend Drone dans l’Acadian Recorder du 6 avril 1833 et ce Mr C. Currycomber qui en 1841 collabora au Morning Herald, and Commercial Advertiser de Halifax. En 1839, Mitchell avait cherché en vain un éditeur pour un manuscrit de théologie, peut-être « Calvinism : the doctrine of the scriptures », et il en avait conclu qu’il était mieux adapté au contexte et au marché américains qu’écossais. Ce manuscrit parut finalement à Glasgow en 1846. En 1841, McCulloch travaillait à un autre manuscrit sur la divinité du Christ qui, semble-t-il, resta inédit. Il ne fit aucune tentative pour publier dans la province ses ouvrages d’imagination, même après avoir demandé à Mitchell de reprendre ses manuscrits à Blackwood. Les 16 premières lettres de Stepsure, telles qu’elles avaient paru dans l’Acadian Recorder, ne sortirent sous forme de livre qu’en 1862.
Pendant ses dernières années, McCulloch ne se détourna pas de ses autres centres d’intérêt. L’histoire naturelle n’était pas le moindre. D’abord passionné d’entomologie après l’ouverture de la Pictou Academy, il s’intéressa aussi à l’ornithologie après son séjour en Grande-Bretagne en 1825–1826. Pendant toutes ses années à Pictou, l’étude de l’histoire naturelle fut à la fois une source de plaisir et un outil d’enseignement. Ses dons de collections d’insectes aux universités de Glasgow et d’Édimbourg, son admission à la Wernerian Society of Edinburgh en 1823, ses apports à des collections privées et ses échanges de plantes avec le naturaliste écossais Patrick Neill le firent aussi connaître avantageusement. En 1828, il tenait dans la pièce ouest de l’académie un musée d’histoire naturelle où il collectionnait « oiseaux, bêtes à quatre pattes et choses rampantes ». John James Audubon fut très impressionné par cette collection lorsqu’il visita Pictou en 1833, d’où il repartit avec des cadeaux – oiseaux, coquillages et minéraux. À compter de cette visite, il collabora pendant des années avec Thomas McCulloch fils, futur professeur de philosophie naturelle au Dalhousie College, qui lui envoya à New York des spécimens ornithologiques de la province. En 1834, McCulloch père, faute de recevoir un soutien des autorités provinciales, attira l’attention du British Museum sur sa collection. Le British Museum refusa cependant d’acheter le Pictou Museum, si bien que Thomas McCulloch fils transporta la collection en Grande-Bretagne et la vendit à divers particuliers, dont le comte de Derby. Comme McCulloch l’écrivit tristement à Mitchell, jamais pareille collection n’avait quitté l’Amérique du Nord mais, refusant de se laisser abattre, il commença à constituer avec son fils une deuxième collection importante quand il s’installa à Halifax. Il passa ses dernières années à parcourir la province pour recueillir des spécimens et fit notamment une excursion à l’île de Sable avec l’un de ses anciens étudiants, Adams George Archibald*. Dans les années 1820, McCulloch écrivit à Mitchell qu’au retour de ces excursions, il était « piqué à tous les endroits accessibles [du corps] et aussi plein de démangeaisons qu’un pauvre Écossais peut l’être ». Ses lettres de 1841 à Mitchell révèlent que la recherche de spécimens, dont certains se retrouvent dans une petite collection à la Dalhousie University, l’occupait toujours. McCulloch revit une dernière fois son fidèle correspondant à l’occasion d’un autre voyage en Écosse en 1842. Il y retrouva aussi d’anciens collègues ; comme le rappellerait l’un d’eux, il pleura abondamment sur son banc en entendant évoquer des souvenirs, puis monta en chaire et prononça devant « [les] fidèles un discours fort intéressant et fort vivant sur la Nouvelle-Écosse ».
Intelligence supérieure et remarquable énergie, foi calviniste et pensée libérale : telles étaient les forces qui animaient Thomas McCulloch. Ses premiers écrits théologiques le firent connaître comme l’un des grands esprits de la province, et ses polémiques, soutenues dans les journaux ou dans des pamphlets, continuèrent d’attirer sur lui l’attention du public. La logique puissante et la clarté de ses argumentations donnaient de la force à ses prises de position répétées en faveur d’un traitement équitable pour les non-conformistes, dans une province qui reconnaissait le droit à la dissidence. Comme le montrent les lettres de Stepsure, il pouvait utiliser aussi bien la satire que l’érudition ou la logique pour exposer sa vision de la société néo-écossaise. Cette vision s’inspirait de son éducation écossaise et de son appartenance à l’aile scissionniste du presbytérianisme. Animé d’une profonde foi calviniste, il était résolu à « remplir [les] provinces [nord-américaines] d’une race de prédicateurs évangéliques ». En matière séculière, sa conviction fondamentale était qu’une éducation libérale pouvait former une nation chrétienne de citoyens éclairés et responsables. Quand la réalité politique fit obstacle à son idéalisme, il se tourna vers le courant réformiste naissant de la Nouvelle-Écosse et en fit valoir les ressemblances avec les mouvements qui existaient en Grande-Bretagne et au Canada. Toutefois, même si le cadre théorique du mouvement réformiste était en voie de définition, il fallut attendre que Joseph Howe prenne la cause en main pour que s’organise en Nouvelle-Écosse un parti politique voué à la réforme. En raison de son intelligence et de son énergie, McCulloch s’exaspérait de voir des gens se dévouer moins que lui ou, parce qu’ils lui étaient intellectuellement inférieurs, adhérer à des positions dont il avait démontré l’illogisme. Il avait trop confiance en la justesse de ses positions pour ne pas préférer l’affrontement à la coopération, et il était trop sûr de son intégrité pour faire des compromis. Il comptait donc d’ardents admirateurs et des amis dévoués, mais aussi des ennemis jurés. Quand son chemin croisait celui de personnages aussi ambitieux et combatifs que lui, tels Inglis et MacKenzie, il n’y avait aucune possibilité d’entente. En fin de compte, son influence fut réelle, tant parce qu’il contribua à la littérature canadienne que parce qu’il forma nombre de futurs avocats, hommes d’affaires, érudits, ministres du culte, missionnaires, éducateurs et scientifiques.
La plus importante collection de documents rédigés par McCulloch est celle conservée aux PANS, MG 1, 550–558. Elle comprend sa longue correspondance, riche en détails, avec James Mitchell et le fils de ce dernier, James, des brouillons de documents et des lettres d’intérêt régional, des notes sur ses lectures scientifiques et ses papiers théologiques et littéraires. Parmi ceux-ci se trouvent les manuscrits des 16 premières lettres signées Stepsure, des fragments de « William », d’« Auld Eppie’s tales » et de « Days of the Covenant », l’histoire de « Morton » et celle de James MacGregor, et diverses pièces.
Parmi les ouvrages religieux de Thomas McCulloch, on trouve Popery condemned by Scripture and the father : being a refutation of the principal popish doctrines and assertions [...] (Édimbourg, 1808) ; Popery again condemned [...] : being a reply to a part of the popish doctrines and assertions contained in the remarks on the refutation, and in the review of Dr. Cochran’s letters, by the Rev. Edmund Burke [...] (Édimbourg, 1810) ; The prosperity of the church in troublous times [...] (Halifax, 1814), réimprimé with introductory remarks by Rev. Robert Grant (New Glasgow, N.-É., 1882) ; Words of peace : being an address, delivered to the congregation of Halifax [...] in consequence of some congregational disputes [...] (Halifax, 1817) ; The report of a committee, appointed by the synod of the Presbyterian Church of Nova-Scotia, to prepare a statement of means for promoting religion in the church [...] (Halifax, 1818) ; A lecture, delivered at the opening of the first theological class in the Pictou academical institution [...] (Glasgow, 1821) ; A memorial from the committee of missions of the Presbyterian Church of Nova Scotia, to the Glasgow Society for Promoting the Religious Interests of the Scottish Settlers in British North America [...] (Édimbourg, 1826) ; A review of the Supplement to the first annual report of the Society [...] ; in a series of letters to the Rev. Robert Burns [...] (Glasgow, 1828) ; et Calvinism, the doctrine of the Scriptures, ouvrage posthume publié à Glasgow, en 1846.
McCulloch figure aussi dans la dédicace d’un manuscrit, comme l’un des membres du comité qui rédigea la brochure intitulée The subjects and mode of baptism ascertained from Scripture, being a conversation between a private Christian and a minister [...] ; by a committee of the Associate Presbytery of Pictou (Édimbourg, 1810), dont un exemplaire est conservé à l’Univ. of Edinburgh Library. Sa conférence sur l’éducation, donnée en 1818, a été publiée sous le titre de The nature and uses of a liberal education illustrated ; being a lecture, delivered at the opening of the building, erected for the accommodation of the classes of the Pictou academical institution (Halifax, 1819).
Les ouvrages littéraires de McCulloch, qui ont été publiés, sont : Colonial gleanings (Édimbourg, 1826) et les lettres signées Stepsure. Ces lettres n’ont paru sous la forme d’un roman qu’en 1862, lorsque Hugh William Blackadar* les imprima sans nom d’auteur à Halifax sous le titre de The letters of Mephibosheth Stepsure (l’année 1860 qui apparaît sur la page de titre est une erreur). Une édition plus récente, accompagnée d’une introduction de Northrop Frye et annotée par John Allan Irving et Douglas G. Lochhead, a été publiée sous le nom de McCulloch et porte le titre de The Stepsure letters ([Toronto], 1960) ; une autre édition, accompagnée d’une introduction de Gwendolyn Davies, est en cours de préparation par le Centre for Editing Early Canadian Texts, de la Carleton University, à Ottawa.
Atlantic Baptist Hist. Coll., Acadia Univ. (Wolfville, N.-É.), Edward Manning, corr., vol. 1 ; Thomas McCulloch letters, 1821–1825.— Dalhousie Univ. Arch. (Halifax), DAL, MS 2–40 (Thomas McCulloch papers) ; MS 2–41 (J. J. Audubon letters).— NLS, Dept. of
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Susan Buggey et Gwendolyn Davies, « McCULLOCH,THOMAS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/mcculloch_thomas_7F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mcculloch_thomas_7F.html |
| Auteur de l'article: | Susan Buggey et Gwendolyn Davies |
| Titre de l'article: | McCULLOCH,THOMAS |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1988 |
| Année de la révision: | 1988 |
| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |



