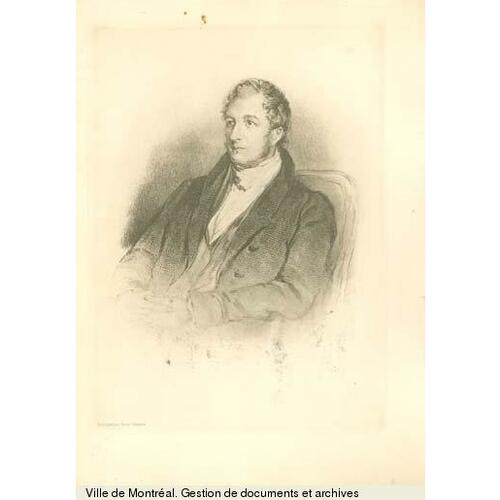Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2904938
GALT, JOHN, auteur et colonisateur, né le 2 mai 1779 à Irvine, Écosse, fils de John Galt, capitaine de navire, et de Jean Thomson ; le 20 avril 1813, il épousa à Londres Elizabeth Tilloch, et ils eurent trois fils, dont Thomas et Alexander Tilloch* ; décédé le 11 avril 1839 à Greenock, Écosse.
John Galt naquit dans une région où les distinctions de classe s’estompaient rapidement et où les horizons intellectuels s’élargissaient sous l’effet conjugué de la philosophie écossaise des Lumières et de la Révolution française. Le métier de son père et la vue des navires qui sillonnaient la Clyde étendirent certainement ses horizons géographiques, mais l’excentricité et le langage pittoresque de sa mère modelèrent bien davantage sa personnalité, en lui instillant ce qu’il appelait sa « prédilection héréditaire pour les bizarreries ». Sa piètre santé le mit à part des autres enfants, le poussa à l’introspection et l’amena à fréquenter les vieilles femmes qui habitaient derrière chez sa grand-mère. En les écoutant raconter leurs souvenirs et leurs histoires, le jeune Galt devint féru de ballades et de contes, ce qui marqua son œuvre d’écrivain, comme il l’admit dans The literary life [...]. Sa mère voyait d’un mauvais œil sa passion pour les livres (comme sa fascination pour les fleurs) ; elle l’incitait plutôt à l’action et espérait le voir réussir dans le monde. En contrebalançant sa tendance à l’isolement, l’attitude maternelle contribua peut-être à faire naître en lui cet éternel tiraillement entre la vie littéraire et la vie « active ». Dans son autobiographie, il note que la mort de sa mère, survenue en 1826, « affaiblit [...] le mobile qui avait auparavant aiguillonné [ses] énergies ».
Galt eut toujours une allure très impressionnante. Selon un camarade de classe, G. J. Weir, à 7 ans il avait déjà la taille d’un garçon de 14 ans. Dès sa jeunesse pourtant, il se crut appelé à se distinguer autrement que par son bel air et sa « carrure herculéenne » ; tout à fait conscient de ses lacunes, il comprit « la nécessité de devenir l’artisan de [sa] propre ascension ». À cause de sa santé fragile et du fait que sa famille vivait tantôt à Irvine, tantôt à Greenock (où elle se fixa finalement vers 1789), il ne fit que des études sporadiques et eut des précepteurs à la maison ou à l’école. À cette époque, dans l’Ayrshire, il n’aurait pas été exceptionnel pour un garçon de son milieu d’aller à l’université, mais apparemment ses parents et lui considéraient le commerce comme un choix naturel. Entré au bureau des douanes de Greenock vers l’âge de 16 ans, il le quitta bientôt pour occuper, dans la même ville, un poste de commis à la James Miller and Company.
Galt put grandement parfaire son éducation en formant un cercle de littérature et de discussion avec deux compagnons d’école, William Spence et James Park. Ensemble ils organisèrent en 1804 une rencontre avec le poète James Hogg – le célèbre berger d’Ettrick – qui rapporta que leur conversation était « bien supérieure à ce qu[’il] avai[t] jamais été accoutumé à entendre ». La fréquentation de ses deux amis (emportés toutefois prématurément par la maladie) amena Galt à définir ses priorités : il s’occuperait de commerce le jour, et se consacrerait à la culture et à la littérature le soir ; en outre, elle élargit ses horizons intellectuels grâce à l’émulation et à la critique réciproque. Spence s’intéressait davantage aux mathématiques, et Park à la critique littéraire, qu’à la création proprement dite. D’un naturel combatif, Galt les concurrençait dans leur domaine. La double occupation qui était sienne à cette époque développa en lui une détermination et une discipline telles qu’il avait malgré tout « beaucoup plus de loisirs que la plupart des hommes ». Il mentionna d’ailleurs en 1834 : « [en] bien moins de deux années extrêmement pénibles, j’ai pu dicter et publier dix ouvrages – dont une bonne partie alité ». Voilà qui prouve l’efficacité de son régime de vie et de son « travail sédentaire ».
Dès 1804, Galt sortait du rang : assidu en affaires, il travaillait à la Greenock Library, avait publié quelques poèmes dans le Greenock Advertiser ainsi que dans le Scots Magazine et avait levé un corps de tireurs d’élite volontaires pour contrer ce qu’il appelait la deuxième guerre révolutionnaire de France. Il était pourtant insatisfait de son sort. Un jour que ses employeurs avaient reçu une lettre d’insultes au sujet de leurs pratiques commerciales, il réagit trop fort : il poursuivit le coupable et le tint en respect jusqu’à ce qu’il ait rédigé une lettre d’excuses. Cet incident, et peut-être aussi un chagrin d’amour (la jeune fille mourut), le décida à partir pour Londres en mai 1804. Ce fut le premier et le plus dramatique de ses voyages. Son principal objectif était de fonder sa propre entreprise, ce qu’il fit après quelques mois de solitude. Bientôt, la compagnie de consignation et de courtage qu’il forma en 1805 avec un compatriote, John McLachlan, rapporta la somme alors considérable de £5 000 par an. En 1807, il publia dans le Philosophical Magazine un premier article sur l’Amérique du Nord : « A statistical account of Upper Canada ». Son cousin et compagnon de classe William Gilkison*, qui avait été capitaine de navire sur les Grands Lacs, lui avait fourni des renseignements pour ce texte qu’il rédigea en toute hâte, en partie pour faire valoir que l’émigration vers le Nouveau Monde allégerait le problème de la surpopulation en Europe. Les succès financiers de Galt lui valurent sans doute une grande renommée dans la Cité et convainquirent son père de lui transférer une forte somme d’argent. Cependant, à cause de la complexité des affaires et de la faillite d’un correspondant (racontée dans The Autobiography of John Galt), son entreprise subit de lourdes pertes et ferma ses portes au cours de sa troisième année d’existence.
Ce revers, qui suivait la réalisation de certaines de ses « ambitions démesurées », força Galt à changer d’orientation. Entré à la Lincoln’s Inn pour y étudier le droit, il dut cependant abandonner peu après pour cause de maladie et partit en voyage en 1809 dans l’espoir de se remettre. Contrairement à la mode de l’époque, il ne fit pas de grande tournée européenne ; il cherchait plutôt à circonvenir le blocus continental en établissant une route commerciale via l’Empire ottoman. Après un échec, il fit une nouvelle tentative à Gibraltar, avec une compagnie dirigée par Kirkman Finlay, mais les victoires de lord Wellington dans la péninsule Ibérique rendirent son initiative inutile. Galt tomba malade encore une fois, comme dans presque tous les moments de crise. Rentré à Londres en 1811, il épousa deux ans plus tard Elizabeth Tilloch, fille de l’éditeur du Philosophical Magazine, et tenta de vivre principalement de sa plume.
Après son retour, Galt publia à compte d’auteur deux amusants récits de voyage. En 1812, il fit paraître un recueil de cinq de ses tragédies, de même que Life and administration of Cardinal Wolsey, ouvrage solidement documenté qui connut plusieurs éditions. Les critiques pourfendirent ces pièces : dans une lettre, Walter Scott dit qu’elles étaient « les pires jamais vues ». Par contre, son premier récit de voyage eut un tel succès que, selon Galt, le produit des ventes remboursa son long périple. En 1816, il publia la première partie d’une biographie de Benjamin West, peintre américain et président de la Royal Academy of Arts. Durant cette période, Galt produisit aussi beaucoup de manuels scolaires, principalement sous les pseudonymes de sir Richard Phillips et de John Souter. Cependant, si l’on exclut les ouvrages d’imagination, il est difficile d’identifier tous ces écrits car, au cours de sa carrière, il utilisa au moins dix noms de plume et publia souvent sous le couvert de l’anonymat. De son propre aveu, il avait voulu, par ses premières incursions en littérature, « acquérir la réputation d’un type brillant », mais ses revers commerciaux et littéraires, comme son besoin désespéré d’argent (sa famille s’agrandissait, et il avait choisi de partager la succession paternelle avec sa mère et sa sœur), l’amenèrent à considérer autrement son travail d’écrivain. Ce qu’il appelait son dernier ouvrage d’amateur, un conte sicilien intitulé The Majolo [...], parut en 1816.
The earthquake (1820), que Galt considérait comme son premier roman sérieux, fut un échec commercial. En revanche, il remporta un certain succès au théâtre avec The appeal [...] (1818), dont Scott, affirmait-il, avait composé l’épilogue. L’année 1820 marqua un tournant : il connut une popularité immédiate avec The Ayrshire legatees [...], roman épistolaire publié en feuilleton par William Blackwood, dans lequel Galt raconte, avec une ironie semblable à celle de Smollett, le voyage que fait à Londres une famille d’Écossais pour toucher un héritage. Suivit en 1821 son ouvrage encore le plus célèbre, Annals of the parish [...], publié sous forme de livre par Blackwood et que la critique acclama.
Bien que Annals ait souvent passé pour un roman, il s’insère dans une catégorie d’ouvrages que Galt qualifiait d’« histoires théoriques ». Écrit sous forme d’autobiographie fictive (genre dont Galt fut l’un des artisans les plus précoces, les plus innovateurs et les plus prolifiques), ce livre dépeint, tels que les voit un prêtre de village, les changements sociaux et industriels qui balayaient l’Ayrshire à l’époque. Encore aujourd’hui, ses compatriotes apprécient fort qu’il y ait employé le dialecte de l’ouest du pays, auquel il tenait au point d’avertir Blackwood de « ne toucher à aucun des idiotismes écossais ». Par contre, cet emploi gêne quelque peu le Nord-Américain qui lit aujourd’hui ses œuvres écossaises. Galt continua dans la veine réaliste en publiant Sir Andrew Wylie [...] (1822) ; lord Blessington, qui avait à son insu servi de modèle à l’auteur, lui déclara que le personnage de lord Sandiford lui semblait « très naturel, car dans les mêmes circonstances il aurait agi de manière semblable ». Loué avec raison pour sa capacité de recréer le réel, Galt essuyait parfois des reproches à cause de son manque d’imagination. Dans Autobiography et Literary life, il prit la peine de souligner que sa particularité comme écrivain était « l’originalité », et que ses meilleurs livres prouvaient qu’il aurait pu faire encore mieux si la littérature avait été son unique occupation.
La comtesse de Blessington, qui devint sa protectrice littéraire, et lord Byron (avec qui il avait voyagé en Méditerranée en 1808–1809 et dont il allait publier en 1830 une biographie très critiquée mais très lue) aidèrent Galt à atteindre la renommée. Dans Literary life, il note qu’il était en relation avec plus de femmes de la noblesse que du commun et qu’il connaissait une soixantaine de membres du Parlement. Après le succès que connut The Ayrshire legatees, il n’avait pas ménagé ses efforts : les plus célèbres de ses contes écossais intitulés « Tales of the west » parurent presque tous entre 1820 et 1822. Il publia en 1822 l’histoire fictive d’un élu municipal, The provost, que l’historien de la littérature Keith M. Costain a comparé au Prince de Machiavel. Avec The member [...] (1832) et The radical [...] (1832), cet ouvrage montre que Galt contribua tôt et de manière importante à l’évolution du roman politique. Il est difficile d’évaluer l’effet de son œuvre sur les hommes politiques, dans un siècle où la littérature avait un immense pouvoir, mais il vaut la peine de noter que George Canning lut The provost d’une seule traite en assistant à une séance du Parlement. Apparemment, le succès des contes écossais (The last of the lairds [...] s’ajouta à la série en 1826) monta à la tête de Galt. Se vantant de mieux connaître l’âme écossaise que Scott lui-même, il se mit au roman historique. Trois ouvrages aujourd’hui presque oubliés en résultèrent : Ringan Gilhaize [...] (1823), The spaewife [...] (1823) et Rothelan [...] (1824).
Au début des années 1820, Galt relança sa carrière commerciale en s’occupant de ce qui allait devenir la Canada Company. Cette société naquit à la suite des efforts que déployèrent les loyalistes haut-canadiens de la frontière du Niagara en vue d’obtenir réparation pour les dommages qu’avaient causés les troupes américaines pendant la guerre de 1812. Galt s’était fait un nom dans le milieu des coulissiers parlementaires, particulièrement en facilitant, par ses stratagèmes, l’adoption d’un projet de loi pour la construction du canal Union en Écosse en 1819. Cette renommée, ses lointaines relations familiales en Amérique du Nord et le fait qu’il avait publié « A statistical account of Upper Canada » une douzaine d’années plus tôt incitèrent les loyalistes à le pressentir comme mandataire. La promesse d’une commission de 3 % le convainquit d’accepter. Toutefois, le gouvernement britannique se révéla réticent à indemniser les victimes et, par la suite, Galt ne réussit pas à emprunter pour liquider les réclamations. C’est alors qu’il songea, probablement sous la pression d’un vieil ami et résident du Haut-Canada, le prêtre catholique Alexander McDonell, à utiliser les ressources de la colonie. La solution consistait à vendre les réserves de la couronne et du clergé, établies en vertu de l’Acte constitutionnel de 1791, et à affecter une part de la recette au dédommagement de ceux qui l’avaient mandaté.
Galt mettait beaucoup d’espoir dans cette stratégie, mais elle ne donna pas grand résultat, du moins sur le moment. En revanche, l’idée de liquider les réserves arrivait à point, et Galt l’employa dans un autre projet : il forma, avec des marchands et des banquiers londoniens, une société par actions qui achèterait les terres de ces réserves et les revendrait à profit à des émigrants britanniques. En 1824, Galt était secrétaire de cette société dont le capital projeté s’élevait à un million de livres et qui réunissait certains des plus éminents financiers de Londres. La Canada Company n’obtint sa charte que le 19 août 1826, au terme de deux ans de disputes avec le gouvernement. Pendant cette période, Galt consacra au projet la plus grande part de son énergie débordante ; ainsi, au printemps de 1825, il visita le Haut-Canada avec les quatre autres commissaires chargés d’évaluer les terres à acheter. Par suite de querelles avec des personnages de la colonie, surtout le procureur général John Beverley Robinson* et le révérend John Strachan*, on remplaça les réserves du clergé (c’est-à-dire la moitié du total) par ce qu’on appela plus tard la Huron Tract, soit un million d’acres situées en région sauvage. En définitive, la compagnie choisit d’acheter parmi les réserves de la couronne un million et un tiers d’acres situées un peu partout dans la colonie, en plus de la Huron Tract et de diverses terres qui totalisaient au delà d’un million d’acres. Elle paya le tout un prix uniforme de 3s 6d l’acre.
Comme Galt devait s’occuper sur place des affaires de la compagnie, il élut domicile dans le Haut-Canada en décembre 1826. Dès lors, il eut beaucoup à faire. Au bureau qu’il ouvrit à York (Toronto), il examinait d’innombrables offres d’achat. En avril 1827, il fonda en grande pompe la localité de Guelph puis, grâce à un plan assez ambitieux d’investissement de capitaux, en fit rapidement un foyer de peuplement (il était très influencé par ces espèces de villes champignons qu’étaient les domaines de la Holland Land Company et de Pulteney, qu’il avait visités dans l’ouest de l’État de New York) [V. David Gilkison*]. Parti en expédition de reconnaissance au lac Huron, il arriva à la fin de juin au campement de William Dunlop et de Mahlon Burwell, respectivement gardien et arpenteur au service de la Canada Company. Il fonda à cet endroit une autre ville champignon, Goderich. Dès l’automne de 1828, une route la reliait à Guelph, qui avait continué de se développer rapidement pendant l’année. On embaucha Samuel Strickland* pour gérer les affaires de la compagnie à Guelph et achever les travaux entrepris par Galt. De plus, en 1827 et 1828, Galt ouvrit des agences de la compagnie ailleurs en Amérique du Nord.
Singulière, repliée sur elle-même, la population de la petite ville d’York ne savait comment réagir face à un visionnaire déterminé comme Galt. Quant à lui, même s’il connaissait les idiosyncrasies des communautés isolées (comme il allait le démontrer dans ses romans nord-américains), il accumula les bévues : il s’associa à des réformistes comme John Rolph* et fréquenta des gens qui n’avaient pas la faveur de l’establishment local, dont la femme de John Walpole Willis* ; enfin, dans un geste irréfléchi mais compréhensible, il retint des fonds dus au gouvernement afin d’aider les colons indigents de La Guayra, ces immigrants britanniques qui n’avaient pas réussi à s’établir en Amérique du Sud et que, à défaut d’entente officielle sur leur cas, on avait acheminés à la Canada Company dans le Haut-Canada. Galt, qui manqua toujours de déférence envers l’autorité, se brouilla avec le lieutenant-gouverneur sir Peregrine Maitland*, son secrétaire le major George Hillier, l’archidiacre Strachan et le family compact. Tolérant en matière religieuse et bien disposé envers les Indiens des Six-Nations, dont il avait présenté les revendications foncières en Angleterre en 1825 [V. Tekarihogen* (1794–1832)], il ne pouvait pas être accepté d’emblée dans la société étriquée et partiale d’York. Son sentiment d’être victime de complots (sujet abordé dans Autobiography) confinait à la paranoïa, mais son principal problème, que l’éloignement de la métropole compliquait encore davantage, était que les administrateurs de la compagnie le soupçonnaient de trop dépenser et de produire des comptes incomplets. De fait, non seulement Galt était-il épouvantablement nul en tenue de livres mais, trop occupé à mettre en valeur les plus vastes domaines de la compagnie, le bloc de Guelph et la Huron Tract surtout, il avait négligé la vente des terres facilement accessibles soit à partir d’York, soit par route ou par eau, ou encore celle des réserves de la couronne qui étaient éparpillées. Au printemps de 1828, la Canada Company dépêcha auprès de lui son comptable, Thomas Smith, en principe pour l’aider mais en réalité pour faire enquête. Lorsque Smith rentra en toute hâte à Londres avec des documents de la compagnie, Galt décida d’y retourner afin de rassurer les administrateurs. À son arrivée à New York, au début de 1829, il apprit qu’il avait été rappelé ; Thomas Mercer Jones* et William Allan* le remplaceraient. Il débarqua le 20 mai en Angleterre, où les journaux avaient annoncé son rappel. Assailli par ses créanciers, il fut bientôt emprisonné pour n’avoir pas payé les frais de scolarité de ses fils.
Comme dans bien des échecs commerciaux de ce genre, les faits demeurent obscurs. Le rappel de Galt coïncida avec une chute des actions de la compagnie sur le marché londonien. Assurément, dans la gestion quotidienne et les ventes courantes, il avait eu moins de panache que lorsqu’il inaugurait des routes et fondait des villes. Ses successeurs allaient être plus discrets, plus attentifs aux petites choses. Il demeure néanmoins que la surintendance de Galt à la Canada Company fut une étape importante dans le développement de la province. Bien que la compagnie ait fait souvent l’objet de controverses [V. Frederick Widder*], elle contribua beaucoup au peuplement, et on ne la liquida que dans les années 1950, après la vente de son dernier lot. Quant à Galt, même si son rappel avait nui gravement à sa réputation d’homme d’affaires, il put dès 1833 (soit au moment où les actions de la Canada Company étaient les plus en demande sur le marché, grâce en grande partie au travail de Jones et d’Allan) lancer une entreprise coloniale, la British American Land Company, dont le but était de mettre des terres en valeur dans les Cantons-de-l’Est, au Bas-Canada. Galt en fut le secrétaire mais dut démissionner en décembre 1832 pour des raisons de santé.
Pendant son séjour en prison, Galt s’était remis à écrire afin de s’assurer un revenu. Avec l’aide d’anciens éditeurs comme Blackwood et de nouveaux, tels Henry Colburn et Richard Bentley, il put mettre fin à son incarcération principalement en mettant à profit ses expériences canadiennes. Lawrie Todd [...] (1830), Bogle Corbet [...] (1831) et Autobiography (1833), œuvres qui servent d’ordinaire à mesurer son importance à titre d’écrivain du Nouveau Monde, parurent coup sur coup après sa libération, survenue en novembre 1829, et ce même s’il était déjà gravement handicapé par ce qui semble avoir été de l’artériosclérose. Les cinq dernières années de sa vie furent marquées par d’énormes souffrances et, comme il en témoigna lui-même, par l’invalidité. Il continua néanmoins de publier abondamment livres et articles. En 1834, il quitta Londres avec sa femme pour s’installer à Greenock. Les trois volumes de Literary life parurent la même année, et le Fraser’s Magazine demeura un débouché pour ses talents journalistiques. En 1837 cependant, il avait ralenti son rythme et ne produisait plus que des textes mineurs, des recensions et quelques poèmes. Il mourut à Greenock le 11 avril 1839.
Le Canada ne peut guère prétendre avoir occupé une grande place dans la vie de Galt, puisqu’il y résida moins de trois ans. Il avait eu l’intention de s’y établir en permanence, mais ce furent plutôt ses fils qui le firent, en 1833–1834 : l’aîné, John, devint registrateur du comté de Huron ; Thomas devint juge en chef de l’Ontario ; le benjamin, Alexander Tilloch, travailla pour la British American Land Company et fut l’un des Pères de la Confédération ainsi que le premier haut commissaire du Canada à Londres. John Galt croyait que l’on se souviendrait encore de son passage à la Canada Company « quand [ses] nombreux livres ser[aient] oubliés ». De 1807 à 1836, soit pendant toute la durée de sa vie active, il publia sur l’Amérique du Nord plus de 30 écrits dont la majorité traitent du Canada. Tout à fait conscient d’assister à la naissance de nouvelles identités nationales, il exprimait, notamment dans ses articles du Fraser’s Magazine sur les « traditions américaines », l’excitation qu’il éprouvait à contribuer, tant dans le réel qu’en littérature, à la mise au monde de la conscience nationale des Haut et des Bas-Canadiens. Dès 1813, dans un ouvrage malicieusement intitulé Letters from the Levant [...], il avait parlé de son intérêt pour « tout ce qui tend à préserver, à intensifier et à perpétuer ces affections populaires qui, malgré qu’il [ait été alors] à la mode de les qualifier de préjugés, demeurent les sources qui renforcent, élèvent et soutiennent la dignité des nations ».
Attentif à encourager les bons « préjugés nationaux », Galt dépeignit tous les segments de la société nord-américaine, dont les immigrants pauvres dans Lawrie Todd et ceux plus fortunés dans Bogle Corbet. En employant le slang américain dans Lawrie Todd et en utilisant la langue, fort différente, du Canada dans Bogle Corbet (qui précéda de cinq ans le premier des livres où Thomas Chandler Haliburton* mit en scène son personnage de Sam Slick), il a laissé d’importantes archives sociales et historiques. Ses portraits de la vie pionnière, qu’il jugeait plus fidèles que ceux de l’Américain James Fenimore Cooper, allaient selon lui devenir de plus en plus précieux avec le temps. La critique Elizabeth Waterston a signalé que Bogle Corbet fut le « premier ouvrage d’importance à définir l’identité canadienne par rapport à un modèle américain ». De plus, ce livre raconte l’histoire d’un anti-héros, et le recours fréquent de Galt à des anti-héros masculins non militaires, surtout dans Bogle Corbet et Autobiography, démontre qu’il avait la conviction que « l’homme qui fait pousser un épi de maïs là où il n’y en a jamais eu fait davantage pour le bien du monde que n’en fit Jules César ». D’autres critiques, dont Clarence G. Karr, ont suggéré que l’intérêt personnel le stimulait plus qu’il ne le laissait croire. Certes, Galt présenta une requête au gouvernement afin d’obtenir une commission sur la vente des terres de la couronne, mais il estimait que sa réclamation était juste, qu’il avait « contribu[é] au bien-être de l’humanité », aidé à « bâtir en terre vierge un asile pour les exilés de la société – un refuge pour ceux qui fuyaient les calamités du vieux monde et ses systèmes voués à l’échec ». Il notait d’ailleurs dans Literary life : « Je n’ai pas non plus souvenance d’avoir tiré vanité de quelque louange dont mon propre jugement n’avait pas ratifié, à un degré quelconque, le bien-fondé. »
Dans quelle mesure les efforts et les idées de Galt contribuèrent-ils à la naissance de la conscience canadienne et américaine ? Pareille question ne saurait trouver de réponse. Par contre, on sait que Autobiography fut réimprimé deux fois à Philadelphie l’année même de sa publication en Angleterre et qu’en 1849 Lawrie Todd en était à sa dix-septième édition. Les réclames de l’époque montrent que certaines œuvres de Galt étaient en vente dans le Haut-Canada ; Henry Chapman réimprima The life of Lord Byron à Niagara (Niagara-on-the-Lake) en 1831. On reconnaît le prix que Galt accordait à ses œuvres nord-américaines par les longues mentions qu’il en fait dans Autobiography et dans Literary life.
De toute évidence, la renommée de John Galt au Canada tient à ses liens avec la Canada Company, tandis qu’en Grande-Bretagne elle repose sur ses « histoires théoriques » écossaises. En partie parce qu’il avait changé de lieu d’activité et avait cru que littérature et affaires n’étaient pas incompatibles, sa réputation déclina après sa mort. La dichotomie qu’il créa lui-même en racontant successivement, à un an d’intervalle, sa vie d’homme d’affaires et sa vie d’écrivain gêna encore davantage l’appréciation globale de ses réalisations. Le fait qu’il fut rappelé du Haut-Canada au moment même où sa carrière de colonisateur était à son apogée freina ses ambitions nord-américaines, et sa réputation en Grande-Bretagne pâtit de la confusion dans laquelle se trouvaient ses affaires littéraires à sa mort. Ce n’est que récemment que les historiens ont rétabli l’importance du rôle de Galt au Canada, pays où les affaires ont occupé une place centrale, et que la réévaluation et la réédition de ses œuvres ont confirmé l’originalité et l’importance de son apport à la littérature britannique et nord-américaine. Bien qu’il existe de bonnes études littéraires et historiques sur Galt, on attend toujours l’ouvrage définitif qui montrera toute son importance pour les deux continents et pour les mondes de la littérature et des affaires.
La plupart des manuscrits des ouvrages publiés de John Galt ont été perdus ou détruits ; ceux qui restent ainsi que ses autres papiers sont éparpillés dans plusieurs établissements du Canada et de la Grande-Bretagne. La NLS, Dept. of mss, conserve un bon nombre de ses lettres de même que quelques manuscrits littéraires. Une partie de la collection de manuscrits divers que Mme Galt rapporta au Canada à la suite du décès de son mari se trouve dans les papiers Galt aux APC, MG 24, I4, tandis que d’autres documents sont inclus dans ses papiers aux AO, MU 1113–1115. Les AO possèdent aussi une volumineuse collection de documents de la Canada Company qui contiennent plusieurs lettres d’affaires de Galt. Au PRO, dans les papiers du ministère des Colonies, particulièrement CO 42/367 ; 42/369 ; 42/371 ; 42/374 ; 42/376 ; 42/379–381 ; 42/383 ; 42/387–389, et aux APC, RG 5, A1, on trouve également beaucoup de documents concernant les entreprises de Galt au Canada.
L’Univ. of Guelph Library, Arch. and Special Coll., dans la ville fondée par Galt, est sans doute le seul établissement qui tente d’acquérir toutes sources manuscrites ou imprimées ayant trait à Galt, que ce soit les différentes éditions de ses ouvrages publiés ou des études critiques le concernant comme auteur ou colonisateur. La bibliothèque possède ainsi une vaste collection d’ouvrages publiés incluant plusieurs éditions originales et rares, de même qu’un grand nombre de collections de documents pertinents, dont la plus remarquable est celle de H. B. Timothy, acquise récemment, et un bon nombre de manuscrits littéraires de Galt, dont sa biographie inédite de sir Walter Scott. Il existe de plus petites collections de documents sur Galt dans les Lizars family papers, la Goodwin-Haines coll., et dans les Canada Company papers.
L’article de Harry Lumsden, « The bibliography of John Galt », Glasgow Biblio. Soc., Records, 9 (1931), et l’ouvrage d’I. A. Gordon, John Galt : the life of a writer (Toronto et Buffalo, N. Y., 1972), constituent les meilleures sources bibliographiques. Le livre de Gordon avec celui de J. W. Aberdein, John Galt (Londres, 1936), et l’article de [D. M. Moir], « Biographical memoir of the author » (paru sous la lettre grecque delta dans l’édition de 1841 de l’ouvrage de Galt, The annals of the parish and the Ayrshire legatees [...] (Édimbourg et Londres), i-cxiii), sont les études les plus approfondies sur la carrière littéraire de Galt. P. H. Scott, dans John Galt [...] (Édimbourg, 1985), fait une analyse plus limitée, mais il est le premier à accorder aux ouvrages de Galt sur l’Amérique du Nord leur place véritable. Deux recueils d’essais, John Galt, 1779–1979, C. A. Whatley, édit. (Édimbourg, 1979), et John Galt : reappraisals, Elizabeth Waterston, édit. (Guelph, 1985), présentent des critiques récentes sur Galt.
L’ouvrage le plus érudit concernant l’activité de Galt au sein de la Canada Company est celui de R. D. Hall, « The Canada Company, 1826–1843 » (thèse de ph.d., Univ. of Cambridge, Cambridge, Angl., 1973). On peut aussi consulter : R. K. Gordon, John Galt (Toronto, 1920) ; H. B. Timothy, The Galts : a Canadian odyssey ; John Galt, 1779–1839 (Toronto, 1977) ; Thelma Coleman et James Anderson, The Canada Company (Stratford, Ontario, 1978) ; et C. G. Karr, « The two sides of John Galt », OH, 59 (1967) : 93–99.
Galt fut un auteur tellement prolifique que ses écrits sur l’Amérique du Nord ont été submergés par la masse de ses autres ouvrages. La liste chronologique suivante de ses publications relatives à l’Amérique du Nord et aux affaires coloniales constitue un extrait des titres de l’ensemble de son œuvre et, quoique non exhaustive, une preuve de l’intérêt prolongé de Galt pour les affaires du Nouveau Monde.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Roger Hall et Nick Whistler, « GALT, JOHN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/galt_john_7F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/galt_john_7F.html |
| Auteur de l'article: | Roger Hall et Nick Whistler |
| Titre de l'article: | GALT, JOHN |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1988 |
| Année de la révision: | 1988 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |