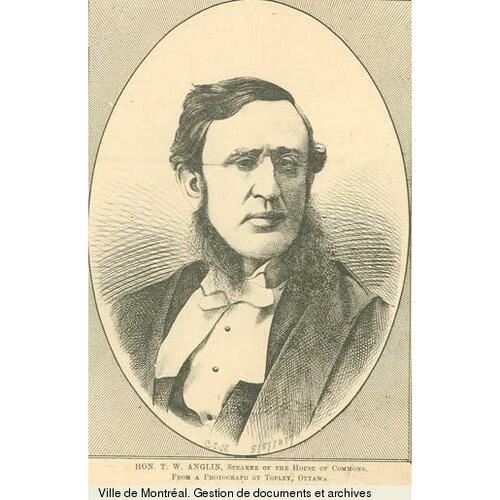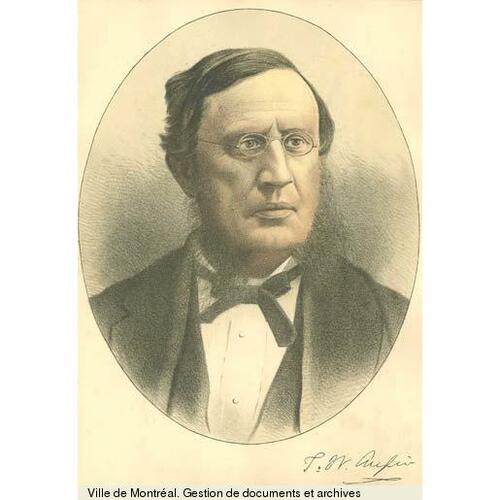Provenance : Lien
ANGLIN, TIMOTHY WARREN, journaliste, éditeur, homme politique et fonctionnaire, né le 31 août 1822 à Clonakilty (république d’Irlande), fils de Francis Anglin, employé de l’East India Company, et de Joanna Warren ; en 1853, probablement le 26 novembre, il épousa à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, Margaret O’Regan (décédée en 1855), et ils n’eurent pas d’enfants, puis le 25 septembre 1862, dans la même ville, Ellen McTavish, et de ce mariage naquirent dix enfants ; décédé le 3 mai 1896 à Toronto.
Né dans une famille irlando-catholique, bourgeoise et relativement à l’aise du comté de Cork, Timothy Warren Anglin fit de bonnes études classiques à Clonakilty. Il se destinait au droit, mais la grande famine qui frappa l’Irlande en 1845 mit fin à ses projets ; il dut se résigner à enseigner dans une école de sa ville natale. Le lundi de Pâques 1849, il s’embarqua pour Saint-Jean, manifestement convaincu qu’immigrer augmenterait ses chances de réussite. Ses antécédents irlandais, catholiques et bourgeois l’influenceraient tout au long de sa vie et en feraient un porte-parole éloquent des catholiques irlandais du Nouveau-Brunswick et du Canada.
Anglin était arrivé depuis peu à Saint-Jean lorsqu’il fit sa première intervention publique. À la suite d’une émeute survenue le 12 juillet, il écrivit à un journal de la ville, le Morning News, une longue lettre dans laquelle il déplorait les luttes confessionnelles, reprochait aux autorités municipales d’avoir laissé dégénérer les événements et pressait chacun de rester calme pour travailler ensemble au bien de la colonie. Cette lettre le fit remarquer et acheva de le convaincre de fonder un journal. Le Saint John Weekly Freeman, voué à l’amélioration de la condition des Irlando-catholiques de la ville, parut pour la première fois le 4 août 1849.
Au fil des années 1850, Anglin devint, par l’intermédiaire de son journal, le porte-parole laïque reconnu des Irlandais catholiques, qui représentaient environ le tiers de la population de Saint-Jean. Comme ils en formaient la tranche la plus pauvre, ils souffraient d’autant plus des piètres salaires, du chômage, des mauvaises conditions de logement et des maladies. Ils subissaient diverses formes de discrimination : économique, sociale, politique et religieuse, et les citoyens « respectables » les jugeaient enclins à l’ivrognerie, à la débauche et à la violence. À titre de leader catholique irlandais, Anglin menait sa bataille sur plusieurs fronts. Il défendait ses compatriotes lorsqu’on les accusait d’être dépravés ou de représenter un fardeau pour la société. Il cherchait à leur redonner le respect d’eux-mêmes en publiant des nouvelles d’Irlande, en appuyant la formation de groupes ethno-religieux comme l’Irish Friendly Society ou en encourageant la création de sociétés de bienfaisance catholiques. Mais il les incitait aussi à supplier Dieu de les aider à se réformer et à se transformer. Dans le Freeman, il stigmatisait les bagarres, l’immoralité, les parents qui, « trop paresseux pour travailler, ou trop dissipés et lâches pour faire vivre leur famille », poussaient leurs enfants à « faire de la mendicité un métier ». En un sens, il montrait peu de compassion et de compréhension, mais son attitude se justifie : selon lui, les catholiques irlandais, pour se faire accepter, devaient éviter tout agissement qui menaçait le tissu social ou effrayait les groupes dominants. Anglin se sentait tenu de les « réformer » afin d’être mieux en mesure de réclamer ensuite, pour eux, plus de reconnaissance sociale et de droits. Sa position, identique à celle de l’Église, est bien celle d’un bourgeois qui n’était pas tout à fait aveugle à la pauvreté dans laquelle beaucoup vivaient. Même sa philosophie économique ne différait guère de l’individualisme du xixe siècle, qui prônait le laisser-faire. Certes, il favorisait la création de diverses entreprises, à Saint-Jean et dans les environs, car elles donneraient du travail aux catholiques irlandais, mais il était convaincu que les règles du jeu devaient être celles de la libre entreprise et du capitalisme.
Sans jamais être une grande réussite financière, le Freeman devint, dans les années 1850, un élément important de la vie politique du Nouveau-Brunswick et demeura la principale tribune d’Anglin pendant un quart de siècle. Celui-ci adorait le ton belliqueux qui dominait alors le journalisme politique et il excellait dans ce genre. D’abord, le Freeman appuya les réformistes, ou smashers comme on les appelait quelquefois, mais lorsqu’ils eurent pris le pouvoir, en 1854, Anglin les trouva décevants. Le nouveau gouvernement, dirigé par Charles Fisher*, ne se montrait pas plus généreux que l’ancien à l’égard des catholiques. Le projet de loi de 1855, qui prohibait les boissons alcooliques sauf à des fins médicales, choqua Anglin ; pour lui, c’était là une négation des droits civils. Il rompit donc avec les smashers et resta dans l’opposition même après le rappel de la prohibition en 1856. En fait, il sembla toujours plus à l’aise dans l’opposition. C’était davantage un indépendant qu’un véritable homme de parti : sans doute avait-il des intérêts particuliers à défendre à titre de leader irlando-catholique, mais surtout il trouvait « plus facile et plus agréable » d’attaquer que de défendre.
Anglin tenta une première fois, en 1860, d’obtenir une charge publique, soit un siège d’échevin au conseil municipal de Saint-Jean, mais il échoua. En 1861, on l’élut député indépendant de la circonscription qui regroupait le comté et la ville de Saint-Jean à la chambre d’Assemblée du Nouveau-Brunswick. Durant toute sa carrière, sa pensée politique fut pragmatique, mais au fond il était libéral et vaguement démocrate. Il appuyait l’extension du suffrage, le scrutin secret et les élections simultanées ; cependant, ses tendances démocrates se mêlaient de libéralisme, terme qui à l’époque désignait l’individualisme et le laisser-faire prônés par la bourgeoisie de Grande-Bretagne. D’après lui, les idéaux libéraux se réaliseraient moins par des systèmes politiques ou des programmes législatifs précis que par le maintien, sous quelque forme de gouvernement que ce soit, de la justice et de la liberté individuelle. « Là où les droits de l’individu sont foulés aux pieds, écrivait-il, il y a despotisme. » C’est l’influence de la religion, et non l’utilisation du pouvoir de l’État, qui résoudrait les problèmes sociaux.
La guerre de Sécession et ses conséquences furent, dans les années 1860, déterminantes pour l’Amérique du Nord britannique. Anglin trouvait beaucoup à redire contre les sentiments, les idées et la conduite des chefs et des citoyens de la république ; cependant, il ne voyait nul motif de se réjouir des problèmes américains. À ses yeux, la destruction des États-Unis serait une tragédie pour le monde entier. En outre, contrairement à tant d’habitants de l’Amérique du Nord britannique, il ne trouvait aucune grande leçon constitutionnelle à tirer de la guerre. La source du mal était, selon lui, non pas le républicanisme ou la forme particulière du fédéralisme américain, mais l’esclavage érigé en institution et le fanatisme qui existait tant dans le Nord que dans le Sud.
La guerre souleva la question de la défense des colonies et du lien impérial. Anglin adopta une attitude nuancée envers la Grande-Bretagne. Sans jamais accepter la domination britannique de l’Irlande, il convenait toutefois qu’il n’était ni nécessaire ni juste de critiquer le lien impérial du point de vue de l’Amérique du Nord britannique. Ce lien constituait la meilleure protection des colonies contre toute tentative de conquête de la part des Américains. Anglin s’appliquait à faire valoir que les habitants de l’Amérique du Nord britannique, y compris les catholiques irlandais, ne désiraient nullement être intégrés dans la République américaine. Mais, comme les colonies étaient les témoins innocents des conflits entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, la mère patrie devait assumer en grande partie l’organisation et le financement de leur défense.
L’atmosphère de crise qu’engendra la guerre, combinée aux problèmes économiques et politiques des colonies, poussa les fonctionnaires britanniques et nombre de coloniaux à embrasser l’idée d’une union des colonies nord-américaines. Cette idée n’emballait pas Anglin, même s’il croyait l’union probable, voire opportune dans un avenir plus ou moins rapproché, surtout si la Grande-Bretagne rompait ses liens avec les colonies. À l’époque toutefois, il ne la trouvait ni nécessaire ni souhaitable. Elle n’apporterait ni puissance militaire ni avantages économiques extraordinaires, du moins aux gens du commun et surtout pas aux habitants de Saint-Jean ou du Nouveau-Brunswick. Les grands gagnants, prétendait-il, seraient les hommes politiques et les hommes d’affaires des colonies centrales, dont l’extravagance, l’extrémisme et l’incompétence avaient été à l’origine des problèmes coloniaux. Il valait bien mieux, pour les hommes publics, promouvoir le développement matériel essentiel, quoique banal, comme la construction routière, l’aide aux colons et la levée des barrières commerciales, plutôt que de poursuivre « des chimères et des fantaisies aux frais de la population ».
Puisque, pour Anglin, l’idée même de l’union était prématurée, on ne s’étonnera guère qu’il se soit opposé à la version particulière de ce projet contenue dans les Résolutions adoptées à Québec en 1864. Le Freeman en critiqua les conséquences économiques avec une sévérité particulière, soutenant que les arrangements financiers étaient injustes pour le Nouveau-Brunswick, qu’il faudrait augmenter les droits de douane à l’importation et qu’à Saint-Jean le transport et le secteur manufacturier se développeraient moins vite qu’ailleurs, et ainsi de suite. Quant aux dispositions constitutionnelles, Anglin estimait qu’il ne s’agissait pas d’une union législative de nature à protéger vraiment les intérêts particuliers du Nouveau-Brunswick. De plus, le fait que les délégués de la conférence de Québec entendaient soumettre le projet non pas à l’ensemble de l’électorat, mais uniquement aux Parlements coloniaux, le scandalisait : « De toute évidence, on conspire pour priver le peuple du droit de décider lui-même si cette union se réalisera ou non. »
La conjoncture qui régnait au Nouveau-Brunswick obligea le gouvernement de Samuel Leonard Tilley à tenir des élections au début de 1865. En personne et dans les colonnes du Freeman, Anglin livra une dure et habile bataille qui le rangea parmi les adversaires les plus notoires de la Confédération. Étant donné que la majorité s’opposait, comme lui, au projet d’union, le gouvernement essuya une cuisante défaite. Les partisans de la Confédération attribuèrent leur échec à divers facteurs, mais particulièrement à un complot fomenté par des ecclésiastiques et des laïques, tel Anglin, qui, croyaient-ils, avaient poussé les catholiques à voter en bloc contre eux. Tout au long de leur lutte pour l’union, ils appuyèrent leur stratégie sur cette conviction, pourtant erronée. Non seulement est-il douteux que les catholiques aient voté ainsi, mais il est assez évident qu’il n’y eut aucun effort concerté de la part de la hiérarchie ecclésiastique pour les pousser tous à accorder leur suffrage au même camp.
Anglin devint conseiller exécutif sans portefeuille dans le gouvernement hostile au projet confédératif formé en avril 1865 par Albert James Smith* et Robert Duncan Wilmot. Dès le début, la situation fut difficile. Le gouvernement était désavantagé par un ralentissement de l’économie, l’obstruction manifestée par le Conseil législatif et des divisions internes : certains membres du cabinet s’étaient opposés aux Résolutions de Québec sous prétexte qu’elles donnaient trop de pouvoir aux provinces, d’autres parce qu’elles n’en donnaient pas assez. De plus, les adversaires de la Confédération se firent accuser de déloyauté, surtout après que les autorités impériales eurent déclaré que l’union était hautement souhaitable, en particulier à des fins de défense. Dès le début, Anglin, l’Irlando-catholique, fut la cible de la campagne de « loyauté » des partisans de la Confédération. Même s’il semble avoir été un membre du cabinet consciencieux et utile, il constituait une cible de choix pour les attaques dirigées contre le gouvernement. Selon un journal, sa nomination même était « une contrainte et une insulte pour tout loyal sujet protestant de Sa Majesté dans la province ». S’opposer à la Confédération, répétait Anglin, n’était pas un signe de déloyauté envers l’Empire, mais il était impossible de mettre fin à une telle accusation, car elle était politiquement utile aux tenants de la Confédération.
La question de la loyauté prit encore plus d’importance quand, à l’automne de 1865, la menace fénienne parut s’aggraver. La branche américaine du mouvement des féniens, déterminée à libérer l’Irlande de la domination britannique, projetait d’attaquer les colonies britanniques d’Amérique du Nord. Ni Anglin ni la grande majorité des Irlando-catholiques du Nouveau-Brunswick n’appartenaient au mouvement, ni même ne sympathisaient avec lui, quoique Anglin et d’autres aient sûrement voulu une Irlande plus libre. Néanmoins, les partisans néo-brunswickois de la Confédération profitèrent de l’occasion pour prétendre que deux forces s’opposaient dans la colonie : les fédéralistes protestants et loyaux, d’une part, et les catholiques proféniens et antifédéralistes dirigés par Anglin, d’autre part. Cette stratégie se révéla très fructueuse à l’élection partielle dans la circonscription d’York, en novembre 1865, où le partisan de la Confédération Charles Fisher battit John Pickard*. Peu après, Anglin quitta le cabinet, en partie parce qu’il en avait assez des injures, mais surtout parce qu’il ne croyait plus que le gouvernement faisait assez pour garantir la construction d’une ligne de chemin de fer entre Saint-Jean et Portland, dans le Maine. Cependant, il continua de donner un appui général au gouvernement et demeura un adversaire notoire du projet confédératif.
Pour bien des raisons, la position du gouvernement s’affaiblit peu à peu. Surtout, les partisans de la Confédération continuèrent d’user avec efficacité de l’argument de la loyauté, puissamment aidés par un raid fénien tout à fait burlesque contre le Nouveau-Brunswick en avril 1866. Le lieutenant-gouverneur, Arthur Hamilton Gordon*, profita de la crise et de la faiblesse du gouvernement pour exiger un changement. Aux élections qui suivirent, en mai et juin, les opposants à la Confédération, y compris Anglin, furent battus à plate couture. D’après un journal néo-brunswickois, les résultats du scrutin signifiaient que « le fénianisme et l’annexion[nisme], bref les idéaux de Warren et d’Anglin, [étaient] « démolis » et que l’engeance traîtresse des sympathisants féniens [était] écrasée ». Quant à Anglin, il estimait que « les conspirateurs » avaient gagné.
Dans sa lutte contre la Confédération, Anglin avait présenté nombre d’arguments qui, vus de Saint-Jean, étaient particulièrement sensés. En outre, il avait passablement raison de critiquer les tactiques des fonctionnaires britanniques et des partisans néo-brunswickois de la Confédération. Cependant, il semblait ne vouloir accepter qu’un projet d’union parfait. Si, comme il le soutenait, il appuyait l’idée générale, il aurait dû voir que les conditions ne seraient jamais idéales et qu’aucun arrangement ne pouvait être sans défauts. De toute façon, il accepta le verdict de l’électorat et décida de donner une chance équitable à la Confédération.
Pour Anglin, comme pour le nouveau dominion du Canada, les années 1867 à 1872 furent une importante période d’adaptation. Il cessa de militer contre la Confédération, même s’il prenait sûrement plaisir à en signaler les faiblesses, qu’il avait lui-même prédites. Aux premières élections générales de la chambre des Communes, il remporta la victoire dans la circonscription de Gloucester, à majorité acadienne, sur la côte nord du Nouveau-Brunswick ; il allait conserver ce siège durant 15 ans. Sur la scène nationale, il disputa le leadership officieux des catholiques irlandais à Thomas D’Arcy McGee*, jusqu’à l’assassinat de ce dernier en avril 1868. Par la suite, il continua de se prononcer sur des questions qui intéressaient particulièrement sa communauté, mais ses critiques étaient rarement violentes. Certes, la condition des Irlando-catholiques du Canada ne lui semblait pas idéale, mais il y voyait une amélioration et la croyait au moins meilleure que celle de ses compatriotes aux États-Unis. Quant à la position du Nouveau-Brunswick dans le nouvel ordre politique, Anglin relevait les problèmes, surtout la situation économique difficile de Saint-Jean, mais il les croyait inévitables et peut-être pas aussi graves qu’il ne l’avait craint. Par ailleurs, il s’inquiétait de l’expansion géographique du pays, qui selon lui représentait un trop lourd fardeau, et déplorait qu’on ait sacrifié des droits du Canada au moment de la signature du traité de Washington en 1871 [V. sir John Alexander Macdonald]. Cependant, en ces matières comme en bien d’autres, Anglin montrait, en prenant pour critère l’intérêt supérieur de la nation, qu’il acceptait le nouveau dominion. De plus, il consolida sa position à la chambre des Communes : indépendant en 1867, il devint en 1872 un membre important du parti libéral, encore assez peu structuré et dont le chef était Alexander Mackenzie. Au fil des cinq premières années d’existence du pays, cet ancien adversaire de la Confédération en vint donc à accepter le nouveau régime. Il n’en aimait pas tous les aspects, mais il lui avait donné le temps de faire ses preuves et ne l’avait pas trouvé totalement déficient.
En 1872 et 1873, Anglin s’occupa surtout de la question des écoles du Nouveau-Brunswick [V. John Costigan*]. D’après lui, une loi provinciale sur les écoles publiques, adoptée en 1871, empêchait les catholiques, pourtant soumis à l’impôt scolaire, d’avoir leurs propres établissements d’enseignement, à moins d’accepter de les financer eux-mêmes, ce qui était contraire aux pratiques en vigueur au moment de la Confédération. Cette question était fort complexe, et Anglin défendit la cause des catholiques de bien des façons : en écrivant dans le Freeman ; en intervenant à Ottawa, tant dans les coulisses que sur le parquet de la chambre des Communes ; en discutant avec les évêques catholiques de la province, John Sweeney* et James Rogers* (il leur demandait des directives ou leur donnait des avis) ; enfin, en aidant ceux qui contestaient la loi en justice à préparer des plaidoiries. Finalement, les catholiques du Nouveau-Brunswick perdirent la bataille, et l’énergie qu’Anglin avait dépensée pour eux lui mit à dos les hommes politiques protestants de la province. Lorsque le scandale du Pacifique fit tomber le gouvernement de Macdonald en novembre 1873, on l’exclut donc du nouveau cabinet formé par Mackenzie, et ce, même si l’on reconnaissait sa compétence dans les cercles libéraux. Les autres députés du Nouveau-Brunswick prétendaient que la population de la province n’appuierait pas un cabinet dont ferait partie Anglin. Cependant, en récompense des services rendus au parti, on le nomma président de la chambre des Communes en mars 1874.
Surmontant son naturel combatif, et mettant toute son application et son intelligence à profit, Anglin exerça ses fonctions de président de manière satisfaisante. Bien sûr, il ne pouvait pas participer au débat qui se poursuivait, aux Communes, sur la question scolaire, mais il continuait de travailler en coulisse à Ottawa et exprimait assez ouvertement ses positions dans le Freeman. Être à la fois président de la chambre des Communes et journaliste s’avéra d’ailleurs plein d’embûches. Anglin pouvait difficilement conserver une réputation d’impartialité aux Communes tout en exprimant des opinions partisanes dans son journal. En outre, le lien entre le gouvernement et le Freeman lui fit perdre son siège aux Communes en 1877, à cause d’un conflit d’intérêts. Suivant l’usage en pareil cas, il s’était efforcé de ne pas s’occuper directement de l’aspect commercial du Freeman, mais le comité des Communes qui étudia l’affaire conclut que les précédents étaient erronés et que les commandes d’imprimerie passées au service commercial du Freeman par le département des Postes en 1874 et 1875 étaient des marchés qui entraînaient l’exclusion. On ne divulgua le rapport du comité qu’à la fin de la session, en avril, si bien qu’Anglin put se présenter à une élection partielle pendant l’été. Après une lutte acharnée, il remporta la victoire ; au début de la session de 1878, il fut réélu président de la chambre, mais non à l’unanimité.
Au cours des années 1870, les opinions fondamentalement conservatrices d’Anglin devinrent évidentes. Comme bien d’autres, il craignait et dénonçait le socialisme, le républicanisme rouge et le communisme, qui menaçaient la civilisation occidentale et surtout ses bases religieuses. À l’instar de bien des leaders catholiques, il estimait que l’athéisme et le scientisme représentaient un danger pour l’Église et la morale chrétienne. Effrayé par ces courants de pensée et d’autres éléments perturbateurs, il rejetait tout ce qui visait à affaiblir davantage le rôle de la religion dans la société. Les hommes d’Église, déclarait-il, avaient le droit et le devoir d’identifier et de condamner ce qui était illégitime et impie. Toutefois, le catholique avait, autant que quiconque, la liberté de se former des opinions politiques. Au clergé de la province de Québec qui dénonçait le parti libéral [V. Ignace Bourget*], il répliquait que celui-ci n’était pas comme « le parti d’infidèles qui, en Europe, salissait] le nom de libéral en guerroyant sans relâche contre toute vraie liberté, contre la société et contre Dieu ». Bien qu’il ait été d’allégeance libérale, Anglin n’était pas un réformateur social. Sa morale puritaine excluait toute compassion pour les faiblesses de la nature humaine. Il soutenait les causes généreuses mais insistait beaucoup sur le maintien de la loi et de l’ordre. D’après lui, la religion et le dur labeur pouvaient triompher du paupérisme, qu’il trouvait relativement peu répandu en Amérique du Nord. Pourtant, malgré son conservatisme et sa foi en la libre entreprise, il ne se joignit pas aux nombreux bourgeois canadiens qui condamnaient les associations ouvrières. Le Freeman rapportait assez objectivement les activités de ces organismes, et Anglin en vint même à approuver les efforts des syndicats, dont bon nombre de membres, à Saint-Jean, étaient des catholiques irlandais, quand leurs actions étaient légales, modérées et non violentes.
Après la défaite des libéraux en 1878, l’étoile d’Anglin se mit à pâlir. De 1878 à 1882, il fut l’un des grands censeurs du gouvernement Macdonald ; tant aux Communes que dans le Freeman, il intervenait surtout sur les grandes questions du jour, la Politique nationale et le chemin de fer canadien du Pacifique. Il continuait de se prononcer sur ce qui touchait les Irlandais catholiques ; il préconisait, entre autres, l’envoi d’une aide économique à l’Irlande et l’instauration de l’autonomie politique dans ce pays. Cependant, sa position dans Gloucester vacillait : le nationalisme acadien gagnait des adeptes [V. Onésiphore Turgeon*], Mgr James Rogers se montrait peu enclin à lui donner un appui constant, des hommes politiques de la région se taillaient une place, et lui-même n’arrivait pas à maintenir des liens forts dans sa circonscription. Il mena une campagne courageuse aux élections de 1882 mais fut ignominieusement battu par Kennedy Francis Burns. Ce désastre et la baisse de popularité de son journal le poussèrent à rompre ses attaches avec le Freeman et à s’installer à Toronto en 1883.
La vie à Saint-Jean avait pris une coloration terne, dénuée de satisfaction et de perspective. Par contre, à Toronto, le chef libéral Edward Blake*, dont la stratégie consistait à courtiser les catholiques de l’Ontario afin de leur faire appuyer le parti fédéral, avait besoin d’un lieutenant. Avec le soutien financier de membres du parti, Anglin prit en main un hebdomadaire catholique, le Tribune. En outre, il collabora à la page éditoriale du Globe. Les libéraux devaient aussi tenter de lui trouver un siège aux Communes. Anglin s’acquitta de toutes ses responsabilités avec sérieux et alla jusqu’à livrer une lutte perdue d’avance à D’Alton McCarthy dans la circonscription de Simcoe North en 1887. Cependant, sa diligence ne rapporta guère aux libéraux qui, après leur défaite aux élections de 1887, lui retirèrent leur appui. Le Tribune sombra et Anglin perdit son poste au Globe. Désillusionné, il se retrouvait sans travail, situation très angoissante pour un homme de 65 ans qui avait une femme et sept enfants de 4 à 22 ans à nourrir. Sa famille ne connut jamais la misère, puisque dans les années précédentes il avait réussi à investir une somme substantielle ; il trouva cependant un emploi stable peu de temps avant sa mort. Entre-temps, le gouvernement ontarien du libéral Oliver Mowat* lui confia, en guise de faveurs, plusieurs postes : président de la commission des institutions municipales qui fit deux rapports en 1888 ; commissaire de l’Ontario à la Centennial Exposition of the Ohio Valley en 1888, où la province avait un stand minier ; secrétaire de la commission d’enquête sur le système carcéral et pénitentiaire de l’Ontario en 1890–1891 ; et enfin membre de l’Ontario Royal Commission on Municipal Taxation, qui déposa son rapport en 1893. Cependant, l’insécurité de sa situation devint telle que sa femme et son fils aîné, Francis Alexander*, en furent réduits à supplier en secret (et en vain) ses adversaires politiques, sir John Alexander Macdonald et sir John Sparrow David Thompson, de lui confier un poste dans l’administration fédérale. Pendant ces années, il publia quelques articles dans des revues et journaux, prononça un certain nombre de discours et rédigea le chapitre consacré à l’archevêque John Joseph Lynch* dans un volume qui célébrait le cinquantenaire de l’archidiocèse de Toronto. De 1888 à 1892, il fut membre du Toronto Separate School Board. Il n’obtint un emploi permanent qu’en mai 1895, celui de greffier en chef de la cour de surrogate de l’Ontario, probablement en partie grâce à l’influence de ses deux fils avocats, Francis Alexander et Arthur Whyte. Un an plus tard, il mourait d’une embolie cérébrale.
Sans être un personnage illustre de l’histoire du Canada, Timothy Warren Anglin ne fut pas non plus un raté. Il manifesta diligence et compétence dans presque tous ses rôles – journaliste, homme politique, porte-parole des Irlando-catholiques, président de la chambre des Communes et commissaire. Il ne brillait pas d’un éclat remarquable, mais on respectait ses talents, sa détermination, sa conscience et sa droiture. Durant la deuxième moitié du xixe siècle, son nom et ses prises de position étaient connus dans une bonne partie de l’Amérique du Nord britannique. À titre de leader des catholiques irlandais, il avait forgé un outil important pour aider ce groupe à s’intégrer à la société canadienne. Enfin, malgré l’insécurité de ses dernières années, il avait préparé une base solide pour l’avenir de ses enfants. Francis Alexander devint juge en chef de la Cour suprême du Canada et Mary Margaret se tailla une réputation internationale comme actrice. Souvent coupable de dogmatisme et de pharisaïsme, Anglin n’était pas un homme particulièrement engageant, mais en dernière analyse sa personnalité et sa carrière commandent respect et admiration.
Le présent article est extrait pour l’essentiel de la biographie de l’auteur intitulée, Timothy Warren Anglin. Les principales sources sur Anglin sont citées dans les renvois en bas de page de cet ouvrage et peu de nouveaux documents ont fait surface depuis sa parution. La source unique la plus importante est le Freeman. Il a commencé à paraître en 1849 sous le titre de Saint John Weekly Freeman (Saint-Jean, N.-B.) ; le 4 févr. 1851, il paraissait trois fois la semaine sous le titre de Morning Freeman ; du 29 août 1877 au 2 nov. 1878, il parut quotidiennement ; après il devint hebdomadaire. Sont également utiles : le Tribune (Toronto), 1883–1887 ; d’autres journaux contemporains, et les papiers de nombreux particuliers comme John Sweeney (Arch. of the Diocese of Saint John, Saint-Jean), sir Samuel Leonard Tilley (AN, MG 27, I, D15, et Musée du N.-B., Tilley family papers), Edward Blake (AO, MU 136–273), Arthur Hill Gillmor* (APNB, MC 243), Alexander Mackenzie (AN, MG 26, B), et James Rogers (Arch. of the Diocese of Bathurst, Bathurst, N.-B. ; copies à la UNBL). [w. m. b.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
William M. Baker, « ANGLIN, TIMOTHY WARREN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 21 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/anglin_timothy_warren_12F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/anglin_timothy_warren_12F.html |
| Auteur de l'article: | William M. Baker |
| Titre de l'article: | ANGLIN, TIMOTHY WARREN |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la révision: | 1990 |
| Date de consultation: | 21 mars 2025 |