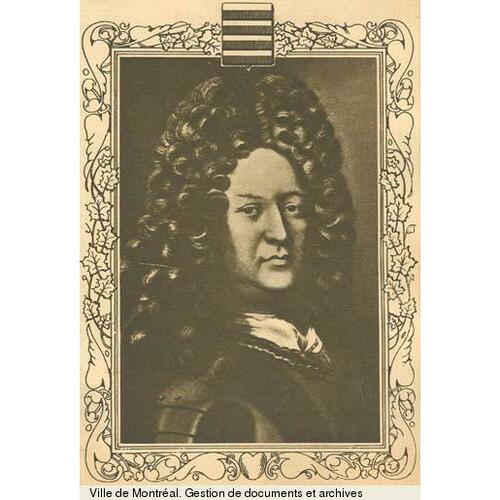Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
BRISAY DE DENONVILLE, JACQUES-RENÉ DE, marquis de DENONVILLE, colonel et général de brigade des Dragons de la Reine, inspecteur général des dragons, gouverneur général de la Nouvelle-France de 1685 à 1689, maréchal de camp, sous-gouverneur des ducs de Bourgogne, d’Anjou et de Berry ; né le 10 décembre 1637 et décédé le 22 septembre 1710,
La famille Brisay du Poitou pouvait, au xviie siècle, retracer la lignée de ses ancêtres plus de 500 ans en arrière ; elle se disait issue de Torquatus Byrsarius à qui Charles le Chauve avait confié en 852 le soin de défendre, contre les invasions des Vikings et des Bretons, les territoires compris entre la Loire et la Vilaine. En outre, elle se prétendait du même sang que les comtes d’Anjou et les rois Plantagenets d’Angleterre. La seigneurie de Brisay, sur la rive gauche de la rivière Vienne, remonte au xie siècle.
Pierre de Brisay, né en 1523, fils de François de Brisay et de Marie de Hémard, hérita de sa mère la seigneurie de Denonville, près de Chartres, en Beauce, devenant ainsi le premier Brisay de Denonville. Pierre, neveu du cardinal de Denonville, entra dans le clergé et fut nommé archidiacre de Mâcon, puis abbé de Saint-Père-en-Vallée, près de Chartres. Il retirait des revenus considérables de cette abbaye. Toutefois, entre 1563 et 1568, il se joint aux huguenots et, à l’âge de 52 ans, il épouse une jeune fille de 25 ans, Jacqueline d’Orléans, fille de Claude d’Orléans. Leur fils Jacques hérita de la seigneurie de Denonville et, en 1606, il se trouvait être l’aîné du clan. Huguenot convaincu, il joignit les rangs de l’armée, devint capitaine de cavalerie et mourut au siège de Bréda en 1625.
Son fils, Pierre de Brisay, né en 1607, hérita des titres de seigneur de Denonville, vicomte de Montbazillac, seigneur de Bellavilliers, seigneur châtelain de Thiville, seigneur marquis d’Avesnes et seigneur de Chesnay. À l’exemple de son père, il embrassa la carrière des armes et servit d’abord en Hollande en qualité de cornette d’une compagnie de chevaux-légers sous les ordres du maréchal de Châtillon. En 1628, il épousa Louise d’Alès de Corbet, fille d’un huguenot, aide de camp et gentilhomme ordinaire de la chambre de Louis XIII. Les deux familles étaient de petite noblesse ; comme elles n’avaient pas rang parmi les grandes familles de France, elles devaient lutter pour leur avancement, ce qu’elles firent non sans quelques succès. Pierre de Brisay et sa femme abjurèrent le protestantisme et retournèrent au catholicisme romain en 1636. Louis XIII nomma Pierre de Brisay gentilhomme ordinaire de la chambre du roi en 1642 puis conseiller du roi au Conseil d’État et au Conseil des Finances en 1653. En 1668, il était maréchal de camp dans les armées de Louis XIV.
Quatorze enfants naquirent de ce mariage, dont six moururent en bas âge. Le septième, Jacques-René, le futur gouverneur général de la Nouvelle-France, naquit un an après la conversion de ses parents mais le climat d’austère calvinisme dans lequel ses parents avaient été élevés marqua l’enfant. Toute sa vie, Jacques-René fut un homme pieux et un ardent défenseur du clergé.
À cette époque l’armée et le service de l’Église étaient les seules carrières qui s’ouvraient aux membres de la noblesse à moins qu’ils n’aient choisi de vivre retirés à la campagne dans leurs terres. Des six fils de Pierre de Brisay de Denonville qui atteignirent l’âge adulte, trois choisirent l’armée, trois entrèrent au service de l’Église. L’un d’eux, Charles de Brisay d’Huillé, unit les deux carrières en devenant chevalier tonsuré de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; il mourut en Crète en combattant les Turcs. En sa qualité d’aîné, Jacques-René prit le titre de marquis de Denonville et encore très jeune entra dans l’armée. Sa correspondance ultérieure démontrera que son instruction n’avait pas été très poussée. Capitaine dans le régiment Royal en 1663, il prit part, l’année suivante, à la campagne que le duc de Beaufort [Bourbon] mena en Afrique du Nord contre les pirates algériens. Trois ans plus tard, il servait dans les Pays-Bas et, en janvier 1668, il reçut le grade de capitaine des dragons. Cette même année, en novembre, il épousa Catherine Courtin, fille de Germain Courtin de Tangeux. Denonville fit toute la guerre de Hollande (commencée en 1672) et acquit la réputation d’officier compétent doublé d’un soldat valeureux, ce qui lui valut un brevet de lieutenant-colonel des Dragons de la Reine en 1673, et de colonel en 1675. En 1681, on le nomma inspecteur général des dragons pour les provinces de Flandre, Picardie, Artois et Hainaut et en 1683 il fut promu général de brigade. L’année suivante, Louis XIV le désignait à la succession de Le Febvre* de La Barre au poste de gouverneur général de la Nouvelle-France. Sa commission porte la date du jet janvier 1685. Tout bien considéré, le traitement de 24 000# par an qui y était attaché n’était pas des plus généreux ; le roi, toutefois, lui acheta son régiment pour 60 000# et le donna ensuite au comte de Murcé, parent de Mme de Maintenon.
On ignore la raison exacte qui a présidé au choix de Denonville pour le poste de gouverneur ; quoi qu’il en fût, il était impérieux de remplacer La Barre. Dix ans plus tôt, après plusieurs années de paix, les Iroquois avaient pris l’offensive avec l’intention de chasser les Français de l’Ouest pour ensuite diriger vers Albany le commerce des fourrures qui se faisait jusqu’alors à Montréal ; ils comptaient se réserver le rôle d’intermédiaires. Louis de Buade* de Frontenac, gouverneur à l’époque, avait tenté de modérer leurs menées et cherché à apaiser les Cinq-Nations, mais il n’avait réussi qu’à aiguiser leur agressivité. Par la suite La Barre voulut consolider la position française par les armes mais échoua lamentablement. Il réussit tout de même à amener Louis XIV et Seignelay, le ministre de la Marine, à adopter des mesures plus efficaces pour assurer la domination française en Amérique du Nord.
L’Espagne et l’Empire avaient conclu la paix avec la France en août 1684, ce qui permit à Louis XIV de choisir un gouverneur général pour la Nouvelle-France parmi ses officiers les plus compétents. Rien n’indique que Denonville ait dû sa nomination à une influence quelconque à la cour ; seules auraient joué sa probité et les preuves qu’il avait données de sa compétence dans l’armée. Dans une dépêche à Jacques de Meulles, intendant de la Nouvelle-France, le marquis de Seignelay, ministre de la Marine, écrivait : « Il est un des plus estimez officiers du Royaume [que] Sa Mate lui a choisy comme un homme qui par sa vertu travaillera au bien de la Religion, par sa valeur et son experience remettra les affaires que Mr. de la Barre a comme abandonnées dans la paix honteuse qu’il vient de faire avec les Iroquois, Et par sa sagesse evitera toute sorte de difficultez et embarras avec vous ».
Denonville ne resta pas oisif pendant les cinq mois qui s’écoulèrent entre sa nomination et l’embarquement pour Québec. Il rassembla tous les renseignements qu’il put obtenir sur la Nouvelle-France, puis ébaucha, pour les soumettre à l’approbation du ministre, les grandes lignes de la conduite et des mesures qu’il entendait adopter. Denonville surveilla personnellement le recrutement des 500 hommes de renfort que le ministre avait accordés aux troupes de la marine en service dans la colonie et s’assura que leur équipement était parfait. Dans ce domaine, son souci du détail était remarquable. Huit ou neuf lieutenants réformés lui offrirent leurs services avec le grade de sergent et reçurent de Denonville l’assurance qu’ils retrouveraient leurs grades réels au fur et à mesure que se créeraient des vacances. Ce fait témoigne hautement de la confiance qu’il inspirait à ses hommes.
En arrivant à La Rochelle avec sa femme enceinte et ses deux filles, âgées de quatorze et de trois ans, Denonville fut atterré quand il constata le manque d’espace et les conditions infectes qui régnaient sur les vaisseaux qui servaient au transport des troupes. Il demanda immédiatement au ministre que d’autres arrangements soient pris, mais sans succès ; il sollicita alors 40 hommes de troupe supplémentaires qui remplaceraient ceux qui, selon ses sombres prévisions, ne survivraient pas à la traversée. Là aussi il échoua. À cause de l’état de Mme de Denonville, le marquis et sa femme firent la traversée à bord d’un navire marchand. Le nouvel évêque de Québec, Mgr Jean-Baptiste de Saint-Vallier [La Croix], homme austère mais énergique, partageait avec eux la table du capitaine.
Le 1er août, Denonville et sa famille arrivèrent à bon port et, peu de temps après leur arrivée à Québec, la marquise de Denonville donna naissance à une autre fille. Vers la fin du mois, les navires de troupes jetèrent l’ancre dans le port et les craintes les plus pessimistes du gouverneur se confirmèrent ; sur un des vaisseaux, 60 hommes avaient été emportés par le typhus ou le scorbut ; sur l’autre, 80 étaient fort mal en point. Les services de l’Hôtel-Dieu de Québec étaient débordés car il y avait à ce moment-là au-delà de 300 victimes des fièvres à l’hôpital. Et, par surcroît, la maladie avait fait des ravages dans les troupes qui étaient déjà dans la colonie : plusieurs hommes avaient péri, victimes de l’influenza qui avait balayé la colonie l’année précédente, et plus du quart des autres étaient inaptes au service militaire. Denonville en renvoya 44 en France.
Dès les premières semaines qui suivirent son arrivée, Denonville parcourut l’itinéraire Québec, fort Frontenac (Kingston, Ont.), Québec, observant tout sur son passage ; ce qu’il vit le consterna. En fait, il a été le premier gouverneur à s’intéresser à l’état de la société canadienne et à vouloir apporter des réformes. Il constata que les seigneuries étaient très dispersées et les habitations qui y étaient construites, très éparses, ce qui en rendait la défense à peu près impossible. Les jeunes Canadiens, qui côtoyaient régulièrement les Indiens, avaient adopté beaucoup de leurs mœurs, d’aucunes excellentes, mais la plupart néfastes. Il les jugea avec la sévérité d’un puritain : ils lui parurent débauchés, indisciplinés, sans aucun respect pour l’autorité, quelle qu’elle fût. Les fils des seigneurs lui semblaient les pires de tous. Il remarqua, cependant, que tous ces jeunes Canadiens étaient en parfaite forme physique, robustes et pleins d’entrain. Il fallait trouver le moyen de canaliser et diriger ce débordement d’énergie. Il préconisa l’envoi d’un certain nombre d’entre eux en France pour y recevoir des commissions dans la Garde ou dans tout autre régiment permanent. À sa demande, le roi mit à la disposition du gouverneur et de l’intendant six commissions dans les troupes de la marine en service dans la colonie qu’ils accorderaient à des gentilshommes canadiens. Cette initiative fut une réussite et Denonville recommanda que la France n’envoie plus d’officiers français dans la colonie. Désormais, les militaires et le cortège de valeurs aristocratiques qu’ils représentaient domineront la société canadienne.
Comme mesure à long terme, à l’aide d’une subvention du gouvernement au montant de 400#, Denonville établit à Québec une école de navigation qui formerait des Canadiens à la carrière de pilote, carrière pour laquelle ils manifestaient d’ailleurs de grandes aptitudes. Il s’occupa de faire dresser des cartes marines du Saint-Laurent plus au point que les cartes hollandaises en usage jusque-là. À la même époque, il demanda au ministre de veiller à ce que les nobles dans la pauvreté ne soient plus envoyés dans la colonie et réussit à obtenir de modestes rentes pour certaines familles de la noblesse qui autrefois avaient bien mérité de la colonie, mais qui vivaient maintenant dans le dénuement.
L’ivrognerie, déclarait-il, était un vice des plus répandus dans la colonie. Les coquins et les fainéants n’avaient qu’une ambition : tenir une taverne et éviter ainsi le dur travail de la terre. La moitié des maisons de la colonie était, à son avis, des débits de boisson. Pour modérer les abus qui étaient l’apanage de ce genre de commerce, de strictes ordonnances régirent les tavernes. Les ivrognes et ceux qui menaient une vie de débauche, si la cour les reconnaissait comme tels, seraient mis au pilori, exposés à l’humiliation publique. Il était parfaitement d’accord avec le clergé au sujet de la vente de l’eau-de-vie aux Indiens et des déplorables conséquences que cette pratique engendrait ; aussi fit-il tout ce qu’il put pour en restreindre le commerce.
Il prit aussi des dispositions pour réprimer les abus qui depuis toujours avaient cours dans le commerce des fourrures. Le gouverneur et l’intendant étaient conjointement investis du pouvoir d’accorder 25 congés de traite par an, chaque congé donnant à son détenteur le droit d’expédier un canot de marchandises de traite dans l’Ouest. Or ses prédécesseurs avaient accordé un nombre excessif de congés à ceux qui avaient su gagner leur faveur. Denonville savait pertinemment qu’il y avait environ 600 coureurs de bois continuellement hors de la colonie, de sorte que les fermes étaient à l’abandon et les familles retombaient à la charge publique ; de plus, ces coureurs de bois devaient à des marchands de fortes sommes pour des marchandises vendues à crédit. Bien que les plus graves abus n’aient été le fait que d’un petit nombre, Denonville résolut d’y mettre bon ordre. Il limita à 25 le nombre des congés et ne les accorda qu’aux familles qui en avaient le plus grand besoin et qu’on avait jusque-là tenues à l’écart de cette faveur ; ce faisant, il se créa des ennemis parmi les familles influentes de la colonie. Dorénavant, les détenteurs de permis devraient déclarer le nom des trois « voyageurs » que comptait chaque canot et produire la liste des marchandises qu’ils expédiaient. Les voyageurs s’inscriraient aux registres à Montréal ou à Trois-Rivières, à l’aller comme au retour, et obtiendraient des missionnaires, dans les postes de l’Ouest, un certificat attestant leur bonne conduite.
Il était d’avis que l’établissement des postes de l’Ouest avait été une grave erreur qui se soldait par l’affaiblissement de la colonie et par des dépenses exorbitantes. La colonie se trouvait maintenant impliquée dans toutes sortes de querelles entre tribus et la présence de ces postes ne diminuait en rien l’hostilité de ces tribus envers les Français. Les postes constituaient d’ailleurs une lourde responsabilité, vu les difficultés de ravitaillement et le coût énorme des approvisionnements, surtout en temps de guerre. À l’instar de Colbert, il croyait qu’il eût été beaucoup plus sage de concentrer au cœur de la colonie toutes les ressources françaises et de faire venir les Indiens à Montréal pour trafiquer. Les Canadiens auraient pu alors s’employer à la pêche dans le golfe plutôt que d’aller toujours plus avant vers l’Ouest dans des régions inhabitées, délaissant la façon de vivre des Français pour adopter les manières des Indiens et leur notion des valeurs. Dénoncer la situation était une chose, la corriger ou la renverser en était une autre : cette tâche s’avéra tout à fait impossible.
Dans la colonie même, Denonville trouva amplement à s’occuper. Il considérait que les trois villes étaient des nids à incendie et qu’il était impérieux de prendre des mesures pour les mettre à l’abri d’un sinistre. Il aurait aimé que s’ouvre une fonderie qui utiliserait le riche minerai de fer qu’on trouvait près de Trois-Rivières ; on y fabriquerait des poêles, ce qui contribuerait grandement à réduire les risques d’incendie. Il dut néanmoins se résoudre à admettre que ce projet était hors de question pour le moment, vu l’absence de capitaux et de main-d’œuvre spécialisée dans la colonie. Parce que Montréal était sans aucune sorte de défenses, Denonville fit construire une palissade par les troupes. À Québec il donna ordre de bâtir un nouveau magasin pour l’entreposage de la poudre et des armes pour éliminer un grave danger : comme il le fit remarquer, il suffisait d’une étincelle pour que le toit prenne feu ; l’explosion qui en résulterait, outre les dommages considérables qu’elle causerait, laisserait la colonie virtuellement sans défense tant que n’arriverait pas de France un nouveau chargement d’armes et de munitions.
Le gouverneur ne tarda pas à découvrir que l’intendant trafiquait pour son propre compte à même le magasin du roi. Il en fit part au ministre qui rappela immédiatement Jacques de Meulles pour le remplacer par Jean Bochart de Champigny, ami de longue date de Denonville. Cette nomination avait pour but d’éviter que ne se répètent des conflits comme ceux qui avaient opposé naguère le gouverneur et l’intendant à la table du Conseil souverain. Effectivement, Denonville informa le ministre qu’il désirait se retirer de ces réunions : bien d’autres tâches l’attendaient ailleurs, disait-il, et, n’étant pas avocat, il avait le sentiment que son apport aux délibérations du conseil était négligeable. Le ministre, cependant, craignait que cette pratique ne crée un dangereux précédent, mais il consentit à ce que Denonville ne soit présent que lorsque le conseil solliciterait son avis.
Ces problèmes internes perdaient grandement de leur importance en regard des dangers extérieurs qui menaçaient la colonie. Tout comme il avait été le premier gouverneur à se préoccuper de réforme sociale dans la colonie, il fut aussi le premier à prendre pleinement conscience de l’étendue de la menace qui planait sur le Canada. Il avait reçu des ordres très clairs : il fallait écarter le péril iroquois, sans le recours aux armes, si possible. Il expliqua au ministre que le danger ne venait pas seulement des Iroquois, qui voulaient éloigner les Français de la traite des fourrures dans l’Ouest, mais que la colonie était aussi menacée au sud par les Anglais de New York et au nord par la mainmise que les Anglais exerçaient sur la baie d’Hudson. Pour parer définitivement à la menace venant du sud, il faudrait, à son avis, que Louis XIV achète de Jacques II la province de New York, après quoi les Iroquois seraient bien forcés de garder la paix. Il y avait, toutefois, bien peu de chances que cela ne se réalise. Quelques semaines après son arrivée, Denonville était déjà convaincu que les Iroquois ne s’en tiendraient pas aux termes du traité conclu avec La Barre ; tôt ou tard, au moment de leur choix, ils attaqueraient les établissements français. Seul leur désir d’amener d’abord les nations de l’Ouest à quitter l’alliance française les retenait encore car ils avaient toujours pour politique : un ennemi à la fois. Dans les circonstances, Denonville jugea qu’il serait infiniment préférable d’attaquer le premier ; cependant l’invasion des territoires iroquois exigeait une préparation soignée et minutieuse.
Pendant qu’on mettait en branle ces longs préparatifs, Denonville s’occupa de la menace que constituait la présence anglaise à la baie d’Hudson. Malgré les pourparlers en cours à Londres entre diplomates français et anglais au sujet de la signature d’un traité de neutralité, prélude à une entente définitive sur les prétentions territoriales en Amérique du Nord, Denonville envoya par terre, de Montréal à la baie James, une expédition de 105 hommes, sous le commandement de Pierre de Troyes*, officier des troupes de la marine. Ils outrepassèrent leurs instructions écrites, assez vagues d’ailleurs, et s’emparèrent de trois forts anglais de la baie James et d’un butin de 50 000 peaux de castor de premier choix, après quoi ils laissèrent des Canadiens en garnison dans les forts ; la menace qui pesait sur le flanc nord de l’empire du commerce des fourrures se trouvait ainsi écartée.
Pendant ce temps, au sud, le gouverneur de New York, Thomas Dongan, Irlandais catholique, avait envoyé une expédition de trafiquants de fourrure d’Albany, guidés par des coureurs de bois canadiens renégats, commercer avec les Outaouais de Michillimakinac, leur offrant des marchandises à bien meilleur prix que les Français. C’est cette tribu qui fournissait aux Français la majeure partie de leurs fourrures ; une défection de leur part entraînerait la ruine du Canada. À la même époque Dongan échangeait avec Denonville une correspondance froide mais polie ; il lui offrait de coopérer au maintien de la paix dans l’Ouest mais priait Denonville de lui accorder son appui dans les démarches qu’il avait entreprises pour obtenir du gouvernement français le remboursement de 25 000# qu’il estimait lui être dues en retour de son service sous les ordres de Jacques, duc d’York, dans les armées de Louis XIV, avant la restauration des Stuarts en Angleterre.
Ces tentatives de la part d’Albany convainquirent Denonville que la suprématie française dans l’Ouest ne serait consolidée qu’en recourant aux mêmes moyens qui avaient réussi à la baie James. Il apprit que Dongan projetait, pour l’année suivante, une autre expédition à Michillimakinac ; la fidélité des Outaouais était chancelante, séduits qu’ils étaient par les belles paroles des Anglais et des Iroquois qui voulaient leur faire oublier leur haine traditionnelle à l’égard des Cinq-Nations et les amener à trafiquer avec Albany. Si les Iroquois venaient à rencontrer des canots canadiens dans l’Ouest, ils les pillaient, signe flagrant de leur mépris pour les Français.
Denonville savait fort bien qu’il n’avait pas assez de troupes pour anéantir les Iroquois en une seule expédition. Il avait à peine ce qu’il lui fallait pour attaquer un seul flanc des Cinq-Nations et il eût été essentiel d’attaquer les deux flancs à la fois, les Agniers et les Tsonnontouans, les refoulant vers le centre afin de les forcer à combattre. Il demanda des renforts au ministre mais rien ne lui garantissait qu’ils arriveraient à temps. Le temps jouait contre lui et il lui en fallait pour fortifier les établissements sans défense. Comme politique à long terme, il recommanda que les établissements canadiens soient déplacés et que les maisons soient regroupées en villages au lieu d’être échelonnées le long du fleuve ; pour le moment, il n’osait même pas construire des fortins sur les seigneuries les plus exposées de peur que les Iroquois, mis en éveil, ne se lancent à l’attaque de ces établissements pour les saccager et les piller. Le mieux à faire était de cacher ses intentions aux Iroquois le plus longtemps possible, puis de lancer toute son armée contre les Tsonnontouans, la plus puissante et la plus belliqueuse tribu des Cinq-Nations, mais aussi la plus éloignée.
En dépit de strictes mesures de sécurité, il était difficile de dissimuler qu’il se préparait quelque chose et les Onontagués en eurent vent. Au début de 1687, ils proposèrent de tenir une conférence au fort Frontenac dans le but d’aplanir les divergences et Denonville y consentit. Quand le père Jean de Lamberville, le missionnaire attaché à la mission d’Onondaga, se rendit à Québec pour faire les arrangements, Denonville ne souffla mot de ses intentions de peur que Lamberville, volontairement ou non, ne révèle aux Iroquois les plans de la campagne. Denonville craignait que, s’ils en étaient informés, ils ne massent un nombre considérable de guerriers le long des rapides du Saint-Laurent et ne dressent des embuscades aux armées françaises, en même temps qu’ils attaqueraient les établissements des colons. Il fallait absolument que les Iroquois restent perplexes quant aux agissements de l’armée française jusqu’à ce que les troupes soient en position de frapper le grand coup ; la sécurité de l’armée et des colons, le succès de la campagne en dépendaient.
On expédia bien à l’avance les approvisionnements au fort Frontenac et dans les postes de l’Ouest. On fournit aux officiers en garnison dans l’Ouest des instructions détaillées leur indiquant où et quand ils se joindraient à l’armée avec tous les alliés indiens et tous les coureurs de bois qu’ils auraient pu rassembler. On donna ordre à certains détachements de bloquer les principales routes qui menaient à Michillimakinac et de s’emparer des trafiquants d’Albany qui s’aviseraient de traverser les Grands Lacs.
Le 13 juin 1687, l’expédition quitta Montréal, elle comptait 832 hommes des troupes de la marine, plus de 900 hommes de milice et environ 400 Indiens alliés. Quelques jours auparavant un convoi était arrivé à Québec avec 800 hommes des troupes régulières à bord mais il était trop tard pour les incorporer aux forces expéditionnaires.
Pendant que l’armée remontait les eaux tumultueuses du Saint-Laurent l’avant-garde captura plusieurs Iroquois en embuscade le long du fleuve. Au fort Frontenac, l’intendant de Champigny, qui avait devancé le gros de l’expédition, s’empara, par des ruses contestables, d’un certain nombre de Goyogouins et d’Onneiouts afin de les empêcher de porter aux villages iroquois, situés au sud du lac, la nouvelle de l’approche de l’armée. Un autre groupe d’Iroquois, soi-disant neutres, qui habitaient un village près du fort, furent aussi capturés pour les mêmes raisons. En tout, 50 à 60 hommes et 150 femmes et enfants furent faits prisonniers. On les expédia à Montréal afin qu’ils servent d’otages au cas où des Français tomberaient aux mains des Iroquois.
Le lendemain de l’arrivée de Denonville au fort Frontenac, on apprit que deux groupes de trafiquants d’Albany en route pour Michillimakinac avaient été capturés. Eux aussi furent envoyés à Montréal et gardés en prison pendant un certain temps. Les renégats canadiens qui les avaient guidés furent jugés sommairement et fusillés. Les marchands d’Albany ne devaient plus tenter de trafiquer au nord des Grands Lacs : un autre danger avait été écarté.
L’attaque contre les Agniers ne remporta pas un succès aussi remarquable. Après une brève escarmouche, l’ennemi s’enfuit dans la forêt et les Indiens, alliés des Français, refusèrent de se lancer à leur poursuite. Il y eut peu de victimes de part et d’autre, mais les villages agniers et leurs réserves de vivres furent systématiquement détruits. Denonville avec le gros de ses troupes se rendit jusqu’à Niagara où il érigea un fortin à l’embouchure de la rivière : tous ses hommes eurent alors l’occasion d’admirer les chutes. Laissant derrière lui, au nouveau fort, une garnison de 100 hommes sous le commandement du sieur de Troyes, Denonville ramena sans encombre son armée à Montréal, qu’il atteignit le 13 août. La campagne donna à peu près les résultats qu’il en avait attendus, mais pas tous ceux qu’il eût souhaités.
Avant de se lancer en campagne, Denonville avait reçu ordre du ministre de faire autant de prisonniers iroquois qu’il le pourrait et de les expédier en France pour les faire servir sur les galères du roi. Il se rendit au désir du ministre et expédia en France 36 des 58 prisonniers, mais il donna clairement à entendre qu’il aurait mieux aimé n’en rien faire. Il pria qu’on les traite avec humanité et qu’on les renvoie au Canada quand viendrait le temps de conclure une paix avec les Cinq-Nations ; c’est ce qu’on fit, mais seulement 13 revinrent, les autres ayant succombé à la maladie soit en France soit au cours de la traversée. Il eût évidemment été plus sage de garder les prisonniers Iroquois dans la colonie, pour d’éventuels échanges.
Cet incident fit couler beaucoup d’encre et on lui a attribué à tort toutes sortes de répercussions. La plupart de ces Iroquois étaient des prisonniers capturés selon des méthodes admises en temps de guerre et, si on compare le traitement dont ils ont été l’objet à celui que les Cinq-Nations infligeaient à leurs prisonniers, ces Iroquois furent relativement bien traités. Le service sur les galères du roi n’était en aucune façon aussi horrible que la littérature romantique a bien voulu le faire croire. Ceci dit, le fait demeure que Denonville commit une erreur de jugement quand il obéit, fût-ce à contre cœur, aux ordres du ministre. En outre, ses ennemis et, après eux, des générations d’historiens ont pu dénaturer les faits au grand détriment de sa réputation.
La campagne a toutefois réussi à démontrer la justesse des vues de Denonville qui affirmait que des forces beaucoup plus nombreuses que celles dont il disposait étaient nécessaires pour vaincre les Cinq-Nations en une seule campagne. Dans ses dépêches au ministre il déclara sans ambiguïté que, à moins de disposer d’un effectif de 4 000 hommes et de vivres en quantité suffisante pour deux ans, il vaudrait mieux entamer des négociations de paix. Autrement la colonie s’engagerait dans une longue guerre d’usure qui ferait de nombreuses victimes et entraînerait la destruction des établissements les plus exposés. Pour bien convaincre le ministre de l’urgence de la situation, Denonville délégua à Versailles, avec un projet pour conquérir New York, Hector de Callière, gouverneur de Montréal et commandant en second. Selon ce projet, un corps expéditionnaire de 800 hommes partirait du Canada pour aller raser Albany pendant qu’une escadre de six frégates portant 1 200 hommes, venue directement de France, prendrait Manhattan qui deviendrait une base d’où les envahisseurs iraient ravager la côte de la Nouvelle-Angleterre jusqu’à Boston. Denonville et Callière prétendaient que ces expéditions avaient de meilleures chances de succès que les campagnes contre les villages iroquois enfouis au cœur de la forêt ; une fois New York dévasté, le flanc iroquois serait contourné et les Iroquois se verraient forcés d’accepter les conditions de paix des Français.
Pendant ce temps, la maladie avait fait de grands ravages dans la colonie : sur une population de 11 000 habitants, plus de 1 400 étaient morts. En outre, des bandes de guerriers iroquois continuaient à faire des victimes dans la région de Montréal. À Niagara, le fort était entouré de maraudeurs iroquois, de sorte que la garnison se trouvait prisonnière ; et 89 hommes moururent de scorbut. Au fort Frontenac, la situation était la même : 100 hommes furent victimes du scorbut et les Iroquois brûlèrent les dépendances et le bétail. Aussi Denonville, pour accorder un peu de répit à la colonie, entama des négociations de paix avec les chefs de trois des Cinq-Nations. Il insista beaucoup pour que toutes les nations alliées des Français soient aussi incluses dans les pourparlers. En dépit du fait que pendant que se déroulaient les négociations les Iroquois surprirent des Indiens de l’Ouest, qui se rendaient trafiquer à Montréal, pillèrent les canots, tuèrent un certain nombre d’Indiens et emmenèrent les autres prisonniers dans leurs villages, on en vint finalement à une entente. La paix serait ratifiée l’année suivante à Montréal par les Cinq-Nations et non seulement trois d’entre elles ; dans l’intervalle on suspendrait les hostilités. Deux mois plus tard, toutefois, l’entente était en péril. Le chef Huron Kondiaronk, qui craignait que le traité de paix n’eût pour seul résultat que de permettre la concentration des forces iroquoises contre son peuple, attira dans une embuscade un parti de délégués iroquois qui se rendaient à Montréal pour conférer avec Denonville. Kondiaronk tenta de laisser croire aux Iroquois qu’il avait obéi aux ordres des Français, mais la garnison de fort Frontenac réussit à convaincre les Iroquois du contraire et l’incident n’eut pas les conséquences qu’en escomptait Kondiaronk et que des historiens lui attribueront plus tard.
Pendant les mois qui suivirent, Denonville fit de son mieux pour consolider les défenses de la colonie, mais les Canadiens, rassurés par les négociations de paix et la disparition des bandes de rôdeurs iroquois, montraient peu d’intérêt. Comme Denonville sut le prévoir, plusieurs devaient plus tard payer de leur vie une telle insouciance.
Le printemps de 1689 s’était insensiblement mué en été, et rien ne bougeait du côté des Iroquois, pas plus que n’arrivaient de France les approvisionnements et les ordres du ministre. Dans les colonies anglaises, Sir Edmund Andros, gouverneur de la Nouvelle-Angleterre et de New York, faisait de son mieux pour empêcher les négociations directes entre les Iroquois et les Français ; il prétendait que les membres des Cinq-Nations étaient sujets de la couronne britannique et que, par conséquent, les Français devraient négocier directement avec lui et non avec les Iroquois. Les Français et les Iroquois s’unirent pour rejeter cette prétention mais Andros avait réussi à retarder la ratification du traité ; dans l’intervalle, on apprit en Nouvelle-Angleterre que la guerre avait éclaté entre l’Angleterre et la France à la suite de la glorieuse révolution, qui avait placé Guillaume III et Marie sur le trône d’Angleterre. Denonville, par contre, ignorait tout de cette situation.
En apprenant de la bouche des Anglais d’Albany que l’Angleterre et la France étaient en guerre, les Iroquois abandonnèrent toute idée de paix avec le Canada. Auparavant, le gouverneur de New York avait tenté de les empêcher d’attaquer les établissements canadiens, suivant en cela les ordres reçus de Londres, mais avait plutôt encouragé les attaques dans l’Ouest. Les Iroquois pouvaient maintenant déclencher une attaque contre le Canada et ils avaient la conviction de pouvoir compter sur l’appui des Anglais. Pendant que Denonville, qui n’était pas encore au courant des derniers événements en Europe, attendait impatiemment les délégués iroquois pour la ratification du traité de paix, les Cinq-Nations levaient des troupes. À l’aube du 5 août, environ 1 500 guerriers s’abattirent inopinément sur le village de Lachine, situé à quelques milles de Montréal. Même si les pertes de vie ne furent pas, et de loin, aussi élevées qu’on le prétendra plus tard, la férocité soudaine de l’attaque portait un coup terrible à la colonie. Vingt-quatre colons furent tués, entre 70 et 90 furent faits prisonniers, dont 42 ne revinrent jamais, et 56 des 77 maisons furent rasées.
On accusa Denonville de n’avoir pas réagi comme l’exigeaient les circonstances. Après coup, il est peut-être possible de soutenir qu’il aurait pu contre-attaquer avec plus de vigueur, mais dans les circonstances, étant donné les rapports fragmentaires, contradictoires et exagérés qui lui parvinrent sur les mouvements de l’ennemi, les ordres qu’il donna étaient les seuls qu’il pouvait logiquement donner ; ceux-ci ne pouvaient avoir qu’une portée générale, laissant à Philippe de Rigaud de Vaudreuil, commandant des troupes de Montréal, le soin d’user de son initiative et de son jugement. Vaudreuil, beaucoup plus que Denonville, est à blâmer de n’avoir pas immédiatement tiré parti de la situation en lançant une sanglante contre-attaque. L’effet de surprise avait permis aux Iroquois de remporter la première d’une série de victoires analogues qui marqueront les hostilités qui allaient se poursuivre pendant dix ans. Mais ces victoires ne furent pas toujours faciles. Peu après l’attaque de Lachine, un petit groupe de Canadiens dépêchés par Denonville rencontrèrent une bande de guerriers iroquois sur le lac des Deux-Montagnes. Sans subir de perte, les Canadiens tuèrent 18 adversaires et firent trois prisonniers qui furent brûlés vifs sur la place Royale à Montréal en guise de représailles contre les mauvais traitements que les Iroquois avaient infligés aux Canadiens qu’ils avaient capturés. À l’est, Denonville lança les Abénaquis contre les établissements de la Nouvelle-Angleterre où la dévastation qu’ils semèrent égalait bien celle que les Iroquois avaient laissée derrière eux à Lachine.
À cause des guerriers iroquois qui rôdaient constamment autour des établissements, Denonville dut abandonner l’idée de laisser une garnison au fort Frontenac. Plus tôt, on avait abandonné Niagara à cause des difficultés de ravitaillement. Le fort Frontenac n’avait plus d’utilité militaire, sa garnison était prisonnière d’une poignée d’Iroquois en embuscade et il fallait organiser des convois de plusieurs centaines d’hommes pour en assurer le ravitaillement. Le 24 septembre, Denonville dépêcha au commandant Philippe Clément Du Vault l’ordre de faire sauter le fort et de rentrer à Montréal avec ce qui restait de la garnison.
Trois semaines plus tard, les vaisseaux si longtemps attendus arrivèrent de France. À bord se trouvaient Callière et Louis de , comte de Frontenac, qui venait remplacer Denonville au poste de gouverneur général. On a souvent prétendu que Frontenac avait été nommé de nouveau pour sauver la colonie des conséquences néfastes de l’administration inepte de Denonville, à preuve le massacre de Lachine et l’abandon du fort Frontenac. La chronologie des événements apporte un démenti à ces affirmations. La nomination de Frontenac à la succession de Denonville remonte au mois d’avril 1689, soit quatre mois avant le massacre de Lachine. À la vérité, Louis XIV et le ministre, dans une dépêche en date du 1er mai 1689, exprimèrent leur entière satisfaction des mesures qu’avait prises Denonville ; ils sanctionnaient d’avance l’abandon du fort Frontenac s’il était jugé nécessaire. Puis, le 31 mai, Louis XIV signa le document qui donnait à Denonville l’ordre de rentrer en France. Le roi y déclarait que, à cause de la guerre en Europe, il avait décidé de le rappeler « pour vous donner de l’employ dans mes armées où je suis persuadé que vous me servirez avec la mesme application, le mesme zèle et le mesme succez que vous avez fait par le passé ». Ultérieurement toutefois, Paul de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, persuada le roi de nommer Denonville son adjoint à la charge de gouverneur du petit-fils du roi, le duc de Bourgogne, en reconnaissance de ses 33 années de service aux armées du roi. En 1688, Denonville avait donné à entendre qu’il aimerait être rappelé si le ministre rejetait ses propositions quant à la politique à suivre pour assurer la protection de la colonie ; la guerre faisant rage en Europe, il n’y avait pour la colonie aucun espoir de recevoir les renforts demandés. De plus, la santé de Denonville n’était pas très bonne car il s’était usé au travail ; cette seule raison aurait justifié son rappel. Il n’existe toutefois aucune preuve que Denonville ait été rappelé pour des motifs autres que ceux qui étaient stipulés dans la dépêche de Louis XIV.
Denonville était arrivé en Nouvelle-France immédiatement après que les Iroquois eurent imposé une paix honteuse aux Français et qu’une épidémie eut décimé la population ; le moral des Canadiens était très bas et la colonie était sans défense. Denonville réussit de façon remarquable à bloquer les tentatives du gouverneur de New York pour déloger les Français de l’Ouest et détourner vers Albany le commerce des fourrures de Montréal. Il affaiblit l’emprise des Anglais sur la baie d’Hudson en prenant les forts de la baie James. Avec de faibles effectifs, il a su restaurer l’équilibre militaire et démontrer aux Iroquois que leurs villages, même les plus éloignés, pouvaient être anéantis. Avec une franchise brutale, il indiqua clairement au ministre quelle serait la force militaire dont la colonie aurait besoin pour la mettre à l’abri des attaques. Quand on lui refusa les troupes qu’il avait demandées, il se conforma aux ordres reçus et négocia un traité de paix honorable. Ce n’était pas sa faute si ce traité ne dura que quelques mois : il n’avait aucun pouvoir sur les événements d’Europe qui mirent le feu aux poudres et déclenchèrent l’attaque iroquoise sur Lachine. Il est significatif qu’on accorda finalement à son successeur les effectifs qu’il considérait comme nécessaires pour écraser les Iroquois ; il fallut cependant neuf ans de luttes meurtrières pour y arriver.
Denonville apporta aussi dans l’administration civile une contribution importante ; il opéra des réformes qui allaient avoir de profondes répercussions sur la société canadienne. Dans ce domaine, toutefois, comme dans le domaine militaire, il était jusqu’à un certain point son propre ennemi. Le poste de gouverneur était avant tout une fonction politique et le caractère de Denonville se pliait mal à ce rôle. Il n’avait rien d’un courtisan. Il était d’une honnêteté désarmante et recherchait la perfection en tout. Il exigeait beaucoup des autres, trop même ; cependant il exigeait encore plus de lui-même. Si les choses n’allaient pas, il endossait immanquablement le blâme ; si elles allaient bien, il en accordait le crédit à ses subordonnés, ou à Dieu. Il quitta la colonie tout de suite après une victoire des Iroquois, et son successeur, dans les dépêches à la cour, non content de rapporter la situation comme étant beaucoup plus grave qu’elle ne l’était en réalité, s’empressa d’en rejeter tout le blâme sur Denonville. D’autres personnes, cependant, exprimèrent leur profond regret de le voir quitter la colonie. Tout bien considéré, la colonie avait de bonnes raisons de lui être reconnaissante.
Denonville et sa famille quittèrent Québec à la mi-novembre et après une traversée très dure débarquèrent à La Rochelle le 26 décembre. Le mois suivant, il présenta son rapport au ministre. La promotion de Denonville au grade de maréchal des camps et armées du roi prouve hors de tout doute que Seignelay et Louis XIV étaient satisfaits de la façon dont il s’était acquitté de ses fonctions. Le 25 août 1690 il fut nommé sous gouverneur du duc d’Anjou et le 24 août 1693 il fut investi de la même responsabilité auprès du duc de Berry. Sa vieillesse toutefois fut assombrie par la disgrâce qui frappa son fils, colonel d’infanterie, qui fut congédié sur ordre du roi, pour avoir livré son régiment sans opposer de résistance à George Hamilton, comte d’Orkney, au cours de la bataille de Blenheim en 1704. Six ans plus tard, le 22 septembre 1710, le vieux marquis mourut dans son château ; il fut inhumé deux jours après dans la crypte de la chapelle du château.
La majorité des sources manuscrites concernant le terme de Denonville, comme gouverneur général, se trouvent aux AN, Col., B, Col., C11A et Col., F3. Les APC et les AQ possèdent des microfilms et des transcriptions de ces séries. On trouvera d’autres documents aux ASQ et aux New York State Archives, Albany. Les documents contenus dans ce dernier fonds sont publiés dans NYCD (O’Callaghan et Fernow). Le récit flatteur des événements racontés par Lahontan, New Voyages to North America (Thwaites), a été écrit plusieurs années plus tard ; on doit faire des réserves sur ce récit.
Il existe une biographie de Denonville, écrite par Thérèse Prince-Falmagne, Un marquis du grand siècle, Jacques-René de Brisay de Denonville, gouverneur de la Nouvelle-France, 1637–1710 (Montréal, [1965]) ; cette biographie est précieuse par les renseignements qu’elle contient au sujet des antécédents de Denonville.
Parmi les articles de revues les plus utiles, mentionnons : Jean Leclerc, Denonville et ses captifs iroquois, RHAF, XIV (1960–61) : 545–558 ; RHAF, XV (1961–62) : 41–58 ; Le rappel de Denonville, RHAF, XX (1966–67) : 380–408. Il y a aussi l’article d’Eccles, Denonville et les galériens iroquois, RHAF, XIV (1960–61) : 408–429.
La période durant laquelle Denonville s’acquitta de ses fonctions de gouverneur général de la Nouvelle-France est traitée dans tous les ouvrages d’histoire générale du Canada ; les préjugés et le peu de rigueur scientifique atténuent la valeur de ces premiers ouvrages. Francis Parkman est le tenant d’une interprétation « conservatrice » dans Count Frontenac and New France under Louis XIV (Boston, 1877), tandis qu’Eccles offre une interprétation nouvelle dans Canada under Louis XIV (Toronto, 1964).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
W. J. Eccles, « BRISAY DE DENONVILLE, JACQUES-RENÉ DE, marquis de DENONVILLE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/brisay_de_denonville_jacques_rene_de_2F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/brisay_de_denonville_jacques_rene_de_2F.html |
| Auteur de l'article: | W. J. Eccles |
| Titre de l'article: | BRISAY DE DENONVILLE, JACQUES-RENÉ DE, marquis de DENONVILLE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1969 |
| Année de la révision: | 1991 |
| Date de consultation: | 2 avr. 2025 |