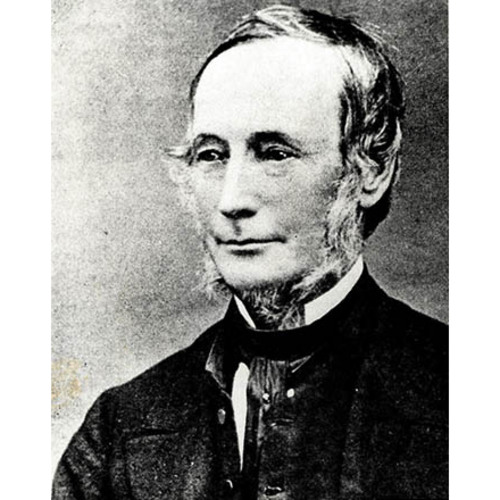Provenance : Lien
WORKMAN, JOSEPH, médecin, marchand, homme politique, professeur et fonctionnaire, né le 26 mai 1805 près de Lisburn (Irlande du Nord), fils de Joseph Workman et de Catharine Goudie (Gowdie) ; le 30 mai 1835, il épousa à Montréal Elizabeth Wasnidge, et ils eurent sept fils et trois filles ; décédé le 15 avril 1894 à Toronto.
Joseph Workman comptait parmi ses ancêtres un théologien puritain du xviie siècle, le révérend William Workman, de Gloucester, en Angleterre ; farouche adversaire de l’archevêque William Laud, il avait été excommunié de l’Église d’Angleterre. Le fils de William Workman, aussi prénommé William, servit en Irlande dans l’armée d’Oliver Cromwell et y reçut une généreuse concession foncière. Joseph Workman père, lui, était instituteur. Peu après la guerre d’Indépendance américaine, il immigra à Philadelphie, où il enseigna l’anglais pendant trois ans dans un collège. Rentré en Irlande vers 1790, il épousa Catharine Goudie, originaire de l’Ayrshire, en Écosse, et ils eurent une fille et huit garçons. Joseph, le quatrième d’entre eux, eut d’abord pour précepteur l’un de ses frères aînés, Benjamin, puis fréquenta une grammar school et une école secondaire à Lisburn. En 1826, il trouva un poste à l’Ordnance Survey d’Irlande, où il demeura trois ans.
Précédé par cinq de ses frères, Joseph Workman immigra à Montréal avec le reste de la famille en 1829. Au cours des cinq années qui suivirent, il étudia la médecine au McGill College, assistant aux cours en faculté, faisant du travail clinique au Montreal General Hospital et recevant des leçons particulières du docteur John Stephenson*. En 1835, il obtint son doctorat en médecine. Sa thèse portait sur le choléra asiatique, sujet d’actualité et maladie dont il avait été à même de constater les ravages à Montréal durant les étés de 1832 et de 1834. À l’encontre de bon nombre de médecins parmi les plus réputés de l’époque, il soutenait que le choléra était une maladie contagieuse.
Peu après avoir reçu son diplôme, Workman épousa, à l’église presbytérienne St Gabriel Street, Elizabeth Wasnidge, originaire de Sheffield, en Angleterre. Il ouvrit un cabinet à Montréal mais, moins d’un an après, la mort du frère de sa femme le contraignit à changer d’orientation. En 1836, il reprit la quincaillerie que son beau-frère avait tenue à Toronto. Bientôt, son frère Samuel alla exploiter avec lui la Workman Brothers and Company, au 36 de la rue King, en face de l’église St James. À l’instar de ses frères Thomas* et William*, associés dans une quincaillerie montréalaise, Joseph était un homme d’affaires entreprenant et prospère, qualités que le Board of Trade de Toronto reconnut en l’élisant vice-président au milieu des années 1840. De plus, en cette époque de politique instable, il se fit connaître comme un partisan de la réforme au discours cohérent et direct. Les nombreux commentaires acérés qu’il publiait dans des journaux réformistes comme le Toronto Mirror lui valurent d’être qualifié, par ses adversaires, de « calomniateur le plus dur et le plus téméraire qui ait jamais manié la plume ». Il fut échevin du quartier St David de 1847 à 1849, fit partie de la commission que le gouvernement créa afin d’enquêter sur la situation du King’s College [V. Henry Boys* ; Robert Easton Burns*] et devint en 1850 le premier président du Toronto Public School Board.
Workman avait abandonné la quincaillerie en 1846 pour retourner à ses premières amours, la médecine. Il se bâtit une nombreuse clientèle et, à la demande du docteur John Rolph*, donna, à la Toronto School of Medicine (dont Rolph était le fondateur) des conférences sur l’obstétrique, les maladies féminines et infantiles, puis la matière médicale. Selon un de ses anciens étudiants, le docteur Walter Bayne Geikie, c’était « un homme de grand talent, un pédagogue excellent et très instruit ».
En 1853, abruptement encore une fois, la carrière de Workman prit un autre virage. D’abord à titre temporaire, puis à titre permanent, il devint surintendant médical du Provincial Lunatic Asylum, qui avait récemment ouvert ses portes à Toronto. Son ami et collègue Rolph avait veillé à sa nomination. Déjà partisan de la réforme avant la rébellion de 1837–1838, Rolph était devenu un membre influent du cabinet réformiste de Francis Hincks* et d’Augustin-Norbert Morin*, pour qui l’asile était une source de graves embarras politiques. En choisissant Workman, Rolph lui confia le soin de dénouer les « intrigues » dont l’établissement, pourtant bien jeune, n’avait cessé d’être le théâtre.
Avant 1830, dans le Haut-Canada, il n’y avait pas eu de loi sur les malades mentaux. Ceux qui ne présentaient aucun danger pour la collectivité, les « fous paisibles », étaient soit confinés à la maison, soit, s’ils étaient pauvres et sans famille, placés dans un autre foyer ou « exclus » de toute la communauté. Les « fous furieux », qui menaçaient la vie ou la propriété, étaient parfois incarcérés dans les prisons de district. En 1830, parce que la population s’accroissait rapidement et que l’on rapportait que depuis peu, à l’étranger, le traitement des malades mentaux avait fait des progrès, les magistrats du district de Home demandèrent qu’« un lieu quelconque soit aménagé en asile d’aliénés ». L’Assemblée du Haut-Canada allait débattre de la question durant neuf ans. Au cours de cette période, le plaidoyer le plus éloquent en faveur d’un établissement provincial vint du docteur Charles Duncombe*. Dans son rapport de 1836 sur les asiles, il recommandait de construire un établissement où l’on appliquerait les principes du « traitement moral », c’est-à-dire le régime de douceur et de compassion que l’on était en train d’instaurer en France, en Angleterre et aux États-Unis. Dans ces nouveaux asiles étrangers, affirmait Duncombe, le taux de guérison pouvait atteindre 90 %. En 1839, l’Assemblée du Haut-Canada réagit à son rapport en adoptant une loi qui autorisait « la construction, dans la province, d’un asile pour l’accueil des aliénés ».
La construction de l’asile provincial au 999 de la rue Queen, d’après des plans de John George Howard*, ne commença qu’en 1845. En attendant, à compter de 1841, les aliénés de la province, de plus en plus nombreux, logèrent dans un « asile temporaire » que l’on avait aménagé dans l’ancienne prison de Toronto, rue King [V. William Rees* ; Walter Telfer*]. Ce fut une amère déception pour les réformateurs qui, dans la décennie précédente, avaient réclamé un établissement où les malades mentaux pourraient bénéficier du traitement moral. Jusqu’à la fin des années 1840, le surintendant médical et le conseil d’administration de l’asile se livrèrent une guerre sans merci pour avoir la haute main sur les affaires internes. Quatre surintendants se succédèrent et repartirent après avoir compromis leur réputation, tandis que le conseil continuait de nommer les fonctionnaires subalternes en faisant montre de ce que le docteur George Hamilton Park qualifia en 1848 de « favoritisme mesquin ». Quant aux patients, ils se trouvaient dans une situation à peine moins déplorable que dans les prisons de district. Dans l’ensemble, le traitement moral n’était pas appliqué. Le célèbre aliéniste anglais James Hack Tuke, qui se rendit à l’asile temporaire en 1845, nota que c’était « l’un des endroits les plus tristes et les plus déprimants qu[‘il eut] jamais visités ». Il y avait 70 patients dont les visages portaient les marques indélébiles de la misère, de la faim et de la souffrance ».
L’asile permanent ouvrit ses portes prématurément le 26 janvier 1850 ; seules les deux ailes avant étaient terminées. Les pensionnaires s’y trouvaient à peine mieux qu’auparavant. Bien que d’éminents citoyens, dont George Brown*, rédacteur en chef du Globe, aient insisté pour que la « vieille clique » ne soit pas transférée dans le nouvel édifice, le gouvernement ne créa « aucun nouveau comité pour en améliorer l’administration ». Fait peu surprenant, le docteur John Scott*, nommé surintendant en 1850, se trouva bientôt en butte au conseil de l’asile, que présidait le docteur Christopher Widmer*. Pendant quelque temps, son beau-père, le révérend John Roaf*, membre influent du conseil, le protégea. Mais même lui ne put le sauver quand la presse torontoise révéla qu’on l’accusait d’avoir transformé « l’asile d’aliénés en salle de dissection » pour les étudiants en médecine. Une loi intitulée Act for the Better Management of the Provincial Lunatic Asylum at Toronto entra en vigueur le 14 juin 1853, et Scott démissionna le 1er juillet.
Chaos administratif, incompétence professionnelle, négligence envers les patients, telle était donc la situation à l’asile lorsque Workman en assuma la surintendance par intérim en 1853. La loi avait beaucoup étendu les pouvoirs du surintendant en réduisant la taille, l’indépendance et l’autorité du conseil sur les affaires courantes, et en lui donnant toute latitude d’embaucher et de congédier les « gardiens et domestiques ». Voyant le désordre que ses prédécesseurs avaient semé, Workman s’empressa de faire le ménage (l’expression peut bien être prise au pied de la lettre). Une de ses premières corvées fut de superviser l’élimination de « la fosse d’aisances la plus nauséabonde et la plus énorme [qui fût] » : les constructeurs n’ayant pas relié les canalisations sanitaires à l’égout central, trois ou quatre pieds d’excréments s’empilaient sous la cave. Grâce à cet administrateur à la poigne solide, l’ordre et l’efficacité ne tardèrent pas à régner dans tous les services. Tant au Canada qu’à l’étranger, l’asile de Toronto acquit une excellente réputation. Workman obtint sa permanence le 1er avril 1854 ; il allait rester aux commandes encore 21 ans.
Au début de son mandat, Workman connaissait peu l’aliénation mentale et peut-être encore moins les nouvelles méthodes de garde et de traitement des aliénés. Sa nomination avait même des relents de ce favoritisme dont, plus tard, il allait tellement critiquer la présence dans le réseau des asiles. Cela dit, il dut apprendre son métier sur le tas, comme tous les membres de la première génération de médecin qui devinrent aliénistes (terme appliqué aux spécialistes du traitement institutionnel des malades mentaux jusqu’à ce que le mot « psychiatre » entre dans l’usage, dans les années 1890). Ce n’était pas un novateur ; sa perspective théorique et sa pratique thérapeutique s’inscrivaient dans le courant dominant de la psychiatrie de l’époque.
Les tenants de ce courant affirmaient – et c’était leur conviction fondamentale – que la folie, sous toutes ses formes, était une maladie strictement somatique. La folie, écrivait Workman dans son rapport de 1868–1869, « n’est jamais simple désordre mental » ; pour lui, c’était un désordre physique attribuable à « des changements fonctionnels ou structurels » survenus dans le cerveau ou, en raison de « l’activité réflexe », dans d’autres systèmes organiques (par exemple, on attribuait l’hystérie à une maladie des organes reproducteurs féminins). Lorsqu’il s’agissait de déterminer les causes de ces changements fonctionnels ou structurels, Workman éliminait la longue liste des prétendus agents « moraux » (psychologiques) auxquels on avait fermement cru plus tôt au xixe siècle. Selon lui, « le chagrin, l’amour, la dépossession, l’émoi religieux, [...] les querelles familiales, la jalousie, la peur », pour ne nommer que ceux-là, n’engendraient pas la folie. Les seules causes déterminantes avaient une origine physique : par exemple « les blessures au crâne, l’apoplexie ; l’épilepsie ; l’intempérance parentale ; la masturbation [et] l’infection scrofuleuse et syphilitique ».
Le diagnostic de Workman, à savoir que tous les cas de folie étaient associés « à une forme quelconque d’anomalie somatique », dictait sa thérapeutique générale. D’abord, il fallait refaire la santé physique du patient en lui donnant une « bonne alimentation » et de généreuses rations d’alcool. Les médicaments, par contre, devaient être utilisés « le moins possible ». Ses rapports annuels démontrent qu’il adhéra strictement à ce régime curatif dès le début de son mandat. En 1859, année représentative, l’asile dépensa 1 614,72 $ en « bière, spiritueux et vin », mais seulement 139,33 $ en médicaments.
Une fois que le patient avait recouvré la santé physique, Workman se consacrait à « la guérison de la maladie mentale » en recourant à un traitement moral soigneusement défini. « Douceur constante, patience de tous les instants, bonne foi à toute épreuve, déclarait-il en 1858, tels sont les agents moraux essentiels employés aujourd’hui dans tout asile d’aliénés bien tenu. » Il ne doutait pas que ce traitement, associé à un travail utile, à des divertissements de groupe et à l’instruction religieuse – activités destinées à éloigner le patient des pensées et des émotions morbides – produirait les taux de guérison de 90 % promis par les premiers promoteurs de l’asile, tel Duncombe. Ses espoirs furent vite réduits à néant. Dix ans après son arrivée à l’asile de Toronto, il racontait devant l’Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane : « J’ai été stupéfait de voir que je ne pouvais pas parvenir à des résultats aussi satisfaisants que ceux que mes prédécesseurs semblaient avoir obtenus [...] mon pourcentage de rétablissement était faible. » Tel était le problème le plus troublant, le plus menaçant même, auquel faisaient face les aliénistes de sa génération. Après avoir convaincu la population qu’elle pouvait espérer des merveilles, comment lui expliquer que les asiles ne semblaient pas pouvoir guérir les malades ? Et si les asiles ne guérissaient pas les malades, par quoi allait-on bien pouvoir les remplacer ? Ces questions allaient tourmenter Workman jusqu’à la fin de son mandat.
La réponse crevait les yeux, mais ni Workman ni ses collègues n’étaient prêts à la voir : les belles thérapies médicales et morales dans lesquelles ils mettaient tant de foi ne fonctionnaient tout simplement pas dans la majorité des cas. Accepter cette explication aurait, bien sûr, été un suicide professionnel. Aucune profession ne saurait admettre ouvertement qu’elle repose sur des théories erronées. Il fallait trouver d’autres explications à l’échec.
Workman, pour sa part, en offrait trois dans les rapports qu’il rédigea à la fin des années 1850 et au début de la décennie suivante. Premièrement, et c’était plutôt faible, il affirmait que les réformateurs comme Duncombe avaient suscité des « attentes démesurées » dans l’opinion publique, attentes que même les meilleurs asiles ne pourraient jamais combler. Deuxièmement, il soulignait que les asiles étaient forcés d’accepter des classes d’individus qu’aucun surintendant, ni même aucun des premiers promoteurs de l’asile, n’avait jamais prétendu pouvoir guérir. Les municipalités de la région considéraient l’asile comme un dépotoir, une bonne pension où elles pouvaient commodément envoyer les fauteurs de troubles et mésadaptés de tous genres, les indigents, les personnes atteintes de déficiences congénitales, les vieillards et les gens séniles. La présence de ces patients « bien inoffensifs », mais manifestement incurables, obligeait à refuser des cas « graves, susceptibles d’amélioration ou vraiment dangereux ». « Chaque incurable, prévenait-il, empêche huit malades curables » d’entrer à l’asile, et ceux-ci, « par conséquent, risquent de devenir aussi des cas désespérés ».
Enfin, Workman attribuait partiellement son insuccès à « l’indifférence et [à] la parcimonie de la province ». Avec la « somme dérisoire » qui portait le nom de « subvention parlementaire », pourvoir convenablement aux besoins des patients, et plus encore les guérir, était carrément impensable. On ne pouvait pas non plus espérer de guérisons, soulignait-il, tant que les deux ailes arrière de l’asile ne seraient pas terminées. À cause du surpeuplement (en 1853, les deux ailes avant, conçues pour environ 250 patients, en abritaient 373), il se révélait impossible de classer vraiment les malades, bien que cela ait été considéré comme l’un des éléments fondamentaux du régime de traitement moral. « Des crédits abondants, au moment utile, pour le traitement et la garde des aliénés », voilà ce que Workman réclamerait durant 22 ans aux gouvernements qui se succéderaient et, finalement, il perdrait la bataille.
C’est au cours même du mandat de Workman que l’État canadien vit le jour et qu’une structure gouvernementale fortement centralisée s’installa. Cette organisation bureaucratique se fit sentir, plus que partout ailleurs, dans le secteur de l’assistance publique, et des asiles en particulier. Dans les années 1840, l’asile temporaire de Toronto avait été administré par un conseil local de 12 membres non rémunérés qui était tout à fait indépendant du gouvernement. Le Toronto Lunatic Asylum Act de 1853, inspiré du nouveau Provincial Penitentiary Act de 1851, inaugura une ère d’administration gouvernementale et de centralisation. L’asile passait sous la compétence de la couronne et allait être géré par un conseil salarié, nommé par le gouvernement et formé d’« au moins quatre personnes ». Quatre ans plus tard, en 1857, le gouvernement prit une nouvelle mesure centralisatrice : la fusion du conseil du pénitencier et du conseil de l’asile. En 1859, se réunissait pour la première fois un organisme de surveillance des établissements d’assistance publique qui n’avait pas son pareil en Amérique du Nord : le Board of Inspectors of Prisons, Asylums and Public Charities. L’intention du gouvernement n’avait rien de mystérieux : le système d’établissements publics ayant été jusque-là assez chaotique et de plus en plus coûteux, il voulait en assainir la gestion financière, en augmenter l’efficacité et l’uniformiser. À la Confédération, en 1867, les « hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité » devinrent un domaine de compétence provinciale, et l’Ontario acheva le processus en faisant ce qui s’imposait en toute logique : abolir l’ancien conseil et nommer un seul inspecteur des prisons, asiles et établissements publics de charité. Le premier titulaire de ce poste, John Woodburn Langmuir*, allait respecter tout à fait la préoccupation centrale du gouvernement, à savoir une « saine économie politique ». Sa devise étant « l’économie la plus stricte compatible avec [une] bonne gestion », il allait faire du système ontarien d’assistance sociale l’un des plus efficaces et des moins coûteux d’Amérique du Nord.
Réduire les dépenses importait trop au gouvernement pour que Workman obtienne jamais ce qu’il réclamait, des « crédits abondants, au moment utile ». Au lieu de terminer les deux ailes arrière de l’asile, le gouvernement recourut à une échappatoire : des succursales temporaires. L’ancien bâtiment du King’s College situé dans Queen’s Park, à environ deux milles de l’asile principal, ne servait plus : la University Branch y ouvrit ses portes en juillet 1856. On inaugura une deuxième succursale en 1859 après réaménagement des casernes du fort Malden à Amherstburg, à environ 250 milles à l’ouest de Toronto. La dernière, située dans un vieil hôtel du lac Couchiching, à quelque 80 milles au nord de Toronto, s’ouvrit en 1861. Néanmoins, les patients continuaient inexpliquablement d’affluer à l’asile principal, où l’encombrement demeurait un problème pressant. Le conseil des inspecteurs conclut que l’institution de ce « réseau de succursales éloignées » témoignait d’« une grave lacune sur le plan économique ». Workman avait une solution à proposer, et c’est dans son rapport annuel de 1865 qu’il l’exposa de la manière la plus complète. Il préconisait un réseau qui comprendrait « trois asiles curatifs pour le traitement de patients malades depuis peu » – l’asile de Toronto et deux nouveaux établissements, l’un à Kingston et l’autre à London – ainsi que « six asiles secondaires, chacun construit pour 200 pensionnaires mais susceptibles [d’en recevoir] 400 », où on logerait « ces cas chroniques qui paralys[aient alors les] asiles principaux ».
Les inspecteurs accueillirent par un silence poli ce projet ambitieux et coûteux. En juillet 1863, excédé que les autorités municipales lui envoient constamment des malades « absolument incurables », Workman refusa pour la première fois d’admettre quatre femmes de cette catégorie. Les inspecteurs ne tardèrent pas à réagir en le blâmant. Tout en admettant que l’asile « ne conv[enait] pas tout à fait [aux] besoins », ils sommèrent Workman de trouver de la place à ces quatre femmes et d’ajouter 50 lits afin de porter la capacité de l’asile de Toronto à 400. Mieux valait, concluaient-ils, « exposer » à un léger surpeuplement « les 350 patients qui [étaient] déjà dans l’établissement » plutôt que d’« exposer les familles, et la société elle-même, aux dangers que présentaient] des aliénés en liberté, curables ou incurables, vu les fréquents événements tragiques dont ils [étaient] la cause ». Protéger la société, et non pas guérir les aliénés, telle était la priorité absolue des inspecteurs.
Workman avait fondé sa position sur la nécessité d’appliquer de nouveau, à l’asile de Toronto, les principes premiers de Philippe Pinel et de William Tuke, qui au cours des années 1790 avaient instauré le traitement moral dans des asiles européens. Et il avait perdu. Bien sûr, c’était un revers personnel mais, dans une perspective plus générale, sa défaite illustre à quel point, pour les aliénistes du xixe siècle, la quête de la reconnaissance professionnelle et de la légitimité fut semée d’embûches. Contrairement à d’autres médecins – qui, pendant une bonne partie du siècle, durent faire des pieds et des mains pour se constituer une clientèle suffisante – les aliénistes étaient assurés d’avoir une population de patients. De plus, il s’agissait d’une population captive. Pourtant, ironie du sort, l’asile, leur château-fort, était pour eux un bien mauvais ouvrage de défense. Les aliénistes employés comme surintendants d’un asile étaient des fonctionnaires salariés. Ils se trouvaient donc soumis aux caprices et aux volontés d’un groupe de profanes – administrateurs et hommes politiques – qui se souciaient souvent fort peu de leurs aspirations professionnelles. La psychiatrie n’allait devenir une profession autonome et acquérir ses lettres de noblesse qu’au xxe siècle, longtemps après la mort de Workman. La plupart des psychiatres quitteraient l’asile et les fous pour le cabinet et les névrosés – patients plus respectables et plus traitables. La psychiatrie se redéfinirait à partir de nouvelles théories psychologiques dont la plus célèbre a été sans aucun doute le freudisme.
Les dernières années de Workman à l’asile de Toronto ne furent pas sans nuage. L’inspecteur Langmuir s’avéra un administrateur parcimonieux mais compétent. Dès 1870, le nombre total de lits dans les asiles de l’Ontario atteignait non plus 1 000, mais 1 500, grâce à la reconstruction du vieux Rockwood Asylum de Kingston [V. Charles Kirk Clarke*], ainsi qu’à l’ouverture d’un nouvel asile de 500 lits à London [V. Richard Maurice Bucke*] et grâce, enfin, à l’achèvement des deux ailes arrière de l’asile de Toronto. Et pourtant, on ne savait trop pourquoi, le nombre de nouveaux cas semblait toujours dépasser les places disponibles. Vaillamment, Langmuir s’efforçait d’aller au-devant de la demande. Par exemple, à titre de solution de rechange aux asiles « principaux » et « secondaires » de Workman, plus coûteux, il institua un programme de construction de nouveaux asiles de « style cottage » ; on logeait les malades incurables et curables dans des pavillons distincts mais qui relevaient d’un même grand établissement. Cependant, lorsqu’il prit sa retraite, en 1882, même lui dut admettre sa défaite : il n’avait pas réussi à mettre au point, pour le long terme, une politique efficace sur les asiles. Dans les 20 années suivantes, ses successeurs continueraient de multiplier les établissements – Mimico en 1890, Brockville en 1894, Cobourg en 1902 et Penetanguishene en 1904 – mais il s’agissait d’un processus sans fin, chacun étant bientôt surpeuplé. Né en 1850 d’un établissement qui logeait 211 patients, le réseau ontarien des asiles comptait, au début de la Première Guerre mondiale, huit grands établissements qui abritaient quelque 6 000 patients.
Workman quitta l’asile de Toronto en juillet 1875 « pour des raisons que [lui comprenait] », nota-t-il dans son journal. Le véritable motif était sans aucun doute l’inspecteur Langmuir et son régime bureaucratique. Même si, à l’intention du public, il allait écrire en 1884 dans Alienist and Neurologist que l’inspecteur était son « brise-lames [... sa] meilleure protection contre une présentation déformée des faits ou contre la calomnie vengeresse », l’autorité de Langmuir lui avait paru de plus en plus lourde à supporter. Trop indépendant d’esprit et trop direct, Workman ne pouvait se contenter du rôle de rond-de-cuir. Ses 19 années de retraite, durant lesquelles il vécut dans sa maison du 113 rue Mutual, furent plus heureuses. De nombreux honneurs lui échurent : on l’élut président de l’Association médicale canadienne en 1877, puis de la Toronto Medical Society en 1878 et, enfin, de l’Ontario Medical Association en 1881. Dans chacune de ces fonctions, il défendit vigoureusement le droit de la médecine au statut de profession véritablement autonome. Sa réputation de spécialiste des questions psychiatriques dépassait les frontières. Il fut le premier aliéniste canadien à devenir membre honoraire de la prestigieuse Royal Medico-Psychological Association de Grande-Bretagne. Au Canada, on l’appela souvent comme témoin expert dans des procès criminels ; il y prônait passionnément, mais sans grand succès, une définition médicale de la folie plus vaste que celle qu’autorisait l’étroit cadre juridique des règles de M’Naghten. Linguiste accompli, Workman passa beaucoup de temps, pendant sa retraite, à traduire de l’italien ou de l’espagnol des articles de psychiatrie qui parurent dans les principales revues médicales d’Amérique du Nord. Il donna des conférences dans beaucoup de localités ontariennes, ainsi qu’aux réunions du Canadian Institute, et il publia également des articles sur une variété de sujets. La mort le surprit en pleine activité le dimanche 15 avril 1894 (il était alors dans sa quatre-vingt-neuvième année).
Joseph Workman est indubitablement le plus renommé des aliénistes canadiens du xixe siècle. Très admiré de son vivant, il fut considéré dans ses dernières années comme le « Nestor des spécialistes canadiens », pour reprendre les mots fort justes de l’aliéniste anglais Daniel Hack Tuke. La plupart des historiens canadiens ont perpétué cette tradition de vénération et lui ont accolé l’étiquette commode de parfait « réformateur du traitement de l’aliénation ». Certes, il ramena l’ordre à l’asile de Toronto et inaugura une ère de progrès dans les soins prodigués aux malades mentaux au Canada. Des documents confirment son intégrité et son dévouement ainsi que sa compassion pour ses patients. Toutefois, on néglige une dimension plus fondamentale de sa carrière si l’on voit simplement en lui le médecin tout entier préoccupé d’améliorer le triste sort des aliénés. Workman est un représentant de la dialectique qui, au xixe siècle, engendra l’État moderne et les professions modernes comme la psychiatrie. Le gouvernement, pour sa part, s’annexa la compétence de cette nouvelle spécialité médicale, et sa prétention à la vérité irrécusable de la science, pour mieux atteindre ses propres objectifs de « contrôle social ». En nombre de plus en plus grand, les déviants et les personnes incapables de se suffire à elles-mêmes – souvent victimes de la transition brutale qui avait mené au capitalisme industriel – furent placés sous la garde bienveillante et censément désintéressée de la profession médicale. Ainsi, d’urgents problèmes sociaux se trouvèrent médicalisés, donc dépolitisés. En retour, le gouvernement encouragea et contrôla les professions nouvelles, dont la psychiatrie, en garantissant, par une législation restrictive, leur droit à l’autonomie et leur monopole sur les patients. Workman appartenait à cette première génération d’hommes qui rêvaient d’accéder au rang de professionnels et qui nouèrent avec l’État une alliance difficile dont, encore aujourd’hui, leurs successeurs se félicitent et se plaignent tout à la fois.
Joseph Workman a rédigé de nombreux articles et études de cas en psychiatrie qui ont paru dans l’American Journal of Insanity (Utica, N. Y.), précurseur de l’American Journal of Psychiatry (Baltimore, Md.) : « Insanity in Canada », 12 (1855–1856) : 141–146 ; « Cases of insanity illustrative of the pathology of general paralysis », 13 (1856–1857) : 13–24 ; « Notes of a visit to lunatic asylums in Great Britain and Ireland », 16 (1859–1860) : 278–294 ; « Notes illustrative of the pathology of insanity », 17 (1860–1861) 1–18 ; « Case of moral, mania ? », 19 (1862–1863) 406–416 ; « On certain abdominal lesions in the insane », 20 (1863–1864) : 44–60 ; « Insanity of the religious-emotional type, and its occasional physical relations », 26 (1869–1870) : 33–48 ; « Demonomania and witchcraft », 28 (1871–1872) : 175–193 ; « Case of Erastus Hotchkiss », 32 (1875–1876) : 405–419 ; « Narcolepsia », 37 (1880–1881) : 294–299 ; et « Moral insanity – what is it ? », 39 (1882–1883) : 334–348. Ses commentaires faits au cours de la réunion de 1863 de l’Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane ont été publiés dans le vol. 20 de l’American Journal of Insanity.
La contribution de Workman à d’autres revues médicales comprend : « Observations on insanity » et « Cholera in 1832 and 1834 », Canada Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science (Montréal), 1 (1864–1865) : 401–412 et 2 (1865–1866) : 485–489 respectivement ; « A description of the pestilent condition of the Toronto lunatic asylum in 1853 and the means adopted to remove it », Sanitary Journal (Toronto), 2 (janv. 1876) ; « Insanity and crime », Canada Lancet (Toronto), 9 (1876–1877) : 16–21 ; et « The public care of the insane and the management of asylums », l’Alienist and Neurologist (St Louis, Mo.), 5 (1884) : 492–501. En outre, deux de ses alllocutions à la section médicale du Canadian Institute ont été publiées dans le Canada Medical Journal, 6 (1869–1870) : 205–211 et 289–295 ; ses traductions de quelque 19 articles sur la psychiatrie ont paru dans le Canada Lancet entre 1880 et 1890.
Une photographie et un buste de Workman sont conservés par l’Academy of Medicine (Toronto), qui possède aussi une copie dactylographiée de son journal (l’original se trouve aux UTA, B80–0015).
Academy of Medicine, W. T. Aikins papers.— AN, RG 5, C1.— ANQ-M, CE1-126, 30 mai 1835.— AO, RG 10, 20-B–4, particulièrement 1841–1882 ; 20-B–5, particulièrement 7 juin 1845 ; 20-B–6.— Boston Médical Library-Harvard Medical Library, Harvard Univ. (Boston), Edward Jarvis papers, Workman à Jarvis, 1er nov. 1855.— Clarke Institute of Psychiatry Arch. (Toronto), C. K. Clarke papers.— MTRL, J. G. Howard papers.— Canada, prov. du, Assemblée législative, App. des journaux, 1849, app. M, app. III, app. BBBBB ; 1854–1859 (rapport annuel du directeur général, Provincial Lunatic Asylum) ; Journaux, 1841–1866, particulièrement 1851 ; 1852–1853 : 412, 677, 1067–1068 ; Parl., Doc. de la session, 1860–1866 (rapports annuels du directeur général, Provincial Lunatic Asylum) ; Statuts, 1851, chap. 2 ; 1853, chap. 188.— Canada Gazette, 1854 : 523.— H.-C., House of Assembly, App. to the journal, 1836, n° 30 ; Journal, 1830–1840, particulièrement 1839 : 8, 52, 119, 186, 226, 387.— Ontario, Legislature, Sessional papers, 1867–1920 (rapports annuels de l’inspecteur des prisons et intitutions de charité, particulièrement rapports du directeur général du Provincial Lunatic Asylum, 1867–1870, et de l’Asylum for the Insane, 1871–1920).— Benjamin Workman, « Asylums for the chronic insane in Canada », American Journal of Insanity, 24 (1867–1868) : 42–51.— Examiner (Toronto), 1849–1852, particulièrement 27 févr. 1850, 2–16 July, 12–19 nov. 1851.— Globe, 1844–1854, particulièrement 31 janv. 1850, 25 nov. 1851, 24 mars 1853.— Toronto Mirror, 1846–1848, particulièrement 2–9 oct., 27 nov. 1846, 12 mars 1847.— Upper Canada Herald, a Political, Agricultural & Commercial Journal (Kingston, Ontario), 1832–1837.— Weekly Globe (Toronto), 8 févr. 1850.— Rainer Baehre, « From pauper lunatics to Bucke : studies in the management of lunacy in 19th century Ontario » (thèse de m.a., Univ. of Waterloo, Ontario, 1976) ; « The illregulated mind : the making of psychiatry in Ontario, 1830–1921 » (thèse de ph.d., York Univ., Downsview [Toronto], 1985) ; « Joseph Workman (1805–1894) and lunacy reform : humanitarian or moral entrepreneur ? » (communication faite à la réunion annuelle de la SHC, Montréal, 1980).— Geoffrey Bilson, A darkened house : cholera in nineteenth-century Canada (Toronto, 1980).— David Boyle, Notes on the life of Dr. Joseph Workman (Toronto, 1894).— T. E. Brown, « Living with God’s afflicted » : a history of the Provincial Lunatic Asylum at Toronto, 1830–1911 » (thèse de ph.d., Queen’s Univ., Kingston, 1981).— William Canniff, The medical profession in Upper Canada, 1783–1850 [...] (Toronto, 1894 ; réimpr., 1980).— Michel Foucault, Madness and civilization : a history of insanity in the age of reason, Richard Howard, trad. (New York, 1965).— G. N. Grob, Mental institutions in America ; social policy to 1875 (New York, 1973).— H. M. Hurd et al., The institutional care of the insane in the United States and Canada, H. M. Hurd, édit. (4 vol., Baltimore, Md., 1916–1917 ; réimpr., New York, 1973).— D. J. Rothman, The discovery of the asylum : social order and disorder in the new republic (Boston, 1971).— A. T. Scull, Museums of madness : the social organization of insanity in nineteenth-century England (Londres, 1979).— R. B. Splane, Social welfare in Ontario, 1791–1893 ; a study of public welfare administration (Toronto, 1965).— H. N. Stalwick, « A history of asylum administration and lunacy legislation in Canada before confederation » (thèse de ph.d., Univ. of London, Londres, 1969).— D. H. Tuke, The insane in the United States and Canada (Londres, 1885 ; réimpr., New York, 1973).— J. S. Tyhurst et al., More for the mind : a study of psychiatric services in Canada (Toronto, 1963).— Rainer Baehre, « Origins of the penitentiary system in Upper Canada », OH, 69 (1977) : 185–207.— T. [E.] Brown, « Architecture as therapy », Archivaria (Ottawa), n° 10 (été 1980) : 99–124.— Cyril Greenland, « Three pioneers of Canadian psychiatry », American Medical Assoc., Journal (Chicago), 200 (1967) : 833–842.— C. G. Stogdill, « Joseph Workman, M.D., 1805–1894, alienist and medical teacher », Canadian Medical Assoc., Journal (Toronto), 95 (1966) : 917–923.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Thomas E. Brown, « WORKMAN, JOSEPH », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/workman_joseph_12F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/workman_joseph_12F.html |
| Auteur de l'article: | Thomas E. Brown |
| Titre de l'article: | WORKMAN, JOSEPH |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1990 |
| Année de la révision: | 1990 |
| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |