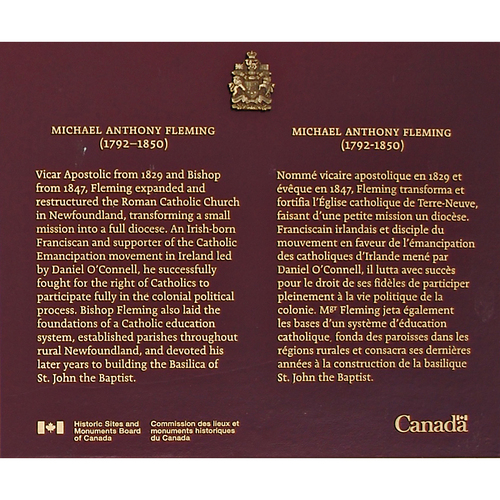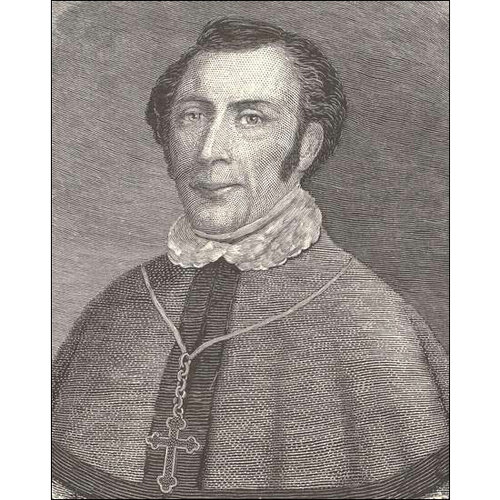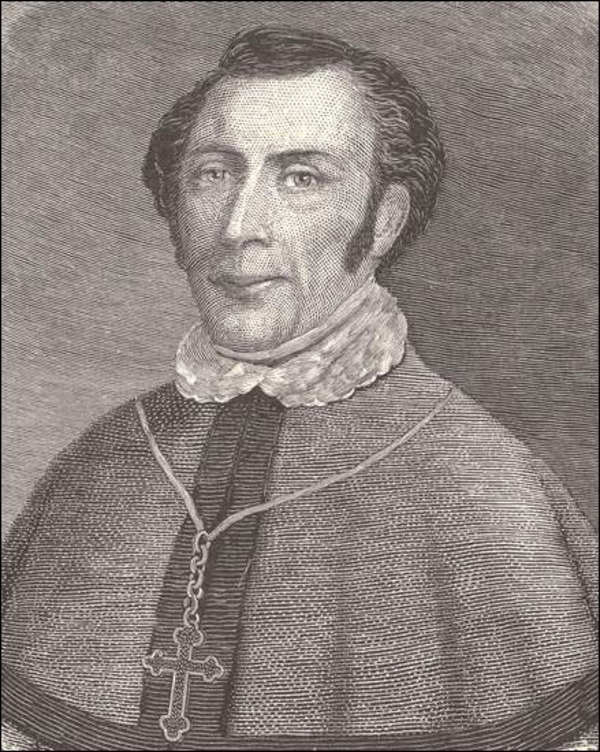
Provenance : Lien
FLEMING, MICHAEL ANTHONY, prêtre franciscain, évêque et auteur, né vers 1792 à Carrick on Suir (république d’Irlande) ; décédé le 14 juillet 1850 à St John’s.
Dans sa jeunesse, on attribuait à Michael Anthony Fleming « une personnalité agréable, des manières engageantes, une aptitude pour l’étude et un tempérament doux », traits qu’on ne lui reconnut pas toujours à la maturité. Son oncle, le prêtre franciscain Martin Fleming, l’encouragea à opter pour la vie religieuse et, en 1808, Thomas Scallan* admit Michael Anthony comme novice au couvent franciscain de Wexford. On lui conféra les ordres mineurs, le sous-diaconat et le diaconat en septembre 1814 ; il reçut l’ordination le 15 octobre 1815, apparemment quelques mois avant d’atteindre l’âge canonique de 24 ans.
Affecté ensuite au couvent de Carrick on Suir, dont le supérieur était son oncle, Fleming fut associé à la démolition de la chapelle délabrée de l’endroit et à son remplacement par une belle église, encore en chantier lorsqu’il partit pour Terre-Neuve. On allait insinuer plus tard qu’il avait mésusé de fonds recueillis pour les travaux et que le scandale ainsi causé l’avait obligé à quitter l’Irlande. Toutefois le bien-fondé de telles accusations est difficile à déterminer.
Fleming se rendit à Terre-Neuve à l’automne de 1823 sur l’invitation de Scallan, devenu vicaire apostolique de l’île. Au début, semble-t-il, il n’était là qu’en congé, le temps d’amasser des dons pour l’église de Carrick on Suir, et les autorités franciscaines n’acceptèrent une prolongation de son séjour que sur les instances de Scallan. Pendant six ans, il fut son vicaire à St John’s. Assistant énergique et compétent, il assuma une part énorme des charges paroissiales, surtout à mesure que la santé de Scallan déclinait. Dès 1824, l’évêque le disait « un véritable trésor » et, plus tard, il déclara que sa collaboration représentait « presque celle d’un associé ».
En fait, les deux hommes différaient tant l’un de l’autre, de tempérament comme d’opinions, que leur relation demeure l’un des aspects les plus énigmatiques de la carrière de Fleming. En 1834, ce dernier allait dire de Scallan : « [c’est] le prélat le plus zélé qui ait jamais occupé ou peut-être occupera jamais le siège épiscopal de Terre-Neuve ». De son côté, dès 1824, l’évêque voyait en lui un successeur possible. Pourtant, Fleming rappellerait en 1835 leurs « fréquentes dissensions », surtout à l’égard d’un groupe de catholiques laïques de St John’s que lui-même traitait de « libéraux ». Il faisait alors état de trois conflits majeurs. Le premier, survenu probablement en 1829, avait porté sur la question de savoir qui de lui ou d’un comité laïque de construction devait gérer les sommes recueillies pour l’agrandissement de l’église. Le deuxième avait surgi devant le refus des autorités des Orphan Asylum Schools (dont les instituteurs et les élèves étaient catholiques) de donner des cours de religion même après les heures de classe, « par crainte de déplaire à leurs voisins protestants ». De son propre chef, Fleming avait préparé plus de 500 orphelins de ces écoles à la communion, alors que l’évêque n’avait autorisé qu’une cérémonie privée. Enfin, troisième conflit, Fleming avait reproché à certains catholiques, dont Scallan, d’assister à des offices protestants, car selon lui c’était sanctionner « un culte d’hérétiques ».
Néanmoins, lorsque Scallan demanda au Saint-Siège un coadjuteur en 1827 et soumit à cette fin les trois candidatures requises, il marqua une nette préférence pour Fleming, qu’il disait « doué de toutes les qualités nécessaires à l’évêque qui aurait la charge de [la] mission [de Terre-Neuve] ». Le 10 juillet 1829, Pie VIII nomma Fleming évêque titulaire de Carpasia et coadjuteur de Scallan. Celui-ci procéda à l’intronisation le 28 octobre à St John’s ; Thomas Anthony Ewer* et Nicholas Devereux jouaient avec lui le rôle d’évêques consacrants. Scallan mourut à peine sept mois plus tard, et Fleming lui succéda automatiquement à titre de vicaire apostolique le 28 mai 1830.
Recruter des prêtres fut l’une des priorités de Fleming et le préoccupa tout au long de son épiscopat. Même s’il fut porté plus tard à prétendre que Terre-Neuve n’en comptait que sept au moment de son accession, le rapport qu’il envoya à Rome à cette époque en donnait neuf (plus lui-même), répartis dans cinq vastes paroisses qui, selon diverses estimations, totalisaient entre 30 000 au 80 000 catholiques. D’après lui, tant en qualité qu’en nombre, ces prêtres ne suffisaient pas à la tâche. La colonie avait impérativement besoin d’un clergé plus nombreux, estimait-il, et il était possible d’en assurer l’entretien.
Fleming se rendit en Irlande à plusieurs reprises pour faire du recrutement. La première fois, avant la fin de 1830, il obtint quatre nouveaux prêtres, dont Edward Troy*, Charles Dalton* et Pelagius Nowlan, qui arrivèrent au milieu de l’année suivante, de même que deux séminaristes, Michael Berney et Edward Murphy, qu’on ordonna à Terre-Neuve dans les mois suivants. En 1833, à l’occasion d’un deuxième voyage, cinq autres prêtres, dont James W. Duffy*, répondirent à son appel. Très vite, cet apport important de sang neuf et le décès ou le départ de quatre prêtres qui avaient servi sous Scallan changèrent le visage de l’Église catholique de Terre-Neuve. Le clergé de Fleming différait de l’ancien sous plusieurs aspects notables. Il était plus nombreux : durant son mandat, Fleming ne cessa pas d’en grossir les rangs – 21 nouveaux prêtres dans les années 1830 seulement, et non moins de 36 au total. Il était aussi plus stable : la plupart de ses membres étaient des séculiers ordonnés expressément pour Terre-Neuve. Contrairement à beaucoup de leurs aînés, formés sur le continent européen, la majorité des recrues avaient fait leurs études en Irlande, surtout dans les collèges diocésains du sud-est. Ces nouveaux prêtres appartenaient à une génération qui pouvait pratiquer sa religion ouvertement et avait assisté à la victoire du mouvement de Daniel O’Connell en faveur de l’émancipation des catholiques, dont le clergé avait été l’un des moteurs. On pouvait s’attendre qu’ils fassent valoir davantage que leurs prédécesseurs les droits de leurs coreligionnaires et exprimeraient avec plus de force leurs aspirations. En outre, contrairement aux précédents évêques de l’île, tel Patrick Lambert*, Fleming n’envoya pas de candidats à la prêtrise dans les séminaires du Bas-Canada. Plus encore, par crainte de tisser des liens trop étroits avec les insulaires, il n’acceptait pas de Terre-Neuviens de naissance comme aspirants au sacerdoce. Ces lignes de conduite, qui ne changèrent qu’à sa mort, donnèrent bien sûr à son Église une forte teinte irlandaise.
En 1833, Fleming ramena aussi d’Irlande, plus précisément de Galway, des religieuses de l’Order of the Presentation of Our Blessed Lady, les premières à s’établir dans la colonie [V. Mlle Kirwan*, dite sœur Mary Bernard]. Inquiet de ce que garçons et filles fréquentaient les mêmes classes et de ce que les Orphan Asylum Schools ne dispensaient pas d’instruction religieuse, il les avait invitées à venir enseigner aux filles de familles pauvres. Les religieuses reçurent un accueil enthousiaste et ouvrirent à St John’s, en octobre 1833, la première école officiellement catholique de Terre-Neuve. Encouragé de voir que l’établissement comptait autant d’élèves que possible, soit 450, l’évêque fit construire moins d’un an plus tard une nouvelle école qui pourrait en recevoir 1 200.
Voyageur infatigable, Fleming ne négligeait pas non plus le territoire de sa mission. Ainsi, en 1834, il fit une longue visite pastorale qui le mena dans 46 villages, de la baie Conception à l’île Fogo et lui permit de confirmer plus de 3 000 fidèles. La chaleureuse réception que lui réservèrent les colons, protestants aussi bien que catholiques, allégea beaucoup les considérables rigueurs du voyage. En 1835, il consacra deux mois à une tournée semblable, cette fois de St John’s à la baie d’Espoir, à bord d’une petite goélette qu’il s’était fait construire, le Madonna. Un des principaux buts de ce voyage était de visiter les Micmacs à Conne River, mais par suite d’un malentendu la plupart ne se trouvaient pas au campement. À son retour à St John’s, en septembre, Fleming constata qu’une épidémie de variole s’était déclarée. En novembre, la maladie gagna un village voisin, Petty Harbour ; convaincu de l’inefficacité des autorités civiles, il se rendit sur place et y resta jusqu’à la fin de l’hiver. Il exerça son sacerdoce auprès des habitants de ce village, y construisit une nouvelle église et y aménagea un cimetière.
Malgré les succès de recrutement de Fleming et son indubitable sollicitude pastorale, il reste que les dissensions politiques et religieuses gâchèrent la première décennie de son épiscopat. Causes d’une cassure entre l’Église catholique et les autorités civiles, elles exacerbèrent les craintes et inquiétudes des membres des diverses confessions en même temps qu’elles divisèrent profondément les fidèles mêmes de Fleming. Mais on avait semé les graines de la discorde avant même qu’il ne devienne évêque. Déjà, en 1830, ses ouailles avaient plusieurs motifs d’irritation : deux tentatives visant à mettre en vigueur une loi sur la célébration des mariages qui leur était préjudiciable, l’absence de subventions publiques aux Orphan Asylum Schools, la controverse sur l’admission au Conseil de Terre-Neuve du commandant militaire, qui était l’un de leurs coreligionnaires, et par-dessus tout le fait que l’émancipation civile des catholiques n’était pas réalisée à Terre-Neuve. En 1831, Fleming lui-même, d’un ton calme, écrivit à Londres au sujet de cette émancipation, tout comme le gouverneur Thomas John Cochrane*. On reconnut d’emblée le bien-fondé de la position catholique, mais aucune mesure immédiate ne s’annonçait. Par contre, on accepta de verser un traitement à Fleming en qualité d’évêque catholique, ce qui fit dire à sir Thomas Spring-Rice, secrétaire d’État aux Colonies : « £75 pour acheter un évêque, voilà qui n’est vraiment pas cher ». Les catholiques terre-neuviens ne devinrent des citoyens à part entière que le 27 août 1832, en même temps qu’entraient en vigueur le gouvernement représentatif et le droit de vote pour une bonne partie de la population masculine.
Pour les sièges de St John’s aux élections suivantes, Fleming appuya un marchand estimé, William Thomas, ainsi que les « radicaux » John Kent* et William Carson, soit, comme il l’écrivit plus tard, « un Anglais, un Irlandais et un Écossais, un catholique, un protestant et un presbytérien ». Fait important, il ne soutint pas Patrick Kough*, entrepreneur auprès du gouvernement et membre du groupe de laïques catholiques avec lequel il s’était déjà trouvé en désaccord. Le rédacteur en chef du Public Ledger, Henry David Winton*, mit en doute la valeur de Kent, lequel réagit en disant que le journaliste en avait contre son état de catholique irlandais. Sur ce, Winton exigea que Fleming se dissocie de Kent. Le prélat répondit qu’il voyait dans les remarques de Winton une critique de la participation du clergé à la politique. Winton l’attaqua alors de front et écrivit dans le Public Ledger que Fleming avait perdu tout droit à la considération des protestants autant que des catholiques « respectables ». Furieux, les catholiques terre-neuviens tinrent une série d’assemblées publiques en faveur de leur évêque. Les résultats des élections, peu concluants (Kent, Thomas et Kough remportèrent la victoire), comptèrent beaucoup moins que le fait suivant : le ton sectaire qu’on avait donné à la campagne transforma la désaffection des catholiques irlandais en une solidarité contre l’establishment. Les choses empirèrent en 1833, au moment de l’élection partielle qui visait à pourvoir le siège laissé vacant par la nomination de Thomas au conseil. Cette fois Carson, réformiste haï de l’establishment, faisait la lutte à Timothy Hogan, autre laïque catholique « libéral » que les marchands soutenaient. Comme Fleming accordait un appui sans réserve à Carson, Hogan se retira de la course en alléguant l’influence indue du clergé. On boycotta alors son commerce et il dut présenter des excuses publiques.
La nuit de Noël, en guise de représailles contre l’appui du Public Ledger à Hogan et sa critique du clergé, une foule de catholiques encerclèrent la maison de Winton. Les magistrats appelèrent la garnison, et plusieurs manifestants furent blessés par baïonnette. Tout en prônant l’obéissance à la loi, Fleming protesta auprès du gouverneur Cochrane contre ce qu’il considérait comme un abus de force, puis il déclara publiquement que le gouverneur n’avait pas autorisé l’intervention des militaires. Aux yeux de Cochrane, c’était là un travestissement délibéré de certaines de ses paroles conciliantes et, comme il le dit dans une dépêche à Londres, un indice supplémentaire de la détermination de Fleming à assurer l’ascendant politique des catholiques.
On accusa Cochrane de bigoterie dans une série de lettres signées d’un pseudonyme et parues dans le Newfoundland Patriot au début de 1834. Plus furieux que jamais, il commanda au procureur général James Simms* d’en poursuivre l’auteur pour diffamation. L’aveu de l’abbé Edward Troy l’ébahit, car il ne croyait pas ce prêtre assez audacieux pour avoir écrit de telles lettres sans l’approbation de Fleming. C’est seulement au rappel de Cochrane, en novembre 1834, que son successeur Henry Prescott*, désireux d’apaiser les tensions, arrêta les poursuites.
Sur la foi des dépêches de Cochrane, le gouvernement britannique avait entrepris en 1834 des démarches afin que Rome blâme l’activisme politique de Fleming. Le cardinal Capaccini, sous-secrétaire d’État au Vatican, fut saisi de l’affaire. Il jugea inopportun d’y mêler le pape et écrivit en novembre à Fleming une lettre personnelle qu’il envoya d’abord à Londres pour la faire approuver. Sa Sainteté, disait-il, serait sûrement mécontente d’apprendre de quoi on accusait son évêque ; il ne fallait pas se livrer à des activités « avilissantes pour la dignité sacerdotale ». Fleming s’indigna des plaintes dont il était l’objet. Elles venaient, pensait-il, de la femme du juge en chef Henry John Boulton*, qui s’était jointe depuis peu au groupe de ses adversaires catholiques et qui, à son avis, pratiquait la religion avec mollesse. En juin 1835, dans deux lettres à Capaccini, il mit de l’avant ses réalisations, parmi lesquelles 1 200 conversions, et justifia ses actes. En faisant allusion au laxisme religieux qui avait marqué l’époque de Scallan, il affirma sa résolution « d’extirper d’une main puissante les vices qui depuis si longtemps pourrissaient et infestaient le cœur de la communauté ». Ses principaux opposants, précisait-il, étaient Kough, Hogan, Mme Boulton et Joseph Shea, qu’il qualifiait de catholiques « libéraux », catégorie de gens pour laquelle le pape n’avait pas la moindre sympathie. Politiquement, il avait selon lui appuyé les candidats dont l’élection serait « avantageuse pour le pays » ; la presse avait donné des « versions burlesques » de ce qu’il disait en chaire. Capaccini accepta ce plaidoyer en disant qu’il avait voulu non pas blâmer, mais prévenir ; par bonheur, ajoutait-il, les accusations étaient dénuées de fondement. Il transmit ensuite à Londres les lettres de Fleming et sa propre réponse.
Le départ de Cochrane n’avait guère eu d’effets apaisants. En fait, les agissements du nouveau juge en chef, Boulton, aggravèrent les tensions confessionnelles. Juriste intransigeant, il appliquait de nouvelles règles de procédure et des peines sévères, que plusieurs percevaient comme préjudiciables aux catholiques. Dès juin 1835, Daniel O’Connell présentait des protestations contre lui à la chambre des Communes, sans aucun doute avec l’appui de Fleming.
La situation se détériora manifestement après qu’on eut attaqué Winton, le 19 mai 1835, entre Harbour Grace et Carbonear. Bien que les assaillants soient demeurés inconnus, on attribua communément le crime au « fanatisme religieux » éveillé par les critiques du Public Ledger contre le clergé catholique. (Il existe cependant une deuxième hypothèse, tout aussi plausible : Winton avait traité de « canailles » les chasseurs de phoque qui s’étaient réunis en 1832, sur les lieux mêmes où surviendrait l’attentat, pour se liguer contre les marchands ; peut-être certains d’entre eux s’étaient-ils vengés.) Quoi qu’il en soit, protestants et catholiques vitupérèrent à pleines pages les uns contre les autres dans les journaux locaux, et l’archidiacre anglican, Edward Wix*, alla jusqu’à garder dans sa chambre des pistolets chargés.
Entre-temps, en mars 1835, le gouverneur Prescott avait reçu une protestation officielle d’un boutiquier catholique, Michael McLean Little. Parce qu’il avait soutenu Hogan et qu’il était abonné au Public Ledger, disait-il, on l’avait dénoncé comme un ennemi du catholicisme et son commerce en avait souffert. Selon lui, Troy avait même affirmé : « tant que McLean Little n’aura pas été réduit à la mendicité, il ne pourra pas devenir un bon catholique ». Si on ne restaurait pas sa réputation à la face de tous, il risquait l’ostracisme et la ruine. D’autres catholiques de St John’s avaient eu des expériences similaires. Prescott s’entendait dire par ses conseillers que des poursuites judiciaires contre Fleming seraient inutiles ; déjà, il était convaincu que Rome ne parviendrait pas non plus à tempérer les ardeurs politiques de l’évêque. En mai, il avisa Londres que selon lui le rappel immédiat de Fleming et de Boulton était le seul remède aux maux de Terre-Neuve.
Comme le nouveau secrétaire d’État aux Colonies, lord Glenelg, était réfractaire à l’idée de « recourir à l’autorité du pape dans une dépendance de la couronne britannique » et qu’il croyait que les dénonciations en chaire avaient cessé, il se tourna vers l’évêque de Londres, James Yorke Bramston, qu’on pensait en mesure d’avoir quelque influence sur Fleming. Bramston écrivit donc à son confrère, mais dans sa réponse, en janvier 1836, Fleming fit valoir que, tenu par Prescott dans l’ignorance des accusations qu’on portait contre lui, il ne pouvait pas se défendre.
Puis, en février, Glenelg apprit qu’à St Mary’s les personnes accusées avec l’abbé Duffy (qu’on avait déjà appréhendé) de destruction préméditée de propriété avaient résisté aux constables venus les arrêter. Rien ne prouvait que Fleming ni même Duffy avaient approuvé leur attitude, mais l’incident fut l’un des facteurs qui poussèrent Glenelg à communiquer avec le Vatican. D’après son rapport au ministère des Affaires étrangères, il semble qu’en substance Glenelg se plaignait que l’évêque ne tenait pas ses prêtres bien en main et que la population catholique de Terre-Neuve était « poussée aux extrémités les plus atroces par [... sa] conduite et [son] langage ». Il fallait, concluait-il, demander à Rome de rappeler Fleming et Troy ou à tout le moins d’admonester l’évêque.
Après avoir prévenu le Vatican que des « mesures extraordinaires » pourraient être prises si rien ne se faisait à propos de Fleming, le représentant de la Grande-Bretagne à Rome apprit que le cardinal Fransoni, préfet de la Propagande, écrirait à l’évêque de Terre-Neuve. La lettre, datée du 31 mars 1836, passa elle aussi par Londres. De toute évidence, Fleming avait bonne réputation à Rome ; Fransoni l’informait simplement qu’on avait mis la Propagande au courant des dissensions provoquées par la participation du clergé aux affaires politiques, puis il lui rappelait la lettre de Capaccini. En se tenant à l’écart de ces affaires, disait-il, Fleming ne pourrait qu’aider à pacifier sa mission et mettre davantage l’accent sur les charges pastorales.
Lord Glenelg, de son côté, écrivit à Prescott. Il espérait que la lettre du cardinal Fransoni aurait un « effet salutaire » sur Fleming et disait qu’on passerait l’éponge si l’évêque corrigeait sa conduite ; sinon, il faudrait prendre des mesures pour ramener le calme dans l’île.
Paradoxalement, à la même époque, Fleming tentait d’obtenir du gouvernement britannique un terrain à St John’s pour une cathédrale. Après avoir reçu la lettre de Fransoni, il se mit bientôt en route pour l’Angleterre afin non seulement de se défendre mais aussi de renouveler sa requête. Sa première demande remontait à novembre 1834 ; adressée au roi, elle portait sur un terrain de six ou sept acres, appelé « the Barrens », qui appartenait au Board of Ordnance mais n’allait plus servir puisque la garnison s’en allait. Les protestants de Terre-Neuve, remarquait-il, avaient reçu nombre de faveurs du gouvernement ; il n’avait rien à en redire, mais la majorité catholique, qui n’en avait reçu aucune, avait tout autant droit à la considération. Dans sa correspondance à propos de ce terrain, il soulignait sans relâche le délabrement de l’église existante, « guère plus solide qu’une écurie mal construite », et proposait de la remplacer par un « bel édifice de pierre » jouxtant une résidence et une école pour 1 500 ou 1 600 élèves. Même si le terrain demandé était « exposé au vent », comme il l’écrivit à O’Connell, il constituait un emplacement superbe qui dominait la ville ; une église élevée à cet endroit serait un impressionnant symbole de la présence du catholicisme dans la colonie. Fleming n’était cependant pas au bout de ses peines : avant d’obtenir cette propriété, il allait devoir supporter, selon ses propres mots, « près de cinq ans d’humiliations et d’ennuis ».
Conformément aux instructions qu’il avait reçues, Prescott informa Fleming en août 1835 qu’on devait « différer » l’examen de sa demande et que toute requête ultérieure devrait passer par le gouverneur. Fleming ne renouvela sa demande qu’en juin 1836, soit à peu près au moment de l’avertissement du cardinal Fransoni et de la lettre de Glenelg à Prescott sur l’oubli des griefs passés, donc juste avant qu’il ne s’embarque pour l’Angleterre. Cette fois, il évoqua les églises catholiques récemment construites dans les petits villages de pêcheurs : de même que ces églises étaient des richesses pour les villages, sa cathédrale serait « un réel et substantiel atout pour St John’s ». Manifestement très désireux de se montrer conciliant, il demanda au gouverneur de le soutenir auprès du ministère des Colonies et lui expliqua longuement pourquoi, la première fois, il s’était adressé directement à Londres. Cette tactique était sage car, entre-temps, Prescott avait proposé que toute terre laissée vacante par l’armée revienne au gouvernement terre-neuvien.
La présence de Fleming en Angleterre en 1836 poussa sans doute le Board of Ordnance à examiner l’affaire en août. Il n’arriva toutefois à aucune solution. Ce n’est qu’en juin 1837 que l’évêque, de retour à St John’s, apprit officiellement que le gouvernement britannique avait décidé de lui concéder, pour les immeubles qu’il entendait construire, « une portion aussi grande que nécessaire du terrain en question ». Une lecture attentive des documents aurait pu lui montrer que les mots « en question » n’étaient vraiment pas limpides : on ne faisait aucune mention explicite du terrain qu’il avait demandé.
À ce stade, les difficultés vinrent largement des autorités terre-neuviennes, qui préconisaient désormais d’élever sur ce terrain un palais de justice et une prison. Leur attitude négative s’était peut-être intensifiée sous l’effet des événements survenus dans la colonie en l’absence de Fleming. C’est l’abbé Troy qui avait alors administré le vicariat, avec des pouvoirs limités. En juillet 1836, Fleming lui avait demandé de mettre fin aux controverses journalistiques et, en septembre, il lui avait écrit : « si de nouvelles élections ont lieu avant mon retour, j’espère que vous ne ferez aucune intervention publique ». Pourtant, à l’occasion des turbulentes élections de novembre, les prêtres catholiques, Troy et Dalton en tête, se firent bien voir. Leur appui fut même, probablement, un facteur décisif de la victoire massive des candidats « radicaux ». Peut-être l’abbé Troy n’avait-il pas reçu la lettre de Fleming avant les élections ; de toute façon on annula celles-ci et, en juin 1837, un nouveau scrutin suivit. Le clergé participa moins bruyamment cette fois mais l’issue fut identique. Par ailleurs, la façon dont on menait en justice la cause de Duffy et d’autres accroissait l’opposition des catholiques à l’endroit de Boulton. Prescott lui-même visait toujours le rappel de Fleming et avait monté un dossier d’accusations contre lui.
Fleming ne prit conscience des difficultés posées par le terrain de la cathédrale qu’en septembre 1837, à l’occasion d’une rencontre avec Prescott. D’abord, il pensa que le gouverneur trouvait, comme lui, que les autres terrains ne convenaient pas ; mais, rappelé le lendemain, il fut prié de choisir tout de suite l’un d’entre eux et de s’engager à y construire. Il refusa tout net et, irrité, repartit pour Londres pendant l’hiver. En mars 1838, dans une lettre à sir George Grey, sous-secrétaire d’État aux Colonies, il récapitula toute l’affaire en disant qu’il avait agi comme si les catholiques de Terre-Neuve devaient « être amenés à ne pas se considérer comme l’objet d’un bannissement politique, à ne pas se voir comme des parias politiques ». C’était une question de principe, affirmait-il. Si le gouvernement ne pouvait juger bon de concéder le terrain, il le paierait plein prix. Un mois plus tard, dans une réponse laconique, Grey lui apprit que le gouvernement britannique avait commandé à Prescott de le mettre sans délai en possession du terrain « si aucune objection insurmontable ne se pos[ait] ». Quelques semaines plus tard, une équipe dirigée par Troy clôturait neuf acres en moins d’un quart d’heure.
Il est remarquable de voir à quel point Fleming déployait peu d’efforts pour atténuer l’opposition dont il était l’objet dans les cercles gouvernementaux. Persuadé que les catholiques terre-neuviens étaient systématiquement exclus des sphères d’influence et des charges publiques, il n’avait nulle intention de mettre un terme à ses protestations. De plus, il était conscient que ses adversaires catholiques avaient l’oreille du gouverneur et, comme il l’écrivit plus tard, il sentait que Prescott nourrissait envers lui « une haine profonde et inextinguible ». En effet, le gouverneur croyait fermement que le remplacement du vicaire apostolique par un homme « vraiment pieux, éclairé, droit et bienveillant » était « le plus grand besoin » de la colonie, et sans doute ne pouvait-il guère être amené à changer d’avis. Le ministère des Colonies aussi était résolu à presser les autorités vaticanes de maîtriser l’évêque. Aucune accusation nouvelle et précise ne pesait sur Fleming lui-même, mais pendant son absence en 1836–1837, Troy avait assurément harcelé ses opposants catholiques, allant même dans un ou deux cas jusqu’à refuser le baptême ou la sépulture.
Indolent à se défendre devant Londres, Fleming se donnait par contre un mal considérable pour protéger sa réputation à Rome. Il y passa quelque temps en 1837 et fut bien reçu. D’ailleurs, croyait-il, il devait aux attaques de ses ennemis une part de l’attention dont il bénéficiait. Déjà en 1836 il avait fait publier là-bas un document sur sa mission, Stato della religione cattolica [...]. L’année suivante, il rédigea à l’intention du Saint-Siège un rapport plus complet, intitulé Relazione [...]. Il y disait être la cible des persécutions et calomnies d’un petit groupe de catholiques riches et « indifférents », appuyés par « deux ou trois » prêtres, mentionnait que le gouvernement lui avait reproché des inconvenances sans toutefois consentir à lui communiquer des accusations précises, donnait un compte rendu impressionnant de ses voyages et de son travail à Terre-Neuve, décrivait les ennuis qu’il venait d’éprouver pour acquérir le terrain de la cathédrale et exposait ses projets d’avenir.
Pourtant, certaines des accusations lancées contre Troy impliquaient l’ordre ecclésiastique, et Rome ne pouvait les négliger. Le 5 janvier 1838, Grégoire XVI lui-même écrivit à Fleming que, à la suite de rapports indéniables sur les agissements de Troy, il jugeait nécessaire que ce prêtre soit relevé de sa charge. « Veillez donc, Vénérable Frère, disait-il, [...] à ramener la paix troublée, à éviter le scandale et à vous assurer que nul n’a quelque motif de se plaindre d’un des prêtres soumis à votre autorité. » Cette missive dut avoir de l’effet car quelque temps après (probablement à son retour d’Europe en octobre 1838) Mgr Fleming retira Troy de St John’s et l’affecta à la lointaine paroisse de l’île Merasheen. Du Vatican, Fransoni lui assura qu’il avait bien fait dans les circonstances et que le Saint-Siège avait toujours bonne opinion de lui.
Les relations de Fleming avec Londres connurent alors une période de calme relatif. La mutation de Troy avait éliminé une source importante de mécontentement. Une délégation terre-neuvienne formée de Carson, de Patrick Morris et de John Valentine Nugent* avait obtenu, avec l’aide de Fleming, la destitution de Boulton. La question du terrain de la cathédrale était désormais réglée. Le gouvernement posa un autre geste de conciliation. Fleming avait demandé maintes fois, sans résultat, de pouvoir examiner les accusations qui pesaient contre lui, car il se trouvait dans l’intenable position de devoir préparer une défense sans savoir de quoi il retournait. Finalement, en août 1838, Grey lui écrivit que les événements en question étaient de l’histoire ancienne et que Glenelg considérait « malavisée » toute autre discussion. Conscient de n’avoir aucune autorité pour juger la manière dont le clergé catholique s’acquittait de ses fonctions, Glenelg comprenait aussi « combien la tranquillité publique serait forcément troublée dans l’île si l’on ressassait cette affaire ». Il proposait donc de tout oublier et exprimait l’espoir que Fleming ferait de même.
La trêve prit fin en 1840, soit au moment où Fleming et le clergé de St John’s parvinrent à faire élire le catholique Laurence O’Brien* au lieu de James Douglas*, libéral convaincu mais presbytérien. Comme il jugeait que Fleming était intervenu par « pur amour de la dissension », Prescott redit au nouveau secrétaire d’État aux Colonies, lord John Russell, qu’il fallait un évêque plus modéré. Sur ce, le ministère des Affaires étrangères prévint Rome que, si Fleming n’était pas déposé, le clergé catholique des colonies ne recevrait plus aucune subvention. Par l’entremise du ministre des Affaires étrangères d’Autriche, le prince de Metternich, Rome tentait de nommer un vicaire apostolique à Corfou (Kerkyra, Grèce), alors sous domination britannique. Metternich se fit dire qu’on étudierait cette question si Rome s’occupait de l’évêque de Terre-Neuve.
Fleming eut vent de la manœuvre en août 1840, pendant qu’il se trouvait en Angleterre pour la cathédrale, et il s’empressa d’écrire à Rome au sujet de cette « nouvelle persécution ». À son retour en novembre, il envoya à Russell une lettre où il rappelait les vieilles accusations dont il était victime et blâmait Prescott. Dans sa lettre à Rome, il avait décrit ses efforts en faveur de la cathédrale et les desseins que nourrissait contre lui l’un de ses prêtres, Timothy Browne*. Le refus du gouvernement britannique d’admettre un évêque à Corfou eut beaucoup d’effet : sans s’engager à déposer Fleming, le Vatican informa Metternich qu’il convoquerait l’évêque. Le 24 novembre, Fransoni écrivit à Fleming : le pape souhaitait qu’il vienne tout de suite, en passant par Londres si possible, où le conflit pourrait peut-être se régler. Cette lettre, Fleming prétendit ne jamais l’avoir reçue. Mais il savait que circulaient à St John’s des rumeurs, probablement d’origine gouvernementale, selon lesquelles le Saint-Siège l’avait convoqué. Il continua donc à faire son apologie auprès de Rome, en évoquant les progrès de la cathédrale et en réfutant les allégations de Browne.
En Angleterre, on s’inquiétait de Terre-Neuve. En mai 1841, informé des dissensions confessionnelles, le gouvernement autorisa un comité spécial des Communes à examiner l’ensemble de la situation. Même si le comité ne recueillit que des indices incomplets et ne présenta aucun rapport, une bonne partie des témoignages enregistrés portaient sur les conflits internes de l’Église catholique. De plus, le témoignage impartial de sir Richard Henry Bonnycastle suggérait que les autorités coloniales avaient peut-être traité injustement Fleming, quels qu’aient été ses défauts. Russell conclut donc qu’il fallait un nouveau gouverneur et choisit sir John Harvey*, nomination qui changea le climat de la colonie. Lorsque, le 12 juillet 1842, Fransoni écrivit pour savoir pourquoi l’évêque n’avait pas donné suite à sa lettre de convocation, les pressions en faveur de sa destitution avaient diminué. Rome ne semblait plus insister pour sa comparution. Il fallut plus de temps à Fleming pour contrer les représentations de Browne mais, en 1843, il était, semble-t-il, parvenu à se disculper.
Aussi graves qu’ils aient été, ces problèmes ne détournaient guère Fleming de son grand rêve, de son grand œuvre : la construction d’une cathédrale qui commanderait l’attention et le respect. Dès l’acquisition du terrain en 1838, il fit réaliser une esquisse par John Philpott Jones, de Clonmel (république d’Irlande), puis des plans détaillés par un architecte nommé Schmidt, de Hambourg (République fédérale d’Allemagne). À son retour à l’automne, il se rendit à l’île Kellys pour surveiller la taille de la pierre. Au printemps, il fit la tournée des villages de pêcheurs voisins afin de convaincre les propriétaires de bateaux, protestants comme catholiques, de transporter la pierre à St John’s. La clôture du terrain, la coupe du bois pour les échafaudages et le traînage de la pierre jusqu’au chantier mobilisèrent une multitude de volontaires. Ainsi en mai 1839 des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants passèrent deux jours à creuser les fondations pour excaver plus de 79 000 pieds cubes de terre que les femmes transportaient dans leurs tabliers.
Un coup dur survint en 1840 : la faillite de la banque londonienne qui gardait les fonds du vicariat. Cette perte de £4 700 ne découragea pas Mgr Fleming, et ses fidèles se montrèrent généreux : le 20 mai 1841, jour de la pose de la pierre angulaire, il avait reçu £2 300 en dons ou promesses de dons. Cependant, tous n’approuvaient pas son ouvrage grandiose. Un de ses paroissiens, Henry Simms, se plaignit à Rome en 1843 que la cathédrale était « condamnée par tous les hommes de bon sens », puis il ajouta : « elle ne convient pas à notre situation ». Toutefois, l’opinion qu’exprima le Newfoundland Vindicator était probablement plus répandue : « La population est émerveillée [...] – elle suit les travaux avec intérêt de semaine en semaine – les murs, à eux seuls, lui inspirent une sorte de vénération. » Nullement ébranlé par ceux qui prétendaient qu’il tentait l’impossible, Fleming se dévouait corps et âme à sa tâche ; il agissait à titre de maître d’œuvre et exhortait ses fidèles à multiplier leurs efforts. Entre 1840 et 1845, il alla à quatre reprises en Europe pour commander des matériaux de construction ; la dernière fois, il était épuisé et malade à son départ de Terre-Neuve. On avait interrompu les travaux en 1841 ; les dépenses excédaient alors les £21 000. Fleming avait en tête d’amasser assez de matériaux sur le chantier pour qu’on achève l’extérieur en une saison. Quand il revint en septembre 1845, le temps était venu de poser le toit ; l’édifice fut terminé en quelques semaines. L’évêque avait aussi veillé à la construction d’autres édifices : un couvent (adjacent à la cathédrale) pour les Sisters of Mercy, immédiatement après leur arrivée en 1842, et une vaste résidence pour les religieuses de l’Order of the Presentation, achevée en 1845.
Le 9 juin 1846, pendant que Fleming se trouvait de nouveau en Europe pour s’occuper de la cathédrale, un incendie ravagea St John’s et détruisit l’école et la résidence des religieuses de l’Order of the Presentation, et avec elles la plupart des objets de valeur et documents de l’évêque, qu’on y avait mis en sûreté. Il estima les pertes à plus de £6 000, somme qu’on ne pouvait guère solliciter auprès d’une population elle-même réduite à l’indigence. À son grand dam, il ne reçut rien du fonds d’aide créé alors en Grande-Bretagne et administré par le gouvernement. Le seul autre édifice à avoir brûlé était la vieille église anglicane, qui devait de toute façon être remplacée sous peu. Une somme de £14 000, soit la moitié du fonds d’aide, alla à la construction d’une cathédrale de l’Église d’Angleterre, et Fleming dut se débrouiller seul. Par bonheur, l’enthousiasme populaire était tel qu’au bout de quelques semaines les paroissiens s’engagèrent à soutenir l’entreprise de Fleming. En avril 1847, celui-ci retourna en Europe afin de se procurer des matériaux pour l’intérieur de la cathédrale et pour la reconstruction du couvent.
Encore inachevée, la cathédrale fut ouverte au culte le 6 janvier 1850. Souffrant, vaincu par le labeur, Mgr Fleming y célébra la messe ; ce fut son unique office dans la nouvelle église. On attribua largement sa mort, survenue quelques mois plus tard, aux inlassables efforts qu’il avait consacrés à son projet. Comme l’écrivit le Patriot & Terra-Nova Herald : « La cathédrale [...] a été l’édifice sur lequel, semble-t-il, il a tout misé. » Elle symbolisait aussi bien la foi de Fleming en l’avenir de Terre-Neuve que son attachement au catholicisme.
L’instruction de la jeunesse avait occupé Fleming presque autant que la cathédrale. Sous sa garde, l’école des religieuses de l’Order of the Presentation prospéra ; dès 1846, il y avait huit religieuses, un nouveau couvent et une école de 2 000 places que fréquentaient des filles de presque toutes les régions de l’île. Cependant, le « laxisme » des catholiques de classes moyenne et supérieure préoccupait toujours Fleming, qui résolut de fonder un deuxième établissement où « les dames catholiques respectables pourraient recevoir une éducation solide et pieuse ». Cette fois, il fit appel aux Sisters of Mercy, de Dublin, qui formèrent en 1842 une mission de trois membres, dont sœur Mary Francis [Marianne Creedon*]. Elles ouvrirent leur école à St John’s en mai 1843 et, même si l’entretien de leur communauté posa quelques problèmes au début, l’école continua d’accueillir avec succès une trentaine d’élèves payantes.
En 1836, le Parlement terre-neuvien avait adopté la première loi de la colonie sur l’instruction, qui affectait des crédits aux écoles confessionnelles existantes et à l’établissement d’écoles élémentaires non confessionnelles qu’administreraient des conseils scolaires publics. Fleming, peut-être à contrecœur, accepta cette loi. Là où les catholiques prédominaient, l’instruction religieuse pouvait être assurée en vertu d’un règlement du conseil scolaire qui autorisait les élèves à se retirer à cette fin. Cependant, par voie de règlement, la plupart des régions à majorité protestante inscrivirent au programme la Bible de Jacques Ier d’Angleterre, en précisant qu’on devait la lire sans commentaire, après la classe, à ceux dont les parents le désiraient. Les catholiques s’opposèrent à cette décision et Prescott y mit son veto. De leur côté, la plupart des protestants ne pouvaient accepter l’exclusion de la Bible, de sorte que les conseils de leurs régions refusèrent d’allouer des fonds aux nouvelles écoles. L’avertissement du Public Ledger selon lequel le nouveau système « serait un échec total » se vérifia amplement.
En 1843, une nouvelle loi créa des conseils scolaires protestants et catholiques distincts. Les fondations de l’instruction confessionnelle étaient donc posées, et un réseau d’écoles élémentaires catholiques allait s’étendre dans toute l’île. Assez étrangement, Fleming se trouva à s’opposer en 1843–1844 aux écoles secondaires protestantes et catholiques distinctes. À son avis, la loi ne garantissait pas le caractère confessionnel des secondes, et sa propre autorité sur elles n’était pas reconnue. Étant donné cette opposition, on ouvrit un établissement non confessionnel en 1844 ; il ferma ses portes en 1850.
Le problème éducatif le plus persistant auquel Fleming eut à faire face trouva sa solution en 1847. Même si les Orphan Asylum Schools n’avaient toujours que des élèves catholiques et recevaient chaque année une partie de la subvention réservée à l’instruction catholique, elles demeuraient officiellement non confessionnelles. Fleming n’avait pas contesté cette disposition, mais il fut ravi quand la Benevolent Irish Society, qui parrainait ces écoles, le consulta sur leur orientation future. Il avait espéré, dit-il, confier l’éducation des garçons à des frères mais n’avait pas voulu se mêler des affaires d’une institution établie. Avec le consentement de l’association de bienfaisance, quatre frères franciscains irlandais arrivèrent à St John’s en septembre 1847 ; dès lors, le caractère des écoles ne fut plus douteux. À la mort de Fleming, le principe de l’instruction catholique était acquis partout à Terre-Neuve.
Tant sur le plan politique que clérical, Fleming donna à son Église un caractère manifestement irlandais. Fidèle partisan de Daniel O’Connell, il put compter plusieurs fois sur l’aide du patriote irlandais dans ses relations avec le gouvernement britannique. Lorsque O’Connell fit campagne pour faire abroger l’union législative de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, l’évêque permit qu’on fasse une collecte pour cette cause aux portes des églises, et y contribua lui-même généreusement. D’ailleurs, en matière ecclésiastique, Fleming était plutôt tourné vers l’Europe. Contrairement à ses prédécesseurs, il n’entretenait pas de relations suivies avec l’Église du continent nord-américain, même s’il correspondit à l’occasion avec William Walsh*, évêque de la Nouvelle-Écosse et Irlandais comme lui, et même s’il fut pour quelque chose dans la décision prise par Rome, en 1844, de scinder en deux le diocèse de la Nouvelle-Écosse. C’est justement Walsh qui l’avait prévenu en 1843 qu’on songeait à réunir les diocèses de l’Amérique du Nord britannique sous l’autorité d’un archevêque qui siégerait à Montréal. Fleming protesta auprès de Rome avant même que cette proposition n’y arrive, mais sans donner le véritable motif de son opposition, soit le fait que les évêques canadiens devaient une bonne part de leurs revenus à « la générosité des protestants britanniques ». Pour des raisons semblables, il contra en 1847 un projet de Walsh, celui d’ouvrir avec l’assistance du gouvernement un séminaire dans l’une des colonies anglophones.
Le 4 juin 1847, Pie IX fit du vicariat de Terre-Neuve un diocèse. Cet honneur n’allait pas sans inconvénients : comme le diocèse était annexé à l’archidiocèse de Québec, l’évêque n’avait que le rang de suffragant. Fleming protesta contre cette décision en alléguant la difficulté d’accès au continent. (Il ajouta que l’inclusion du Labrador dans le diocèse de Terre-Neuve était « peu judicieuse », car ce territoire était plus facile à desservir à partir de Québec.) Il fallut attendre le mandat de son successeur pour que le Vatican se rende aux arguments de Terre-Neuve et place le diocèse sous sa juridiction immédiate.
Le 18 novembre 1847, Fleming, alors âgé de 55 ans seulement, écrivait que sa « constitution [était] devenue si fragile » que voyager était désormais hors de question pour lui. Plus tôt dans l’année, il avait demandé à Rome un coadjuteur en recommandant John Thomas Mullock*, père gardien de la maison des franciscains à Dublin, qui était son ami et conseiller depuis nombre d’années. Malgré certaines réserves – la candidature n’était pas venue de la nouvelle province ecclésiastique de Québec et l’épiscopat de Terre-Neuve ne devait pas être tout bonnement transmis d’un franciscain à un autre – Rome approuva la requête et nomma Mullock avant la fin de l’année. Débarqué à St John’s en mai 1848, ce dernier prit en charge une grande partie des affaires diocésaines. Au printemps de 1850, Fleming, de plus en plus faible et déjà dans une semi-retraite, quitta la résidence épiscopale pour s’installer à la maison franciscaine de Belvedere. C’est là qu’il mourut quelques mois plus tard. Le jour où on l’inhuma dans la cathédrale pour laquelle il s’était tant dépensé, des milliers de personnes vinrent lui rendre un dernier hommage.
Malgré ses défauts, Fleming était un pasteur infatigable et dévoué. L’aspect mondain de l’épiscopat ne signifiait rien pour lui ; il aimait mieux « passer des semaines d’affilée à l’île Kellys pour aider les ouvriers à tailler la pierre » que d’aller dîner à la résidence du gouverneur. Les jeunes et les pauvres bénéficiaient toujours d’une attention spéciale de sa part, et il fut généreux pour eux dans son testament. C’était en outre un solide meneur d’hommes, qui voyait loin et savait prendre des décisions. Quand il avait un but en tête, il refusait de transiger ou de se laisser distraire par des questions de moindre importance. Dans ses écrits, les dates, les chiffres, les montants d’argent sont très souvent erronés ou contradictoires ; il ne se souciait pas particulièrement de ces choses. L’important, toujours, était son grand dessein du moment. Malgré le ton souvent emporté, ses lettres sont relativement exemptes de rancœurs personnelles. Il ne réglait pas des comptes ; il défendait des causes. Avant sa mort, il tenta même une réconciliation avec son grand adversaire, Winton. Parfois qualifié d’ignorant, il était en fait doué pour l’organisation et la communication.
On accusait à l’occasion Fleming d’être un bigot qui exploitait les dissensions religieuses pour accroître son pouvoir politique. C’est aussi injuste qu’inexact. Il était plutôt, et tout à la fois, un défenseur rigide de la théologie catholique et un adversaire résolu de la domination protestante (anglicane). Il refusait le paiement des droits de mariage ou d’inhumation qui allaient à l’Église d’Angleterre, mais demandait sans embarras au pouvoir législatif de la colonie que les méthodistes aient les mêmes privilèges que les anglicans et les catholiques en matière de célébration des mariages. Même en politique, Fleming et son clergé soutinrent des protestants libéraux et combattirent des catholiques proches de l’establishment. Le fait qu’on ne nomma aucun catholique au conseil entre 1825 et 1840, et que nulle part ses coreligionnaires n’avaient un tant soit peu leur juste portion des charges publiques, l’irritait sincèrement. Pour lui, mieux valait supporter la division politique que consentir en silence à une injustice flagrante.
Fleming avait pour principaux adversaires un groupe de laïques et de prêtres catholiques auxquels s’ajoutaient des gens qui, tel Winton, avaient des vues très proches des leurs. Cette opposition, il avait du mal à l’accepter parce qu’il croyait essentiel aux intérêts de l’Église que les catholiques fassent front commun sous la conduite de leur évêque. La majorité de ses fidèles acceptaient volontiers et soutenaient l’autorité du clergé. Ce qu’on reprocha surtout à Fleming, c’est le traitement que son clergé réserva à ceux qui ne partageaient pas cette attitude. Indéniablement, il y eut des injustices et des excès, mais sa responsabilité demeure difficile à déterminer, et des indices montrent qu’il n’approuvait pas automatiquement la conduite de Troy. En outre, la politique proprement dite n’était pas seule en cause : les catholiques qui n’avaient pas les mêmes intentions de vote que lui ne l’appuyaient pas non plus, dans l’ensemble, sur les questions ecclésiastiques.
Mgr Michael Anthony Fleming fut un pivot dans l’histoire de Terre-Neuve. À sa manière, il contribua peut-être plus que tout autre à la transition qui permit à l’île de devenir une colonie organisée, dotée d’institutions semblables à celles de l’Europe et du reste de l’Amérique du Nord. Indirectement, aussi, il fut probablement celui qui fit le plus pour contrecarrer l’hégémonie des marchands et en assurer, à la longue, le remplacement par une forme de gouvernement responsable envers la collectivité. Certes, son épiscopat laissa à Terre-Neuve un héritage de dissensions ; mais il aida aussi un peuple à accéder à la maturité.
Parmi les ouvrages publiés de Michael Anthony Fleming, citons : Letters on the state of religion in Newfoundland, addressed to the Very Rev. Dr. A. O’Connell, P.P. [...] (Dublin, 1844) ; « Newfoundland » [deux lettres au révérend John Spratt, Dublin, 24 sept., 8 oct. 1834], Catholic Magazine and Rev. (Birmingham, Angl.), 6 (1835) : lxxii–lxxxi ; « Religion in Newfoundland » : v–xii ; Stato della religione cattolica in Terra-Nuova [...] (Rome, 1836) ; et Relazione della missione cattolica in Terranuova nell’America settentrionale [...] (Rome, 1837).
Arch. of the Archdiocese of St John’s, Fleming papers ; Howley papers, transcripts of docs. in the Archivio della Propaganda Fide (Rome).— Archivio della Propaganda Fide, Acta, 1847 ; Scritture riferite nei Congressi, America settentrionale, 2 (1792–1830) ; 5 (1842–1848).— Basilica of St John the Baptist (Roman Catholic) (St John’s), St John’s parish, reg. of baptisms, 1823.— PRO, CO 194/80 ; 194/82 ; 194/85 ; 194/87–93 ; 194/96–97 ; 194/99 ; 194/102 ; 195/18 ; 197/1.— Gentlemen-bishops and faction fighters : the letters of bishops O Donel, Lambert, Scallan, and other Irish missionaries, C. J. Byrne, édit. (St John’s, 1984).— Newfoundlander, 29 oct. 1829, 26 mai, 2, 9 juin, 28 juill., 25 août, 27 oct. 1831, 30 août, 13, 20, 27 sept., 4 oct. 1832, 14 févr., 26 sept. 1833, 25 oct. 1838, 12 janv. 1846, 24 juin, 16, 23 sept. 1847.— Newfoundland Indicator (St John’s), 16 mars, 20 avril, 1er juin, 20, 27 juill., 17 août 1844.— Newfoundland Vindicator (St John’s), 27 mars, 3 juill. 1841.— Patriot & Terra-Nova Herald, 26 juill. 1843, 29 juill. 1847, 20, 27 juill. 1850.— Public Ledger, 24 août 1827, 14, 21, 25 sept., 13 nov. 1832, 9 févr., 18, 25 mai, 19 août, 9 sept., 22, 29 nov. 1836, 25 mai 1841.— Centenary volume, Benevolent Irish Society of St. John’s, Newfoundland, 1806–1906 (Cork [république d’Irlande, 1906]).— Gunn, Political hist. of Nfld.— M. F. Howley, Ecclesiastical history of Newfoundland (Boston, 1888 ; réimpr., Belleville, Ontario, 1979).— R. J. Lahey, « The building of a cathedral, 1838–1855 », The Basilica-Cathedral of St. John the Baptist, St. John’s, Newfoundland, 1855–1980, J. F. Wallis et al., édit. (St John’s, 1980).— F. W. Rowe, The development of education in Newfoundland (Toronto, 1964).— Hans Rollman, « Gentlemen-bishops and faction fighters [...] » [recension de livre avec corrections], Nfld. Quarterly, 81 (1985–1986), n° 4 : 12–14.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Raymond J. Lahey, « FLEMING, MICHAEL ANTHONY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 avr. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/fleming_michael_anthony_7F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/fleming_michael_anthony_7F.html |
| Auteur de l'article: | Raymond J. Lahey |
| Titre de l'article: | FLEMING, MICHAEL ANTHONY |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la révision: | 1988 |
| Date de consultation: | 28 avr. 2025 |