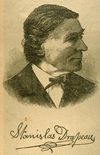voyers, I : 12, 30, 33, 38, 68, 80, 91 ; II : 62, 63 ; Inv. testaments, I : 169.— Tanguay, Dictionnaire.— [Prosper Cloutier], Histoire de la paroisse de
– l’abbé Rousseau, Parkman, Sulte, Mgr Tanguay – se rallièrent à la thèse de Ferland et de Faillon. Une seule voix discordante s’éleva, qu’on feignit de ne point entendre : celle de l’historien
, Dictionnaire.— P.-G. Roy, Inv. concessions, IV : 108–111, 114s., 237s. ; V : 276s. ; Inv. jug. et délib.,1717–1760, II : 77.— Tanguay, Répertoire
.— Tanguay, Dictionnaire, 3 : 438.— P.-M. Dagnaud, Les Français du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse [...] (Besançon, France, 1905), 24s.— [J.-]A. Deveau, La ville
chevaliers de Saint-Louis, 229.— La Chesnaye-Desbois et Badier, Dict. de la noblesse (1863–1876), VI : 989.— Tanguay, Dictionnaire.— Stanley, New France, 224
jusqu’à nos jours de l’abbé Cyprien Tanguay*, parus de 1871 à 1890, constituaient un ouvrage colossal et significatif ; ils demeuraient
, RHAF, I (1947–48): 101–107, 257–270,— Sulte, Hist. des Can. fr., II : 37.— Tanguay, Dictionnaire, I : 207, 379.
, passim.— Tanguay, Dictionnaire.— Vachon, Inv. critique des notaires royaux, RHAF, IX (1955–1956) : 547.— J.-E. Roy, Histoire du notariat, I
), çe qui n’est pas forcément un indice que l’abbé était pour lors en France. Tanguay, Allaire et Sulte, à la suite de Noiseux – dont les renseignements sont très souvent erronés – lui font
de compositeurs locaux, tels Guillaume Couture, Alexis Contant* et Georges-Émile Tanguay, tout en faisant entendre aussi un répertoire plus
Dubocq qui, en 1662, épousait à Québec la Huronne Marie-Félix, et qui serait né en 1634, d’après le recensement de 1667, et en 1636, d’après Tanguay. Si ces deux dates sont à peu près correctes, nous
, BRH, XL (1934) : 499.— Tanguay, Dictionnaire, I : 206.
des engagements pour l’Ouest, ANQ Rapport, 1931–1932, 277, 281–283, 351, 356–358 ; 1932–1933, 285, 287–289, 291, 294–299, 301s.— Tanguay, Dictionnaire, III : 491s.— L. P
–89.— Tanguay, Dictionnaire, 1 : 141 ; 3 : 154.— James Gibbs, The rules for drawing the several parts of architecture (Londres, 1728 ; réimpr
Tanguay), dans la paroisse Notre-Dame de Montréal ; elle mourut à l’île Sainte-Thérèse le 24 octobre 1687. Dugué fut inhumé à Montréal le 18 décembre 1688. Sept de ses neuf enfants lui survécurent
service du roi. Louis XV lui accorda toutefois une pension de 800# en 1730. Il mourut en France, le 7 juin 1736. Malgré ce qu’a écrit Mgr Tanguay, il ne s’était jamais marié
juin, 3 nov. 1785, 18 déc. 1788, 16 juill. 1789, 19 juill. 1792.— Tanguay, Dictionnaire.— Sulte, Mélanges historiques (Malchelosse), VI : 144.— Tousignant, La genèse et
supérieur de la Nouvelle-France, de 1717 à 1760 (7 vol., Beauceville, Québec, 1932–1935), 5 : 200.— Tanguay, Dictionnaire, 3.— Tremaine, Biblio. of Canadian imprints, 360
Paul Vachon, 14 juin 1716.— AQ, NF, Registres de la Prév. de Québec, 25 janv. 1694.— Jug. et délib., passim.— Recensement du Canada, 1681 (Sulte).— Tanguay