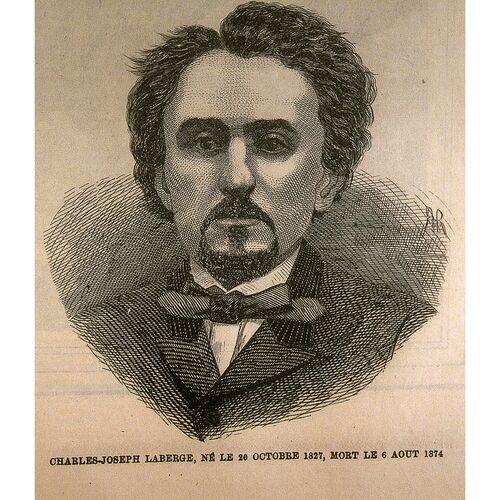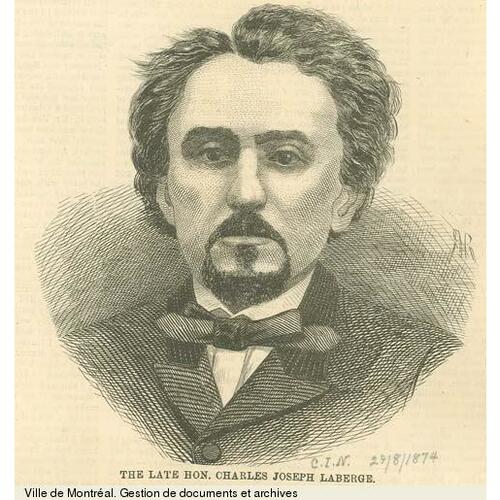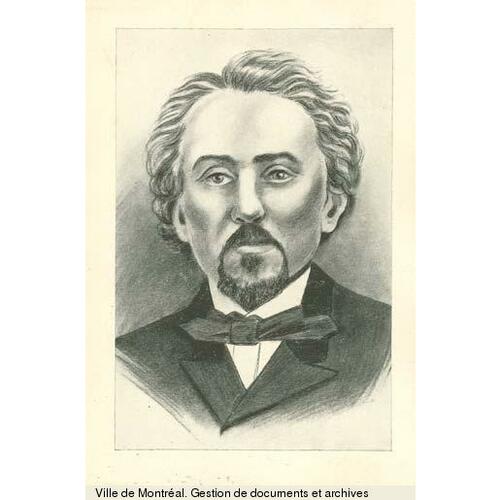Dans le cadre de l’accord de financement entre le Dictionnaire biographique du Canada et le Musée canadien de l’histoire, nous vous invitons à participer à un court sondage.
LABERGE, CHARLES, avocat, journaliste et homme politique, né à Montréal le 21 octobre 1827, fils d’Ambroise Laberge, marchand, et de Rose Franchère, sœur de l’explorateur Gabriel Franchère*, décédé dans la même ville le 3 août 1874.
Bientôt devenue veuve et restée pauvre, la mère de Charles Laberge donna quelque temps des leçons de musique, afin de subvenir aux besoins de quatre enfants en bas âge. Charles, dont la santé lui donnait des inquiétudes, fut confié à un cultivateur de la Rivière-des-Prairies pour que l’air pur de la campagne fortifiât ses poumons.
Il s’inscrivit au collège de Saint-Hyacinthe en 1838 et termina ses études classiques en 1845. Tous les témoignages confirment que, d’emblée, le jeune Laberge s’imposa à ses maîtres et à ses condisciples par sa vivacité intellectuelle et une facilité d’assimilation qui lui faisaient récolter, comme l’écrivait Laurent-Olivier David*, « sans effort et sans travail des succès que beaucoup d’autres cherchent vainement en travaillant ».
C’est surtout dans les essais littéraires et oratoires que ses dons se manifestaient avec le plus de bonheur. Journaliste en herbe, il fonda au collège un journal au titre prédestiné, le Libéral, dans lequel sa plume facétieuse se donnait du champ aux dépens des professeurs qui déplaisaient aux élèves. Discourant un jour, devant lord Elgin [Bruce*], en visite au collège, il s’attira le compliment qu’il deviendrait un orateur distingué, pronostic que Louis-Joseph Papineau, de retour d’exil, avait affirmé qu’il était déjà réalisé, après l’avoir entendu durant les exercices littéraires de 1845 : « Franchement, monsieur, je n’ai jamais aussi bien parlé que vous venez de le faire ; si j’ai eu le titre d’Orateur, vous en avez le talent. »
Au terme de ses études collégiales, Charles Laberge étudia le droit à Montréal sous la direction de René-Auguste-Richard Hubert. Admis au barreau en 1848, il s’associa avec l’avocat Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme*, mais dès 1852, il alla s’établir à Saint-Jean-d’Iberville, où en peu de temps il se créa une clientèle considérable.
Encore étudiant en droit, Laberge avait déployé une activité intense au sein de l’Institut canadien, dont il fut l’un des fondateurs. En novembre 1845, ses confrères l’avaient élu secrétaire-correspondant de leur association. Lorsque l’Avenir commença de paraître en novembre 1847, il se trouvait au nombre des « treize » collaborateurs dont la moyenne d’âge ne dépassait pas 23 ans. Soit à la tribune de l’Institut canadien, soit comme journaliste, il aborda les sujets les plus variés, mais il insista surtout sur la nécessité où se trouvait le Canada de s’annexer aux États-Unis. Dans une série d’articles parus dans l’Avenir, du 2 juin au 30 octobre 1849, et signés « 34 étoiles », il développait la thèse suivante : « Nous sommes arrivés à l’époque où le Canada doit devenir république, où notre étoile doit aller prendre place dans le ciel américain. »
Avec quelques-uns de ses amis de l’Institut canadien et de l’Avenir, Jean-Baptiste-Éric Dorion*, Joseph Papin* et Charles Daoust*, il se laissa dériver vers la politique active dans le sillage de Louis-Joseph Papineau. En 1854, élu député du comté d’Iberville, il appartint, avec dix de ses confrères de l’Institut canadien, pareillement favorisés dans leurs comtés respectifs, à cette constellation de jeunes libéraux ayant à leur tête Antoine-Aimé Dorion*, que deux adversaires politiques, Joseph-Charles Taché* et Pierre-Joseph-Olivier Chauveau* sous le pseudonyme de Gaspard Le Mage, s’efforcèrent de ridiculiser dans un pamphlet intitulé la Pléiade rouge.
À la chambre, au témoignage d’Oscar Dunn*, Laberge « était sur son véritable terrain, dans l’élément qui convenait le plus à ses facultés. Pas assez retors pour être un avocat de premier ordre, ni assez profond pour faire autorité dans la magistrature, il possédait un don naturel d’éloquence, une largeur d’idées, une droiture de caractère qui lui créait, sans effort de sa part, une place exceptionnelle dans une assemblée délibérante ». Et Dunn ajoutait : « Il parlait une belle langue, un français véritable ; sous ce rapport, personne n’a été mieux doué que lui dans notre pays. »
Lorsque le ministère conservateur tomba, en 1858, sur la question du siège du gouvernement, il accepta d’entrer comme solliciteur général dans le cabinet de George Brown et d’Antoine-Aimé Dorion, qui ne vécut que deux jours. Bien qu’éphémère, cette alliance avec l’Écossais qu’abhorrait le Canada français ne fut certes pas de nature à le rehausser à ses propres yeux et aux yeux de ses amis.
Quoi qu’il en soit, il se décida, en 1860, à quitter la carrière de la politique active pour se consacrer exclusivement à sa famille et à sa profession. C’est ainsi qu’aux élections générales de 1861 il refusa de poser sa candidature. Si, en 1813, il se laissa nommer juge à Sorel par le gouvernement libéral, les conservateurs revenus au pouvoir se hâtèrent, l’année suivante, de lui faire réintégrer la vie privée, ce qu’il accepta d’ailleurs avec philosophie, se plaisant infiniment au sein du foyer qu’il avait fondé le 23 novembre 1859, en épousant Hélène-Olive Turgeon, fille de l’ancien conseiller législatif Joseph-Ovide Turgeon.
Le journalisme eut toujours pour lui de vifs attraits. En 1860, avec son ami Félix-Gabriel Marchand*, il établissait le Franco-Canadien (Saint-Jean-d’Iberville), auquel il collabora épisodiquement. Il fit de même pour un autre journal libéral, l’Ordre (Montréal), dans lequel il inséra des articles signés « Libéral mais catholique ».
Comme la plupart de ses amis libéraux, il prit parti contre le projet de confédération des provinces de l’Amérique britannique du Nord. En 1865, répondant, dans une assemblée publique tenue à Montréal, à ceux qui disaient que les adversaires de la confédération n’indiquaient aucun autre remède : « Je n’admets pas, s’écriait-il, qu’un changement de constitution soit devenu nécessaire, mais, supposons qu’il le soit, sommes-nous justifiables d’accepter un régime politique qui va nous donner trois ou quatre ennemis au lieu d’un ? Si déjà nous avons tant de peine à lutter contre le Haut-Canada, comment ferons-nous lorsque nous aurons à combattre contre trois ou quatre autres provinces ? » Il proposait la solution « séparatiste » : « S’il faut changer de constitution, séparons-nous, puisque nous ne pouvons pas nous accorder, et faisons régler les questions de douane et de tarif intéressant toutes les provinces par un petit congrès qui n’aura pas le droit de s’occuper d’autre chose. »
C’est sans doute sur les instances réitérées de ses amis libéraux qu’il s’arracha, en 1872, de son patelin de Saint-Jean-d’Iberville, où il était vivement apprécié par ses concitoyens, qui l’avaient élu maire à deux reprises, pour retourner se fixer à Montréal et assumer la rédaction du National. Dès son premier numéro, le 24 avril 1872, ce journal rompait avec la tradition de l’Avenir et du Pays : « Le National sera un journal politique et non religieux, mais organe spécial d’une population catholique, et en conformité aux croyances de ceux qui dirigent le journal, quand l’occasion s’en présentera, nous abonderons dans le sens catholique ; et nous désavouons d’avance tout ce qui pourrait échapper à l’inadvertance dans la rapide rédaction d’un journal quotidien, pour protester de notre entier dévouement et de notre filiale obéissance à l’Église. » Déjà gravement atteint dans sa santé, Laberge ne put donner sa mesure. Son ami Oscar Dunn nous apprend que « ce n’est qu’au prix d’efforts vraiment héroïques qu’il parvenait à écrire ses articles sous l’étreinte du mal qui le rongeait » : « Pauvre et chargé de famille, il imposait silence à ses tortures pour accomplir son travail quotidien ; et le sentiment du devoir était tel chez lui qu’il y puisait la force de dompter la maladie, au point quelquefois de faire illusion aux siens et de leur donner de courtes espérances. »
À la douleur physique s’ajoutait la douleur morale. Chrétien convaincu, il avait toujours souffert de la suspicion que des adversaires et même des membres du clergé entretenaient au sujet de ses convictions religieuses, sous prétexte qu’il faisait profession de libéralisme. Cette souffrance s’était avivée au moment où l’Institut canadien, étant l’objet des censures épiscopales contenues dans les trois lettres pastorales émises par Mgr Ignace Bourget* le 10 mars, le 30 avril et le 31 mai 1858, vit s’éloigner quelque 135 de ses membres pour fonder l’Institut canadien-français [V. Cassidy]. Lorsqu’en 1867 des journaux conservateurs se mirent à invectiver les membres de l’Institut canadien en les traitant d’« excommuniés », Charles Laberge s’émut et, dans une lettre datée de Saint-Jean, le 16 août 1867, il fit part à Mgr Bourget qu’en sa qualité d’un « des fondateurs de cet Institut » et du fait qu’il en était « encore membre », bien qu’il ne participât plus à ses réunions, il voulait être éclairé dans le « cruel embarras » où il se trouvait au sujet de « l’assertion si positive d’excommunication » lancée contre lui et ses confrères.
Selon lui, les divergences qui avaient abouti à la malheureuse scission de 1858 eussent pu être évitées : « Lorsque, il y a quelques années, des difficultés surgirent, je pensais, et je pense encore, que les mêmes ressources et la même énergie qui avaient fondé l’Institut canadien-français auraient été plus utilement employées à changer la face de l’Institut canadien, et j’ai plusieurs fois offert mes services pour parvenir à ce résultat. Il me semblait qu’en faisant admettre un grand nombre de nouveaux membres, on pourrait imprimer à l’Institut une autre direction et conserver une institution prospère et qui est parvenue à sa 23e année, fait unique dans le Bas-Canada. Je suis encore prêt à employer toute l’influence que pourrait me donner ma qualité de fondateur pour parvenir au même résultat, s’il était encore désirable. »
Laberge n’avait jamais lu les lettres pastorales de 1858 relatives à l’Institut canadien. Lorsqu’il en entendit parler, il consulta son directeur de conscience, « un prêtre distingué, qui depuis est devenu évêque, lequel me dit, écrit Laberge à Mgr Bourget, que, comme je ne prenais aucune part active et publique aux travaux de l’Institut, je pouvais sans inconvénient en demeurer membre, sauf à m’en retirer quand cela serait nécessaire ».
Ce « prêtre distingué » était sans doute l’abbé Charles La Rocque, curé de Saint-Jean-d’Iberville de 1844 à 1866, et troisième évêque de Saint-Hyacinthe de 1866 à 1875. En effet, dans la correspondance Bourget-La Rocque au sujet des membres de l’Institut canadien, on devine comme le curé de Saint-Jean-d’Iberville, puis l’évêque de Saint-Hyacinthe, était réticent devant l’attitude intransigeante et inflexible adoptée par l’évêque de Montréal à leur endroit.
Laberge suppliait donc Mgr Bourget de le tirer de ses perplexités : « Maintenant, Monseigneur, je désire savoir à quoi m’en tenir, et je ne suis pas assez bien pour avoir l’honneur d’une entrevue avec Votre Grandeur, à Montréal. Quoique membre de l’Institut, je continue à recevoir les sacrements, sur la foi de la consultation rapportée plus haut. »
Quelle que fût la réponse de l’évêque de Montréal – si toutefois il y eut réponse – Charles Laberge, tout en cessant d’être membre de l’Institut canadien, resta fidèle jusqu’à la fin à la position qui avait fait de lui, « toutes proportions gardées », selon Oscar Dunn, « le Montalembert de son parti, associant à des convictions religieuses solides les idées modernes sur l’Église et l’État, démocrate autant que chrétien » ; « j’ignore ce qu’était dans le fond son libéralisme, ajoutait Dunn, mais il avait les espérances du catholique convaincu ».
Au lendemain de sa mort, survenue le 3 août 1874, son successeur à la rédaction du National pouvait écrire dans le journal qui avait recueilli les dernières productions de sa plume : « Il reste un homme politique modèle, et il a toujours été la preuve vivante qu’on pouvait être libéral sincère et catholique fervent. »
Les journaux auxquels Laberge a collaboré, soit le Franco-Canadien (Saint-Jean-d’Iberville), le National (Montréal) et l’Ordre (Montréal), doivent être consultés pour une étude complète de ce personnage. Il faut y ajouter : l’Avenir (Montréal), 2 juin–30 oct. 1849 et l’Opinion publique (Montréal), 27 août 1874. [p. s.]
ACAM, 901.135.— Borthwick, Hist. and biog. gazetteer, 220.— L.-O. David, Souvenirs et biographies, 1870–1910 (Montréal, 1911), 43–49.— Oscar Dunn, Dix ans de journalisme, mélanges (Montréal, 1876), 229–241.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Philippe Sylvain, « LABERGE, CHARLES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 29 mars 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/laberge_charles_10F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/laberge_charles_10F.html |
| Auteur de l'article: | Philippe Sylvain |
| Titre de l'article: | LABERGE, CHARLES |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la révision: | 1972 |
| Date de consultation: | 29 mars 2025 |


![[Hon. Charles Joseph Laberge] [image fixe] / Studio of Inglis Titre original : [Hon. Charles Joseph Laberge] [image fixe] / Studio of Inglis](/bioimages/w600.4252.jpg)