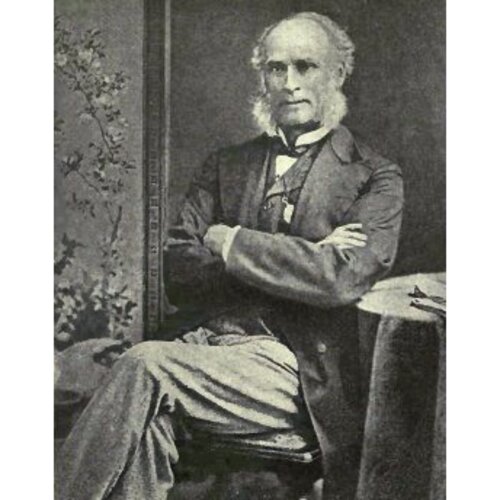Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3357216
MEREDITH, EDMUND ALLEN, fonctionnaire et auteur, né le 7 octobre 1817 à Ardtrea, comté de Tyrone (Irlande du Nord), fils du révérend Thomas Meredith ; le 17 juillet 1851, il épousa Anne Frances Jarvis, et ils eurent huit enfants ; décédé le 12 janvier 1899 à Toronto.
Issu d’une respectable famille anglo-irlandaise, Edmund Allen Meredith connut une enfance solitaire et instable qui le marqua peut-être pour la vie. Son père mourut quand il avait deux ans. Peu après, sa mère épousait un autre ecclésiastique et immigrait à Montréal en ne laissant derrière elle qu’Edmund (son benjamin) et son fils aîné, qui était déjà ordonné. Edmund vécut chez un vieil oncle célibataire qui le mit au pensionnat de Castleknock, près de Dublin, à l’âge de neuf ans. À 16 ans, il entra au Trinity College, où il obtint une bourse d’humanités et des prix en économie politique et en sciences. En 1837, il reçut sa licence ès arts. En 1842, il rejoignit au Canada le reste de sa famille, d’abord installée à Toronto, puis à Montréal. Bien qu’il ait été admis au barreau en 1844, il ne pratiqua pas le droit. D’abord, il aspira à un poste dans un collège torontois, mais au lieu de cela, peut-être grâce à l’influence de son frère William Collis, avocat au Bas-Canada et futur juge en chef à Québec, il fut nommé en 1846 au poste à temps partiel et non rémunéré de directeur du McGill College. Un an plus tard, la chance lui souriait : le 20 mai 1847, il entrait dans l’administration publique de la province du Canada, au salaire de 2 600 $.
Bien qu’il ait eu les qualités requises et se soit fort bien acquitté de son travail, Meredith touchait une rémunération qu’il jugeait insuffisante et il trouvait que l’on ne reconnaissait pas assez ses mérites, ce qui, par moments, l’irritait. À première vue, il aurait difficilement pu espérer mieux. Il avait un titre et du prestige ; les meilleurs cercles politiques et mondains de la province lui étaient ouverts. Pourtant, n’avoir ni pouvoir réel ni fortune le faisait manifestement souffrir. Sa carrière de fonctionnaire conservera bien des aspects obscurs tant que les départements où il travailla n’auront pas fait l’objet d’études plus poussées. Néanmoins, on en connaît les grandes lignes. Durant les 20 années où il fut adjoint au secrétaire de la province du Canada, il s’occupa avec diligence d’une foule de questions, dont bon nombre se rangeaient parmi les affaires courantes. Peut-être cette diversité même – qui faisait de son département le point à partir duquel se répartissaient les activités gouvernementales – lui procurait-elle quelque plaisir, mais on voit mal comment il aurait pu aimer ce qui, dans son travail, était souvent franchement ennuyeux : affaires locales et municipales, autorisations de routine. Ce qui le combla pendant cette période, ce fut son mariage merveilleusement heureux et ses fonctions au Bureau d’inspecteurs des asiles et prisons – simple à-côté qui fit pourtant de lui, jusqu’à la fin de ses jours, un passionné du travail correctionnel, des œuvres de bienfaisance et surtout de la réforme pénitentiaire.
Anne Frances Jarvis, connue sous le diminutif de Fanny, aînée des trois filles de William Botsford Jarvis*, shérif du district de Home, avait rencontré son futur mari pour la première fois quand elle avait 13 ans, à sa maison de Rosedale, où il s’était présenté en 1843 avec une lettre d’introduction pour son père. Cinq ans plus tard, les fréquentations devenaient sérieuses, et en 1851 ils se mariaient. Belle, délicieuse et enjouée, l’enfant chérie de la gentry torontoise avait mené une existence de rêve, toute remplie de fêtes et de promenades à cheval. Normalement, comme le dit l’historienne Sandra Gwyn dans sa captivante étude de la famille Meredith, elle aurait dû épouser quelque brillant officier d’un régiment de renom, et Edmund, un bas-bleu qui aurait été préparé à partager l’existence méditative d’un fonctionnaire assez peu sûr de lui. Mais Fanny succomba au charme de ce bel homme élégant, qui mesurait près de six pieds, de 13 ans son aîné et qui toute sa vie, comme son journal en témoigne abondamment et de manière poignante, lui porta un amour mêlé de dévotion. Ne notait-il pas en 1864, à l’occasion de leur treizième anniversaire de mariage : « Je l’aime plus que jamais, et toutes ses lettres débordent de l’amour et de l’élan le plus parfaits » ?
Fanny et Edmund passèrent les premières années de leur mariage à Québec. Capitale temporaire du Canada, elle offrait maintes réunions mondaines (dîners, bals, carnaval d’hiver), toutes animées par la présence des officiers de la garnison britannique ; par comparaison, la société torontoise paraissait bien terne. Puis, en 1865, Meredith et ses collègues entreprirent une migration forcée jusqu’à la « localité subarctique de bûcherons » dont la reine Victoria avait choisi de faire la nouvelle capitale du Canada. « Plus je connais Ottawa, écrivait-il dans son journal le 17 novembre 1865, plus je la déteste et l’abhorre. » Ce dégoût, alimenté par la boue, les rats, les problèmes de logement, les difficultés avec les serviteurs et bien d’autres misères d’ordre domestique ou climatique, allait persister durant des années.
Sur le plan professionnel, l’avènement de la Confédération, en 1867, fut une épreuve pour Meredith. Il dut quitter la fonction qu’il aimait tant au Bureau d’inspecteurs des asiles et prisons, et il trouvait que son nouveau poste de sous-secrétaire d’État aux provinces était ennuyeux et lui offrait peu de champ d’action. En 1868, il tenta sérieusement, mais en vain, de décrocher un poste rémunérateur à Toronto. Puis la rébellion du Nord-Ouest, en plaçant son département au centre des événements, dissipa quelque temps son ennui en 1869. Lorsque son ancien ministre à Québec, William McDougall*, subit un échec à cause des problèmes de Rupert’s Land, il n’en fut pas mécontent. Il préférait de beaucoup travailler avec le supérieur de McDougall, le charmant Joseph Howe*, qu’il a qualifié de « vieillard éloquent » et d’« homme des plus aimables ». « Nous ne reverrons plus jamais son pareil », disait-il. Cependant, la routine ne tarda pas à se réinstaller, si bien que Meredith, assailli de problèmes financiers, se lança dans une deuxième campagne en vue d’obtenir un poste plus payant hors d’Ottawa, celui de secrétaire de la future compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. Cette fois, il compta sur son grand ami Sandford Fleming*, avec qui il partageait une fascination pour l’heure légale. De nouveau, peut-être par bonheur, ses espoirs s’évanouirent parce que sir John Alexander Macdonald refusa de coopérer. Il y eut pire encore. En novembre 1873, il devint sous-ministre du département de l’Intérieur nouvellement créé, dont Alexander Campbell était le premier titulaire. C’était un département vaste, qui comprenait notamment la direction des Affaires indiennes et le Bureau des terres de la Puissance, mais à ce stade de sa carrière Meredith n’avait pas du tout envie d’assumer de nouvelles et lourdes responsabilités. Néanmoins, lui-même et Campbell en vinrent rapidement à s’estimer pour leur compétence, et apparemment, en qualité de sous-ministre, il réalisa une imposante restructuration de l’administration des affaires indiennes et des terres. Quand les libéraux d’Alexander Mackenzie prirent le pouvoir, en 1873, il les servit loyalement et bien, contribuant ainsi à l’idéal d’une fonction publique non partisane. Les libéraux avaient immensément besoin de l’expérience et de la compétence professionnelle de cet homme qui était reconnu pour maîtriser aussi bien les détails que l’essentiel des affaires gouvernementales et qui, de l’avis général, était le meilleur rédacteur législatif d’Ottawa.
Le journal de Meredith lève le voile sur ce qui se passait, pendant cette période, dans les coulisses de la haute et de la basse politique. On y lit par exemple qu’Alexander Campbell critiqua sévèrement la manière dont John Alexander Macdonald s’était conduit en 1873, juste avant de perdre le pouvoir : « Il a dit que, si seulement sir John A. était resté sobre pendant la dernière quinzaine, le ministère n’aurait pas été défait. » Meredith couvrait d’un mépris aristocratique certains membres du nouveau gouvernement, dont son propre ministre, David Laird*, de l’Île-du-Prince-Édouard, « longue créature sèche qui sembl[ait] un type très fruste ». Par contre, David Mills*, Ontarien au tempérament d’intellectuel qui succéda à Laird en 1876, lui plaisait beaucoup : « Le nouveau ministre travaille à merveille [...] très agréable et intelligent. »
Meredith quitta officiellement l’administration publique le 11 février 1879, soit près de 32 ans après sa nomination initiale. Au cours d’une brève cérémonie, son « cher vieil ami » Gustavus William Wicksteed, greffier en loi de la chambre des Communes, sut traduire l’essentiel de sa contribution : « Vous avez été pour nous un brillant exemple de la manière dont l’éducation, le savoir et la fréquentation des belles-lettres peuvent répandre charme et grâce sur l’accomplissement des devoirs publics et se faire agréablement sentir jusque dans les aspects arides et parfois ingrats de la vie de fonctionnaire. »
Pour le moment, on ne peut établir de façon définitive la contribution de Meredith aux affaires gouvernementales et ministérielles. Cependant, quelques détails captivants se font jour. En faisant de son beau-frère, Hewitt Bernard, son secrétaire officiel, Macdonald donna un exemple qui fut suivi à des paliers inférieurs : Meredith eut pour commis principal le cousin de Fanny, Grant Powell. Président du Bureau du service civil, il prôna, avec plus ou moins de succès, l’amélioration des conditions de travail, le droit à la rente de retraite et la hausse des salaires. Dans un discours prononcé en 1872, il affirma que l’échelle des salaires dans la fonction publique du Canada était honteusement basse par rapport à celle d’autres pays. Que l’un des fonctionnaires les plus remarquables de sa génération ait exprimé pareille opinion en public donne une idée du moral qui régnait dans l’administration canadienne au milieu de l’époque victorienne. Tout de même, être fonctionnaire dans la seconde moitié du xixe siècle présentait des agréments. La journée de travail commençait à neuf heures trente le matin et se terminait à quatre heures de l’après-midi ; on prenait tranquillement deux heures pour manger. On avait donc assez de loisirs pour s’adonner à toute une gamme d’activités créatrices à l’extérieur, surtout si l’on occupait un poste élevé. Meredith fut l’un des pionniers de cette tradition : il fut président de la Natural History Society, membre de l’Ottawa Literary and Scientific Society et cofondateur de l’Ottawa Art Association. Membre fondateur de la congrégation anglicane St Alban the Martyr, il joua un rôle majeur dans ses premières campagnes de souscription en organisant des séances de lecture auxquelles lui-même prenait une part importante.
En outre, Meredith écrivait sans relâche. Il signa une série d’opuscules ainsi que des articles dans des périodiques aussi prestigieux que la Canadian Monthly and National Review de Toronto. Parmi ses nombreuses publications, qui témoignent à la fois de desseins très sérieux et du goût des Victoriens pour les sciences appliquées, figurent un ouvrage sur les salaires, les prix et les revenus fixes, un autre intitulé Earth sewage versus water sewage [...], paru à Ottawa en 1868, qui prônait un « système [sanitaire] sans eau courante », un Essay on the Oregon question, paru à Montréal en 1846, et même un opuscule sur la formation des miliciens intitulé Short school time, with military or naval drill [...], publié à Québec en 1875. Toutefois, il s’enorgueillissait surtout des rapports et textes divers qu’il rédigeait à titre de secrétaire du Bureau d’inspecteurs des asiles et prisons, et il avait raison de croire qu’ils se comparaient avantageusement aux documents d’État du même genre produits ailleurs.
Cela dit, on sent, à la lecture de son journal, que ce qui soutenait Meredith, c’était la joie que lui procurait sa famille, et surtout Fanny. Le couple eut huit enfants, dont six parvinrent à l’âge adulte. Meredith fut présent à toutes les naissances, et il adorait son rôle de père et de chef de famille. Son fils Colborne Powell, qui devint architecte à Ottawa, a évoqué les délices de la vie familiale et la facilité avec laquelle son père, toujours digne en public, pouvait se détendre et, comme il le disait lui-même, « [s’]amuser comme un fou avec [ses] petits ». Il prit volontiers sous son aile plusieurs des membres impécunieux de la famille Jarvis, dont la sœur de Fanny, mariée à un alcoolique. Il trouva une place dans la Police à cheval du Nord-Ouest pour le frère de Fanny, qui avait fait un mariage malheureux et menait une vie de fêtard.
C’est à titre d’inspecteur des prisons que Meredith donna la pleine mesure de ses compétences et manifesta le mieux son souci de réforme. On chercherait en vain, parmi ceux qui travaillèrent au xixe siècle dans l’administration de l’aide sociale et les établissements correctionnels du Canada, un personnage doté d’aussi solides qualités administratives, d’une telle connaissance des innovations européennes et américaines et d’une perspective aussi critique des pratiques en cours.
En qualité d’adjoint au secrétaire de la province, Meredith en apprit beaucoup sur les établissements et pratiques d’assistance sociale, mais son engagement direct commença quand il entra au Bureau d’inspecteurs des asiles et prisons. Créé par une loi en 1857, l’organisme constituait un remarquable pas en avant mais, quand il fut dissous, à la Confédération, les espoirs qu’on avait mis en lui n’étaient pas entièrement réalisés. Lorsqu’ils se réunirent pour la première fois, le 27 décembre 1859, Meredith et ses collègues, dont le docteur Wolfred Nelson* et John Langton, autre haut fonctionnaire, croyaient que leur mandat, qui consistait à inspecter, administrer et énoncer des lignes directrices, déboucherait sur l’étude et le règlement scientifiques de nombreux problèmes sociaux. Le bureau supervisait les hôpitaux de marins et d’immigrants, 4 asiles d’aliénés, 2 maisons de correction pour jeunes, le pénitencier de Kingston et les 52 prisons communes réparties sur l’immense territoire de la province du Canada. Meredith fut secrétaire du bureau durant toute l’existence de celui-ci et en fut également président à compter de 1864. Sous sa direction, les inspecteurs lisaient une foule de documents parus dans d’autres pays et enquêtaient systématiquement sur les conditions qui régnaient au Canada. La quantité de données que le bureau amassa et analysa est impressionnante. À partir d’un questionnaire envoyé aux shérifs et à d’autres personnes dans les comtés, les inspecteurs brossèrent un tableau de la situation qui les consterna. De prime abord, les grands établissements, y compris les asiles et le pénitencier, semblaient progressistes et bien administrés, peut-être parce qu’ils se soumettaient assez bien au contrôle bureaucratique, mais Meredith était convaincu que les conditions qui régnaient dans les prisons sous administration locale étaient abominables. Il soutint toujours qu’en mêlant criminels endurcis et novices, détenus de tout âge et de toute condition, on faisait des prisons de véritables écoles du crime. Il était sidéré qu’il n’y ait aucune distinction entre les détenus et qu’on ne parvienne pas à leur inculquer de solides principes de religion, d’éducation ou de formation par le travail. En outre, les prisons choquaient ce bureaucrate passionné d’organisation, et il critiquait aussi bien leur coût, bien supérieur à celui du pénitencier, que leurs défauts notoires. Fortement influencé par ce qui se faisait alors en Angleterre, il tenta, avec plus ou moins de succès, de convaincre les comtés d’instaurer un système fondé sur la séparation. Le bureau put amener certains comtés à faire des réaménagements, mais la réforme était loin d’être satisfaisante.
C’est au pénitencier que Meredith obtint les meilleurs résultats. Il avait d’abord cru que Kingston était un établissement relativement progressiste, mais cette impression ne résista pas à un examen sérieux. Dans son rapport de 1861, il parla de « répression rigide », de « coercition absolue » ; le régime en vigueur, disait-il, « ne permet ni de modifier ni d’améliorer la condition du prisonnier qui se conduit bien ». Meredith était alors devenu le principal disciple canadien de sir Walter Crofton, réformateur irlandais des prisons qui avait rejeté les rigueurs de ce qu’on appelait le régime Auburn, appliqué au pénitencier de Kingston [V. Hugh Christopher Thomson*], en faveur du programme suivant. L’incarcération commençait par une phase strictement pénale, mais les prisonniers qui se comportaient bien étaient récompensés de diverses façons : pécules, remises de peine, sentences indéterminées par exemple. L’assistance postpénale était un autre aspect important du régime Crofton. Meredith réussit à convertir ses collègues inspecteurs aux principaux éléments de ce régime, mais il se buta à la résistance du directeur du pénitencier, Donald Aeneas Macdonell*, homme de la vieille école, et à l’indifférence, sinon à l’hostilité, de ses supérieurs politiques, surtout sir John Alexander Macdonald qui continuait de croire que le châtiment et la dissuasion devaient primer sur la réhabilitation.
Néanmoins, Meredith et ses collègues parvenaient à adoucir certains des pires aspects du régime appliqué par Macdonell. Dans son journal, Meredith fait état, parfois en termes cinglants, d’affrontements fréquents avec le directeur. Les conditions de détention s’améliorèrent au moins quelque peu, mais seules des réformes mineures furent réalisées. En 1868, le gouvernement conservateur s’inspira de l’expérience de Meredith pour rédiger la première loi pénitentiaire du dominion. Elle apporta certaines améliorations importantes, tels un programme de rémission de peine au mérite et le versement de petites sommes aux prisonniers qui s’en rendaient dignes par leur travail. Le programme eut quelque succès, mais dans l’ensemble le pénitencier demeura un lieu aussi triste qu’auparavant.
En matière de traitement des jeunes délinquants, Meredith était aussi avant-gardiste. Les maisons de correction mises en place par suite de la loi de 1857 faisaient du bon travail, mais selon lui il fallait en retirer les plus âgés parmi les jeunes car ils nuisaient à la discipline. Il recommandait de distinguer les enfants reconnus coupables de crime de ceux qui, simplement démunis ou négligés, pouvaient encore échapper à la délinquance. Macdonald, en tant que procureur général, n’acceptait pas que les enfants de cette seconde catégorie soient placés comme apprentis ou dans des fermes, car il estimait que c’était empiéter sur les droits parentaux. Il appartint au mouvement de sauvegarde de l’enfance des années 1880 et 1890 [V. John Joseph Kelso*] d’aller dans la direction prônée une génération plus tôt par Meredith et ses collègues.
Quand il prit sa retraite, Edmund Allen Meredith retourna vivre à Toronto et, grâce à un bel héritage, acheta une maison sise sur une propriété qui avait jadis fait partie du domaine des Jarvis. Avec Fanny, il y mena une vie heureuse et utile. Comme les affaires correctionnelles l’intéressaient toujours, il présenta en 1887 une communication sur la réforme des prisons aux réunions de la National Prison Association of the United States (qui se tinrent à Toronto) et, en 1896, à l’âge de 79 ans, il fut membre d’une commission d’enquête sur le pénitencier de Kingston. Il compta aussi parmi les fondateurs du Homewood Asylum de Guelph [V. Stephen Lett*]. Durant de nombreuses années, il fut membre de la Prisoners’ Aid Association du Canada et prit souvent la parole à ses assemblées annuelles. Vice-président de la Toronto General Trusts Company, il parcourait chaque jour à pied, dit-on, les deux milles qui séparaient Rosedale de son bureau de la rue King. Il mourut le 12 janvier 1899 après une intervention chirurgicale à la prostate ; Fanny s’éteignit deux décennies plus tard, en septembre 1919.
Parmi les ouvrages de références standard qui dressent la liste des nombreuses publications d’Edmund Allen Meredith, on trouve : Canadian men and women of the time (Morgan ; 1898) ; Morgan, Bibliotheca canadensis et Canadiana, 1867–1900.
Le présente biographie doit beaucoup à l’ouvrage de Gwyn, Private capital. Exposé sur Meredith le plus complet jusqu’à maintenant, cette étude traite surtout de l’individu. Son rôle de réformateur de l’assistance sociale est examiné dans l’ouvrage de R. B. Splane, Social welfare in Ontario, 1791–1893 ; a study of public welfare administration (Toronto, 1965), et celui de réformateur des prisons dans la thèse de W. A. Calder, « The federal penitentiary system in Canada, 1867–1899 : a social institutional history » (thèse de ph.d., Univ. of Toronto, 1979), particulièrement aux pages 204–206. J’ai étoffé ces comptes rendus en consultant le journal de Meredith et ses autres papiers aux AN, MG 29, E15, les papiers des secrétaires de la province (AN, RG 4 et RG 5), qui comprennent de longs documents rédigés par Meredith, et les rapports annuels du Bureau des inspecteurs des asiles et prisons dans Canada, prov. du, Parl., Doc. de la session, 1860–1866, et Canada, Parl., Doc. de la session, 1866–1867, no 40. [p. o.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Peter Oliver, « MEREDITH, EDMUND ALLEN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/meredith_edmund_allen_12F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/meredith_edmund_allen_12F.html |
| Auteur de l'article: | Peter Oliver |
| Titre de l'article: | MEREDITH, EDMUND ALLEN |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1990 |
| Année de la révision: | 1990 |
| Date de consultation: | 1 janv. 2026 |