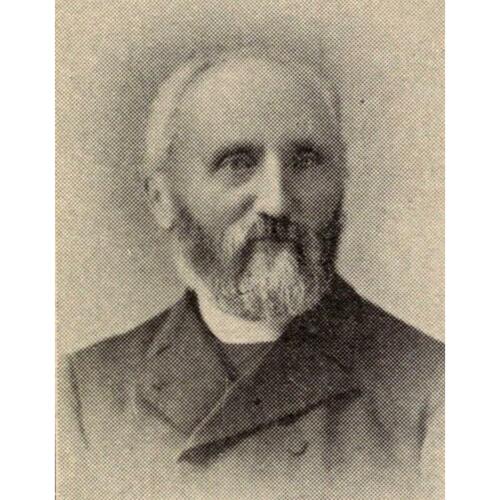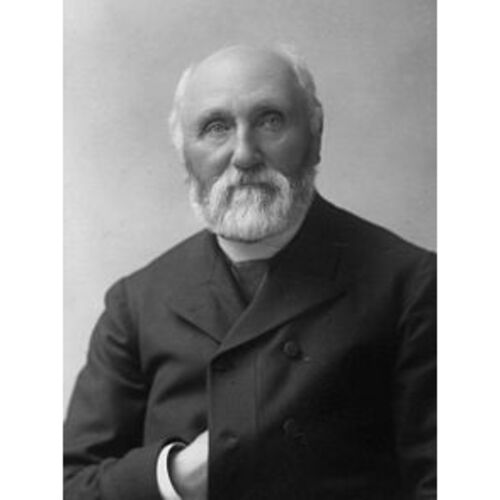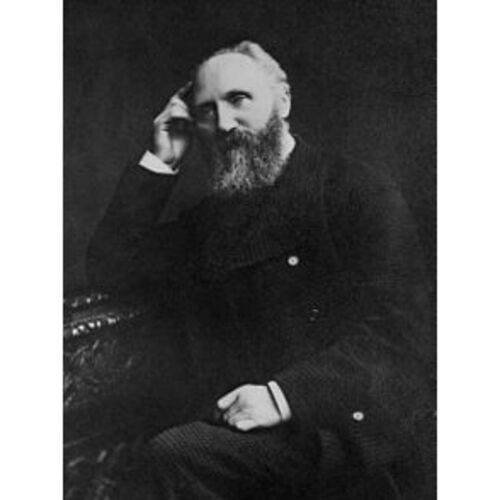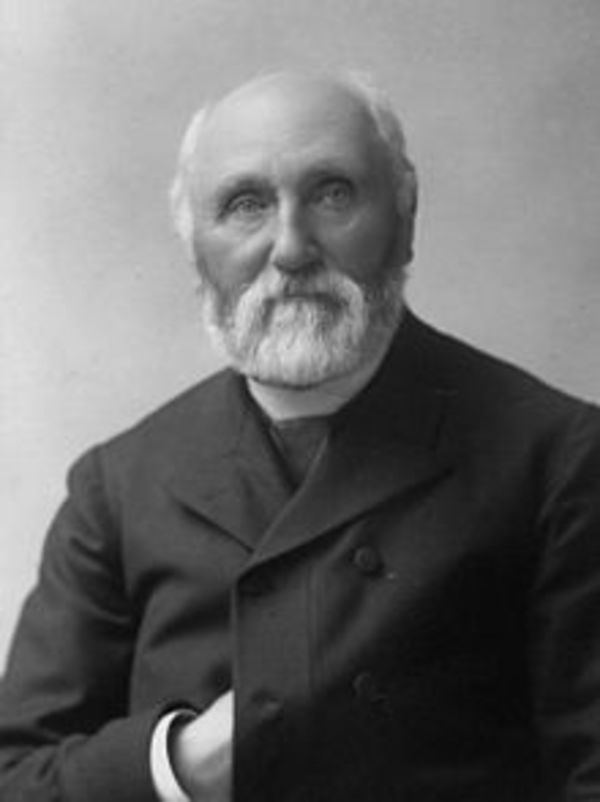
Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
DUNCAN, WILLIAM, missionnaire laïque, né le 3 avril 1832 à Bishop Burton, Angleterre, fils de Maria Duncan ; décédé célibataire le 30 août 1918 à New Metlakatla (Metlakatla, Alaska).
Comme l’auraient dit les habitants de son Yorkshire natal, William Duncan vint au monde du « mauvais côté du lit » (était de descendance illégitime). Élevé par ses grands-parents maternels, il ne fut jamais proche de sa famille, même si sa mère finit par se marier et par avoir deux filles. La honte que lui inspiraient parfois ses origines ne l’empêcherait pas de devenir le porte-étendard du protestantisme victorien sur la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord. Au début du xxe siècle, il serait l’un des plus illustres missionnaires du monde anglo-saxon.
Duncan grandit à l’ombre de la grande église abbatiale de Beverley. Jusqu’à l’âge de 14 ans, il fréquenta la National School de cette ville marchande, après quoi il entra à la George Cussons and Sons, grande entreprise de tannage et de commerce en gros de peaux et de cuir où travaillait son grand-père. À l’instar de certains de ses jeunes compatriotes, il entendait bien faire son chemin dans le monde florissant des affaires. Guidé par un employeur paternaliste et stimulé par les idées du conférencier Samuel Smiles, il continua de s’instruire en fréquentant le Mechanics’ Institute et en suivant des cours du soir. Lecteur vorace d’écrits sur la débrouillardise et la réussite, il valorisait, comme Smiles, l’épargne, le travail, la discipline et la ponctualité, clefs du succès commercial et de l’avancement personnel. Fraîchement promu voyageur de commerce à l’âge de 21 ans, il s’émerveillait de fréquenter désormais une « classe d’hommes bien supérieurs à [lui] sous le rapport de l’instruction, du rang et des talents et [d’être] traité avec respect par eux ». Il attribuait sa bonne fortune à l’intervention divine : « Assis dans une belle pièce confortable et à une table couverte des bonnes choses de ce monde, [...] Oh ! je sentais mon cœur déborder de gratitude envers Dieu qui, par son merveilleux amour, m’élevait ainsi. » Pour Duncan, pareille réussite profane ne pouvait être obtenue sans transformation religieuse. Cette conviction serait l’une des assises de son œuvre parmi les Amérindiens du Pacifique Nord.
Enfant, Duncan s’était fait remarquer comme chantre à l’église abbatiale de Beverley et avait passé des heures à participer aux répétitions de la chorale ou aux offices du soir et du dimanche. Il en garderait pour toujours une passion pour la musique sacrée, mais le rituel lui inspirait beaucoup de méfiance. En effet, en enseignant à l’école du dimanche, il avait subi l’influence d’un évangélique, le révérend Anthony Thomas Carr, selon qui l’Église chrétienne se composait de croyants plutôt que de confessions religieuses. Carr signala Duncan à l’attention de la Church Missionary Society et, après la mort subite du révérend, le jeune homme, très affecté par cette perte, se sentit tenu d’offrir ses services à la société évangélique. De 1854 à la fin de 1856, il s’initia au métier d’instituteur missionnaire en travaillant à l’école modèle affiliée à un établissement de la société, le Highbury Training College for Schoolmasters, et dans les missions des « quartiers miséreux » de Londres.
La Church Missionary Society donnait corps aux convictions de l’époque. La position dominante de l’Angleterre dans le monde, ses colonies et ses relations commerciales offraient d’« étonnantes possibilités de répandre davantage la vérité de l’Évangile », affirmait le Church Missionary Intelligencer. « Si notre époque est celle des missions, il est tout aussi vrai que le peuple de notre pays est le messager [qui doit s’adresser] à toute la terre, précisait-il. Les païens crient, et ils crient vers nous – vers nous, Anglais du dix-neuvième siècle. » En étendant leur hégémonie, l’Empire et l’Église prirent dans leurs filets les Tsimshians du Pacifique Nord. Ce fut James Charles Prevost, capitaine dans la marine royale, qui attira l’attention de la Church Missionary Society sur les autochtones de la rivière Nass (Colombie-Britannique). Et ce fut au jeune et fervent instituteur que les secrétaires de la société confièrent le mandat d’aller inculquer un mode de vie chrétien aux Tsimshians.
Duncan arriva à l’île de Vancouver en juin 1857 et passa l’été à Victoria, où il rencontra beaucoup de membres de l’élite coloniale. Il logeait chez le révérend Edward Cridge, aumônier de la Hudson’s Bay Company, avec qui il noua une solide relation qui serait déterminante pour son avenir. À la fin de septembre, il partit pour le fort Simpson (Port Simpson), sur la Nass, où William Henry McNeill* était agent principal. Sur les instances du gouverneur James Douglas*, il s’installa à demeure à l’intérieur de ce poste de la compagnie. Environ 2 300 Amérindiens, rapporta-t-il, vivaient autour du fort [V. Paul Legai*]. Il se mit à l’étude de la langue tsimshiane et avoua dans une lettre à Cridge qu’il se sentait « presque écrasé en songeant à [sa] situation ». « Ma solitude, l’ampleur de la tâche, qui paraît augmenter sans cesse devant moi, [...] semblent parfois sur le point de m’engloutir », disait-il.
De 1857 à 1862, Duncan resta l’hôte de la Hudson’s Bay Company et bénéficia de sa protection. Il apprit à parler couramment le tsimshian, bâtit une école et instaura des exercices d’apprentissage par mémorisation et des exercices physiques pour les enfants et les adultes. « Ils peuvent chanter des cantiques et apprennent God Save the Queen, écrivit-il fièrement [...] Ils ont appris à utiliser des formules de politesse envers leurs semblables et corrigé plusieurs de leurs habitudes. »
Comme la plupart des missionnaires de son temps, Duncan était convaincu que de nombreux éléments de la civilisation qu’il connaissait faisaient partie du christianisme. Cependant, il représentait la Church Missionary Society sous le secrétariat du révérend Henry Venn, donc à une époque où la société visait à offrir un mode de vie chrétien à ses convertis éventuels. Dans son programme sur l’Église autochtone, Venn pressait ses missionnaires d’intégrer la religion aux principales activités économiques et politiques du milieu où ils œuvraient. Ils devaient enseigner, « inciter » et « conseiller ». Leur objectif devait être de créer une vie collective chrétienne, et d’aider les convertis à améliorer leur statut social et à accroître leur influence tout en recevant une instruction chrétienne. Le programme exigeait que les missionnaires tel Duncan observent attentivement la société qu’ils souhaitaient transformer. Ils devaient reconnaître le pouvoir des gouvernements traditionnels, mais ne pas oublier que l’une de leurs principales tâches était de créer une élite autochtone, un pastorat pour la nouvelle Église autochtone. Tout au long de sa vie, Duncan affirmerait suivre ces préceptes.
Au début des années 1860, les Tsimshians du fort Simpson qui avaient choisi de s’allier à Duncan, dont bon nombre de jeunes familles, discutaient de la possibilité de retourner à l’ancien village de Metlakatla. Malgré son désir de se soustraire à l’influence de la Hudson’s Bay Company, Duncan tenait à ce que la décision paraisse provenir des Amérindiens. Il savait que la création d’un établissement chrétien autonome serait son geste le plus important. Ce projet semblait répondre aux exigences premières du programme sur l’Église autochtone et offrait la perspective de voir naître un village qui « dégagera[it] de la lumière et une chaleur rayonnante pour toutes les masses d’humanité [vivant], aux alentours, dans les ténèbres et la mort spirituelles ».
L’utopie fondée par Duncan à Metlakatla durerait de 1862 à 1887 ; elle attirerait l’attention et les éloges de tout le monde missionnaire. Grâce à elle, William Duncan acquit un immense pouvoir, tant dans l’établissement lui-même qu’à titre de conseiller auprès de divers gouvernements. En outre, elle apporta prestige et prospérité aux Tsimshians chrétiens qui étaient prêts à changer leur mode de vie pour créer cette nouvelle communauté.
Ceux qui choisissaient de s’installer à Metlakatla devaient renoncer aux signes extérieurs de leur religion – « les rites démoniaques appelés Ahlied ou procédés de guérison : les conjurations et toutes les pratiques païennes sur les malades ; la consommation de boissons enivrantes ; les jeux de hasard ; [les coutumes qui consistent à] se peindre la figure, à donner des biens par ostentation [et à] mettre des biens en pièces sous l’empire de la colère ou pour effacer la disgrâce ». De plus, ils devaient observer le jour du Seigneur, envoyer leurs enfants à l’école, construire une maison, cultiver un jardin, payer des impôts et avoir « des habitudes de propreté [...] être industrieux [...] paisibles et rangés [et] être honnêtes et droits dans leurs rapports entre eux et avec les [I]ndiens des autres tribus ». La prospérité que l’établissement était censé offrir attirait les Tsimshians, mais aussi la sécurité promise par le missionnaire en ces temps où bien des tribus côtières se sentaient menacées politiquement, économiquement et physiquement.
Au fil des ans, Metlakatla prit l’allure d’une implantation européenne. On y bâtit une grande église, une école, une prison. Une petite conserverie et scierie produisait des marchandises pour l’exportation et la construction. Un comptoir de traite exploité par Duncan permit aux habitants d’échapper à l’emprise de la Hudson’s Bay Company et resta au cœur de la vie économique de la collectivité. Pendant un temps, la mission eut aussi un schooner qui faisait le commerce et assurait les communications avec Victoria, ce qui permettait à Duncan de contrôler les relations avec l’extérieur.
Bien que la pêche, la chasse et, dans une moindre mesure, le piégeage aient continué de soutenir l’économie du village, la vie sociale s’européanisait de plus en plus. La présence d’une chorale d’église, d’une fanfare, d’une police en uniforme, d’une équipe de pompiers, d’une société Dorcas pour femmes, d’une salle de lecture et de cours pour adultes attirait un nombre croissant de Tsimshians. Les nouveaux arrivants étaient tenus d’obéir aux lois de Metlakatla ainsi qu’aux nouvelles lois des gouvernements coloniaux et de la province de la Colombie-Britannique. Duncan fut nommé magistrat, ce qui lui donna des pouvoirs supplémentaires de persuasion non seulement sur les Tsimshians mais aussi sur les Blancs, entre autres les trafiquants d’alcool qui menaçaient le village.
Dès 1875 environ, Duncan avait terminé une réorganisation interne de Metlakatla. Il avait divisé les hommes et les femmes en dix compagnies dont le but était d’« unir les Indiens pour qu’ils s’entraident, de placer sous surveillance chaque membre de [la] communauté et de donner à la majorité [des] hommes l’occasion de contribuer au bien public ». Duncan affirmait que cette structure était un moyen de continuer à intégrer les nouveaux arrivants, mais elle reflète aussi la combinaison de coopération économique, d’adaptation aux besoins des Tsimshians et de pratiques autoritaires qui était en train de caractériser son entreprise.
Renommée en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, la colonie de Metlakatla recevait des fonds de ces trois pays. Elle engendra des villages florissants tels Kincolith et New Aiyansh, et résista aux initiatives rivales des méthodistes [V. Thomas Crosby] et de l’Armée du salut. Plusieurs missionnaires furent envoyés de Grande-Bretagne pour aider Duncan, mais il les affecta presque tous ailleurs ou se querella avec eux ; seuls les révérends Robert Tomlinson et William Henry Collison* lui restèrent fidèles. En tant que premier missionnaire, il était devenu le confident de bien des Tsimshians et exerçait une vaste influence. Le jeune évangéliste résolu de 1857 était devenu à la fois un personnage public et l’artisan de la réussite économique des Tsimshians. Jusqu’en 1880, en Angleterre et en Colombie-Britannique, on ne cessa de vanter ses mérites à cause de la société modèle qu’il semblait avoir créée. À Metlakatla, il appliquait son système avec une discipline rigoureuse, parfois excessive. Fait peut-être inévitable, sa détermination se mua en un pharisaïsme brutal qui contribua à la destruction de son utopie.
Dans les années 1870, pendant la querelle doctrinale qui divisa l’Église de Victoria, Duncan prit le parti de son grand ami Cridge, évangélique comme lui. Après que l’évêque George Hills* eut démis Cridge de sa fonction de doyen de la cathédrale, les habitants de Metlakatla interdirent à l’évêque de venir dans leur village, et les liens entre Duncan et l’Église d’Angleterre s’affaiblirent. Cette rupture eut aussi pour effet de rendre Duncan encore plus réticent à se faire ordonner ministre et à donner la sainte communion aux Tsimshians. À son arrivée, il était un simple instituteur du Yorkshire, un homme qui avait son franc-parler, et pourtant il avait accompli beaucoup. Selon lui, porter des vêtements sacerdotaux et être investi du pouvoir spirituel d’un ministre du culte ne raffermirait pas sa position parmi les Tsimshians. Par ailleurs, offrir le corps et le sang du Christ aux autochtones était imprudent, affirmait-il, car ils étaient spirituellement « imprévisibles ». Non sans contentement, il réitéra cet avis après les débordements de ferveur qui suivirent les sermons d’un ministre nouvellement arrivé à Metlakatla en 1877, le révérend Alfred James Hall.
La résistance des habitants de Metlakatla à l’autorité épiscopale inquiétait l’évêque Hills et la Church Missionary Society. À la suite de la visite pastorale de l’évêque d’Athabasca, William Carpenter Bompas*, en 1877–1878, on eut encore davantage l’impression, à Londres, que la réussite notoire de Duncan à Metlakatla avait masqué la dépendance des autochtones envers lui. L’instruction, l’activité économique, la cohésion sociale et l’européanisation n’avaient pas engendré l’Église autochtone souhaitée par Henry Venn. Certes, Duncan avait créé une ville sise sur un mont, comme il est dit dans la Bible, et une sorte de christianisme tsimshian. Mais il en était devenu l’âme dirigeante et le fondement, non l’inspirateur et le conseiller voulu par Venn. Sa création avait pris un tour exclusif ; elle faisait sûrement partie de l’Église chrétienne, mais de moins en moins de l’Église d’Angleterre.
La subdivision du diocèse de la Colombie-Britannique en 1879 déchargea Hills de la responsabilité du turbulent prédicateur laïque du Nord, mais elle donna lieu à la nomination d’un évêque choisi et soutenu par la Church Missionary Society, William Ridley, qui résiderait à Metlakatla, dans le nouveau diocèse de Caledonia. En même temps, l’expansion du Canada apportait au village d’autres influences – par exemple, la direction des Affaires indiennes, des conserveries commerciales de saumon, le télégraphe – qui menaçaient la position et le pouvoir de William Duncan. Vu le changement du contexte socio-économique, les convertis au christianisme auraient eu de plus en plus de mal à continuer de vivre dans l’isolement, mais la présence d’un évêque, autre source d’autorité et de faveurs, hâta la dissolution de l’unité frileuse et forcée sur laquelle était fondé le système de Metlakatla.
Pour échapper à l’hostilité croissante de Ridley, qu’il en vint à considérer comme un émissaire du « parti de l’Église » de Victoria, Duncan tenta d’obtenir l’indépendance officielle à l’égard de la Church Missionary Society. Il faisait valoir que Metlakatla était cette Église autochtone dont la société avait toujours rêvé. Cependant, dans les années 1880, l’individualisme héroïque des aventuriers missionnaires impressionnait moins la Church Missionary Society que naguère. Ordre, discipline, hiérarchie et règles anglicanes, tel était le code des impérialistes chrétiens de la fin de l’époque victorienne. Henry Venn était mort depuis une dizaine d’années. La société répondit de la façon suivante à la requête de Duncan : le travail à Metlakatla était encore à ses débuts, la traduction des Écritures en tsimshian avait peu progressé dans les dernières années, il n’y avait pas de ministres autochtones et « les principes de l’Église d’Angleterre sont les meilleurs pour guider les toutes jeunes Églises ». En 1882, la Church Missionary Society somma Duncan de retourner en Angleterre pour une rencontre ou de démissionner. Le fait qu’elle croyait pouvoir lui faire accepter ses conditions suggère qu’elle agissait en bureaucratie triomphante. Personne en Colombie-Britannique, ni parmi les amis de Duncan ni parmi ses ennemis, ne s’attendait qu’il démissionne. La plupart auraient reconnu que, comme il l’écrivait, ses « efforts pour Metlakatla avaient créé entre [lui] et les Indiens des liens trop puissants pour qu’ils puissent être rompus ».
De 1882 à 1887, la dissension régna à Metlakatla. La majorité des Tsimshians, inaccoutumés à défier leur missionnaire, soutenaient Duncan. Une centaine peut-être, dont quelques familles de haut rang, appuyaient l’évêque. On se disputait amèrement à propos des bâtiments, des terrains, des lois. Duncan et ses partisans rejetaient la nouvelle loi sur les Indiens ; selon eux, elle ne pouvait s’appliquer à leur communauté civilisée. En outre, ils affirmaient que la terre appartenait aux habitants de Metlakatla et que la société missionnaire n’avait aucun droit sur les deux acres du village appelé Mission Point, où s’élevaient l’église et d’autres constructions. À mesure que d’autres Amérindiens des régions de la Nass et de la Skeena prenaient position, et surtout que certains soulevaient la question plus générale des droits aborigènes dans cette province où les Amérindiens n’avaient signé aucun traité avec aucun gouvernement, la situation devint explosive. Incapables de trouver une solution, les autorités de la Colombie-Britannique, d’Ottawa et de Londres regardaient avec consternation se désintégrer l’utopie chrétienne qui avait jadis symbolisé le « progrès moral et séculier ».
En 1887, comme en 1862, Duncan réagit en fondant une nouvelle communauté. Cette fois cependant, les Tsimshians ne s’installèrent pas dans un village ancestral, mais sur une autre terre, l’île Annette, en Alaska, même si bon nombre d’entre eux craignaient d’être réduits en esclavage par les Amérindiens du lieu. École, conserverie, magasin, scierie, organisation sociale, tout fut rebâti à New Metlakatla. Encore une fois, des gens d’ailleurs s’intéressèrent à leur entreprise et en parlèrent en termes favorables. Ainsi, Henry Solomon Wellcome et John William Arctander publièrent des comptes rendus très flatteurs sur Duncan et son œuvre. En outre, le nouveau marché du tourisme amenait dans l’île Annette bon nombre de visiteurs qui voulaient voir de leurs propres yeux les Tsimshians « civilisés » et leur missionnaire martyr.
À l’aube du xxe siècle, Duncan, âgé de près de 70 ans, était perclus de rhumatismes, de plus en plus parcimonieux et très intransigeant. Il s’agrippait aux cordons de la bourse, s’opposait à ce que les habitants reçoivent de l’instruction après l’âge de 14 ans ou à l’extérieur du village et résistait farouchement au gouvernement américain qui tentait de limiter son autorité dans la colonie. La dissension éclata à New Metlakatla. Certains suivaient encore leur vieux maître ; d’autres voulaient du changement. Dirigés par le ministre presbytérien Edward Marsden – le fils de la première personne que Duncan avait convertie au fort Simpson et le premier membre de la communauté à avoir fait des études supérieures –, ils estimaient que le vieillard devait céder sa place à un habitant de New Metlakatla et que les nombreux biens de la collectivité devaient être transférés aux Tsimshians. Les querelles qui en résultèrent furent encore pires que celles qui avaient eu lieu en Colombie-Britannique. Arrestations, poursuites judiciaires, dénonciations publiques marquèrent la lutte pour l’argent et le pouvoir.
Pour Duncan, l’opposition d’Edward Marsden était particulièrement éprouvante, car sa mère, Catherine Marsden, avait longtemps été la gouvernante de Duncan. Enfant, Edward avait appris les principes chrétiens sur les genoux de sa mère et dans le logis de Duncan. Son expérience du monde extérieur lui permettait, comme à tant d’autres qui occupèrent des positions semblables dans le monde impérial, de mettre en question le pouvoir que des Européens tel Duncan avaient si longtemps exercé. Le combat de Marsden pour la modernité mina la légitimité du maître, et Duncan mourut au moment où le pouvoir lui échappait. Les Tsimshians l’inhumèrent à côté de l’église de New Metlakatla, malgré son vœu de reposer près d’Edward Cridge à Victoria. On estima la valeur de sa succession à 146 159 $ ; une partie de cette somme, 138 679 $, fut déposée dans une banque de Seattle, dans l’État de Washington. Selon la plupart des habitants de New Metlakatla, cet argent appartenait à leur communauté.
Au xixe siècle, on faisait grand cas des exploits du missionnaire qui œuvrait seul. Comme David Livingstone, William Duncan correspondait au type du héros civilisateur de son époque. Son adhésion au christianisme évangélique avait favorisé son ascension sociale. Pendant plus de 20 ans, il put compter sur une société missionnaire à l’influence universelle et sur les réseaux de parenté de familles tsimshianes haut placées. Grâce à leur appui matériel et psychologique, ce fils illégitime, ce voyageur de commerce, cet homme de petite taille au tempérament anxieux accomplit davantage pour sa foi qu’il n’aurait osé l’imaginer. Pourtant, sa réussite ne lui donna pas confiance en lui-même. Elle l’ancra plutôt dans le pharisaïsme et l’amena à s’accrocher au pouvoir. Il n’est pas rare que les rencontres interculturelles qui jalonnent l’histoire des missions chrétiennes aient pris cette tournure.
Metlakatla Christian Mission (Annette Island, Alaska), William Duncan papers, particulièrement WD/C2146, Church Missionary Soc. à Duncan, 3 déc. 1881 ; C2154, journal, 18 févr. 1858 ; statement in reference to Metlakatla, Londres, 1886 ; C2158, notebook, « Laws of Metlakatla », 15 oct. 1862 (mfm à la Univ. of B.C., Special Coll. and Univ. Arch. Div., Vancouver).— Church Missionary Intelligencer (Londres), 1849 : 3, 76–77 ; 1852 : 20 ; 1862 : « Recent intelligence » ; 1863 : 195 ; 1881 : 506.— Peter Murray, The devil and Mr. Duncan (Victoria, 1985).— Jean Usher [Friesen], William Duncan of Metlakatla : a Victorian missionary in British Columbia (Ottawa, 1974).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Jean Friesen, « DUNCAN, WILLIAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/duncan_william_14F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/duncan_william_14F.html |
| Auteur de l'article: | Jean Friesen |
| Titre de l'article: | DUNCAN, WILLIAM |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1998 |
| Année de la révision: | 1998 |
| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |