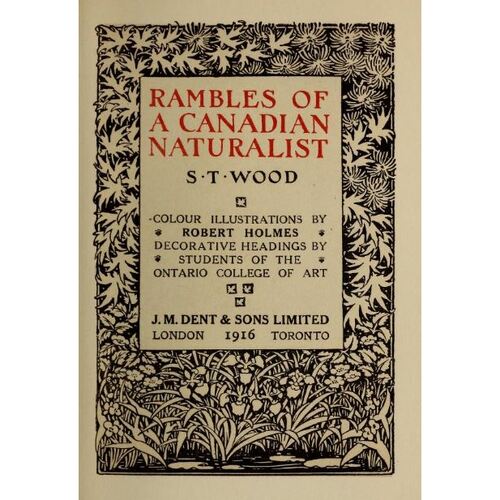Provenance : Lien
WOOD, SAMUEL THOMAS, ouvrier, journaliste, auteur et réformateur, né le 16 janvier 1860 dans le canton de Wollaston, Haut-Canada, fils de Samuel Wood et de Catherine Gibson ; le 19 septembre 1888, il épousa à Toronto Frances Spinks Dwyer (décédée le 25 décembre 1911), et ils eurent deux fils, puis au même endroit, le 3 février 1914, Dora Spears ; décédé le 6 novembre 1917 à Toronto et inhumé à Belleville, Ontario.
Fils d’immigrants anglais, Samuel Thomas Wood passa sa petite enfance dans une ferme au fond des bois. On dit qu’il dormait dans un berceau en écorce de bouleau et entendait les loups hurler la nuit. Lorsqu’il eut cinq ans, sa famille s’installa à Belleville, où il fit ses études primaires et secondaires et fréquenta un collège commercial. En 1885, après avoir vécu un an à Peterborough, il s’établit à Toronto. Employé comme monteur en tuyaux, il fit la connaissance d’un groupe enthousiaste de réformateurs sociaux ou, comme il les appelerait plus tard, de « régénérateurs de la société » et d’« excentriques », de « socialistes, [d’]anarchistes, [de] partisans de l’impôt unique, [de] scientistes chrétiens » qui « discut[aient] librement de tout, aussi bien [du] découpage de la glace de la baie que [de] l’adoption d’une résolution sur la destinée du continent nord-américain ». Converti à l’impôt unique préconisé par Henry George, Wood prônait cette solution aux réunions hebdomadaires du Sandpaper Club et sur une tribune improvisée dans des parcs. Avec le journaliste Thomas Stewart Lyon (beau-frère de sa première femme et ami de toujours) et William Alexander Douglass*, tous deux partisans de l’impôt unique, il fonda vers 1887 la Toronto Anti-Poverty Society. Wood militait aussi au Young Men’s Liberal Club de Toronto, où il rencontra John Stephen Willison*, rédacteur en chef du Globe. Willison l’engagea comme ouvrier en 1891, puis comme reporter et correspondant spécial. À ce titre, Wood fit des reportages un peu partout au pays. Par la suite, il tint dans le Globe une chronique sur les petites choses de la vie appelée « Impressions » (qu’il signait Oncle Thomas) et une courte rubrique quotidienne intitulée « Lessons in economics ». Surtout, il publia dans le même journal des textes d’histoire naturelle dont certains furent rassemblés en 1916 à Toronto sous le titre Rambles of a Canadian naturalist.
À la différence de ceux qui se passionnèrent d’abord pour les questions sociales en prenant con naissance des idées de Henry George mais privilégiè rent ensuite d’autres réformes, Wood ne cessa jamais de croire à l’impôt unique. Économiste autodidacte, il connaissait à fond les œuvres maîtresses de l’école libérale classique et adhérait à l’idée selon laquelle les lois de l’économie sont des lois naturelles. Dans un ouvrage concis, clair et en apparence simple, Primer of political economy : an explanation of familiar economic phenomena, leading to an understanding of their laws and relationships, paru en 1901 à Toronto, il mettait les phénomènes et les lois de l’économie à la portée des élèves du primaire. En décrivant la fabrication d’une paire de chaussures, par exemple, il faisait ressortir l’interdépendance des individus et la bienveillance de la main invisible. Bien qu’il se soit retenu d’y prôner l’impôt unique, son exposé mène nécessairement à cette solution. Il justifiait l’imposition de la valeur locative des terres en disant que tous avaient moralement droit à une part de la richesse de la nature. En outre, il voyait dans l’impôt unique un moyen de simplifier et de purifier la vie économique : cet impôt dissuaderait l’État d’intervenir dans l’économie et rendrait superflus tous les autres impôts, y compris les droits de douane. En matière d’économie, Wood demeurait un libéral de l’école du laissez-faire et ne faisait pas grand cas des efforts déployés pour en rectifier le credo. Au sujet d’Arnold Toynbee, il écrivait que cet économiste et réformateur anglais avait fait le bien en participant à des œuvres sociales dans l’East End de Londres, mais avait eu tort de tomber dans le relativisme historique – tort d’éloigner la science économique de la loi selon laquelle la liberté de produire et d’échanger et la liberté de vendre sa force de travail et tout ce qui est vendable garantissent à tout membre utile de la collectivité qu’il recevra la valeur exacte des services rendus.
Wood était renommé surtout pour ses textes sur la nature, non pour ses écrits sur l’économie. Admirateur de Henry David Thoreau et de Walt Whitman, ami de naturalistes locaux tel William Brodie*, il adorait se promener dans les faubourgs et aux abords des ravins de Toronto, longer le lac Ontario et observer les mœurs des oiseaux ou la structure des plantes à fleurs. Comme le grand écrivain américain de la nature John Burroughs, Wood s’intéressait aux menus détails – la sarracénie aux feuilles en forme de trompette, par exemple, ou le nid d’un pinson chanteur : « Les cinq neufs étaient rangés soigneusement, les bouts les plus étroits vers le bas. Ils étaient pâles, presque blancs, et les taches, d’un brun riche, étaient concentrées sur les bouts les plus larges, comme si le fait d’être exposés au soleil leur avait donné des taches de rousseur. » Wood s’efforçait de situer ce qu’il observait dans un contexte plus vaste. Quoique, en général, il n’ait pas personnifié les oiseaux, ni célébré l’ouvrage de Dieu dans la nature (comme le faisait Catharine Parr Traill [Strickland*]), ses lecteurs prenaient conscience de la présence immanente, dans le monde naturel, d’une force créatrice qui influait sur l’humanité comme sur la vie animale. L’univers de Wood était un univers post-darwinien où la nature était indifférente aux préoccupations humaines, où agissaient inexorablement les lois du changement, de la mort et de la renaissance, où régnait une lutte sans merci.
Malgré toute cette insistance sur la dureté de la nature, et la précarité de la vie des oiseaux, les écrits de Wood dégagent une impression de bienveillance et d’harmonie. Son humour charmant se manifeste par exemple lorsqu’il fait observer qu’« on peut aimer le pissenlit pour les ennemis qu’il s’est fait » ou lorsque, après avoir expliqué que les vachers à tête brune ont coutume de déposer leurs œufs dans les nids d’autres espèces, il décrit deux pinsons familiers élevant et nourrissant assidûment une progéniture bien plus grosse qu’eux.
La chronique de Wood sur la nature avait de nombreux lecteurs, dont sir Wilfrid Laurier, qui avouait qu’elle lui manquait beaucoup quand elle était interrompue temporairement. Encouragé par le succès de Rambles of a Canadian naturalist, Wood préparait un second recueil lorsque, en vacances à Bon Echo, communauté estivale d’avant-garde située dans l’est de l’Ontario et vouée à Whitman, il tomba malade. Quand il mourut, d’un cancer du foie, il n’était plus que l’ombre de lui-même.
Ceux qui connaissaient Wood parlaient tous de sa sérénité, de son bon caractère, de sa subtilité. Melvin Ormond Hammond, rédacteur en chef du magazine du Globe, était frappé par sa « remarquable double personnalité » : il pouvait aussi bien haranguer les promeneurs d’un parc au sujet de l’impôt unique qu’écrire de beaux textes sur la nature. « Son bureau au journal, ajoutait Hammond, était un petit musée ; [...] une fois, le concierge a troublé [le sommeil d’]un serpent placé dans une vieille boîte à biscuits, [et] il a juré qu’il ne referait plus le ménage de la pièce, ce qui faisait bien l’affaire de M. Wood. » L’anticonformisme du personnage se manifestait aussi par le port d’un chapeau noir à larges bords, tout à fait démodé, et par son aversion pour les cérémonies : il aurait été le dernier à briguer un poste public. Il était grand, bien bâti et avait des habitudes frugales. À sa mort, il laissa une succession d’un peu plus de 9 000 $. Sa maison en constituait environ la moitié, le reste étant surtout composé d’obligations et d’argent comptant. On évalua ses effets personnels à 20 $ et, ce qui l’aurait sans doute stupéfié, on jugea que son contrat d’édition avec la J. M. Dent and Company pour Rambles n’avait aucune valeur marchande.
Samuel Thomas Wood acquit sa réputation par ses écrits sur la nature et fut plus tard considéré comme « un naturaliste de terrain bien renseigné et enthousiaste, et un essayiste doué de talent littéraire ». Il fallut attendre le mouvement contre-culturel des années 1970, qui suscita un intérêt marqué pour les antécédents de la critique sociale, pour voir Wood occuper une place mineure parmi les régénérateurs sociaux de la fin de l’époque victorienne.
A tribute to Samuel T. Wood ([Toronto], 1917), publié à compte d’auteur après la mort de S. T. Wood, constitue la principale source d’information sur le sujet. Cet ouvrage relate des souvenirs de sir John Willison, d’Arthur Hugh Urquhart Colquhoun* et d’autres sur Wood, et reproduit des notices nécrologiques ainsi que des commentaires parus dans plusieurs journaux, notamment dans le Globe du 7 nov. 1917. On trouve aussi des détails biographiques dans les actes de mariage de Wood (AO, RG 80-5-0-165, no 14318 et RG 80-5-0-165, no 1794) et dans la notice figurant dans le Standard dict. of Canadian biog. (Roberts et Tunnell), 1. Les papiers J. L. Baillie conservés à la Univ. of Toronto Library, Thomas Fisher Rare Book Library (ms coll. 127), comprennent un mince dossier de coupures de journaux concernant Wood (boîte 36).
En plus de titres mentionnés dans le texte, les publications de Wood comprennent deux essais parus dans le Canadian Magazine : « The regenerators », 1 (mars–oct. 1893) : 64–67 (essai publié sous le pseudonyme « Uncle Thomas »), et « Social amelioration : the contrast between doing good and doing right », 11 (mai–oct. 1898) : 461–466. Wood a aussi fait réimprimer A primer on political economy sous le titre How we pay each other : an elementary reader in the simple economics of daily life (Toronto, 1916).
On trouve des indications sur l’ensemble du contexte entourant le cercle réformiste de Wood et sur le mouvement en faveur de l’impôt unique dans Ramsay Cook, The regenerators : social criticism in late Victorian English Canada (Toronto, 1985), et dans G. H. Homel, « Fading beams of the nineteenth century » : radicalism and early socialism in Canada’s 1890s », le Travailleur (Halifax), 5 (1980) : 7–32. Les usages relatifs à la rédaction d’essais en histoire naturelle sont décrits dans P. M. Hicks, The development of the natural history essay in American literature (Philadelphie, 1924) ; dans L. L. Merrill, The romance of Victorian natural history (New York, 1989), chap. 6 ; et par Alec Lucas, « Nature writers and the animal story », dans Literary history of Canada : Canadian literature in English, C. F. Klinck et al., édit. (2e éd., 4 vol., Toronto, 1976–1990), 1 : 380–404.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Carl Berger, « WOOD, SAMUEL THOMAS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 31 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/wood_samuel_thomas_14F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/wood_samuel_thomas_14F.html |
| Auteur de l'article: | Carl Berger |
| Titre de l'article: | WOOD, SAMUEL THOMAS |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1998 |
| Année de la révision: | 1998 |
| Date de consultation: | 31 déc. 2025 |